Irène Champigny
Le journal qui suit est entièrement inédit. Il est composé de plusieurs « cahiers » dont j'ai extrait les passages concernant Robert Denoël et ceux qu'il a côtoyés à Paris entre 1926 et 1945. Irène Champigny les a tous connus, souvent bien avant lui, et elle pose sur eux des jugements sans complaisance.
Littérature et peinture y sont entremêlées car elle fut essentiellement galeriste, et ne vint à écrire qu'en dilettante, quoique persuadée d'avoir des choses essentielles à dire. Maurice Loutreuil, Christian Caillard, Eugène Dabit, Georges André Klein furent ses familiers.
Le portrait qu'elle trace de Dabit peut surprendre. Contrairement à l'écrivain un peu fallot qui débuta en 1929, elle campe un peintre dominateur, exerçant sur son ami Caillard une influence insoupçonnée.
Robert Denoël est son ami de coeur, et elle a pour lui une affection qui ne s'est jamais démentie, mais elle lui reproche sa versatilité. Les femmes le manipulent, certains écrivains comme Céline ont sur lui un ascendant néfaste, et ses opinions bourgeoises le mènent inéluctablement au fascisme, croit-elle.
Pourtant elle l'aime comme il est : quinze ans d'amitié en témoignent. Si on prend la peine de réunir toutes les mentions de son nom dans ce journal, on s'aperçoit qu'il s'agit d'un long poème d'amour. En 1942 elle avait fait de lui son héritier spirituel : il était chargé de publier son journal après sa mort. Le destin en a décidé autrement : il est mort avant elle.
Sa femme, Cécile Brusson, au caractère emporté, possède une qualité que d'autres n'ont pas : une féminité sans faille. A ses yeux, Cécile est la femme, et les pages qu'elle lui consacre sont inoubliables.
Ses amies de coeur, telles Catherine Mengelle ou Germaine Cellier, n'ont pas cette qualité-là, et elle dévoile leur perfidie et, surtout, leur ingratitude.
Si elle apprécie des écrivains comme Romain Rolland ou Lanza del Vasto, elle vénère sans réserve André Malraux, le résistant comme le littérateur, sans voir la part d'imposture du personnage qu'il s'est composé.
Ses têtes de turc sont les médecins, coupables de myopie à son endroit : mal soignée depuis le début, elle finit impotente, bourrée de sédatifs qui ne calment pas ses maux.
Son seul refuge est la pensée indoue, qu'elle a découverte en 1942, et qui lui permet, dit-elle, de ne pas haïr un monde injuste. Sa tendresse ne s'adresse plus désormais aux hommes, mais à sa seule chienne Doudou, qui mourra en 1944.
Le journal [1942-1948] que j'ai retranscrit comporte des centaines de pages, d'inégal intérêt : il a fallu s'en tenir à celles qui enrichissent notre connaissance de l'éditeur.
J'y ai ajouté à la suite des lettres à elle adressées qui peuvent éclairer certains passages obscurs du journal, ou permettre de mieux appréhender le caractère de cette femme d'exception, qui reste, malgré bien des recherches, assez mystérieuse.
Pour une approche biographique de l'auteur, on peut se reporter à la page que je lui ai consacrée sur ce site.
*
[Cahier noir] [15 février 1942] Il y a quelques jours j'ai appris la mort « en juin 40 » de René Barjavel. Il avait une prescience de cette destinée-là. Je l'entends encore en 1935 à Vichy me conter les angoisses morbides et les horreurs de sa vie de soldat. Une fois encore je suis punie - que c'est bête de se brouiller. Malheureusement les femmes ou maîtresses des amis sont d'admirables instruments de brouille (1). C'était une nature très bonne. Nous avons peu correspondu ensemble car du moment où je fis sa connaissance à celui où il me vit (désespéré) partir pour le grand voyage, comme il disait (2), nous nous vîmes à peu près tous les jours.
Dans mes dossiers pourtant repose une lettre de lui - 4 pages auxquelles j'ai beaucoup réfléchi depuis 6 mois - et la nouvelle si triste de sa mort me parvient quand je ne vois d'autre issue que la mienne, faute de pouvoir accomplir la mission dont il m'investissait 6 ans auparavant (3), mission qui serait une sérieuse, une valable raison de vivre. [...] Vivrais-je pour obéir à Barjavel ? (4)
1. Cette brouille est survenue avant le mariage de René Barjavel avec Madeleine de Wattripont, le 10 octobre 1936. Plus loin elle note à la date du 30 juin 1946 : « J'ai autrefois si durement, si violemment combattu son mariage idiot que la pudeur m'oblige à la plus grande réserve... »
2. Champigny a quitté la France en septembre 1936 pour un grand voyage aux îles du Pacifique, voyage qui devait durer cinq mois.
3. Barjavel lui écrivait, fin 1935 : « Champi vous devez aller vers les Hommes, et non plus vers des hommes, vous devez aller vers les Hommes, et leur dire leur vérité. »
4. [Ajout marginal : ] « René Barjavel bien vivant en 1942 (novembre). Collaborateur... c'est-à-dire mort vivant. » On ne sait où Champigny avait pu apprendre sa mort « au début de la guerre » ; la presse écrite n'en fait pas mention ; peut-être à la radio ? Mais cette fausse nouvelle a dû être rapidement démentie, ce que Champigny n'a appris qu'en fin d'année. On mesure sa solitude dans un petit village du Lot, où elle ne croise que des paysans du cru, seulement préoccupés de leur bétail et de leurs cultures. Mais on relève aussi son diagnostic sans appel : collaborateur ? mort vivant.
[Cahier brun n° 1] Samedi 31 octobre 1942, à St Hilaire (1). Une reprise de contact, fut-ce par téléphone, avec Robert, a toujours été un événement. Je dus lui écrire dans le but de ne manquer à la promesse faite d'offrir un Grand Vent (2) à JB [Jean Brunel]. Ma lettre, sincère, ne contenait que peu de ma pensée. J'ignorais comment il accueillerait mes lègues. Sa réponse fut rapide - une générosité en acte : des livres. Une courte lettre précisant « qu'il n'est plus mon ami ». Lettre partiellement injuste, résultante inévitable des différends jamais liquidés de 38 (3). Lettre émouvante pourtant, dans laquelle une seule phrase me permit de lui demander aussitôt s'il accepterait le legs des papiers qui me sont si chers. Son P.S. offrait de m'aider matériellement. Je m'en autorisai pour le prier de m'aider juridiquement. Sans doute je lui écrivis trop longuement. Ce qui n'empêche que j'eusse dû envelopper toutes les pages d'un papillon d'avertissement. Après coup, je redoute qu'il me prête des intentions - qu'il imagine que je désire forcer sa pensée, rechercher une entrevue - c'est vrai - j'aurais eu plus que de la joie à revoir Robert - mais cela au cas où il eût épousé un sentiment analogue. Or, j'ai perçu aux premiers mots sa réticence - en sorte que j'aurais dû papillonner ma lettre ainsi : « Rien de ce que vous allez lire ne tend à vous faire modifier votre attitude. » Comme il eut la lettre à midi, qu'il n'a pas téléphoné : oui, j'accepte parce que je comprends cette destination par vous choisie ; c'est sans doute qu'il a écrit : non, je ne puis accepter cela de vous, puisque précisément, je ne suis plus votre ami. Et cette pensée déclenche une tristesse amère. Certes, je sais qu'il ne fit jamais cas de ce que j'écrivais (4). Dès lors, comprendra-t-il que ce don se situait sur un plan extra-littéraire ? Quoi qu'il réponde, je suis heureuse, allégée, de lui avoir demandé pardon de mes fautes.
Il en commit pas mal. Il me fit tant souffrir au long de nos années d'amitié, plus que ne firent, réunis, mes amours. Pourtant c'était à moi de m'humilier. D'abord parce que tant de chagrins, de dépits, d'amertumes, de rages, d'indignations, de regrets, n'ayant pu déraciner le sentiment resté vivant au travers des tempêtes les plus contraires, cela prouve à quel point ce sentiment était valable. En second lieu venait mon âge qui m'incite, non à donner l'exemple, mais favorise l'accomplissement de ce que je crois parfois mériter des autres. En troisième condition, mon état imposait de n'attendre plus - c'était assez, trop, d'avoir remis jusque là. Nous avons bien souffert de nos défauts mutuels.
1. La clinique Geoffroy Saint-Hilaire se trouve 59 rue Geoffroy-Saint-Hilaire, dans le Ve arrondissement. Champigny y a séjourné du 31 octobre au 8 novembre 1942.
2. « Le Grand Vent. Précédé de : Essai sentimental sur la chanson populaire par P. Mac Orlan ». C'est l''un des premiers ouvrages publiés par Robert Denoël à l'enseigne des Trois Magots, 60 avenue de La Bourdonnais, en novembre 1929. Bien que tiré à petit nombre (un peu plus de 1000 exemplaires), le livre de Champigny figurait toujours au catalogue de l'éditeur en 1941.
3.
Champigny avait proposé à Denoël le manuscrit d'un essai qu'il se refusait à publier tel quel, et dont il lui demandait de le remanier, ce qui provoqua, en janvier 1938, une rupture entre les deux amis, qui devait durer quatre ans.
4. Plusieurs manuscrits furent proposés, sans succès, à Denoël entre 1932 et 1938.
2 Novembre 1942, midi. Robert a téléphoné. Il doit venir à 2 heures. Et je suis toute cassée d'émotion à la seule pensée de le revoir. Je sais qu'il me revoit pour me rendre service. J'ai beau mettre la pédale sur cette certitude, le son de cette grave raison ne parvient à m'altérer la joie que c'est de me redire : je vais revoir Robert.
Robert est arrivé à 2 H 1/2. Il est resté avec moi jusqu'à 7 heures. J'éprouve une allégresse parfaite. Nous nous sommes retrouvés. Au moins, cela sert de réfléchir, méditer, comprendre. Lui a évolué dans l'action tandis que je changeais dans le silence et la solitude. Nos orgueils, ses injustices et mes colères, furent cause de bien des peines - d'énormes trous furent creusés dans le champ de notre amitié. J'avais terriblement besoin de le revoir, d'être en paix avec lui. Je suis contente, tellement contente.
.St Hilaire, la nuit. J'avais passé un jour inquiet, morose. Un rêve (inscrit ailleurs) perturbait ma quiétude. Si naturel qu'eût été mon désir, je craignais en demandant une chose, d'avoir trop demandé. Surtout je craignais d'offenser malgré moi mon ami. J'avais dit trop ou pas assez. J'avais mal dit. S'il allait ne point comprendre - s'il allait redouter comme une intrusion le fait de lui dire : vous voir, vous entendre, comble ma faim de vivre. Vous m'êtes en ce temps surprenant aussi nécessaire qu'une prairie, un jardin, une rivière, le chien. Pour vous voir sans vous gêner, il faut que je me rapproche de vous afin d'obtenir les heures qu'il vous plaira de me donner. Cela, rien que cela - et je n'oublie rien - et rien que cela m'est douceur et paix - car il eût fallu dire ces mots-là. Le soir vint. Je portais une éternité d'attente. A-t-il tout compris ? Peut-être pas tout. Mais il a consenti. Depuis cet instant, c'est comme si nous avions scellé une paix éternelle pour cette existence-ci, pour toutes celles qui suivront, aussi je crois que j'arriverai à pouvoir lui dire tout. Pour lui, je ne garderai un seul secret (1).
S'il est une joie, une seule joie, que je sois capable de lui offrir, je veux la lui donner sans attendre en retour que l'illumination intérieure du renoncement absolu. Si la certitude compte pour lui, je veux qu'il trouve en moi cette certitude. J'entends qu'il puisse user de moi telle que je suis devenue après des années de recherches, de méditations, de pensées, de ferveur ; user de moi comme d'un miroir qui reflète des années de sa vie ; user de moi pour trouver au fond de mes faiblesses, de mes fautes, la voie de son essentielle vérité - user de ma totale confiance en lui, maintenant qu'il a franchi le cap, dépasser le temps de la lutte, de tous les esclavages matériels.
Car le temps est venu pour lui d'aborder l'importante phase constructive par l'art. C'est à lui de créer. De quel prix serait donc une confiance si fervente si ma volontaire humilité ne le replaçait d'un coup au centre du meilleur de ses espoirs en lui? De quelle force serait un amour qui ne lui serait ardente impulsion ? Lui montrer en pleine lumière cette place qu'avec le temps je lui fis en moi, c'est le resituer au centre des élans enthousiastes de sa jeunesse afin qu'il les considère avec tout l'acquit de sa maturité.
Ah certes, ma féminité, à maintes reprises, souffrit de ne pouvoir lui donner justement tout de cette féminité - c'est naturel. L'homme se méprend aisément. Il ne pressentit jamais qu'en ma tumultueuse jeunesse, j'avais dû arracher de moi un à un des désirs inutiles. Mais voici que j'ai vécu assez pour comprendre plus avant. Ce que je lui apporte en ces temps de naufrages, c'est l'étonnante lumière que j'appelle amour de l'amour. Il faut qu'à cette clarté, il trouve le chemin de sa terre d'élection. Je ne le verrai pas l'atteindre - mais parce que je sais qu'il l'atteindra, une des missions de mon obscure vie sera remplie le jour où il me dira : je suis en route. Et sur les mots qu'il écrira, penchez-vous, Puissance illimitée. Sur cette route-là, gardez-le du moins de toute défaillance. Que serait mon amour de vous, homme, s'il n'était prière ?
1. Champigny a fait de Denoël son héritier spirituel, qui a accepté de publier le présent journal après sa mort. Le destin a voulu que l'éditeur mourût avant elle. Ajout en interligne : « Février 1945 : il a lu ces pages et il a pu me tromper ce printemps-ci dans ma confiance... on n'est jamais certain des fautes d'autrui ? Non. »
Paris, 29 rue Cler (1). Je ne sais rien de plus inattendu, de plus étrange que me voir où je suis - c'est le soir du 9 novembre, à l'hôtel Leveque (chauffé) - sauvage, désaccoutumée des villes, je me sens plus heureuse que jamais. Un bouquet de magnifiques mimosas de race robuste orne ma chambre. Je le dois, comme toutes les joies de ce temps à Robert qui compte aujourd'hui quarante ans (2). Pour la première fois je viens de le voir portant en lui une angoisse profonde [ce dernier mot biffé], et le seul voeu que je forme est qu'il ne lui arrive rien de ce qu'il redoute. Dès lors je lui dis quelle folie il commettait en suivant les Allemands. Il y croyait...
9 H 30 de l'heure de Paris. Eh bien je rêve longuement après cette inscription précise. Robert est venu à 7 heures. Il a parlé avec cette clarté qui m'éblouit toujours - c'est un magicien de la parole - quand je l'écoute il me semble être encore aux îles ou à Batavia, penchée sur ces eaux dans lesquelles d'extraordinaires poissons se meuvent - ainsi sont les idées aux lèvres de Robert : colorées, inouïes, souvent terrifiantes, captivantes toujours. Il a ébauché avec moi un repas intime d'une quiétude qui me fit pour un instant tout oublier. Rompre le pain ensemble, tête à tête, mais cela n'était plus arrivé depuis la rue Ste Anne (1926).
Ensemble nous avons bu dans le verre d'amitié un vin qui, ma foi, en était digne - mais je m'attendais si peu à son au revoir tendre que son baiser me fut bouleversant. C'est cela la beauté de la vie - que l'état d'amour soit capable de tout abolir, de tout restituer, tout y est éternel - tout y est jaillissement, fulgurance, divin commencement. Divin, avec toute la valeur, tout le sens que j'attache à ce mot. Ramakrishna disait qu'il était possible d'aimer Dieu dans tout ce que nous aimons - mais, l'espace d'une seconde, l'instant du vertige, il n'y a plus que du divin en nous, plus rien que la pure énergie universelle. Un seul baiser en état de grâce, l'extase yoguique, ou Ste Thérèse, il n'y a pas de différence.
1. A sa sortie de la clinique Geoffroy Saint-Hilaire, Champigny a séjourné, entre le 9 novembre 1942 et le 8 janvier 1943, au Grand Hôtel Leveque, entre la Tour Eiffel et les Invalides, près du domicile de Robert Denoël, rue de Buenos-Ayres, et aux frais de l'éditeur.
2. Denoël est né à Uccle le 9 novembre 1902.
29 rue Cler. 11 novembre 1942 - mercredi 20 heures. Il est toujours merveilleux d'aimer. Ce qui rend l'amour absolu si difficile (tout au moins ce qui fut si difficile dans mon cas personnel) c'est le besoin de respecter ce que l'on chérit - tant que l'esprit n'est en plein accord avec le sensible, le sentiment vécu ne peut être absolu. Est-ce là une manifestation de féminité en général ? Je l'ignore. Est-ce un trait essentiel de mon caractère ? Oui. Tout le long de ma vie, j'ai connu de véritables paniques lorsque je vérifiais soudain qu'il m'était impossible de respecter ce que j'adorais. Dès lors, une perturbation maligne altérait mes sentiments. Quelle que fût la force de mon inclination, je me retirais jour à jour moralement de celui que je semblais encore aimer. Nulle harmonie n'était plus possible.
Voici que m'advient cette chance : j'aime ; et cette faveur inespérée : je respecte celui que j'aime. Cela, en toute connaissance de ce que nous nommons d'après le code établi, défauts et qualités. Le bonheur que j'en ressens est tel que j'en oublie les inquiétudes, les angoisses. Le tourment corporel se fait plus supportable. A la seconde où j'écris ces mots, la pensée de Manon (1) s'interpose entre la réalité présente et le passé. Son corps, martyrisé par trente années d'infirmités héroïquement supportées se décompose dans sa terre natale. Mais la puissance de sa bonté est là, et d'elle aussi je puis écrire que je l'ai à la fois chérie, respectée.
1. Manon Cadéot était une vieille amie de Champigny ; elle habitait Nérac, près d'Agen.
Dimanche soir 6 H 1/4 de l'heure solaire. 15 novembre 1942, 29 rue Cler. Hier soir, par souci de sa quiétude, je lui écrivis deux pages aussi sincères que sensées. Avant qu'il prenne le temps d'y réfléchir, je le libère de toute réflexion à mon sujet. Mais la nuit vient, le sommeil, le rêve. Dans mes rêves, je jouis toujours de cette impétuosité physique qui caractérisait ma jeunesse. Il est étendu sur un transat de bateau, bien que ce siège soit placé dans une pièce dénudée de tout autre mobilier. Je suis presque étendue sur lui tant je suis contre lui.
Je lui chante des choses qui le font rire à grands éclats. Il ne rit pas de ma chanson qui est souverainement mélancolique, il rit parce que je la lui chante si tristement - chose inouïe, il me tutoie - et, bien que je sois très jeune, j'ai conscience qu'il ne m'a jamais tutoyée, que ce n'est pas moi qu'il tutoie mais celle de la chanson, c'est-à-dire la petite fille que j'étais lorsque je chantais cette chanson-là (qu'en fait je ne lui ai certainement jamais chantée) et que pour cette raison j'inscris ici tant elle me devient douce à cause du bonheur éprouvé dans le rêve ; j'en fus si imprégnée que toute la journée mon visage si particulièrement ravagé depuis des mois avait 15 ans de moins.
Trois femmes sont venues me voir et chacune est restée saisie - il y avait de quoi. « Cli, clou, cla ! les enfants créoles, ne vont ja - jamais à l'école ; sous les magnolias, sous les bananiers, mangent des papayes, giflent des poupées ! Cli, clou, cla, les enfants créoles n'iront ja - jamais à l'école. » Chante, dit-il, chante encore ! (dans le rêve). Je m'entends encore chanter, serrée contre lui, la tête contre son épaule gauche et j'entends son rire, c'est si bon (à noter qu'en cet instant j'entends le tir de la D.C.A.) Ma jambe gauche le gêne ; il fait d'abord un mouvement pour m'allonger tout à fait contre lui ; je le tiens dans mes bras jusque là.
Il m'enserre dans les siens, si fort que je cesse le « Cli, clou, cla » et je bois en quelque sorte son rire, je bois sa gaieté merveilleuse dans un baiser à vous nourrir d'amour pour des éternités. Le rêve s'arrête là, tandis que ces sensations déclenchées dans le sommeil se poursuivent parfois longtemps, que ce soit dans la douceur ou dans le déchirement. Je voudrais savoir s'il en est ainsi pour tout le monde ou si c'est un privilège particulier, car il m'est impossible de me dire : j'ai rêvé.
Endormie ou éveillée, le fait est là. J'ai vécu cette étreinte, j'ai bu ce baiser. En cherchant, je suppose qu'il faut relier ce rêve à ce que j'avais écrit la veille ou le matin (je ne sais plus au juste) à propos de l'aveugle qui avait d'abord chanté dans la rue, puis qui était revenu un moment après me « donner aubade ». Le côté furtif de son baiser d'arrivée fut que je n'osai lui remettre les petites pages vertes ; que seule la timidité me retint de lui dire : il ne faut pas croire qu'il « faille » m'embrasser.
Il faudra que je recherche dans les pages du Swami Vivekananda (1) le passage où il traite du rêve. Si je me souviens bien, il y déclarait qu'à l'état de rêve nous n'inventons jamais, que nous ne faisons que nous souvenir et transposer. Seuls, les corps sont consumés par l'usure. Les pensées, les sensations subsistent. J'aurais donc vécu, réellement vécu, ce baiser-là ; l'affabulation du rêve est seulement pour l'évoquer ; le revivre, d'avoir choisi ceux que nous sommes présentement dans la forme actuelle. Cela me plaît, me repose, de consentir à croire que déjà je l'ai aimé ! Peut-être que certains de nos désirs les plus aigus ne sont que réminiscences... Je suis toute contente. Je trouve toujours une paix d'une incomparable suavité chaque fois qu'il m'est donné cette chance de dépasser un désir en parvenant à la connaissance par le processus du sensible.
Comment souffrirais-je de n'avoir un corps lumineux de jeunesse à offrir à l'homme en lequel je me fonds, quand j'acquiers la certitude de le lui avoir donné antérieurement ! quand cette certitude m'habite exactement ainsi que le sang se répand en moi. J'ai vraiment de la chance. Je lui ai appartenu - il restait à épurer, à perfectionner cet amour. J'y tâche. Si je vis encore un petit moment, je veux parvenir à effacer en lui jusqu'au souvenir de mes fautes.Je veux qu'en se souvenant de ma tendresse, de ma foi en lui, il puisse un jour, dans le secret du coeur, me nommer « l'impeccable »... Mais dans quel pays me nommerais-je « Diva » ?
1.
Ce philosophe hindou [1863-1902], disciple de Ramakrishna, dont elle a découvert l'enseignement en 1942, grâce à la biographie publiée en 1930 par Romain Rolland, est son maître à penser.
16 novembre 1942. Je n'ai été séparée de Doudou (1) qu'une fois. Pendant le long voyage dit du tour du monde (2). Expression tellement inexacte. Voyage étonnant s'il en fut. Au vrai, je fis alors le tour de mon ignorance ; j'appris beaucoup et surtout à me connaître. Si j'avais été alors libérée moralement devant Robert, j'aurais pu correspondre avec lui, aller, en les extériorisant, au bout de toutes mes découvertes. Or, je ne pouvais lui écrire. C'est pourtant à lui seul, pour lui, que j'aurais pu noter mes plus étranges découvertes.
1. Sa chienne, morte la 1er février 1944.
2. Long périple de plusieurs mois aux îles du Pacifique, en 1936, d'où elle rapporta un virus qui doit être celui de la malaria, et qui l'handicapa jusqu'à sa mort.
29 rue Cler. 19/11/42. Je vais me ressaisir. Bien sûr. N'empêche que de ne plus lui écrire fait une fois de plus que je ne puis écrire (1). Tantôt, heures agréables (il m'en reste une migraine affirmée !) Nous avons déjeuné ensemble. Brillant, assuré, intéressant comme toujours. Moi, terne - si heureuse. Un moment, il dit : « Vous qui êtes si particulière, c'est bizarre, vous pensez comme la foule. » (C'était que je pensais « résistance »). C'est qu'il n'a rien retrouvé de moi en profondeur. Sinon il aurait compris que l'énormité de ma solitude dérive de ma seule pensée qui n'est en harmonie, en accord, avec aucune foule.
Mais assez ri. Ce soir je suis lasse, je souffre beaucoup et ne sais plus bien pourquoi nous avons ri. Mais c'était bon de rire. L'admirable, c'est cette sensation de temps compté - quoi que nous disions. Quel que soit le thème de la conversation, lorsque je le quitte, je n'ai conscience que de tout ce qu'il fallait dire, demander, écouter. Je ne puis connaître à ses côtés aucune volonté intellectuelle, pas même le rassasiement. Je ne me sépare de lui, toujours, qu'avec une curiosité, un intérêt accrus.
1. Champigny ne trouve son plaisir que dans l'écriture. Puisque Denoël habite tout près de son hôtel, et qu'il la visite presque chaque jour, elle ne peut lui écrire ce qu'elle ne parvient pas à lui dire.
29 rue Cler. 22 novembre 1942, un dimanche ou lundi, 1 heure. J'ai fort peu vu Robert ces derniers jours. Je ne lui ai pas écrit. J'ai donné des heures à des gens bien divers sans profit pour l'intellect, sans intérêt pour du travail, sans joie pour le coeur - simplement parce que je suis exposée à ceux qui ont besoin de quelqu'un, ainsi que les paratonnerres à la foudre. L'histoire d'Aurélio m'a énormément intéressée. Sténo, je l'eusse notée, pour en retenir plus sûrement les épisodes typiques.
A l'instant, je m'avise qu'il eût été normal que j'éprouvasse une émotion quelconque en me retrouvant une fois encore, et après un intervalle de presque dix ans, au Pré Saint-Gervais. Je fus tout entière accaparée par les changements du faubourg, des fortifs. J'ai revu l'atelier sans penser à Loutreuil. J'ai revu le minable jardin, le bassin, maintenant comblé de feuilles pourries, la véranda, sans penser à Slave ; j'ai pénétré dans les pièces délabrées sans que surgisse une seconde l'image de Sonia, pas davantage celle de Catherine, et Christian lui-même, présent entre ces murs où nous nous trouvâmes si rarement ensemble, l'actuel Christian ne ressuscitant pas la moindre image du passé.
Suis-je devenue soudain insensible ? Suis-je enfin et à tout jamais guérie des maux, chagrins et désespoirs variés qui se rattachent à ces lieux, aux êtres qui les hantèrent ? J'étais, telle que je suis si facilement maintenant : gaie, très gaie, un peu trop gaie peut-être, ne prenant plus la peine comme autrefois de rechercher d'intéressants (!!!) sujets de conversation. Je rencontrerais demain dans Paris Slave en officier allemand que cela me paraîtrait naturel (1).
1. Tous ces noms remplissent les cahiers de Champigny, mais ils n'ont peut-être pas leur place ici. Il importe quand même de rappeler le rôle qu'elle joua entre 1925 et 1927 pour faire reconnaître le génie de Maurice Loutreuil [1885-1925] dans sa petite galerie de la rue Sainte-Anne, où Denoël fut son employé. Christian Caillard fut son compagnon entre 1922 et 1926. Catherine Mengelle fut sa maîtresse entre 1928 et 1934. Sonia était, comme Catherine, l'une des modèles de Caillard puis sa maîtresse. Slave était un réfugié ukrainien, qui fut épisodiquement son amoureux.
Nuit du 25 au 26 novembre 1942. Dans le silence. Qui rompra le silence ? Je ne fais rien qui vaille. Pourtant les jours s'écoulent agités. Il faut si peu à la sauvage que je suis devenue pour croire à de l'agitation. Ce soir, Germaine, Christian, Robert, se sont trouvés réunis ici (1). C'est encore un de mes défauts, de ne pouvoir goûter les êtres qu'un à un. Dès que l'on est plusieurs je n'ai pas grand'chose à dire, et ce que disent les autres me paraît assez vain. Tous ont l'air de trouver naturel de se lever soudain, l'heure venue, comme mus par un ressort, pour effectuer une sortie collective. Ils ne comprennent pas du tout que cette façon de faire me brutalise autant que si l'on me tirait d'un sommeil somnambulique.
1. Germaine Cellier [1909-1976], la célèbre parfumeuse. Christian Caillard, le peintre [1899-1985], son ci-devant amant mais toujours son ami bienveillant.
25/11/42 - rue Cler - la nuit. Caillard pensait à son voyage d'Algérie manqué. Je le trouvais inepte de choisir Vence ! Vence qui devient maintenant une manière de point stratégique. Tourrettes aussi, et Cagnes, et tous les nids à « de l'autre côté ». Robert, lui, était absorbé par l'idée que « l'empire disparaît ». Avant, y songeait-il jamais, à l'Empire ? et aux richesses du Congo belge (1) ? Germaine était hérissée d'autoritarisme. Son bon coeur, son dévouement sont illimités. Sa certitude de tout savoir, sur tous les plans, dans tous les domaines, l'est également. Alors... ça fait un peu drôle.
1. De quel empire s'agit-il ? elle ne le dit pas. Pour un Belge, il ne peut s'agir que du Congo, qui ne souffrira aucunement de la guerre. Mais, le 8 novembre 1942, les troupes anglo-américaines ont débarqué en Afrique du Nord.
[26 novembre 1942] Le 25 novembre est déjà passé. St Hilaire est loin. [...] J'ose parler de la trahison (1) de Robert... mais moi, survivre à Doudou, c'est l'horreur des horreurs. J'attends aussi. Quoi ? Je me sens prête à tout commencer, tout entreprendre, tout tenter, oui, et le contraire aussi, oui, oui, et pourtant mon Dieu, tant de forces d'amour inutiles...
1. Champigny divague à cet endroit, mais elle parle d'une « trahison » de Denoël : laquelle, au juste ? Il faut sans doute en trouver l'explication dans une note du 9 novembre : « je lui dis quelle folie il commettait en suivant les Allemands. Il y croyait », ce qui est confirmé ci-dessous.
Nuit du 29 au 30 novembre 1942, rue Cler. Au temps des cahiers gris, je notais encore de temps à autre quelques uns de ces grands drames qui se jouent dans notre pays. Les incidents personnels du dernier été (1) ne me permettent plus de m'exprimer. Avec Christian je ne m'entretiens pas aisément. Avec Robert Denoël, mettre la conversation sur le présent européen, c'est mesurer les abîmes qui séparent nos conceptions. Je me demande à quel moment sa pensée, ses idées, plus exactement, ont bifurqué.
Il aime la France ; il croit l'aimer. Il en aime le passé. Mais il y a en lui un dosage allemand énorme qui a modifié tout son personnage entre 30 et 40 ans. La seule influence de Céline, bien qu'elle soit à prendre en considération, n'aurait été suffisante à fasciser un esprit cultivé, une intelligence aiguë, fine, critique.
Le terrain était par nature, favorable. Je ne connais rien du docteur Laforgue qui fut l'analyste de Robert. Mais les écrits de cet homme sont d'une lourdeur typique. Je lui attribue plus de part que Céline dans l'évolution denoëlesque (2).
Pourtant, au-dessus de tout, il faut tenir compte d'un point essentiel. Robert est né bourgeois, dans une famille de bourgeois muettement agressifs en raison de leur pauvreté. Robert connaît maintenant, sinon le goût de la richesse, du moins la saveur de l'aisance et de certaines firmes du luxe. Il ne connaît pas le goût de la liberté. Jeune, il a été le prisonnier de sa famille. Libéré de celle-ci, il resta plus de deux ans, encore prisonnier de son milieu, de son éducation. Quand il devint le prisonnier de Cécile, il était déjà enchaîné à la fois par ses innombrables refoulements et ses dévorantes ambitions. Puis il fut l'esclave de son entreprise, de ses luttes, de ses dettes. Maintenant qu'enfin sa chance est venue, il est, sur sa galère dorée, prisonnier à vie des rouages compliqués d'une affaire qui va se développant toujours. J'ai identifié cette ignorance absolue de la liberté, tandis qu'il parlait de ma vie, l'autre soir, avec une cruauté par secondes judicieuse, si dépouillée d'affection, je pourrais presque dire d'estime, que j'en fus toute figée, le souffle court...
« Votre vie, dit-il, avec un sourire fait de sarcasme, d'un rien de mépris, d'assez d'étonnement, votre vie, depuis... des années, n'a été qu'une suite de... mirâcles. » Il prononça « mirâcles » ainsi qu'un autre eût dit « expédients ». Il ajouta : « Jamais vous n'avez consenti à un travail régulier. Jamais vous ne vous êtes pliée à une discipline... » (3)
Je tentai de corriger, mais son idée est faite, établie. En quoi cela peut-il l'intéresser que, de 12 à 14 ans, alors que la catégorie « Marais » compulse les froncements de son nombril, se complaît à se croire monstrueux, n'étant qu'égoïste, privilégiée, je m'apparentais aux « apprentis de la ville », aux « voyageurs au bout d'interminables nuits » et sous tunnels !! de 12 à 14 ans, mon Dieu, quel tapin [?], quelle discipline, quelle régularité ! onze et douze heures de travail par jour ; ensuite, de 14 ans à 30 ans, à part de brèves coupures pour reprendre haleine, à part surtout la halte marocaine d'une année sans labeur, j'ai travaillé à en claquer.
Denoël ne soupçonne même pas ce que je fus capable d'accomplir tant que j'ai dirigé l'équipe du Pré St Gervais. Il y eut des années entières sans vacances, sans repos du corps, sans répit de l'esprit. Quand il me connut (4), j'avais la galerie. J'étais si lasse déjà quand j'en assumai la charge que je me croyais sincèrement vieille à force d'accablements, d'usure, d'infinie lassitude.
Comment expliquer cette sévérité, cette injustice tenace, qui survit, pour mon plus grand étonnement et, je dois l'avouer, pour ma peine ? Comment admettre qu'un homme qui me sait exempte de mensonge, efface jusqu'à la moindre trace de tout ce que je lui ai confié sur ma jeunesse faite de luttes de toutes sortes, de privations, de misère parfois atroce.
Comment admettre qu'indulgent à toutes les paresses féminines, à tous les caprices, lui si viril, si naturellement protecteur, il ait à mon égard cette dureté qui me creuse ? Sans doute, pour ne point tomber dans le genre mélo, je lui ai conté de ma vie les épisodes les plus gais, les plus pittoresques, mais j'ai quand même assez dit pour qu'il sache qu'à l'âge où d'autres commencent l'existence au milieu des privilèges, des facilités, j'avais usé la totalité de mes forces en travaillant.
Seulement, voilà. Au lieu de nourrir l'ambition de la belle situation, de la fortune, je ne poursuivis qu'un rêve : avoir le plus souvent possible du ciel sur la tête. Ce luxe-là, je me l'entendis reprocher par tous les gens riches que je connus. Tous. Sans exception. Il suffisait qu'une homme (une femme) fussent riches pour me dire « Vous avez de la chance, vous ! vous pouvez voyager », ou « Vous en avez de la chance d'être aussi souvent à la campagne ». Je me gardais de leur répondre que pour cette « chance » j'avais renoncé à mille choses auxquelles ils étaient rivés.
Robert, lui, n'avait jamais prononcé ces mots-là. Le rien d'amertume (qui marque tous les refoulements qui existent encore en lui) avec lequel il émit l'autre soir quelques pensées de sévère critique sur ma dure vie, qui lui apparaît, ma foi, comme une succession de fantaisies capricantes, m'a montré, rappelé, combien il est agressivement bourgeois (5), par cela même nécessairement fasciste (5) ? et, pour cela, obligatoirement prisonnier (5)? A jamais prisonnier d'un ordre social dans le sein duquel il deviendra un grand bourgeois, un grand patron ; un ordre social dans lequel il prendrait la place importante que son intelligence mérite et que sa situation saurait imposer, eh bien, en dépit de cette intelligence même, de sa culture, de ses dons, en dépit même de l'analyse, [trois phrases soigneusement cancellées] (je ferais mieux de rêver plutôt qu'écrire aussi stupidement une nuit où je suis si fatiguée par chaque ligne écrite). (6)
1. Je n'ai pas beaucoup d'informations sur les activités de Champigny dans la Résistance lotaine (où André Malraux fut actif à cette époque) et à Vichy. Elle dit avoir répandu au cours de l'été 1942 un tract (« Comment ils les tuent »). Le 16 mars 1943, après avoir brûlé à Mézels des papiers compromettants, elle passa en Correctionnelle à Gourdon.
2.
Le docteur René Laforgue [1894-1962]. Denoël lui a édité une demi-douzaine d'ouvrages psychanalytiques entre 1930 et 1937. Son influence, en tant qu'analyste, est confirmée par René Barjavel qui, en février 1936, écrit : « L'autre soir, chez Robert, j'ai fait la connaissance du Dr Laforgue. J'ai eu la surprise de voir Robert perdre devant lui toute son assurance, être devant lui en admiration comme un enfant, comme moi je le suis devant Robert. Et pourtant, Champi, Robert vaut mieux que lui. Il ne m'a pas emballé du tout, ce brave psychanalyste. Mais je pense que chacun de nous, Robert peut-être plus que quiconque, a besoin d'avoir quelqu'un à admirer.» Le problème est que cette lettre est justement adressée à Champigny, qui ne connaît pas ce psychanalyste, sinon qu'il est d'origine alsacienne, ce qui suppose, dit-elle, une « lourdeur typique ». Typique de quoi ? D'une lourdeur teutonne, qu'elle attribue aussi à Denoël qui, à ses yeux, est d'essence germanique. Les Liégeois sont plus nordiques que latins, c'est indéniable, mais faut-il en faire pour autant des collaborateurs de l'occupant allemand ? Champigny n'hésite pas : tous collabos.
3. Ajout marginal : « Naturellement il a bien ri en lisant tout ceci et fortement démenti ». Champigny permet donc à Denoël de lire ce journal très intime - mais c'est en vue d'une éventuelle publication.
4. Début décembre 1926.
5. A ces trois endroits figurent un point d'interrogation. Champigny a noté en marge : « Les 3 ? sont de Robert. Je les expliquai de voix». De même que Champigny s'interrogeait plus haut quant à l'influence du docteur Laforgue sur Denoël, on peut se demander quelle fut celle du peintre communiste Christian Caillard, avec qui elle vécut durant quatre ans.
6. Ajout marginal : « Cette page qui résume en les outrant, en les dépassant, des défauts de Robert, étale les miens, « car chacun tue ce qu'il aime » disait O. Wilde, et, quand je souffre à ce point, je détruis en moi. Cela dure l'espace d'une heure pour me faire voir ensuite des précisions, de remords, d'humilité [deux phrases cancellées]. Quelle idiote je suis. » Tout n'est pas déchiffrable.
29 rue Cler. Lundi 30 novembre 1942.
Prière pour « Elle »
Que Dieu te protège, Toi, ma compagne nue
Ame grise des brumes nordiques
Que Dieu te protège
Impeccable, soudaine, fulgurante !
A tout ce qui t'offense : dure.
Tendrement obéissante au seul caprice
Et à tout geste de ton Maître,
Mon esclave nue.
Obéissante !
Avec l'aide de Dieu : jusqu'à la mort.
Ô ma fidèle, mon unique compagne nue.
Surtout, que Dieu te préserve du regard des hommes.
Sois secrète.
Reste cachée, mais prête... à jaillir comme une lance,
A t'élancer, comme une arme.
Et que Dieu garde le Serviteur qui te révère.
Alors, ô ma compagne, nous ne ferons jamais,
Toi et moi,
Que ce que Dieu voudra.
A lui, mon voeu plaise.
Qu'il la facilite.
A toi, je voue ma foi.
A lui : ta nudité.
Le soir, Robert vint me rendre visite. Je le priai de lire la prière qui précède. Il trouva ce poème « allusif ». Il le dit en riant, ajouta que ce devait être parfait pour les initiés mais que pour les incroyants restés en-deçà des murs, l'hermétisme en était si absolu que Paul Eluard lui-même s'avouerait vaincu (1)
1. Note marginale : « En 1945 je puis noter qu' « Elle », c'était la lame de poignard de tout parachutiste. C'est donc la prière d'un homme pour et à son arme. » A qui Champigny destinait-elle ce « poème » guerrier un peu dérisoire ?
[Début décembre 1942]
Pascal (1) ? Je lui garde une amitié de bon aloi. Je ne désire plus jamais le voir. Nos rencontres déçoivent ; sa veulerie arrive à me dégoûter.
En somme, il n'y a que Robert pour lequel j'éprouve toujours toutes sortes d'attraits. Nos idées sont aussi loin qu'elles pensent l'être. Mais toujours il m'intéresse, toujours me captive, excite ma curiosité. Vrai, s'il y a un homme avec lequel je n'ai jamais connu une heure d'ennui, c'est Robert.
1. Pascal Copeau [1908-1982], membre éminent du Comité de Libération en 1945, et ami d'enfance de Jean Brunel.
20 H du 5/12/42. Cler. Paris. C'est bon d'avoir le coeur qui bat de joie, c'est bon de n'être plus seule à l'infini au cours des heures ; d'attendre, et de voir surgir des yeux qui plongent au fond des vôtres à sûres plongées. C'est comme d'avoir 15 ans, un frère, un ami, un amant. Je suis si joyeuse. J'ai envie de rire et de pleurer. Mais le dimanche à minuit, c'est de pleurer seulement. Déjeuner rue de Lille avec les Beker (1). Traversé les Tuileries. Vu les grands drapeaux allemands rouges et noirs rue de Rivoli. Passé toute la soirée avec le swing. Joué vingt fois « Lily Marlène », obsédante et douce rengaine à cafard.
1. Robert Beckers [1904-1979], l'ami liégeois de Robert Denoël, qui vivait alors avec l'actrice de cinéma Catherine Hessling.
Dimanche matin 10 H ½. 20 décembre 1942. Robert. Il vient à l'instant où j'étais inexprimablement à bout. Fièvre de douleur, fièvre de chagrin. Mais il me prend dans ses bras, m'embrasse, appuie ma tête folle contre sa solide épaule d'homme, et je passe en un instant (nuit à l'aube), du désespoir à la joie la plus intense. Être près de Robert, avec lui, intimement comme hier soir, il y a tant d'années que j'avais faim et soif de cela. Il croit ne me rien donner quand il m'a seul redonné le goût de vivre, ne fût-ce que le temps nécessaire pour qu'il sût cet inépuisable goût de lui.
De toutes mes heures, hier soir est le miracle dans la tendresse. Tendresse de lui à moi. Amour de moi à lui. L'étrangeté est bien là. Lui-même s'en étonne. Je crois qu'un certain amour malade appelle l'amour de l'autre. Je commence à le chercher, le souhaiter, le désirer. Que pourrais-je envier, grands dieux, quand j'éprouve cette perfection jamais connue, cet abandon, cette pluralité de désirs sans qu'un seul m'obsède ? Que pourrais-je envier lorsque ce soir, je suis avec lui, que je sais le goût de sa bouche, que j'embrasse ses mains et reste agenouillée contre lui ? Si, jeune, j'avais été sa maîtresse, nous aurions connu, souffert, l'inévitable satiété. Devenue indésirable pour lui, je suis à l'abri de son dégoût. L'absence de possession n'a pas empêché les orages. C'est qu'alors, il ne savait pas que je l'aimais. Combien je l'aime. Il est curieux qu'entre 1926 et... , nous n'ayons fait que passer par ces accès sentimentaux.
[22 décembre 1942] Je ne dis rien ; je n'explique rien. J'imagine qu'il croit en moi ; c'est tout ; je ne pense pas qu'il saisisse complètement l'ensemble de ma vie, de mes élans, de mes échecs, de leurs causes ; de mes passions, de leurs objets ; je ne saurais dire ce qu'il apprécie en moi ; mais je suis si sûre qu'il apprécie - peut-être que j'aie tellement vécu, expérimenté, senti, souffert ? C'est possible. Il me connut alors que je portais encore les traces de toutes les folies de la jeunesse. [...] Toutes les années écoulées depuis notre connaissance, je me suis efforcée de ne penser à Robert que chastement. Tout au début, donc lorsque j'étais encore jeune, il sollicitait moins mon désir que plus tard. Peut-être parce qu'il ne possédait pas alors cette assurance virile qu'il n'acquit que par la suite, peut-être parce que j'étais la proie de Joë (1) - mais surtout, je crois, parce que, ce que je désirais, c'était son amour, sa pensée, son secret.
1. Françis Jossinet dit Joë, qu'elle a épousé le 2 avril 1927, et dont elle s'est séparée peu après.
J'étais née pour être l'unique d'un seul. Pauvre départ - mauvais choix - combien je vous ai oubliés, amants ! Car pour retenir un coeur d'esclave, il faut posséder des probités de maître, et combien j'ai pu vous mépriser, mes pauvres, mes chers, mes tendres amants ! Que vous étiez peu de chose ! Combien vous pressentiez peu ce que c'est qu'être un homme - et votre « mesure » sentimentale, votre piètre capacité d'amour, votre absence de souffle dans la passion - même toi, Joë ! - Ah ! lors même que vous me prétendiez adorer, combien vous saviez peu aimer ! C'est votre pauvreté qui me contraignit à considérer comment aimaient les femmes (1). Nul ne comprit rien à ma vie, à mes renoncements ; pas même Robert. Pourtant j'eus devant lui des hontes qui eussent dû tout lui révéler. Il manquait d'expérience. Sa somme sentimentale était déposée sur un être, et j'étais alors si persuadée n'être à ses yeux (comme aux yeux des peintres) qu'une machine à travailler. Il supposait que je tenais à cette petite cour - joyeusement idiote - de la rue Ste Anne : n'ai-je rompu avec tout, avec tous, du jour au lendemain ?
1. Sans être exclusivement lesbienne, Champigny a vécu durant six ans avec la jeune Catherine Mengelle.
Je lui ai raconté comment j'en vins à dire un soir à Joë : « Et maintenant, si je disais oui ? » Je ne lui ai jamais dit, à mon retour du Maroc en juin 1928 l'accablement rageur, sévère, terrifiant, dans lequel me jetèrent les heures de notre revoir avenue La Bourdonnais. A tant d'années de recul, je pourrais réciter tous les détails, tous. C'est alors que je découvris ma solitude, celle que j'ai vécue longtemps, désespérée, atroce.
Catherine entra. Je posai sur sa jeunesse cette étonnante charge d'amour qui eût dû me faire éclater, marchant ainsi vers de nouvelles souffrances, car j'étais seulement un enfant, un être auquel la vie n'avait permis de vivre ni enfance, ni adolescence, ni prime jeunesse ; j'avais plus besoin d'être protégée que d'éduquer, de me choisir un maître qu'un enfant (1).
Je ne vois pas pourquoi les psychanalystes confinent leurs études sur les seuls cas de refoulements infantiles. Je suis bien certaine d'être arrivée sans refoulements jusqu'en 1927/28. Certaine aussi d'avoir sauté de maladie en maladie, glissé d'échecs en échecs, depuis cette date. J'ai cessé de croire en moi, en ma volonté, en des réussites possibles, à mesure que Robert se déprenait (2) de moi affectivement ; libre de me mettre à écrire alors que j'avais toujours aspiré à écrire, je devins incapable d'écrire parce que Robert « méprisait mon ignorance » (du moins il paraissait...) (3)
1. [Ajout marginal de 1945:] A part Gama, Robert est le seul homme qui m'ait traitée en femme, qui ait connu, compris, protégé mes faiblesses.
2. [Ajout marginal de 1945 :] A mesure que je croyais qu'il se déprenait.
3.
[Ajout marginal : ] Maintenant il entre, ouvre mes cahiers et dit : Chérie, ne brûlez rien, n'arrachez rien, promettez-le moi...
[23 décembre 1942] : Il est dans la vie, Robert. Présent, tenace, assuré, il marche d'un pas certain vers l'avenir qu'il désire, qu'il aura. Rester à Paris, c'est rester dans son ombre. C'est la chance de le voir. Est-ce vraiment sage ? Alors que j'ai si peu le droit, la possibilité de compter sur moi. Alors que je sais qu'au mieux des mieux, ma vie physique est si réduite que je ne puis envisager d'efforts vrais ; les moindres sont pour moi épuisants.
Peut-être en m'aidant actuellement, Robert croit-il à une amélioration progressive sur laquelle il n'y a guère à compter. Mon corps infirme ne redeviendra jamais normal... toujours les douleurs me terrasseront, c'est fatal ; toujours j'aurai, même dans la vie la plus modeste, la plus obscure, des besoins assez grands à cause de mon mal même. Si je retournais vivre à la campagne, j'aurais les mêmes besoins, moins de dépenses, nulles possibilités de gains. Mais je sais que la graphologie (1) ne fournira pas ce qui est nécessaire pour vivre. Cela il faut que Robert le sache. Il a encore des illusions sur la qualité de l'animal : homme. Or, il est bon, doux, merveilleux (oh.. si merveilleux) d'être en quelque sorte existante matériellement comme moralement, par Robert.
Mais, si j'ai bien compris Christian, il faut vivre par soi-même, même infirme, ou crever. C'est une théorie soutenable. C'est justement parce qu'il est si malaisé de vivre, que j'avais repensé à la campagne, guère facile elle non plus. Il faudra tout examiner en détail avec Robert, et s'il dit : campagne, eh bien... ce sera sans doute alors honnêtement agir, ne pas risquer d'être ici, charge supplémentaire pour lui.
Paris c'est la peur de la ville, des gens, de la lutte, de tout. Mais l'attente de lui compensant tout. La campagne c'est une autre lutte, dans le calme de l'esprit, avec du temps pour la lecture, mais sans lui. Si je tiens debout un peu moins douloureusement bientôt, il faudra décider ça sérieusement. De toute façon je me sens plus légère, depuis que je possède de quoi « tirer la révérence » sans bruit, sans vilain spectacle.
L'autre soir, j'étais si heureuse, si merveilleusement heureuse, comme à vingt ans quand je m'éveillais sur la plage et que le jour étalait ses promesses de joie, infinies, comme la mer, comme le ciel, j'étais si heureuse que j'ai repensé à cette nécessité de mourir en état d'allégresse. J'ai failli le lui dire. Il aurait répondu : « IDIOTE » en riant si gentiment. Oh, comme toute force est Dieu. Combien toute vie est Dieu. Il n'est une parcelle d'énergie sans laquelle je ne sente Dieu, et dans l'homme que j'aime, son sourire, mes larmes, Dieu. Robert, Robert, je ne sais rien d'autre qu'aimer, si ce n'est croire qui n'est que sentir.
1. Champigny a mené en amateur des travaux de graphologie durant vingt ans. Denoël par exemple, lui demandait régulièrement d'analyser l'écriture de ses auteurs, ou même de ses employés.
Noël 1942, 24/12, 7 heures du soir. Hier, Barjavel, avec lequel j'avais déjeuné, me conduisit voir « Les Visiteurs du soir » (1). Je n'ai pas épuisé le plaisir éprouvé. Je pense déjà à celui que j'aurai à revoir ces images. D'un bout à l'autre j'éprouvais - pour une fois, au spectacle - l'impression de la vie. Puisque tout le monde, au sujet de ce film, emploie le mot « fiction », il faut bien reconnaître une fois de plus que personne ne vit. J'entends par là que les hommes sont guidés par des instincts, des besoins, mais ils ne répondent à nul appel dans le sensible. Ils ne perçoivent sans doute même pas les sollicitations. Si j'avais à raconter le film ? je dirais : c'est comme dans la vie.
1. Le film de Marcel Carné est sorti sur les écrans parisiens le 5 décembre 1942. René Barjavel, qui devait à Champigny son engagement rue Amélie, ne lui fut guère reconnaissant par la suite.
Interrompue par la visite de Caillard. Nous ne reparlons pas de ce que fut l'entretien de la semaine dernière. Ai-je encore de l'amertume ? Je n'en éprouve rien sur l'instant - mais n'ai plus confiance, ni liberté d'expression - il me heurte toujours. Sans doute est-ce malgré lui et on le surprendrait beaucoup en le lui disant. Il est si certain d'être parfait et parfait envers moi. Il faudra absolument que je parle à Robert de cette fameuse conversation de l'autre fois. Ça ira mieux après.
Hier soir, Robert me parle « Europe et politique ». Il m'apprend des quantités de choses. Aujourd'hui nous déjeunons ensemble. Avant le repas, je le prie de lire les pages qui précèdent. Je les laisserai puisqu'il a dit : « Il ne faut pas détruire ce cahier » qui, en fait, lui appartient.
Au cours du déjeuner il m'a soudain donné envie de connaître Céline. Le Céline de 1932, qui m'avait bouleversée en jetant le grand brame de son époque, ce qui me parut alors le cri, le signe, d'une civilisation blessée à mort. Robert est tellement entouré ; d'individus, de pensées, de sentiments ; j'admire que ce destin comblé lui laisse encore faire cas de moi. J'aime donner. C'est si bon, si exaltant, cela fait chaud, bon, gai, de donner.
Je n'ai rien à donner à Robert. Pourtant... Je l'aime comme tous les arbres contre lesquels je me suis appuyée. C'est vrai cela, comme un arbre ; c'est solide, grand, silencieux. Dans tous les pays je connais des arbres, dans tous les paysages où j'ai vécu, un arbre m'est, plus qu'un autre, familier. Dans Paris, c'est Robert, l'arbre (1).
1. [Ajout marginal :] Et ce passage explique tout. Dès le printemps 1927, lors de mes tragédies avec Joë, Robert fut l'arbre.
Pour Robert « visiteur du soir ».
Secret de la 23ème heure - Noël 1942.
Un être passe.
Il veut se décharger du fardeau et en secret.
L'homme ou l'arbre ? Auquel le donner ?
Les mots s'enfoncent dans la chair,
Ainsi fait la pluie sur la terre.
Nulle main ne peut l'en retirer.
Où s'en va l'eau ? Où, le secret ?
Mais s'il faut l'eau, pour que renaisse, dans la terre, le germe enterré,
Que faut-il, pour que disparaisse du cerveau tourmenté, le secret,
Pour que le mal soit conjuré ?
Son temps, la graine, en terre, attend.
Germe, paraît, grandit, fleurit, porte, en sa vraie saison, son fruit.
L'homme qui sait à qui bien donner
Son secret, voit parfois reverdir
Parmi les désespérances enfouies
Le tendre blé des moissons à venir.
Les mots, au travers des branchages,
Passent, passent, comme le vent...
Les mots qu'entend un homme sage...
« Autant en emporte le vent »,
Ce vent maudit qui tout emporte.
Au coeur de l'homme,
Au pied de l'arbre,
Celui qui passe (et ne fait que passer)
A déposé amour en blé.
Son temps, l'amour en l'homme, attend.
Oh ! splendeur des étés ! Vous tous qui récoltez,
Songez au semeur de secrets,
Il vient.
Il passe.
63 rue de Grenelle (1). Nuit du 9 au 10 janvier 1943. Toute une semaine pourrie par les histoires cadurciennes (la police, le procès, la correctionnelle...) Quelle faiblesse, la mienne. C'est seulement hier soir, vendredi, que soudain je me sentis étrangère à toute cette stupide aventure. Oui, soudain, je fus allégée, gaie, libérée. Ça m'est venu par sagesse ou réflexion. Comme ça ! Pouf ! d'un coup. Sans doute mon « ciel » changeait. Sans doute j'entrais dans une « maison » favorable. C'est en tout cas réconfortant d'y penser. Quelques visites. Toujours les mêmes. Mais je vois de moins en moins le seul qui m'intéresse. Je m'habituais trop, rue Cler, à le voir presque quotidiennement. Pour comble et désagrément, l'absence de téléphone amène les visiteurs chez moi au gré de leur caprice, en sorte que je ne suis même pas seule avec Robert.
1. Champigny a quitté le grand hôtel Leveque, rue Cler, pour un appartement de la rue de Grenelle, où elle séjournera jusqu'au 5 février 1943.
[15 janvier 1943] Une vie telle que la mienne ne peut se défendre à Paris. Ma grande, ma si profonde, ma tant réelle solitude, à la campagne est parfois âpre, mais jamais maudite. Là-bas, face à la rivière (dont je sens en moi la voix, ce matin), la solitude était source de paix, de sérénité. Dans la ville je sens le poids de toutes les faillites de ma vie jusqu'à y succomber. Tristes soirs que cette fin d'année 42. Triste début d'une [année] rue de Grenelle, en proie aux soucis les plus avilissants.
Et, lors même qu'ils n'existeraient, il faut me voir telle que je suis. Si les idées se vendaient, peut-être pourrais-je encore gagner de quoi nourrir le chien chéri ? A part cela, qui suis-je ? Que puis-je ? Rien. Réaccrochée un instant au vouloir de vivre, à travers Robert, j'ai fait toute une gymnastique psychique - un véritable entraînement à vouloir - vouloir. J'ai réenvisagé les possibilités parisiennes et la graphologie - folie - il faut un cadre - une installation - le téléphone - une clientèle - être vêtue au moins décemment afin que les clients n'aient pas envie de vous offrir quatre sous de fruits. Il faut aussi, pour inspecter l'esprit des autres, trancher, conseiller, consoler, orienter [...]
Le désir m'était venu de revoir les quelques dossiers non détruits. Depuis que nous avons fait accord, Robert et moi, qu'il accepte (avec émotion, je crois) ce legs d'amitié, j'ai beaucoup repensé à ces papiers. J'aurais aimé en détruire encore quelques uns (qui me sont miens), inscrire des notes, des indications sur d'autres - oui, vrai, cela eût été bon, quelques mois devant soi sans aucun projet d'avenir. Simplement être à la campagne, annoter des papiers dans le silence exquis des nuits fraîches, près du poële à bonne odeur de tan ; savoir qu'au dernier dossier, l'on refermera sa vie comme le papillon borde ses ailes, puis s'enfoncer dans la plus extraordinaire des découvertes.
Mais voilà, c'était peut-être veulerie, lâcheté, instinct stupide de conservation qu'éprouver ces besoins, ces désirs. En tout cas, ils ne sont pas réalisables. Ces misérables m'ont pris ma paix (1). Je ne reconnais plus mon paisible coeur sans haine de jadis. Je ne hais pas. Je ne sais pas, ou je n'ai pas assez de forces, mais c'est déjà assez de constater que je comprends la haine ; nuit après nuit, des meilleures aux pires pensées, j'ai continué à trébucher seule. Mon visage harassé n'a plus d'âge - mon regard plus de lumière - ma bouche est sans sourire - et ma voix m'étonne, qui se casse sur des inflexions étrangères.
1. Champigny a été convoquée au tribunal de Gourdon le 16 mars 1943. Elle ne s'en explique pas dans son journal, écrivant simplement qu'on lui demande des comptes « pour les imbécillités de Vichy ». Une note du même jour : « Depuis trois semaines j'ai vieilli de cent ans. Je m'avoue vaincue - démesurément usée. Je n'en puis plus. Nul ne semble se douter en regardant mon visage ravagé de cette destruction qui s'accomplit en moi. J'ai lutté, cherché, pesé, seule, seule, seule, et impuissante. Nul ne comprend que condamnée par Vichy serait intolérable en mon état maladif ; nul ne comprend ni ne soupçonne que, même acquittée, je suis maintenant sans recours. [...] Avec ce scandale, Mézels ne me paraît plus possible. Je n'ai donc plus rien. Malgré la sottise, la méchanceté qui trop souvent m'y éprouvèrent, les dernières années, la population apprivoisée à l'étrangeté de mes habitudes, m'appréciait, me rendait même assez heureuse. Maintenant, en admettant que le Tribunal se dispense de me tyranniser, je trouverais là-bas, si j'y retournais vivre, une atmosphère de suspicion. Les gens que j'estimais, sans doute me fuiraient lâchement, les pauvres, par souci de leur tranquillité. Quant à moi, comment trouver sur ma route ces monstres de bêtise, de laideur, qui ont bavé sur ma vie dont ils ne connaissaient rien, oui, comment voir ces hommes sans leur dire mon dégoût. »
16/1/43, le matin. Hier soir, j'ai écrit à l'avocat pour lui fournir encore quelques précisions, comme si cela importait, comme si cela pouvait changer quoi que ce soit. Ensuite j'écrivis à Robert. Je voulais lui faire part d'une idée : un ouvrage qui reste à faire sur le prince de Talleyrand. Soudain, je venais de cacheter la lettre, je me demandais attentivement si je la posterais ou si j'attendrais de la remettre à Robert à sa prochaine visite. A cet instant précis j'ai enduré de la tête aux pieds une certitude telle qu'elle était en somme aussi physique qu'un frisson. Je sentis que je devais nous tuer, Doudou et moi, que je n'avais ni travail, ni argent, ni santé, ni espoir d'avoir santé, travail, argent, que tout était sans issues. Vains mes courages passés. Fous les courages que je pourrais encore faire semblant d'avoir. J'ai regardé les tout petits, les minuscules projets nécessaires des dernières semaines, ces actes que je remettais au lendemain : acheter des lunettes pour lire sans pleurer - me faire un peu soigner les dents - rêver d'acheter un stylo qui écrive... alors enfin j'ai souri. Car de tous les actes à accomplir, il n'y en a qu'un d'urgent, c'est de convoquer Jean Brunel pour prendre avec lui des décisions que je ne saurai jamais écrire seule. (1)
1. [Ajout marginal : ] Je me souviens que Robert vint et dit : « Vous achèterez deux paires de lunettes et je vous offre le stylo ».
Vendredi 29 janvier 1943, 15 heures. Robert chéri, le ciel est gris, la maison noire. Ma pensée plane parmi des paysages de clarté. Je revois ceux de la première enfance, les bords de la Vienne à Chinon et le beau parc de Richelieu. Depuis ce dernier novembre, j'ai si souvent désiré être avec vous quelques heures parmi les arbres. Je n'ai plus guère la possibilité d'espérer que de tels désirs puissent un jour être satisfaits. Tantôt, ils se font si aigus que je ne résiste plus à vous en parler.
Lorsque les « temps difficiles » seront franchis, qu'un peu d'harmonie sera rétablie sur le monde ; quand vous disposerez à nouveau d'une voiture, allez un jour en souvenir de moi à Richelieu. Vous m'y rencontrerez (1). Au bruissement soyeux si particulier des bambous, vous réentendrez les tendres choses dites, et même celles qui ne furent jamais proférées. Chaque fois que je vous vois, j'éprouve un apaisement qui m'emplit de gratitude. Je crois que j'ai dans votre pensée une place à jamais stable (2). Je ne tiens plus beaucoup ni solidement à la vie, je ressemble à ces plantes trop bousculées dont on voit les racines hors de terre. Que la terre se dessèche encore un peu autour, c'en sera fait d'elles.
Mais quand vous entrez, que vous êtes près de moi, je me sens alors encore vivante. Ce sentiment fervent, que vous savez, est peut-être la dernière fibre de mes racines. C'est par vous que j'adhère encore un peu à la vie. Dans quelques jours, lorsque je partirai pour Mézels, je ne vous quitterai pas : je m'arracherai de vous. Je tâcherai de vous cacher le chagrin inévitable. Car, à moins que vous ne puissiez venir au cours de ce printemps terrible m'embrasser à Mézels, ce sera d'adieu que je vous étreindrai au départ.
Là-bas, j'espère faire mettre en ordre les rares dossiers non détruits. Sans doute il coulera des années avant que nous ne lisiez ces pages que je ne veux laisser qu'à vous. Il est indispensable que je vous en éclaire la lecture par des notations précises. Je serai avec vous bien après la mort corporelle. Vous m'appellerez quand il vous plaira. Toujours vous vérifierez la permanence de ma présence, l'impérissable durée d'une tendresse qui pour vous deviendra alors lumière et paix.
1. [Ajout marginal : ] Mais depuis... la guerre, la mort est passée par-là. Alors...
2. [Second ajout marginal : ] « 1944. A partir de juin m'enlevèrent cette réconfortante certitude. Puis il y eut « Province » abandonné par Robert parce que : de moi... » Le manuscrit de « Province » lui fut restitué après la mort de l'éditeur par René Barjavel. Il s'agissait de souvenirs d'enfance dans l'Indre.
Presque à l'aube du 2 février 1943, c'est-à-dire quelques heures plus tard. Besoin de fumer qui me creuse autant que la faim. [...] Si seulement j'avais des cigarettes. Si je pouvais m'asseoir par terre, contre Robert ; lui parler. Je crois que mon état me permettrait de lui dire très clairement tout ce que je désire qu'il sache et que précisément je ne parviens jamais à lui dire, ligotée que je suis devant lui par une insurmontable timidité. Par exemple : comment je pense que je pourrais vivre si un seul esprit au monde, oui, un seul, m'accordait la confiance, la compréhension absolue que je prétends mériter, et qu'un autre être, humble, simple, affectif, m'assistât dans l'énorme entreprise matérielle d'exister.
2/2/43. La nuit, l'aube. J'ai passé ma vie à me créer de faux devoirs, à m'en rendre esclave. J'avais, qui sait pourquoi, cette année-là, résolu de m'acquitter d'imaginaires devoirs filiaux. Je trouvai donc l'homme. Dimanche. Printemps. 11 H du matin. J'étais plutôt jolie cette année-là, simple, mais élégante. Je travaillais à la « Délégation roumaine à la Conférence de la Paix » (1). Je gagnais ce que Gama appelait « la solde d'un capitaine ». J'étais plus libre qu'aucun individu de ma connaissance le fut jamais. [...] J'ai beaucoup à te dire. Accorde-moi une promenade et, avant ce soir, tu connaîtras un homme jusqu'au tréfond de ses secrets.»
Un peu anxieuse, très émue d'une si franche confiance, j'acquiesçai aussitôt. Un taxi nous conduisit au bois de Vincennes où, d'allées en allées, pendant des heures nous parcourûmes, je crois, des kilomètres. Mon père avait des années de solitude, de repliement, de silence. Il n'en pouvait plus. Il parla donc. Il me fit le récit de sa vie. Récit assez banal et succinct de l'enfance à la puberté, car il lui tardait d'entrer dans le vif du sujet : ses amours, « son cas ». J'avais, ainsi que l'on dit, « vécu ». Je croyais savoir sur les hommes et la vie bien plus qu'il n'est d'usage à pareil âge. Je me croyais si éclairée ! si savante ! si « affranchie » ! [...] Quand vint le soir de cet interminable jour, je n'avais plus d'âge. Car l'histoire de mon père était celle du masochiste absolu et j'avais dû entendre le récit de ses passions, de ses aventures, de ses amours, de ses crises, depuis le roman avec la grande courtisane tourangelle, jusqu'aux années avec Mimi, en passant par la lamentable expérience conjugale. [...]
En sorte que rien ne me préparait à cette avalanche de révélations. Nous avancions dans les allées ; je n'osais plus le regarder. J'éprouvais pour lui une pitié infinie ; je ressentais un mal panique atroce. Il ne fit pas grâce d'un seul détail. Les femmes spécialisées... les établissements organisés pour ces spécialisations. Le masochisme cérébral, le masochisme physique ; le goût de la torture qui fait chérir celle qui vous bafoue, qui fait fuir la compagne parfaite... Le goût ignoble des pratiques où la bête se vautre pour chercher le spasme au travers des ignominies corporelles.
Ma jeunesse en fut comme fauchée dans sa fleur. Je me contraignis à devenir provisoirement une garce. Car une seule chose comptait : échapper à la menace de cette hérédité, ne pas ressembler à « cela ». Ma mère fit dévier l'ossature de mon squelette. A mon père, je dois la courbe déséquilibrante, la course folle, le gaspillage du meilleur de mes forces et de mes dons à seule fin de ne pas lui ressembler. Sans ce détail, personne, pas même l'ami auquel je destine les rares cahiers non détruits, ne saurait comprendre à fond la mouvance sentimentale d'un coeur fait, je l'ai déjà dit, pour équilibrer toute sa somme individuelle dans un sentiment stable. Je ne suppose pas qu'il y aurait intérêt à m'imposer d'écrire tout ce que j'entendis ce fameux dimanche à Vincennes.
Il fallait seulement signaler pourquoi mon intelligence sut si mal freiner mes impétuosités effarantes. Dire comment naquit, se développa une agressivité qui devint par la suite comme une seconde nature, après avoir été pure défense, inévitable réaction. C'est ainsi que je me suis créé mille tourments, en proie à l'idée fixe d'échapper à une catégorie de souffrances qui me semblaient s'apparenter dangereusement au « cas » paternel.
1. La Conférence de la Paix se déroula à Paris entre janvier 1919 et août 1920. Cette conférence internationale organisée par les vainqueurs de la Grande Guerre avait pour objet de négocier les traités de paix entre les alliés et l'Allemagne vaincue.
Dimanche soir, 7 février 1943, 23 H 30. J'ai toujours l'air si gentille, si reconnaissante que l'on vienne me voir. Je suis toujours si contente de me retrouver seule. Je n'éprouve pas, avec les animaux, ce genre d'ennui qui me saisit soudain tout à trac à côté des gens. Robert c'est autre chose. Je ne le vois jamais à ma suffisance. Du temps où nous étions de longues heures ensemble, rue Ste Anne, j'éprouvais plutôt le besoin d'être davantage avec lui ; j'aurais goûté qu'il me consacrât des heures, le soir, ce qui arriva rarement. Avec Catherine je ne m'ennuyais pas. Je veux dire par-là que dans les périodes sans scènes, elle ne me gênait pas pour exister ; je ne me forçais pas à être continuellement en attitudes pour elle. Un homme auprès duquel il était si facile d'être naturelle, c'était Adam. Peut-être n'ai-je jamais parlé de lui à Robert et il ne reste pas trace d'un seul cahier, d'une seule lettre se rattachant à l'histoire d'Adam.
Samedi 14/2/43, la nuit, 2 heures. Par quelle aberration héroï-comique me suis-je encore une fois imposé une désintoxication ? Comme si j'ignorais, dès le départ, l'inutilité des troubles et réelles souffrances ainsi surajoutés au faix quotidien. Je l'ai fait. J'ai tenu bon. J'ai eu mille fois plus de troubles que je ne pouvais en attendre. J'ai fait tous les traitements dont on attendait un mieux, qui n'est pas venu.
Et hier, à bout de douleurs dorsales et iliaques, ne pouvant plus bouger, j'ai prévenu le docteur que je préférais être intoxiquée et calme, plutôt que désintoxiquée et enragée de souffrance. J'ai pu bouger sans hurler. J'ai pu avoir l'énergie (car c'en est une, maintenant) de coudre dans mon lit. J'ai été gaie bien qu'un peu nerveuse. J'ai raccommodé ma vieille houppelande grise. Celle qui a fait le voyage avec moi. C'est comique de penser que j'emportais sous les tropiques un peignoir en tissu des Pyrénées au lieu d'une douillette de soie ou d'un élégant déshabillé.
J'en avais fait l'achat avec Cécile (1). Cette occupation paisible (de refuser tant bien que mal un vêtement si calqué sur moi, qu'à mon image il craque de toutes parts) me faisait revivre le souvenir de Cécile. Il faut bien que je l'aie aimée infiniment, plus qu'elle m'aimait, si elle m'aima jamais ; car elle m'a toujours manqué au cours de ces dernières années ; je ne me suis jamais accoutumée à ce qu'elle se soit ainsi absentée volontairement de ma vie.
Elle avait certes des amies plus agréables ; en avait-elle beaucoup, qui l'aimassent autant que moi ? J'en doute. Fidèle à mes sentiments comme un vieux chat à sa demeure, ce vide des êtres me désempare après des années autant qu'au premier jour. J'ai prêté à Cécile les pires combinaisons machiavéliques, c'est-à-dire qu'avec ma sottise coutumière en matière sentimentale, je me laissai influencer par les Caillard, quand il leur plut de nous distancer, Cécile et moi, pour des buts et motifs d'eux seuls connus, que je crus deviner mais trop tard pour les déjouer.
D'où, de qui, vinrent les manoeuvres ? Je partis. Finet (2) et sa mère, à quai, eurent mes dernières larmes, mes derniers regards, mes derniers mots. Ils étaient la dernière image que j'emportais de France. Je devais souvent par la suite me remémorer leurs deux silhouettes, sans pressentir que ni au retour, ni plus tard, je ne retrouverais leurs bons yeux, leurs larmes, leurs gestes, leur rire, leur coeur. A Nice, j'avais aussi pris congé de ceux de la rue Cronstadt avec émotion. Ces amis, au cours de mon voyage, s'abstinrent de m'écrire. J'en souffris comme d'un deuil, plus d'une fois amèrement noté. Mais quelle put être au retour ma stupéfaction ! Je leur revenais, affamée de tendresse, lourde, bouclée à éclater de richesses diverses à partager avec eux. Je ne les retrouvai pas. La veille de mon arrivée, Cécile s'était précipitamment enfuie pour ne point me rencontrer, me précisa-t-on.
Chez les Caillard, je sentais une gêne terrible. En moins de 8 jours, sous le plus futile prétexte, éclata une discussion entre Adrien et moi (à propos de Doudou, je crois). Je leur dis combien je sentais que nous étions devenus étrangers ; sans doute l'éloignement m'avait trop transformée... (Mais eux !...) Je partis. Je leur écrivis. Ils ne répondirent jamais. Manon et Claude ne répondirent non plus cette année lorsque j'écrivis après la mort d'Adrien (3). Que s'est-il passé avec Cécile ?
Eh bien voilà. En toute âme et conscience, je l'ignore. J'ai fait mille suppositions. Je crois même avoir interrogé Cécile par lettre, avoir sollicité une franche, une intime explication en dehors de Robert afin de ne blesser nul orgueil. Cécile se mura dans l'indifférence (4). Sans doute parce que l'indifférence préexistait. Du moins je suis tentée de le croire. Par nature, par enracinement de la volonté, par goût, par raisonnement, j'ai toujours tout et rapidement pardonné, quoi que l'on m'eût fait. A plus forte raison ai-je rapidement pardonné les fautes de ceux que j'aimais. Eclater de colère, bondir de rage, ça oui ! Mais user de la rancoeur, jamais.
L'idée que l'on puisse renoncer à quelqu'un que l'on affectionne, me dépasse. Ou l'on s'est trompé, il n'y avait que du charme ; finie la séduction, tout est fini. Ou l'on tient réellement, par cent liens affectifs, moraux, par des habitudes, des souvenirs, à un compagnon, à une amie ; dans ce cas, nulle nature humaine n'étant parfaite, les individus les plus liés pensent soudain se trouver divisés, un jour, des années, mais comment croire que les sentiments, d'amour ou d'amitié étaient mutuels, si l'un seul des deux souffre de la disparition de l'autre ? Orgueil ? Amour propre ?
Bah ! dans l'extrême jeunesse, peut-être. Mais, dès les abords de la trentaine, qui ne sait que les relations sont constamment renouvelables, tandis que les amitiés sont rares, clairsemées, difficiles à nouer, capricieuses à entretenir, réconfortantes à posséder et plus exigeantes à soigner que plantes de serre si l'on ne veut les voir périr de froid, d'étouffement, d'inanition. Oui, dès 30 ans, l'on sait le précieux de l'amitié, la rareté des êtres valables et, quand on renonce à l'un d'eux, c'est que les motifs sont fort graves ou que le sentiment n'existait pas.
Je me flatte d'avoir si bien sincèrement aimé Cécile, telle qu'elle était, avec tous ses défauts ; je garde souvenir d'avoir infiniment profité de ses qualités ; il se trouve que les qualités de Cécile comblaient très particulièrement les côtés les plus droits, les plus simples, les plus réels de ma nature ; je me flatte de n'avoir pas varié d'un pouce dans mon comportement affectif. J'ai eu à cause d'elle, par elle, directement ou indirectement, qu'elle soit ou non coupable de l'avoir ou non voulu, j'ai eu infiniment de peine. J'ai eu contre elle de trop naturels réflexes de colère, de rage - de méchanceté, jamais.
Puisqu'aussi bien j'ai passé des heures hier après-midi en tête à tête avec les souvenirs d'elle, je me plais à consigner ces pensées, dont elle saura plus tard qu'à part rapetasser la vieille houppelande grise, je rédigeais dans le même temps mon testament. Alors, on lui aura remis le souvenir que je lui destine. Alors il sera bon que la seule voix qualifiée pour lui transmettre mon adieu lui assure aussi combien en moi-même j'étais en paix avec elle (5).
1. Première mention de Cécile Denoël dans le journal. Les deux femmes s'étaient rencontrées dès 1927. Cécile avait rompu avec Champigny en 1936 mais pas forcément pour les raisons invoquées ici. La famille Caillard, il est vrai, fut mise en cause.
2. Petit nom familier du fils de Robert Denoël, né en 1933. En wallon liégeois, « finet » signifie : petit garçon mince.
3. Adrien Caillard [1872-1941], acteur puis metteur en scène de théâtre et de cinéma, habitait Nice depuis 1930.
4. Il semble que Champigny n'ait rien su de la liaison amoureuse nouée par Cécile avec Claude Caillard dès 1934. Dans une lettre de 1945 à sa femme, Robert Denoël écrit : « C’est en tout cas, bien avant la guerre que votre liaison a commencé. Elle s’est déroulée sous les yeux du vieux et de la vieille Caillard ».
5. On ne sait si elle pense à Robert Denoël, à qui elle destine ces pages, ou à Jean Brunel, son exécuteur testamentaire.
En paix avec les multiples images d'une Cécile toujours différente - Cécile quand j'arrive du Maroc en 1928 - elle a encore un fort accent belge - elle a un manteau impossible - elle est belle, gaie, éclatante de vie. Cécile, rue du Moulin Vert . Déjà tendue ; si amoureuse, si ardente (1) ; toujours en retard, toujours attendue à l'heure du déjeuner dans l'autre souk de La Bourdonnais (2) ; elle descendait de son taxi avec la majesté d'une actrice désireuse d'en imposer à vingt mille badauds d'un coup - notre petit monde suppléait à l'absence du grand public, je dirai mieux, y remédiait par la qualité de notre admiration.
Le soir, elle faisait des prodiges de magie culinaire. Sans argent, sans gaz, je lui ai vu réussir des repas pantagruéliques. Quittant un instant le rôle de l'impératrice, elle nous éberluait de sa science, de son génie organisateur. Cécile possède au plus haut chef les qualités féminines essentielles pour assurer le bonheur de ceux qui l'entourent. Les déchirures dans ce bonheur, les ruptures d'harmonie, ne venaient d'aucun défaut déparant les dites qualités. Seuls, les troubles profonds qui agitaient sa personnalité en étaient cause.
Cécile débordait de vie à exprimer, de sentiments, et étouffait littéralement d'ambition. Le théâtre seul eût pu combler ce tempérament. Faute d'avoir été dirigée, la force torrentielle de cette âme naïve, fraîche, téméraire, se dispersait, se heurtait, ricochait, disparaissait, comme le Rhône, pour resurgir aussi dangereuse.
J'avais tout compris dès le début - les lucides, les voyants, les clairvoyants, sont odieux. Tous m'inventent ! Nous parlons dans le désert. L'on nous hait pour nos enseignements, nos avertissements. Plus tard, on oublie que tant de sagesse émanait de nous ! A l'époque à laquelle je fais allusion ici, j'avais sur mes amis l'avance de quelques années d'âge. Des amis si surchargés d'expériences qu'entre mon savoir et leur ignorance de l'humain, il y avait des abîmes. Je comprenais si bien ce qui paraissait être « les défauts de Cécile ». Alors que leur ensemble était un état. Mais ses qualités. Ah, ses qualités...
Quand, loin de France je parlais d'elle, que je voulais la faire connaître, comprendre, aimer, je ne dressais pas une description compliquée. Je la campais saine, fraîche, attirante, sentant bon. Je vantais sa propreté raffinée, son allégresse corporelle, le goût insolent que chaque mouvement de son corps affirmait pour la vie, pour l'amour ; j'imitais ses intonations, j'expliquais son rire, le vif de ses regards.
Puis j'en venais à ce qui la caractérise si vivement. Cécile aborde avec des naufragés sur une île déserte. Il n'y a comme ressources que des robinsonnades : la caisse, le canot, des bouts de planches, quelques loques. Mais vous dites à Cécile : « Je t'aime ». Elle rit. Elle n'a plus mal à la tête. La vie est belle. Vous lui parlez tendrement. Elle rit encore et se met à l'ouvrage, à l'oeuvre, à son chef d'oeuvre.
L'heure d'après, il n'y a plus de naufragés. Il y a une illusion de pays. Il y a la certitude d'un foyer. L'on se meut sur sable et roche comme sur carrelages et tapis. Elle a créé une maison. De chacun de ses gestes est sortie une réalisation parfaite. Il y a une maison, je vous assure - des meubles... on les sent, on les devine, on les toucherait - qu'elle les nomme et vous en sentirez la matière ; tout est en place. Canot, caisses, hardes !
Que lui importe les matériaux s'il plaît à son génie féminin, à sa jouissance affective d'agir ? Hardes, caisses et canot lui sont assez pour inventer un confort et, tandis que vous y rêvez, dans l'étonnement, elle a déjà monopolisé les ressources du lieu ; écoutez bien son rire... dans un instant elle vous servira un festin ; il sera opulent car l'usage du généreux lui est aussi habituel que le rire ; il sera varié car elle a de l'originalité, du goût, il sera bon car elle y aura mis tout son coeur, comme s'il s'agissait à chaque menu d'une opération tendant au sauvetage de plusieurs vies et, de surcroît, elle aura pour vous plaire pris encore le temps de s'embellir, d'orner le lieu ; la fleur aux cheveux, le rire du triomphe aux lèvres.
Le regard cueillant, joyeux, l'approbation qui lui est justement due et naturellement nécessaire, elle posera devant les élus les mets préparés avec le geste de l'officiant reposant le ciboire sur l'autel, car elle a reçu une mission, elle a été investie d'un rôle : transmettre, enseigner, parmi toutes les barbares ignorantes de sa génération, le merveilleux secret féminin du bien-vivre ; elle sait qu'elle accomplit au mieux sa tâche ; aussi, tout être sain, normal, tout individu sachant et aimant vivre, subit instantanément l'irrésistible aimantation que Cécile provoque.
Si quelqu'un pouvait assurer à Cécile qu'elle n'a raté ni gâché sa vie. Si quelqu'un pouvait lui faire sentir aussi nettement que je le ressens encore maintenant, en pensant à elle, en évoquant « les Cécile » de tant d'années, combien au contraire elle a dignement réussi et merveilleusement joué le rôle que le destin lui assigna, d'être une Femme. Si on lui disait qu'il n'y a guère de différence entre la reconnaissance du spectateur pour la vedette, et celle qu'elle inspire au public souvent renouvelé de ses relations, de ses amis, à cela près que les spectateurs oublient promptement leurs artistes préférés, les ingrats, tandis que certains spectateurs tels que moi, conservent indéfiniment les souvenirs, le goût, de ces pièces vivantes jouées par Cécile avec aisance, charme, naturel, bonté, pathétique, colère, furie, haine et tendresse.
Cécile, soulevant le rideau-portière des « Trois Magots » pour écraser Robert assis à son bureau, d'un formel, d'un péremptoire « Il ne me plaît pas ? » Cécile, sortant de la douche entre les rideaux de toile cirée, si animalement simple, qu'autour d'elle les porte-manteaux formaient haie de saules et d'aubiers : le soleil, par sa peau, éclairait cette pièce haïe des dieux, en laquelle je crois bien ne pénétra jamais nulle autre clarté que le corps de Cécile.
Cécile, à genoux, devant une chaise, regarde la chatte faire ses petits. Elle rit, pleure, s'émerveille. Elle est la femme. Elle est la maternité en puissance. Elle adore Robert, aussi elle regarde la chatte avec envie, avec ardeur ; elle palpite du besoin d'enfanter. Cécile à la campagne ; elle hurle de joie ; elle vient de voir une bête « à fourrure » ; elle en est certaine ; c'est sur la route de Saint-Céré ; tant de joie l'agite que, même si ce n'est qu'un lapin, on peut dire qu'il lui a fait autant de plaisir qu'une panthère.
Cécile danse. La danse sauvage, c'est Mézels ; est-ce moins sauvage chez Bernard à Montmorency (3) ? pas tellement. Le costume change. Cécile reste nature, primitive, femme. Perturbée dans son milieu, par son éducation, elle a bien failli sombrer dans le remous de faux intellectualisme des années de recherches et de piétinements de Robert ; heureusement, de fois à autres, elle obéit à son instinct - alors elle est sauvée. Cécile rue Amélie. Ah que de Céciles j'ai connues. Ses angoisses, ses craintes, ses orgueils, ses espérances, j'ai suivi tout cela, sans qu'elle dît jamais rien. Elle était toujours lisible. Je la regardais. Ensuite, si j'avais voulu, j'aurais ouvert son âme comme un musicien ouvre un piano et déchiffre doucement pour lui seul, confidentiellement, la partition nouvelle ; le chant d'abord... confidentiellement... l'accompagnement oui, puis la maîtrise du tout.
Parfois, ainsi, quand nous nous trouvions seules, je disais quelques mots. Cécile ne se livrait pas aisément - elle ne se racontait que par accès - elle livrait alors des faits. Ils éclairaient mieux tout ce que l'amitié avertie pressentait si bien. Au début, du temps du Moulin Vert, elle souffrit fort de la bande Chanterou (4), puis de l'amitié de Robert pour celui qui, je crois, partit au Congo (5).
Elle eut un chagrin d'enfant, donc déchirant ; alors, pour ses petits bijoux qu'elle avait vendus ou donnés à Robert pour qu'il les vendît (je ne sais plus bien) et dont Robert ne reparlait jamais, il ne faisait jamais le projet de remplacer ces trésors de jeunesse (6). Que d'autres, ensuite, passent sur la silhouette de mon amie. De combien de tourments elle se déchire. Les années coulent. Ils changent tous les deux - parfois j'ai peur qu'ils changent trop... qu'ils se rencontrent une fois, au carrefour, après une séparation trop longue... et ne se reconnaissent plus. Je crois bien qu'il y eut un moment où, sans la claire voix de l'enfance, ils seraient passés sans se voir.
Cécile la nuit à Vichy. Un peu de champagne, un peu de fièvre, une anxiété sourde, une apparente gaieté ; le tout dans une robe de taffetas noir. J'étais heureuse d'être avec elle ; il m'était bon de l'aimer ; je ne peux bien goûter l'amitié (enfin, je parle du passé, bien sûr) qu'avec les êtres qui m'inspirent, en plus de l'amitié, une tendresse physique. J'ai cette chance que ma tendresse physique n'est jamais troublée par rien d'équivoque. Robert est mon arbre de Paris. Cécile m'a toujours été précieusement prairie et rivière. Ah ! Combien je la regrette, combien elle me manque.
Que j'aurais joie à l'entendre rire. Et cette nuit de Noël, quand nous restâmes à la maison Floquet, Billy, Bamby, Cingria et moi (7). Cécile avait une robe de satin blanc, je crois. C'était l'hiver 35/36 ; je la voyais souvent. Quand vinrent les préparatifs du voyage, elle fut ce qu'elle était toujours pour moi, secourable, adroite, maternelle. Cécile savait bousculer mes incertitudes, résoudre mes remords.
Elle affirmait avec autorité que « j'avais absolument besoin » de l'objet devant lequel elle me sentait crever d'envie ; j'en faisais alors l'acquisition, légère, aidée de ses conseils ; pour elle, dépenser de l'argent était un jeu ; pour moi c'était depuis des années un problème ; Cécile, loin de considérer comme Christian et Armand toujours (et comme Robert parfois) que je me permettais des « luxes » incompatibles avec ma vie, Cécile estimait que je n'avais pas le quart de ce qui m'était essentiel.
Vaincue dès le départ par une misère si effroyable qu'à nul au monde je n'en contai jamais l'exact récit, j'ai traîné au long des années d'inextinguibles soifs jamais satisfaites. Car cette misère m'inspira tant de compassion pour autrui que, dans les brefs instants où j'eus un peu d'argent, j'en fis usage pour aider des gens à posséder le nécessaire, sans jamais oser m'offrir de bien simples choses qui me restaient « le monde interdit ».
Quand par hasard je contentais un plaisir, la moindre critique m'atteignait en plein, je sortais de mon rêve, honteuse, contrite. Cécile, avec son habituel génie féminin, fonçait sur mes hésitations, balayait mes timidités ; son adhésion m'emplissait d'air. Si, les derniers hivers, j'ai revêtu un peignoir chaud, je le dois à Cécile. C'était trop bien, trop cher, je n'osais pas... par chance, elle me pilotait et tranchait décisivement : « Tu en as besoin ».
C'était vrai, et à quel point. Depuis, personne ne se soucie de quoi j'ai besoin. Je puis bien le dire : ce qui m'a rendue orpheline, dans la vie, c'est d'avoir perdu Cécile. Je suis certaine, si je suis la seule à l'exprimer, de n'être qu'une parmi d'autres à éprouver cela. Et ce n'est pas peu. Etre capable, simplement en existant, en étant soi-même, en jouant sa propre vie, d'intéresser à ce spectacle des esprits attentifs, des coeurs prompts à battre et s'attendrir, mener le rôle avec talent, au point que le spectateur illusionné se figure, l'innocent, qu'il participe à ce jeu de toute sa force, en acteur lui aussi, et non point seulement en spectateur, prêt à donner la réplique, fou, entraîné, attiré par l'aimant, mais soudain rejeté, car c'était bien un jeu.
La vie de tous les jours, un décor changeant, le destin, un metteur en scène capricieux... C'était un jeu, certes, et c'est être excellemment capable que laisser des marges durables, profondes, valables, dans un esprit critique, sévère, sur une nature aimante mais endurcie, et je rends ici un dernier témoignage tout de fidélité affectionnée en résumant que sur des scènes désertes, je lui fis jouer des rôles qu'elle improvisait, recréait, pétrissait de la propre matière de sa vie ; elle jouait la femme, l'épouse, l'amante, la mère, l'amie ; elle était tout cela. Actrice, elle ne peut, quand le rideau des changements d'épisodes tombe, discerner qui, parmi les spectateurs, mériterait d'être retenu dans la chaude intimité de la loge, je veux dire du foyer.
Tant pis pour l'amoureux illusionné qui s'incorpore au jeu ! Avec les êtres comme Cécile, il faut justement jouer. Et même, j'en ai vu qu'elle aima parce qu'ils lui jouaient l'amitié. La vivre... surtout en durée, c'est plus sévère. Chère Cécile ! Je m'attendris encore en souvenir d'une de nos dernières nuits ensemble. La servante du restaurant, le menu, le jargon méridional, le vin, tout concourait à une énorme gaieté. C'est la dernière fois que nous avons ri ensemble.
Les dernières heures furent graves, presque silencieuses. Le départ nous saisit, s'imposa, à l'instant où elle allait me dire tout ce qu'alors elle taisait encore. Elle m'entoura de soins, d'attentions jusqu'au dernier moment. Elle vint à bord de l'Eridan (8), avec Finet naturellement. En un clin d'oeil elle vérifia, inspecta tout. Oui, ma cabine était bien située à son goût, à son idée ; oui, je serais bien ; oui, le bateau était confortable, chic, sympathique. Et je ne manquerais de rien ; la malle était organisée avec minutie, perfection. C'est elle-même qui avait plié chaque robe... Je pouvais partir.
Si j'avais eu une soeur, je ne l'aurais jamais plus tendrement chérie que Cécile, ce jour de mars 1936, en ces heures où je cristallisais sur elle toutes mes émotions d'adieux à tous, à la France, à moi-même, si certaine que, si je revenais des antipodes, ce serait tant changé. Je ne sais à quel moment du voyage peut s'inscrire l'accident qui fit mourir sans raison une liaison déjà ancienne, ainsi que des gens s'avisent de mourir subitement (on dit), sans préavis organique.
En quel pays pouvais-je bien être quand elle décida de ne plus jouer avec moi ? Quand je l'imagine dans sa vie présente, je me figure assez bien son personnage ; elle a tellement appelé, désiré, les certitudes matérielles ; elle les goûte énormément ; elle rayonne au centre d'un confort élargi et s'y prélasse un peu ; son regard dit à ceux qui entrent : « Comme vous tombez bien, tenez, le croiriez-vous ? c'est uniquement pour vous que nous avons tout disposé ainsi ; profitez-en beaucoup ; jouissez de tout ce qui est ici ; reposez-vous, soyez calmes, heureux, confiants, l'on vient ici pour être bien et je veux que tout le monde autour de moi soit bien. »
Et, tout naturellement, elle s'adapte au décor, aux partenaires ; elle sait d'instinct que pour celui-ci il faut être débordante de gaieté ; que, devant celui-là, il convient d'être grave et tendre ; inlassablement, jour après jour, elle se penche sur des visages qu'elle oublie l'instant d'après. Elle est la soeur, l'amie, la mère ; elle est la femme, et nous lui sommes aussi inlassablement reconnaissants.
Parfois, le matin, en musant au lit, sa pensée erre dans le passé. Elle revoit les jours difficiles, les chapeaux rares, les échéances tyranniques. Il lui faut se secouer énergiquement, car « il ne lui plaît pas » (9) de s'attarder en vains regrets dévorants, et il en est, des regrets, inévitables, un feu cuisant ; il y avait tant d'amour alors... tant de fragile bonheur si follement gaspillé... Mais vite, elle repousse ces pensées méchantes. Dans sa baignoire, elle met à se frotter, taffer, une activité, une ardeur de matelot briquant un pont de frégate un jour de visite-Amiral ; dans ses états nautiques, elle fait justice au destin, au compagnon, à elle. Après tout, on était jeune - on avait tout à apprendre. Et l'on a beaucoup appris.
On s'est bien un peu éraflé ici, déchiré là, ailleurs, on a perdu quelques plumes dans la lutte, mais enfin, le foyer est là, vivant, debout, le compagnon est là, Finet grandit, la roue tourne, il faut être raisonnable, c'est la vie...
Et puis Robert a dit : un tel à déjeuner. Il faut être belle... Il faut être... Cécile. Mieux cachés que des joyaux en période de révolution, dorment en son coeur quelques secrets. S'en occuper serait du temps perdu. Vivre, c'est penser chaque jour aux fleurs dans la maison, aux joies de Robert, à la santé de Finet. Aussi, mi-contrôlée, mi-inconsciente, elle obéit aux lois des temps présents ; avec les éléments assez riches dont elle dispose, je suis certaine qu'elle fabrique pour un maximum d'individus, le maximum de confort.
Un jour, je serai morte. Robert lui dira mon dernier adieu, lui transmettra mon dernier message : « Je te bénis et te remercie, Cécile, d'avoir suscité ma tendresse et rendu orphelines mes enfances attardées. Les aspects de ta personnalité me sont autant de paysages chers. Oublie mes fautes, je voudrais immortaliser ta meilleure qualité : Femme. » (10)


Cécile Brusson-Denoël en 1934 et en 1935 (sur scène dans Les Cenci)
1. Cécile et Robert Denoël ont habité, d'octobre 1927 à mai 1929, au 51 bis de la rue du Moulin Vert, dans le XIIIe arrondissement. Champigny ne fut pas seule à subir les humeurs fantasques de la jeune femme ; en mai 1928, Robert écrivait : « elle ignore la mesure : ou bien ce sont des débordements d’amour et de tendresse ou bien des colères noires et qui durent. » D'autre part Cécile soupçonnait Champigny, qui était encore fort attirante, d'avoir été la maîtresse de son mari.
2. Les Denoël ont occupé l'appartement attenant à la Librairie des Trois Magots de juin 1929 à octobre 1930.
3. Bernard Steele a occupé jusqu'en 1940 une villa qu'il avait acquise en 1932 à Montmorency.
4. Raphaël Chanterou [Liège 1888 - Bruxelles 1945] est le pseudonyme de Gabriel Dubois, un ancien élève de l'Académie de Liège qui, entre 1912 et 1927, exposa à Paris, et y fit amitié avec de nombreux artistes, dont Modigliani. Il ne s'agit pas d'une amitié de jeunesse : Denoël l'a rencontré en décembre 1926 à la Galerie Champigny. La « bande à Chanterou » était composée de Belges : les frères Crommelynck (l'un peintre, l'autre dramaturge), l'écrivain anversois Horace Van Offel [1876-1944], le libraire George Houyoux [1901-1971], chez qui Denoël avait travaillé en octobre 1926, un homme d'affaires nommé Bultès... Il semble que ce petit monde se livrait à un commerce d'oeuvres d'art douteuses : en 1932 Chanterou fut confondu comme faussaire.
5. Jacques Collet [1900-1959] fit des études de médecine à l'université de Liège, où il rencontra Denoël dès 1920. Les deux jeunes gens sympathisèrent, passèrent en 1926 des vacances en Ardenne, et Denoël lui dédia la même année une nouvelle : « Un Homme de circonstances ». L'année suivante ils se revirent à Paris : « Mon ami Collet, qui vient de se marier, a passé 15 jours chez moi avec sa femme », écrit-il en novembre 1927 à Victor Moremans. Deux ans plus tard, le docteur Jacques Collet s'expatria au Rwanda, où il mourut en 1959.
6. [Ajout interlinéaire : ] « Mais je l'ai dit à Robert maintenant. Il a ri, d'un rire qui m'assure qu'il va la combler en rentrant. » Le journal de Champigny rend crédible l'histoire de la vente des bijoux de Cécile en 1929, pour payer le tirage de « L'Hôtel du Nord ».
7. Rue Charles Floquet, où les Denoël habitèrent entre 1933 et 1939.Billy Fallon est le demi-frère de Cécile, Bamby le surnom d'Aloÿs Bataillard, le gérant de la Librairie des Trois Magots, et Charles-Albert Cingria, l'écrivain suisse dont Bataillard voulait publier les écrits.
8. C'est le nom du paquebot qui, en mars 1936, emmena Champigny de Marseille vers la Nouvelle Calédonie. .
9. Cette tournure typiquement liégeoise (qui signifie : je n'ai pas envie)
a frappé Champigny, qui la rappelle à plusieurs reprises.
10. Je ne crois pas qu'il existe ailleurs un portrait aussi sincère de Cécile Denoël.
Celui-ci est d'autant plus attachant qu'il n'a pas été écrit pour la publication - tout au moins, du vivant de l'auteur.
Dimanche 17 H 30 et le 15 février 1943. J'ouvre ce cahier juste pour essayer le stylo dur, mais demain j'irai voir si le Watterman est encore à vendre. Robert me l'offre. Avec un stylo et des lunettes, voilà de bonnes heures d'assurées. Il faut dire que celui-ci s'apprivoisera peut-être par la suite. Momentanément il est offensant de dureté, il servira pour écrire des n'importe quoi. L'autre sera pour les cahiers.
Robert est venu passer un court instant. Il m'a lu (après mes pages précédentes) une lettre de Cécile. Combien je voudrais que ma pensée lui soit perceptible ; quel réconfort elle aurait en ce moment de crise (1). Hier soir, nous avons dîné chez Mativet avec Marianne et Jean Brunel. Grâce au [le nom d'un médicament], je ne souffrais pas ; j'étais gaie, très contente. Ce soir, j'attends [un nom illisible], demain Caillard. Mais bientôt je reprendrai l'existence mézelloise solitaire.
1. Le couple Denoël va mal : Robert a noué depuis juin 1942 une liaison amoureuse avec Dominique Rolin, et s'apprête à en nouer une autre, bien plus dangereuse, avec Jeanne Loviton, qu'il a rencontrée à Auteuil en janvier 1943.
Nuit du 25 au 26/2/43. Je me vois agitée, malgré moi. Toujours l'histoire du procès du Lot. Les complications d'un départ nécessaire, puis différé, redevenu urgent, puis impossible ! etc. En somme, l'image même de la vie moderne : des efforts pour rien, du courage dans le vide ; de la fatigue sans résultat. Maintenant, il semble que tout soit ainsi fixé. Mes papiers sont en règle. Je dois partir le 3 mars (Inch' Allah !) Je suis si lasse, si brisée, que je ne puis rien écrire d'autre. [...] Qu'écrirais-je qui vaille ! La besogne de vivre pour les gens de mon espèce est déjà assez âpre besogne. Ne forçons point notre talent... [...] Et l'Europe achève de croller. C'est tout. (1)
1. [ Ajout marginal : ] C'est tout. Mais Robert verra que je m'efforçais de vivre, un jour où la douleur m'avait obligée à 3 piqûres d'opium, plus un phanodorme [barbiturique indiqué pour les troubles du sommeil]. Et je veille, je veille...
Le samedi soir, 27 février [1943]. Quel triste moment que celui-ci. La conversation languit. C'est un peu comme sur le quai d'une gare. Le départ choisi et réalisé avant que les apparences aient pleinement conscience des courants qui différencient les vies, fétus de paille dansant au faîte d'une goutte d'écume puis sous le tourbillon. L'on est ensemble encore, sans y être néanmoins tout entier présent.
Puis l'un des deux se lève, dit : je dois vite partir, chérie. Alors, en cet instant, quand j'embrasse Robert, un désespoir sans appel me casse de chagrin silencieux. Ah ! que de départs en une seule vie, d'arrachements, de séparations. Des heures s'écoulent au cours desquelles se forme la résolution de faire porter à « l'Amélie » le panneau de bois peint par Loutreuil (1). Robert le trouvera retour de là-bas, encore tout imprégné de D. et comme dénudé de sa présence.
1. Dans un « cahier brun » rédigé en 1946, Champigny écrit : « Avant de quitter Paris, je lui offris en échange - encore qu'il s'en défendît très fort, mais j'y tins - la pochade sur panneau de bois par Loutreuil représentant une vieille femme que j'aurais pu devenir (mais j'ai vieilli autrement !) faite en 1924, je crois, au Pré St Gervais. » En échange de ses procédés généreux : Denoël a payé tous les frais de séjour de Champigny au grand hôtel Leveque, et sans doute, celui de l'appartement qu'elle occupe alors rue de Grenelle. Il est sur le point de faire une escapade à Bruxelles pour y rencontrer « D », c'est-à-dire Dominique Rolin.
5 mars 1943. Au lit, dans la chambre jaune à Mézels. Malgré la fatigue du voyage, celle surtout qui précède le départ, j'étais contente au point d'être presque bien. Il n'y a que Mézels, son absolu, son divin silence, qui me procure des sensations d'une plénitude aussi dense. Je me remémorais tout ce que la méchanceté a produit contre ma vie depuis 7 mois. Je n'avais pas moins de peine mais déjà je voyais plus sereinement. Je sais à quoi m'expose l'injustice. Je suis résolue à me tuer pour m'y soustraire après avoir lutté des mois et enduré d'énormes épreuves corporelles pour tenter d'aller mieux. Mais de toutes façons, je préfère attendre les décisions de Gourdon ici plutôt qu'à Paris.
Elle est enfin dépassée, la journée du 16 mars 1943. Voici 1 H ¼ du 17. Il faudrait que je puisse raconter le cauchemar des derniers jours, l'étouffante panique des dernières nuits, et enfin, l'abjection de ce jour-ci. Mais après des heures d'effort de tous genres, des nuits sans un instant d'assoupissement, me voici incapable de narrer l'ignominie poussée par moment au grotesque. Je n'ouvre ce cahier que pour bénir les puissances illimitées qui m'aidèrent. Je serai sans doute condamnée dans trois semaines, ce sera peu en regard de ce que j'encourais. Ce soir, en revenant de Gourdon, l'ignoble petit facteur a déposé une belle, bonne, douce, admirable lettre de Robert. Joie ! (1)
1. [ Note marginale : ] A Gourdon, j'eus ma revanche en juin 44 - Résistance.
[2 avril 1943]. Pourquoi Robert ne vient-il pas me voir ? Je ne le lui demanderai pas. Je sais qu'il est occupé. Je sais aussi que ce serait pour lui une étrange détente. Je voudrais tellement être un peu avec lui ici. Devant lui seul j'ose être moi. Avec lui seul je puis être tendre. Je ne peux plus avoir de tendresse pour personne. Je me durcis, je me raidis. L'on m'a fait trop mal. L'on m'a trop menti - trop abandonnée, repoussée ou mal comprise, selon les êtres. Mais surtout, presque tous m'ont sous-estimée. J'apportais tant d'humanité vraie dans mes rapports affectifs. Moralement je ne prétendais pas à ce que l'on fît de moi un cas énorme. J'avais dignement conscience pourtant de ce que j'étais, très exactement, et partant, de ce que j'apportais à chacun. Méconnaissance ou mépris, incompréhension, indifférence, cela revient au même. J'ai souffert des années pour quelques êtres ; je faisais trop de cas d'eux. Puis la sagesse vint. Le renoncement.
Il n'y a personne au monde depuis onze ans avec qui j'ai vécu « intimement ». L'intimité est rayée de mes usages. L'on se méprend parce que je suis si aisément familière en surface. Tandis qu'avec Robert je suis franchement intime. Que je suis sotte de noter cela. Je pourrais aussi bien le dire à Doudou. Je n'entamais ce 2 avril 1943 cette page que pour exprimer mon désir, acéré par la beauté du paysage ; tous les arbres sont en fleurs dans la vallée, mon émotion joyeuse, mon « élan papillon » ont cristallisé mon désir : je voudrais que Robert vienne me voir.
C'est la nuit du 5 au 6 avril 1943. J'ai écouté la radio quelques minutes. J'ai entendu les chiffres qui concernaient les bombardements. Comment les foules supportent-elles tous ces chocs sans achever de perdre la raison. 133 forteresses volantes sur Billancourt, au-dessus des usines Renault (1). Ce devait être assourdissant. Je n'ai pas eu la chance d'assister à un seul bombardement. La pitié est une chose, la curiosité une autre. J'aurais voulu voir une fois comment c'était.
1. L'aviation américaine a pilonné « à l'aveugle » les usines Renault le 4 avril 1943, causant la mort de 327 personnes, et en blessant plus de neuf cents autres.
Nuit du 8 au 9 avril [1943]. Si j'avais mon carnet journalier, je pourrais y noter pourquoi, comment la soirée du 8 avril fut si intéressante. Il n'est pas arrivé, bloqué qui sait où avec les livres qui devaient quitter Paris en même temps que moi. Ce récit ne peut s'inscrire en ce cahier-ci.
9/4/43, 24 h 35. Il est passé tant d'avions au cours de cette journée, qu'avec la nuit le silence étonne. Ce que les paysans peuvent dire de bêtises sur ce sujet est à devenir enragé. Le peuple de chez nous est atrocement désespérant. Comment savoir s'il fut jamais mieux ? Si oui, pourquoi il a régressé à ce point. J'en viens par moments à désirer qu'il arrive quelque accident par ici, n'importe quoi ; un événement qui les sortirait de leur torpeur égoïste, remuerait leur épaisse crasse mentale, mais au fond, je désespère tant de cette race abâtardie !
Sans doute il pourrait se dérouler des incidents prodigieux, passionnants, angoissants. Ils ne verraient, n'éprouveraient, ne comprendraient rien. Leur matérialisme est aussi sordide qu'absolu. De tout temps le paysan a aimé l'argent. Depuis juin 1940, le paysan français passé spéculateur, enrichi par le marché noir, a perdu jusqu'au souvenir de ce qu'étaient la dignité, l'honneur et quelques autres solides vertus morales. [...]
En conscience, si l'on connaît vraiment bien le peuple, donc le fond de la nation (car un pays, pour être un grand pays, ne doit pas seulement être un ensemble de paysages variés dans lesquels triomphent selon les régions, des modes de culture ou d'industries), il faut tristement s'avouer, timidement convenir que la France actuelle en tant que peuple, élément vivant, ne mérite pas du tout une place de premier plan. Il y a 150 ans que ce pays laisse les commandes, non aux juifs, ainsi qu'il fut tant rabâché, mais aux épiciers enrichis.
Il y a 150 ans que le bourgeois non gentilhomme règne en bon sournois. Quand le peuple était dominé par l'aristocratie, il recueillait, je suppose, de-ci de-là, parmi les spectacles, des enseignements, certains exemples, voire les miettes de précieuses traditions. Sous le règne de l'épicier, le peuple, qui a bien senti qu'il n'y avait en vérité, entre cette classe et lui, qu'une seule réelle différence : le compte en banque, a oublié tout le reste, centré toutes ses facultés agissantes sur l'obtention dans le plus bref délai d'une fortune qui le mettrait au rang des bourgeois enviés.
Ce n'est pas difficile. Nulle probité n'est nécessaire. Au contraire, les probités seraient autant d'obstacles. Ce qu'il faut c'est de l'argent, de l'argent toujours, encore de l'argent. L'argent égalise. Les nez pincés deviennent narines dilatées dès que le pauvre hère vertueux (genre Topaze) acquiert l'immeuble, les chevaux de course, ou le bateau, dont la possession font de lui un homme « bien » ! Classé, jugé digne désormais de s'asseoir à la table du bourgeois enrichi 10 ou 20 ans auparavant avec la même facilité de moyens, la même absence de scrupules.
Les valeurs vraies étaient si peu respectées en France que des savants ne purent aller au bout de leurs expériences, mettre au point leurs recherches, des artistes de génie sont morts dans une misère dont leurs contemporains devraient mourir de honte, dans le même temps où le soyeux, le charbonnier, le roi de l'alimentation ou de la quincaillerie, étaient en mesure de subventionner la production de Snobinard Ier du nom, pour exhiber à longueur de bandes un film affriolant sur les cuisses de zizi-panpan.
Un grand pays ? Une nation de premier plan ? Quand aucun secours médical utile n'existe dans les campagnes - pas plus que la surveillance, l'assistance, etc - des campagnes où nul moniteur de gymnastique ne passe, fût-ce une fois l'an, pour stimuler la jeunesse adolescente - où nulle loi ne décrète que tout enfant de pays riverain devra apprendre à nager - où les programmes des écoles ne comportent la plus petite place pour l'enseignement de la plus rudimentaire propreté.
Le régime politique de 1848 à 1918 favorisait déjà peu l'essor humain. La vague d'arrivisme de 1918 à 1940 toléra les tentatives des formes de génie pratique. Une place énorme fut accordée aux manifestations de l'intelligence qui servaient l'ère du mécanisme. Pensée pure, philosophie, poésie, spiritualité, loin d'être recherchées, soutenues, durent se dissimuler, humblement. Depuis 1940... ce que le pays comptait de meilleures valeurs dans tous les domaines, a dû fuir, s'est vu traquer. (1)
1. Cette charge véhémente clôture le premier « Cahier brun » à la date du 10 avril 1943.
[Cahier brun n° 2] C'est maintenant la nuit du 31 janvier au 1er février 1944. En décembre, j'ai lu cinq fois de suite Le Pèlerinage aux sources de Lanza del Vasto (1). Merveilleuse et si enviable expérience. J'aurais voulu rencontrer cet homme, discuter avec lui des points de doctrine qui me passionnent, d'autres qui par brèves secondes me révoltent. Ainsi de dire qu'il faut pour affronter l'expérience spirituelle, avant tout une forte constitution, ce bien précieux : la santé. Or, de ce corps magnifique, que font les saints, les yogis, les ascètes ? Ils le réduisent par successives tortures à une sorte d'anéantissement.
C'est précisément alors qu'ils sont dans la voie. Pourquoi n'ont-ils étudié le processus inverse de celui de leur discipline. Eux partent, esprit mystique dans un corps sain, à la recherche de Dieu, de l'extase, à la seconde de « l'identité ». Je suis allée, mystique de nature au fond, athée, de la saine jeunesse active à l'infirmité, au lieu de volontaires exercices respiratoires, de jeûnes, de tortures contorsionnelles, j'ai vécu mon expérience spirituelle au travers de la discipline tragique de l'irrémédiable infirmité.
A gravir des nuits ainsi qu'autant d'obstacles, années après années, j'ai suivi d'étranges cheminements entre le premier choc cérébral du printemps 1927 aux mois de l'hiver 1943/1944, durant lesquels parfois je crus que mon cerveau se liquéfiait. Je me suis souvent perdue. J'ai aspiré de rencontrer un maître.
1. Publié par Robert Denoël, l'ouvrage est sorti de presse en décembre 1943.


Champigny et sa chienne Doudou à Vichy en 1936 et à Nice en 1943
Soir du 16 février 1944. [...] Depuis, je suis comme privée d'âme, de vie. Tu as tout emporté (1). Depuis 15 ans j'ai tant souffert. Depuis dix ans j'ai vécu de tels repliements, expérimenté une tant inhumaine solitude que sans toi je n'aurais jamais supportée - non, jamais. Tu fus ma seule raison d'être, mon unique source de courage - Ah ! les amis !!! quand je pense qu'ils pensent, qu'ils osent se targuer d'amitié - celui que je juge le plus sévèrement ce soir quand j'écris à tous, bien que ne parlant qu'à toi, mon chien doux, ce qui sera mon adieu, c'est Christian Caillard.
Lui qui fut, en de lointaines années de jeunesse un intime compagnon aimé, lui que je considérai des années comme le meilleur, le plus sûr de mes amis, bien que je me heurtasse sans trêve à ses égoïsmes sans merci - lui qui, depuis dix ans (les années qui représentent justement la somme de ma solitude totale) a toujours considéré qu'il était « hautement » mon ami, qu'il agissait avec une sans pareille « noblesse d'âme » en m'écrivant quatre fois l'an, en me voyant une fois en quatre ans !
Ne parlons même pas de Catherine qui habite à 8 kilomètres de ma maison, qui passe devant sans entrer, qui, depuis juin dernier, n'a jamais une fois demandé de mes nouvelles - huit mois pleins ! et elle ose m'écrire parce que tu n'es plus là - elle ose me parler de tendresse et Caillard d'amitié ! ils me font presque aussi honte que j'ai de mal. Qui (à part Robert depuis un an) s'est soucié (quand tous me savaient dans l'impossibilité de travailler, de gagner un sou) que je puisse vivre ? que je le veuille ou non - je le veux - mais j'aurais pu désirer vivre. L'égoïsme de « mon ami » Christian Caillard m'a rejetée dans les affres d'une pauvreté paralysante.
1. Sa chienne Doudou, que Champigny a dû faire euthanasier le 1er février 1944.
2. Champigny a vécu avec Christian Caillard entre 1922 et 1926, et avec Catherine Mengelle de 1928 à 1934.
Dimanche 19 mars 1944. J'ai décidé de monter à Paris, dimanche. Tout le monde pense gentiment que cela me distraira ! Quelle ironie. 51 Boulevard Lannes, 8ème étage. Deux semaines entières que je suis séparée de Doudou - assez malade depuis mon arrivée à Paris. J'ai revu des amis, tous gentils, et ceux qui m'hospitalisent, si bons, si dévoués, si compréhensifs.
Revu Robert, bien sûr ; moi, toujours pareille devant lui. Lui, plus distant que l'an dernier. Puis, j'habite si loin de son bureau (1), nos entrevues sont rares. J'ai fait la connaissance de Cuny (2), qui doit aux autres paraître si compliqué, qui est si attachant, si bouleversant, et quand il parle de Mézels, il dit « la maison du chien ».
Combien il est toujours passionnant d'approcher un être valable. Combien saisissant de voir l'aveuglement qui empêche les hommes de se connaître. Robert, qui est si intelligent, connaît Cuny depuis des années. Mais c'est le succès seul qui lui fit classer l'homme. Il me parle des années passées ; quand l'acteur, maintenant célèbre, alors inconnu, peignait, écrivait (3).
1. Près de quatre kilomètres séparent le boulevard Lannes de la rue Amélie. En l'absence de métro, c'est une distance qui compte, surtout pour Champigny, qui marche difficilement.
2. L'acteur Alain Cuny [1908-1994], qu'elle a rencontré grâce à leur ami commun René Barjavel.
3. Alain Cuny a en effet débuté par la peinture, mais en 1923-1925, alors que Denoël n'était pas encore à Paris. En revanche, le futur acteur s'intéressa à partir de 1926 à l'écriture et en particulier au surréalisme, et se lia avec Antonin Artaud et Roger Vitrac, deux écrivains publiés par Denoël en 1929.
Nuit du 29 au 30 mars [1944], souvenir des nuits de janvier. Les dernières avec mon ange gardien. Aujourd'hui j'ai déjeuné avec Cuny. Ensuite vu Robert (1). L'un des deux s'est-il douté de cette déroute de mon âme ? Oh ! j'en ose à peine écrire et mon corps est aussi las que mon esprit.
1. Champigny a regagné Mézels le lendemain. C'était, apparemment, sa dernière rencontre avec Denoël.
17 avril 1944, de la chambre jaune face à la vallée, dans la maison du chien. Souvenir pour Cécile. (L'homme de ville sortant de table ou : manuscrit trouvé dans un pâté).
« Souris à mon projet et protège mes vers
Qu'ils soient dignes de toi comme de l'univers,
Je vais, dans mon ardeur poétique et divine,
Mettre au rang des beaux-arts celui de la cuisine. » (1)
1. Dans le Cahier précédent, à la date du 14 février 1943, Champigny fait, sur plusieurs pages, l'éloge des talents culinaires de Cécile Denoël.
19 avril [1944]. J'avais grande envie ces derniers jours d'écrire longuement à Robert. Mais au cours de mon bref dernier voyage, j'ai tellement pris conscience de l'état de demie folie dans lequel se trouvent les esprits les mieux équilibrés que je n'ai pas donné suite à mon projet. C'est sans doute parce qu'il est si fort changé en lui que j'eus la sensation, très pénible sur le moment, qu'il avait une fois encore changé avec moi. Il avait cette sorte de réticence que j'avais enregistrée lors de mon retour d'Extrême-Orient.
C'est si faible, un homme. Les plus intelligents manquent de psychologie à un point incroyable. Les plus fidèles, capables de durables amitiés, subissent, sans naturellement s'en rendre compte, des courants d'influences adverses qui modifient l'expression de l'amitié, sinon le sentiment dans sa profondeur. Je sais si bien celles qu'a subies Robert en 1943, 1944 (1).
Autrefois, je me serais laissée aller à la faiblesse dérisoire de le lui signaler. Car il s'est trahi autant de fois que nous nous sommes vus.
Il est, comme tous ceux qui furent et les rares qui restent mes amis, excusable d'errer. Même quand la vie était (je parle de la vie sociale) douce et facile, les individus vivaient trop repliés mentalement sur leurs propres problèmes, absorbés par leurs activités personnelles, pour accorder à autrui cette observation attentive nécessaire pour suivre et comprendre l'évolution d'un autre esprit, fût-ce, ainsi que c'est le cas entre lui et moi, facilitée par une nature spontanée, franche, sans dissimulation.
En novembre 1943, j'avais déjà ressenti une stupéfaction sans borne. Je faillis alors aussi écrire à Robert pour essayer de mettre certains détails au clair. Nous venions d'échanger quelques lettres à propos du peintre Loutreuil, plus exactement il avait hâtivement répondu à celles dans lesquelles je lui détaillais minutieusement pour quelles raisons je croyais n'être point injuste en éprouvant des griefs assez amers (je devrais dire : une amertume émaillée de griefs) envers l'attitude prise depuis 1937 par le peintre Caillard devant le problème « Loutreuil - Champigny », puisque, il faut bien le dire, il y a un problème dégénéré en conflit : Il me semblait que Robert savait tout. Certes, il ne m'avait connu que deux ans après la mort de Loutreuil, mais il avait entendu tant de récits, que je le croyais, ma parole, aussi fixé que moi-même sur la question (2).
1. Champigny fait allusion à des influences féminines (qu'elle détaille plus loin) et notamment à celle de Catherine Mengelle, son ancienne compagne, coupable à ses yeux d'avoir en 1943 enjôlé Denoël qui, croit-elle, l'entretient pécuniairement. Mais elle parle aussi de 1944, alors qu'il entretient une liaison avec une autre femme, beaucoup plus redoutable : Jeanne Loviton.
2. [ Ajout interlinéaire :] Surtout il avait connu, en sa fin, l'effort tenté pour révéler Loutreuil au public. Les échanges Champigny-Denoël concernant Maurice Loutreuil et son ayant droit Christian Caillard me sont inconnus. Loutreuil est mort le 21 janvier 1925. Denoël a rencontré Champigny le 6 novembre 1926. Le conflit Champigny-Caillard est détaillé plus loin.


Christian Caillard [1899-1985] et Eugène Dabit [1898-1936] au cours des années 1930
Elle se résume ainsi : j'ai vécu avec Caillard du début de 1922 à la fin de 1926. Le poisson dans l'eau, l'oiseau dans l'air, ne sont plus à l'aise dans leurs éléments que je ne l'étais dans ma modeste vie de travail. Christian Caillard avait préparé Normale. Il revenait de Wiesbaden où il avait fait son service dans l'armée d'occupation. Il vivait chez ses parents et possédait, à Belleville (qui sait pourquoi à Belleville ?) un petit atelier. Là, dans un sobre et modeste décor, il peignait des femmes éléphantiasiques car il avait résolu de « se consacrer à la peinture ».
Nous décidâmes, le 1er mai 1922, de vivre en commun. Ce qu'acceptèrent ses parents, sans toutefois lui apporter une autre aide matérielle que l'invitation à dîner chez eux tous les mardis et jeudis. C'était peu. La fortune personnelle de Caillard devait alors se chiffrer à cinq cents francs gagnés en exécutant des panneaux décoratifs pour une exposition marseillaise qui venait d'avoir lieu.
Je fus assez tempérée, quand je compris au bout d'une quinzaine de jours que nous ne pouvions vivre à deux sur l'unique gain de mon travail de secrétariat ; et que lui ne pouvait rien gagner, puisque tout peintre moderne considère comme un déshonneur tout travail réalisé autrement que par le pinceau ! Je l'aimais. Probablement frigide, en tout cas plus passionnée sentimentalement que mue par les sens, je n'avais pas cédé à l'attraction d'un désir irrésistible. Ma vie, en regard de mon âge, 27 ans, était assez joliment meublée de souvenirs amoureux.
J'avais aimé Trajan l'exquis, Gama l'impeccable, Adam le fier, et je sortais, assez meurtrie, d'une brève liaison avec Joë dont j'avais cru aimer l'amour. Joë était si brutal, si matérialiste, que je crus en rencontrant Caillard avoir fait la découverte essentielle de ma vie. Je le crus longtemps. Les femmes sont si sottes. Tout avait commencé, entre Caillard et moi, par un échange d'idées. Une union basée sur une similitude des idées me parut alors non seulement une vérité, mais la Vérité.
Comme nous n'étions guère en âge de ne nous nourrir que de conversations, j'eus tôt fait de saisir quels dangers menaçaient ce fragile bonheur. Tôt fait aussi de décider et dire que, si même je gagnais assez pour deux, il serait immoral que nous vécussions à deux sur mon gain personnel, point de vue que le partenaire partageait pleinement sans toutefois risquer une seule recherche capable d'entraîner sa participation matérielle.
Mes premières propositions furent accueillies avec des railleries dont je ressens encore à distance l'acidité dissolvante. C'est qu'en fait nous n'étions deux qu'apparemment. En vérité, nous étions tragiquement trois. Le mot n'est pas trop gros. Je ne saurais le remplacer. Et cette phrase m'éclaire (ou me rappelle, ce qui est tout un) pourquoi Caillard, parisien pur sang, montmartrois (1), occupait à Belleville un hideux atelier industriel en un temps où la Butte offrait d'innombrables ressources aux artistes.
C'est que Dabit, Dabit inconnu (et pour cause), l'Eugène Dabit de L'Hôtel du Nord, celui qui devait, peu d'années après, ramper aux genoux des maîtres de la littérature, Dabit, qui haïssait tout ce qui était peuple, qui saignait d'être né dans le peuple, Dabit le « futur pote » de monsieur Louis-Ferdinand Céline, avait, en raison sans doute de la modicité du loyer, loué un atelier rue des Mignottes. Je précise, au 6, pour la plaque commémorative promise au littérateur populiste ! (2)
Caillard avait connu Dabit dans une petite académie montmartroise dont j'oublie le nom. Dabit y était massier (3). Une amitié qui dura longtemps était vite née entre les deux génies en herbe. Caillard aimait en Dabit des qualités qui étaient véritables, d'autres qui n'étaient que feintes.
Jusqu'à ce qu'il connût Loutreuil, Caillard vécut sous l'influence de Dabit. Elle était pernicieuse, corrosive ; mais Caillard était alors d'une inexpérience si absolue, il apportait tant d'enthousiasme, de ferveur, de pureté, de bonne foi, que rien ne lui permettait de voir, de juger, de pressentir une seule des failles qu'au premier coup d'oeil je discernai, m'attirant d'un coup une haine implacable. Dabit m'en entoura, si je puis dire, jusqu'à sa mort. Nulle Jenny ne soigna son géranium ou son rosier aussi bien que Dabit entretint l'aversion qu'il nourrissait pour ma personne. Ce qu'il aimait, ce qu'il prisait en Caillard, lui, c'est ce qui lui manquait si fort : la distinction noble inhérente à certains bourgeois mieux dotés d'ancêtres intéressants que de titres de rentes.
Pour Dabit, les qualités intrinsèques de Caillard comptaient peu. Ce qui le flattait jusqu'à la délectation, c'était que Christian fût l'arrière petit-fils d'Alfred de Vigny, le petit-fils de Catulle Mendès et d'Augusta Holmès, le neveu d'Henri Barbusse (4). L'intimité entre Caillard et Dabit était de tous les instants. Dabit a raconté tout au long dans ses livres son histoire à demi sincère. Sa sensibilité d'adolescent avait atrocement souffert lorsque sa mère, très pauvre, avait de loin suivi les armées, employée comme plongeuse et bonne à tout faire chez l'oncle riche, celui de Villa Oasis, qui, en plus d'un bordel à Paris, possédait un de ces bordels volants nommés, je crois, « B.M.C. » (5).
1. Christian Caillard est né le 26 juillet 1899 à Clichy.
2. Cette adresse n'est pas attestée dans les biographies d'Eugène Dabit. Le 6 rue des Mignottes à Belleville est aujourd'hui occupé par un immeuble de deux étages construit en 1956. L'atelier dont parle Champigny a sans doute été rasé après la guerre.
3. L'Académie Biloul, du nom de son fondateur, le peintre Louis-François Biloul [1874-1947], était située à Montmartre. Dabit et Caillard s'y étaient rencontrés en 1921. Dans les écoles d'art le massier est « un élève élu par ses condisciples pour les représenter et pour assurer diverses tâches, notamment gérer les finances communes de la classe ou de l’atelier ».
4. La mémoire de Champigny est sans faille. La musicienne Augusta Holmès [1847-1903] était, officiellement, la filleule de Vigny, mais plus probablement sa fille naturelle. De la liaison qu'elle entretint plus tard avec Catulle Mendès [1841-1909], naquirent cinq enfants dont Hélyonne [1879-1955], qui devint l'épouse de Barbusse.
5. C'est en effet l'abréviation de « bordel militaire de campagne ». L'oncle de Dabit s'appelait Emile Hildenfinger et il tenait bien un bordel rue Montyon, dans le IXe arrondissement. C'est lui qui, en 1923, accorda un prêt aux parents de Dabit pour acquérir l'Hôtel du Nord, quai de Jemmapes. Villa Oasis ou les faux bourgeois, son deuxième roman, est paru en 1932 chez Gallimard.
Quand elle n'était, aux faubourgs de la ville, que femme de ménage, et le père livreur (1), Eugène saignait déjà dans ses orgueils enfantins. A l'âge des premiers troubles, des premiers rêves, ce lui fut un martyre de voir sa mère (qu'il aimait sincèrement, dont il raillait finement les grotesques, envers laquelle il se conduisit toujours très bien) évoluer parmi les pensionnaires de Monsieur « Oasis ». Il assista à assez de scènes crues pour offenser un jeune esprit pur. Le dégoût qu'il en ressentit le marqua assez violemment pour le dériver de la norme, l'écarter des femmes, le rendre, pour des années, quasi impuissant, et pour toujours tourmenté, destructeur.
Il y avait en lui, inanalysé alors, inconscient je crois, un côté pédéraste refoulé qui trouvait son compte et sa joie dans une amitié masculine pour un homme de son âge, qui, aux mérites énumérés ci-dessus, joignait une beauté peu commune. Aussi, dès le début de notre union, trouvais-je en Dabit un ennemi. Il avait l'art subtil d'influencer Caillard en le flattant. Comme il vivait sans amie, sans amours, il ne se lassait pas de démontrer à Caillard les nécessités de la solitude pour peindre.
Chaque jour il allait à l'Académie Grande Chaumière (2). Caillard aussi. Ensuite, le Louvre ou les galeries absorbaient leur temps ; de retour à Belleville, à moins qu'il n'eût à peindre dans son atelier, Dabit était dans le nôtre ; je trouvais naturel, bien sûr, qu'il y partageât nos modestes repas, et ceux, plus consistants, des jours à rôti où je le conviais moi-même à partager le « veau de l'amitié ».
Bien souvent il arrivait que Dabit décide d'aller voir une pièce, un film, entendre un concert. J'affirmais n'avoir envie de rien, être obligée de rester travailler afin que Caillard pût l'y accompagner car j'étais soudain, par amour, devenue horriblement économe... Il n'y avait donc de distractions que pour eux, de véritable détente, d'intimité, qu'entre eux. Il était, sauf les nuits fort courtes (si longues étaient mes journées de travailleuse), toujours entre nous. Il jouissait de toute sa liberté. Ses parents lui assuraient le gîte et la table. Un ménage bordelais (l'homme et la femme tous deux épris en leur maturité de sa jeunesse) qui l'avait adopté pendant la guerre, lui assurait une rente qui couvrait les frais de peinture, les petits voyages, les achats de livres, les soirées divertissantes.
1. En 1898, son père était bandagiste et sa mère éventailleuse, selon l'acte de naissance de l'écrivain. Pourtant Champigny paraît sûre de ses sources : le ménage Dabit-Hildenfinger a dû ensuite faire de mauvaises affaires.
2. Cette académie de peinture fondée en 1904 et située à Montparnasse avait une tout autre renommée que celle de Biloul : la plupart des grands peintres du XXe siècle y furent inscrits.
En sorte que, lorsque animée d'une belle vaillance, je proposai à Caillard de monter une entreprise de décoration, j'eus à vaincre, en plus de ses propres répugnances, les sarcasmes de Dabit. Néanmoins, il fallait vivre, pour une fois, je ne cédai pas, mais nos premières [mot illisible] avec Caillard naquirent au cours des premières discussions d'organisation. Quand je les eus convaincus qu'en sacrifiant chaque jour quelques unes de leurs précieuses heures, ils pouvaient gagner assez pour « aller un jour à Florence », ils m'accordèrent d'ébaucher quelques modèles variés, en rechignant, avec mauvais goût, et l'association prit un nom, c'était nécessaire.
« C & D » fut choisi ; qui voulait dire Caillard et Dabit car de moi, bien entendu, il n'était pas question ! Je ne m'étais jamais occupée de rien de ce genre ; j'étais novice en tout pour ce qui concernait la fabrication ; quant à l'idée de vendre, c'était ce qui me terrassait ; m'en aller de porte en porte proposer les productions de la Maison « C & D » me donnait des suées, des nausées ; je suis née avec une horreur du commerce dont je n'ai rencontré un seul autre cas aussi aigu et marqué. Je devais pourvoir à tout. Ces messieurs faisaient les modèles - humble tâcheronne, j'exécutais ; en plus je me rendais à toutes les adresses fournies par les relations bienveillantes, subir des rebuffades, piétiner en attente de décrocher quelques commandes. Une maison de décoration faisait une nouveauté : le batik. Je lus ce que je pus trouver sur les procédés javanais. J'appris toute seule à cirer, teindre, décorer des étoffes (1).
Mon vestiaire, bien qu'assez modeste, comportait un petit trousseau de linge de soie. Je réduisis en bandes mes chemises et mes combinaisons pour faire seule, en cachette, mes premières expériences, bien que ne sachant peindre ni dessiner. Le tout était de bien mettre au point la technique du métier. J'y parvins vite, sans aide et sans conseils ; j'avais acheté dans un bazar bellevillois une série de pots de terre, taille grand pot au feu, pour 85 centimes pièce (heureux temps !) qui représentaient mes « cuves » à teinture.
Lorsque les deux amis virent ce que j'avais obtenu à force de courage et de ténacité, ils consentirent enfin à se mettre sérieusement au travail. Grâce à un camarade d'enfance qui nous aida toujours en toute circonstance, André Boss-Colvert, nous eûmes des métrages de soie « commandés ferme » qui représentèrent la première collection de l'entreprise « C & D ». Les commandes affluèrent, nombreuses. Au point qu'il nous fallut bientôt disposer d'un atelier et d'un matériel supplémentaires, et engager pour travailler avec nous d'autres peintres et dessinateurs.


Champigny à l'époque « batik » (1925) et Béatrice Appia en 1929
Entre-temps, Dabit était devenu amoureux de Béatrice Appia (2). Elle aussi travailla avec nous du temps du batik. Nos gains nous éblouissaient. Non seulement ils permettaient de vivre mais nous faisions déjà des économies. Quand les modélistes en avaient assez (et ils ne travaillaient jamais qu'une demi-journée, sauf pendant quelques mois où ils donnèrent tous 7 heures de présence à l'atelier), ils filaient à la campagne, peindre en Ile de France ou en Provence ; mes autres équipes exécutaient les commandes passées d'après leurs modèles.
Moi ?... je travaillais modestement 18 heures par jour, ma santé s'en ressentit ; je dus subir, dans les pires conditions, une première opération qui fut, avec une brève convalescence en Quercy, mon seul repos. Malgré tout il y eut bien des joies au cours de ce travail en commun, bien des rires et tellement d'espérances. A mesure que les gains croissaient, nous formions des projets de plus en plus vastes. Tous parlaient de leur avenir d'artiste. Mon complexe d'infériorité s'aggravait de jour en jour. Au milieu de tous ces génies si sûrs d'eux, je n'étais que la petite machine à travail, qui devait se trouver honorée de les servir. Ce que je faisais, et de mon mieux.
L'amertume désespérante que j'éprouvais en face d'eux à être sans don, sans valeur, telle qu'ils me voyaient, ne me salit jamais d'aucune jalousie. J'acceptai humblement, tout en en souffrant au-delà de toute expression, d'être reléguée au rang subalterne des travailleurs manuels, tandis qu'ils évoluaient dans les sphères supérieures réservées aux élus. Je n'étais là que pour les servir. J'organisai donc une exposition pour mettre leurs jeunes talents en vedette. Elle eut lieu dans une salle de la rue La Boétie. J'en ai oublié le nom (3).
Nous n'y fîmes pas un sou de bénéfice et j'avais travaillé triple mais le but essentiel était atteint. L'on avait parlé d'eux. Un petit remous de relations, de compliments flatteurs, s'était produit autour de leurs noms et je dois dire que, dès alors, ils avaient déjà tous cet effréné besoin d'entendre parler d'eux. J'avais bien ravagé ma jeunesse, bien abîmé ma santé quand l'entreprise battit son plein et commença à rapporter d'une façon réellement intéressante. Encore quelques mois ainsi et nous pourrions abandonner la décoration ; ils pourraient se consacrer uniquement à la grande affaire de leur vie, la peinture; je pourrais, de mon côté, lasse de la ville, réaliser un projet cher à mon coeur, acheter une maison à la campagne, en faire une pension spécialement destinée aux artistes et organisée pour eux.
Mais le ciel dispose... Caillard, rentrant de l'Académie, rencontrait souvent dans le métro un homme taciturne qu'il avait vu dessiner à la Grande Chaumière. Les dessins (et là est l'énorme mérite de Caillard) lui avaient paru remarquables. L'homme habitait au bas de la rue du Pré St Gervais, à deux pas de chez nous. Un soir, Caillard osa l'aborder. L'homme, très sauvage, fut surpris. Heureux que ce jeune peintre eût remarqué son travail, il l'entraîna jusqu'à son atelier, lui montra ses peintures.
Une amitié de maître à disciple se forma aussitôt. La connaissance de Loutreuil fut pour Caillard une véritable révolution morale. Comme Loutreuil vivait dans une solitude totale et se consacrait uniquement à sa palette, Caillard en conclut incontinent que pour devenir un grand peintre, il fallait vivre comme Loutreuil (Il poussa même son admiration des théories de Loutreuil jusqu'à ne plus vouloir porter que des costumes d'ouvrier achetés chez Lafont près la gare de l'Est et à ne plus vouloir acheter des chaussettes ailleurs qu'au marché aux puces ! La terre croûle si j'exagère...)
1. Ce procédé de décoration et de coloration des tissus au moyen de cire chauffée est originaire de Java et a été introduit en Europe par les Hollandais. Il s'est trouvé deux dames, Ella Keller et Marguerite Pangon, pour le proposer en France dès 1918 ; en 1921, la seconde ouvrit une école de batik à Paris. C'est apparemment en 1923 que le trio Caillard-Champigny-Dabit se lança dans sa fabrication. Un autre « amateur », qui allait croiser plus tard la route de Denoël, se lança à la même époque dans le commerce de soieries destinées à la fabrication du batik, mais son affaire se solda en octobre 1926 par une faillite frauduleuse : Albert Paraz.
2. En 1923 Eugène Dabit a rencontré à l’Académie de la Grande Chaumière Béatrice Appia [1899-1998], qu'il épousera le 8 juillet 1924.
3. La première exposition organisée par Champigny dont j'aie retrouvé la trace dans la presse eut lieu à la Grande Maison de Blanc, rue Halévy (IXe arr.), début janvier 1925. Ici, il s'agit manifestement d'une galerie plus modeste, et l'événement dut avoir lieu en 1924, avant la rencontre décisive de Christian Caillard avec Maurice Loutreuil.

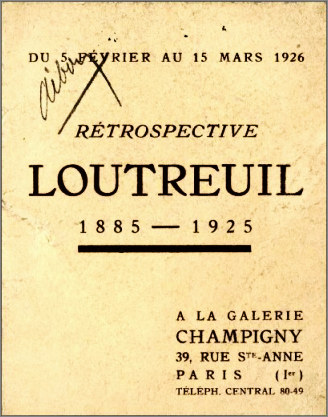
Maurice Loutreuil vers 1920 - Catalogue de sa première grande rétrospective à la Galerie Champigny
Je ne relaterai pas ici, ni maintenant, ni sans doute jamais, ce que je souffris à cette époque dans ma féminité, dans mon amour, dans mon courage ; des liasses de lettres de cette époque en attestent. Après le corrosif Dabit, voici que Loutreuil, sans le vouloir, désagrégeait un à un les liens de si belle association morale avec un compagnon en lequel j'avais eu foi au point de croire même en la durée du compagnonnage.
Dabit et Appia avaient uni leurs vies. Comme par hasard, Appia avait aussi des protecteurs mécènes qui lui assuraient des rentes. Avec ce qu'ils venaient de gagner chez « C & D » ils étaient libres et aisés. Aussi me plantèrent-ils, en plein feu de commandes et en plein printemps dès que la peinture de Loutreuil les eut imprégnés.
Caillard, ne se tenant plus de sentir les autres peindre, n'hésita pas à me laisser, puis m'écrivit que désormais « il avait assez d'argent pour se consacrer uniquement à la peinture et attendre le moment de vivre de celle-ci » - c'était vrai. Vrai aussi qu'avec quelques mois d'effort encore - qu'ils me devaient bien tout en estimant ne me rien devoir - il y eût eu la liberté pour deux et non pour un seul. Je maintins l'entreprise jusqu'aux vacances, puis, harassée, me dis que je serais folle de me tuer plus avant et je cédai à mes équipes de dessinateurs, le matériel et la clientèle qu'ils n'avaient encore que partiellement chipée.
Au cours des vacances assez orageuses, il fut entendu que pour parfaire ma destinée, je ne pouvais rien de mieux que continuer à les servir tous. A l'automne, par l'entremise du charmant et si sincèrement dévoué aux artistes, André Warnod (1), j'entrai comme vendeuse à la galerie d'art que montait la Grande Maison de Blanc, place de l'Opéra.
Les administrateurs n'avaient vu là qu'un moyen de publicité pour attirer dans leurs magasins une clientèle renouvelée. J'étais entrée à condition d'imposer mon équipe, à commencer par Loutreuil dont j'avais déjà réussi à vendre quelques toiles à des amateurs. Ils furent bien étonnés du succès. Une foule se pressa à notre élégante galerie (2).
Warnod et moi avons accroché là bien des inconnus célèbres depuis, qui ont atteint gloire et fortune sans jamais se souvenir de ceux auxquels ils devaient leur démarrage. J'eus des réussites personnelles. Je vendis assez de toiles du pauvre Loutreuil pour que les derniers mois de sa misérable vie fussent illuminés de bonheur, d'espoirs.
De l'hôpital où il traînait plusieurs maladies incurables, il me criait sa reconnaissance. Bien que Caillard aimât alors Loutreuil plus que quiconque au monde, il ne résista pas à l'égoïste désir de quitter Paris en plein hiver pour la Provence. Puisque j'étais, selon mon rôle, au travail... il pouvait partir, être libre, peindre. Il était donc loin de Paris quand Loutreuil mourut, fin janvier (3). Il ne revit pas son ami et ne put qu'aller pleurer de regrets (je l'espère) sur sa tombe à Chérancé.
1. Critique d'art [1885-1960] qui, le premier, consacra dans Comoedia de beaux articles aux expositions organisées par Champigny.
2. Cette exposition eut lieu le 3 janvier 1925. On y trouvait les futurs artistes du Pré St-Gervais dont
Béatrice Appia, Christian Caillard, Eugène Dabit, Jean Fautrier, Pinkus Krémègne, Maurice Loutreuil, Suzanne Valadon, et quelques autres.
3. Maurice Loutreuil est mort à l'Hôpital Broussais le 21 janvier 1925. Champigny est la seule qui lui tint compagnie jusqu'à la fin, ce qui est attesté par la correspondance conservée aux Archives départementales de la Sarthe.
La mort de Loutreuil me fut un tel choc que je renonçai à l'horrible contrainte qu'était ma présence quotidienne, esclavageante, à la Maison de Blanc. Caillard héritier des toiles et de la petite maison [où] j'avais assez à faire à nettoyer vingt ans de saleté, mettre de l'ordre, classer, inventorier. Je recueillis pieusement le moindre papier, résolue à tenir toutes les promesses faites à Loutreuil : faire connaître ses idées, ainsi que sa peinture.
J'avais besoin de liberté matérielle ; je priai C.C. [Christian Caillard] de me donner ma juste part d'argent sur les années que nous venions de vivre. Il m'en trouva ignoble ! Je passai l'été à me mettre en rapport avec tous les gens que Loutreuil avait connus au cours de sa vie - je ne fis qu'écrire. J'avais cent projets. Caillard les dissolut un à un, jusqu'à ce que je cédasse. Je n'avais été créée et mise au monde que pour « servir » le groupe baptisé par moi « du Pré St Gervais » - en conséquence, je devais monter une galerie.
Quand l'automne vint, je mis tout le peu que je possédais, ce petit avoir si péniblement gagné, dans la Galerie Champigny, rue Ste Anne, où je présentai Loutreuil au public avec plus d'ampleur qu'à la Grande Maison de Blanc (1).
J'eus des succès fous. Le tout Paris peinture parla du peintre mort. Tous les critiques en écrivirent et les amateurs en achetèrent. L'équipe des jeunes ne me rapportait rien mais leur rapportait les jouissances de l'encensement.
Je découvris que Dabit avait un talent littéraire - je fis lire ses premières nouvelles à Edmond Jaloux par l'entremise de Laprade (2). Il fut encouragé dans cette voie et abandonna les pinceaux pour le stylo. Tous mes poulains firent parler d'eux ; je leur composai un public, un noyau d'amateurs, leur fournis une foule de relations.
Caillard, directeur conseiller, m'interdisait à son gré tout ce qui eût pu me faire gagner un peu d'argent. J'étais inexperte et fus roulée par les requins de la peinture. Une mauvaise close du bail me priva d'un local qui avait englouti mes disponibilités. La hausse de la livre me ruina. Obtuse devant tout trafic d'argent, en dépit du succès moral énorme de ma galerie, je ne sus pas gagner d'argent et, au printemps 1927, après des efforts, des erreurs, des péripéties de tous genres, je me retrouvai sans galerie, avec 27.000 francs (3).
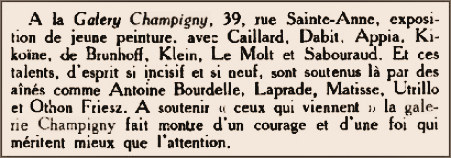
![]()
Deux annonces : l'essor en 1925 [Revue des Beaux-Arts, 15 novembre 1925] - la chute en 1927 [La Semaine à Paris, 22 juillet 1927]
1. La presse mentionne à partir du 1er novembre 1925 la galerie, où Champigny réalise, jusqu'au 20 janvier 1926 trois expositions collectives des peintres du Pré St Gervais. C'est à partir du 5 février qu'elle réalise, avec un catalogue de 33 toiles, la première grande rétrospective Maurice Loutreuil, qui durera jusqu'au 15 mars.
2. L'architecte Albert Laprade [1883-1978] était, comme Champigny, originaire de Buzançais. Le critique Edmond Jaloux [1878-1949] publiait alors dans plusieurs quotidiens des chroniques littéraires très suivies.
3. Les annonces dans la presse de la fermeture définitive de la Galerie Champigny débutent en juillet 1927 et se poursuivent jusqu'en octobre. Vingt-sept mille francs 1927 représentent quelque 15 000 euros.
Après une année de déroute morale intime, je réunis les correspondances de Loutreuil qui, pour mille causes adverses, ne parurent chez Didot qu'en 1929. J'organisai très difficilement une exposition à Londres. Succès énorme, gros gains. Une à Paris, gros succès, peu de gains (1). Caillard, assuré d'argent pour longtemps, s'en fut faire le tour du monde tandis que je prenais le lit pour des maux qui augmentaient depuis 1927. Infirme depuis, je ne pus jamais reprendre une vie active.
Je croyais avoir des droits selon nos anciennes conventions sur l'oeuvre d'un peintre pour lequel j'avais tout fait, et sur les bénéfices duquel Caillard avait pu fonder tout son avenir. Depuis son retour des îles, fin 31, sa gloire monte, il n'a plus besoin de moi. Il me laisserait mourir plutôt que vendre à mon profit quelques toiles de Loutreuil.
Il m'a formellement refusé la prétention d'avoir un droit « puisque je ne m'en occupe plus ». Il a fait en 1943 une exposition sans m'y convier, sans m'avertir (2). Il s'est arrangé pour que les jeunes critiques qui n'existaient pas de mon temps parlassent de Dabit et d'Appia, pas de moi qui fis tout pour eux tous...
Tel est le problème Caillard-Champigny en sa nudité attristante. Robert Denoël, comme correctif de tant d'oubli volontaire, a accordé une interview à un journaliste de province, mélangeant tous les souvenirs alors que je le croyais tellement bien au fait de toute ma vie (3).
Quelle vanité ce serait d'espérer être compris quand on est mort, après avoir été par tous traité de son vivant avec tant de mépris, de désinvolture, d'ingratitude. J'ai été déchirée par ces faits. Dans ma pauvreté actuelle Caillard, en vendant quelques Loutreuil, eût pu me sauver. Si mes pages méritaient d'être publiées, je laisserais à la postérité le soin de juger et conclure. Je maintiens que je meurs d'injustice autant que de douleurs.
Ce que les pages précédentes expriment mal, c'est le stupide étonnement que je ressentis lorsque Caillard, ayant enfin résolu d'exposer fin 1943 je crois, quelques dessins de Loutreuil, il s'arrangea pour « m'enlever ». Je correspondais alors assez souvent avec Robert. Je m'ouvris à lui de cette injustice supplémentaire. A quelques temps de là, je reçus une découpure de journal. Robert, pour réparer les outrages qui m'étaient faits, avait donné (lui, célèbre éditeur sous l'occupation allemande) une interview destinée, dans son esprit, à remettre les choses en place et mon nom en circulation dans le public - et il avait déversé ses souvenirs dans les oreilles d'un godelureau gagnant sa pâtée quotidienne - où, je vous le demande ? dans une feuille de (4).
1. Cette exposition londonienne m'est inconnue. La dernière exposition Loutreuil organisée par Champigny est sans doute celle qui eut lieu chez Marcel Bernheim, rue Caumartin, en août 1927, alors que sa galerie était en liquidation.
2. Cette exposition eut lieu en novembre 1943 à la Galerie de France, rue de la Verrerie (IVe).
3. Champigny paraît évoquer une interview de novembre 1943, qui m'est inconnue.
4. Champigny a laissé sa phrase en suspens et est passée à autre chose à la page suivante.


Robert Denoël en 1927 et en 1943
[Mai 1944] Celui (1) dont je me croyais à peu près connue m'ignore complètement. Peu de mots suffirent à ancrer cette triste certitude. Il me croit capable de haine ! C'est ainsi. Pendant presque 20 ans, l'on ose confier à un ami ces secrets mouvements de l'esprit, du coeur, ces errements des passions de jeunesse, les ambitions morales d'un autre âge ; l'on offre tout, on livre tout. Nu, dépouillé, sans un mensonge.
L'on croit alors que celui-là du moins ne se trompera pas, ne « minimisera » jamais votre souvenir, ne transformera les faits, ne ternira les fraîcheurs conservées, puisqu'il sait tout ! Erreur. Très peu d'hommes sont psychologues. Ils n'ont pas d'intuition, ils ne prennent pas le temps d'observer. Leur sensibilité est canalisée au service de leurs passions ou de leurs désirs si fugitifs et inaccomplis que soient ou restent ceux-ci. Ils jugent donc - même les intelligents - sous l'emprise de leurs passions, sous les influences souvent contradictoires de leurs désirs.
L'ami qui ne me devrait que deux choses : me connaître parfaitement d'abord, puis, me connaissant, être moralement, amicalement mon allié, c'est-à-dire celui qui ne saurait me mentir. S'il me connaissait, il saurait que je considère certains silences comme des mensonges. Cet ami, qui me fut l'autre année si bon, si réconfortant, je le revis en mars, à Paris. C'est pour lui parler une dernière fois, pour l'embrasser avant de mourir que je fis ce voyage (2).
Mes antennes sont trop fines pour errer longtemps. Avant même de le revoir, au ton de ses courts billets, j'avais enregistré un changement. Posément, j'avais voulu considérer cette froideur, cette distance, inexprimées par lui mais par moi si profondément ressenties, comme relevant de la situation dramatique dans laquelle se trouvent brutalement placés tant d'hommes de nos jours.
J'avais fait la part de ses angoisses, de ses travaux, de sa santé, de son foyer... de tout. Impossible de me leurrer. Ainsi que le courant d'air glacé vous avertit que, dans la pièce à côté, une fenêtre vient de s'ouvrir, avant de le revoir j'avais éprouvé ce froid du coeur, cette inquiétude devant le recul d'un coeur.
C'est un ami avec lequel je n'ai jamais eu une brouille venue de l'un de nous, mais plusieurs suscitées par je ne sais quel étrange phénomène d'interférences. Cet homme intelligent a l'esprit livré, le jugement soumis au premier désir qui veut s'amuser de lui. Fort, il l'est sur bien des plans. Mais il ne paraît pas avoir jamais pris conscience de sa pire faiblesse.
Il est la proie de n'importe quelle femme qui veut jouer, le frôler, l'exciter un instant. Point besoin même qu'il aille au bout d'un sentiment, à la réalisation d'un désir. Une simple atmosphère de cajolerie lui suffit. C'est ainsi que nous avons été séparés plusieurs fois au cours de la vie.
Les influences féminines qui s'étaient exercées sur lui étaient : A.M.B., C. - une combinaison de C. + M.S. plus tard et là gravement, C. toujours. Et, comme une arabesque courant sur l'ensemble C.M. (3) chaque fois qu'elle en eut envie.
Jamais il n'y eut entre nous de ces querelles qui éclatent entre amis directement. Jamais. Simplement, je suis absente. Quelqu'un joue le jeu d'augmenter les distances, d'aggraver ma solitude en détournant de moi cet esprit ami. Cela réussit invariablement, nécessairement, il n'y a pas d'explications possibles. Des gens s'acharnent contre vous. Un mot marque.
1. Il s'agit de Robert Denoël.
2. Champigny a séjourné du 19 au 31 mars 1944 à Paris, où elle a rencontré l'éditeur à plusieurs reprises.
3. Toutes ces initiales ne sont pas identifiables. A.M.B. est Anne Marie Blanche, la première associée de Denoël. C. est Cécile Brusson, sa femme. M.S. m'est inconnue. C.M. est Catherine Mengelle.
Une nature telle que la mienne demanderait des éclaircissements, rechercherait si le mot est vrai ou faux. L'homme se tait. D'ailleurs, ce qui le rend si aisément maniable à celles qui en veulent abuser, c'est précisément qu'il se croit fort ; il ne voit pas qu'il est automatiquement influencé.
Cette année, à distance, j'eus grand chagrin à découvrir qu'il venait encore de changer envers moi. Je ne dis rien. Quand, à Paris, je le trouvai distant, presque gêné, je me doutai bien que « C.M. » (1) avait semé en souriant. Or, depuis mon retour, j'appris qu'elle avait passé deux mois, sinon chez lui, du moins dans une très grande familiarité avec lui... Tout s'expliquait.
J'eus même l'enfantillage d'être peinée en constatant qu'ils ont ensemble l'alliance des secrets ! Secret que l'on exige de lui, pour me rendre plus étrangère à tous, ainsi par exemple pour le cas de « D » (2). A une note près dans les gammes santé mentale, j'ai toujours considéré le cas que l'on faisait d'un ami, selon que l'on se comportait avec lui, en franchise de choix. Puisque R. est capable de faire alliance avec C.M. et D. pour me taire ces choses qu'elles mêmes viendront me dire ! c'est qu'il est leur allié, non le mien.
A mon sens, là où se trouve l'amitié la plus sûre, la plus forte, des êtres que l'on estime bien ou pas du tout, ne peuvent évincer ceux que l'on prétend estimer. Etait-il gêné d'avoir supporté des jugements que ma conduite ne mérite pas, bien que mon caractère parfois m'y force ? Etait-il gêné de me mentir ? N'importe. Ce qui compte, c'est qu'il y avait entre nous un état merveilleux de confiance. C.M. est passée. C'est périodique. Comme les comètes et les météores !
Après son passage, son systématique et habile minage, mon ami n'était plus pareillement mon ami. C'était un esprit raidi dans une passagère intolérance, un coeur aigri, décidé à faire peser sur moi l'agitation de ses rancunes sociales. Je n'ai pu retrouver auprès de lui les instants d'abandon de l'hiver 42/43. La défaveur qui brouillait ma personnalité dans sa pensée était telle, qu'il me prêta un défaut que je n'ai pas, afin de pouvoir avoir un grief à formuler.
Que c'est étrange et pénible, justement après deux années au cours desquelles je croyais lui avoir fait don de tant de pensées, de compréhension, où je lui avais apporté tant de franchise. Six mois plus tôt, j'aurais juré que je ne [mot illisible] entière, qu'un être me savait pleinement, justement, sans erreur possible. Je me trompais, car il dit simplement : « Vous êtes capable de haine ».
Avec lui aussi tout est trop tard. Il disait ces mots-là, lui qui faisait savoir combien ma vie avait été amour. Je n'ai pas tenté de me défendre. Je suis lasse de me justifier de fautes non commises ! Lui ! il pouvait dire ces mots sachant tant de détails de ma vie. M'ayant vu supporter pendant des années des actions monstrueuses et les pardonner. Mieux, les dépasser. Mieux encore ! rendre ma tendresse au monstre (monstre envers moi, oui) qui en était capable. Il dit ces simples mots.
Je me sentis plus vide, plus pauvre, plus démunie. Devant sa froideur, j'avais différé jusque là de lui dire pourquoi j'avais entrepris ce voyage en un tel moment. C'était notre dernière entrevue. Bien que ce fût le matin, que je n'eusse pas dormi, j'étais joyeuse. Je n'avais qu'à passer sur sa froideur, ses réticences, sur tout ce qui le rendait si différent envers moi. Tout cela n'était certainement que superficiel. Eh bien, parlons-lui comme s'il était tel que l'an dernier.
Il entra, s'assit, m'offrit une cigarette et, sans préambule, entama son sujet sur le personnage le plus faux, le plus loin de moi qui soit : la haineuse. Le froid prémonitoire qui m'avait saisie quand, après de trop longs silences (car malgré les travaux, certaines lettres, parfois, savent mériter un affectueux accusé de réception à défaut de réponse), le ton de ses petits billets m'avait pincé le coeur, alerté l'esprit, ce froid spécial m'envahit tout entière.
Le même jour j'ai quitté Paris sans dire à mon ami pourquoi j'y étais venue (3). Ainsi donc il n'est pas suffisant d'être ingrat, injuste, de se conduire mal. Il faut encore, parce que l'on est C.M. et que l'on jongle avec le mensonge, desservir celle qui vous fut des années tout service, tout dévouement ; il faut manoeuvrer jusques à écarter de la solitaire, les derniers liens d'affection auxquels nous avions la faiblesse de tenir, ici, dans la maison du chien.
1. Catherine Mengelle. Dans le 4e « Cahier brun » (voir plus bas), Champigny évoque plus longuement les relations entre Catherine et Robert, et ce « stage » qu'elle aurait fait rue Amélie en février ou mars 1944.
2. A cette époque, il ne peut s'agir que de Dominique Rolin, sa maîtresse épisodique depuis juillet 1942, mais on ne voit pas quand Champigny a pu la rencontrer.
3. Ce dernier séjour à Paris, du 19 au 30 mars 1944, n'avait, pour une fois, pas de raison médicale, et, hormis ses rencontres avec Denoël, on ne sait trop ce qu'elle était venue y faire.
Puisque l'on peut tout offrir, tout donner de soi, et que cela n'est rien. Puisque le jeu des désirs suffit pour effacer la beauté des amitiés sans troubles charnels. Puisque l'on répond à votre confiance par de la méfiance, comment moi-même ne point tout remettre en question, comment ne pas douter ? douter de ceux que l'on aime ? Mais c'est n'être plus pur. C'est avoir perdu l'état de grâce.
En cette nuit, j'écris précisément sur l'ami qui par ailleurs fut capable pour moi d'actes sincères, bons, gratuits, généreux. Je pense bien n'avoir tracé ici sur lui un mot injuste. Mais quel regret de voir pareille intelligence se méprendre ; quelle peine qu'une amitié telle que la nôtre soit soumise aux caprices des passantes ; quel étonnement que son jugement soit infirmé au point d'arriver à l'aveuglement le plus absolu, que dis-je, au point de transférer les qualités et défauts de deux personnes, de ravir à l'une tous les trésors de l'âme pour en vêtir somptueusement la « sans âme » ! (1) Et (je ne fais peut-être qu'entrevoir enfin le processus étrange de ces transferts-là) poser sur les épaules de la vieille créature sans charmes cette « pelisse de haine » tissée par l'autre en matières si chatoyantes qu'il s'y est laissé prendre...
R. mon ami, mon ami à qui je fus sans mensonge, posez sur d'autres épaules ce mirifique vêtement - je me dérobe, j'aime mieux rester nue ! Mais, si en 1944, vous avez pu commettre pareille erreur, après tant d'apports, tant d'échanges, si vous me méconnaissez encore, nul ne me connaîtra jamais ! Et les trois phrases qu'il eût fallu vous dire à Paris, la prière qu'il fallait vous adresser, l'accord que nous devions faire, la promesse à laquelle je pensais que vous vous engageriez, tout cela est donc vain, non avenu, jamais à venir. Quelle triste lassitude. Comment ne serais-je amère ?
1. Champigny prête à Catherine Mengelle, la « sans âme », une influence qu'elle n'a sans doute pas eue. Mais il est vrai qu'elle dut être sa maîtresse, et elle ne l'a pas nié formellement. Interrogée le 31 janvier 1950 par un commissaire de police, Catherine déclara : « Nos relations ont simplement été amicales.
Toutefois j’avoue que si Mr Denoël avait été libre
c’est le seul homme avec qui j’aurais aimé faire ma vie. »
[6 juin 1944] L'aube est venue. Certes, mon corps n'est pas moins douloureux ; pourtant je me sens déjà un peu plus quiète. Je voudrais voir Robert, appuyer ma tête contre son épaule, poser sans rien dire ma main dans sa main, l'embrasser, pleurer peut-être, mais certainement lui sourire...
[11 juin 1944] Une longue lettre de Robert reçue le dernier jour de distribution du courrier, soulevait à elle seule mille pensées, sentiments, réflexions. Comment peut-il croire à des distances entre nous ? Il me parle d'amis qui le couvrent. Quels amis ? Quel ami vrai avait-il du temps où il était pauvre, inconnu ? Alors, je n'aimais pas moins son esprit qu'aujourd'hui ; je n'avais pas besoin que son nom fût sur toutes les bouches et sa fortune faite pour l'aimer, même en taisant mon affection ! même en étant sévère, dure, dont il eut plus d'une fois besoin. J'aurais trop à dire après la lecture de sa lettre « confession » pour en écrire sans lumière (1).
1. Cette lettre qu'avait conservée Champigny est du 29 mai 1944 et je l'ai publiée dans la Correspondance.
Nuit du 12 au 13 juillet 1944, au lit. Je vois tant de monde, jour et nuit. Je travaille tant, après être restée confinée des mois, des années, entre les murs de ma chambre, je sors si souvent, que je me trouve cette nuit dans une sorte d'ivresse ainsi qu'il arrive, en pleine mer, quand, par tempête, l'on reste exposé aux vents, aux embruns, au roulis.
Depuis mon retour de Paris, j'ai vu fréquemment les Huyghe, lui surtout, et me suis beaucoup liée avec lui (1). J'avais fait un voyage départemental pour tenter de rencontrer l'homme qui signait autrefois d'un chat (2). C'est au contraire ici que j'ai eu le plaisir de le revoir. Il a dîné à la maison du chien samedi dernier 9 juillet avec trois de ses amis, dont je parlerai en d'autres temps.
Il est revenu aujourd'hui. Nous avons passé la fin de l'après-midi, jusqu'à 20 H ensemble.
Son intelligence étincelle, le suivre est difficile. Comment un tel homme a-t-il pu me faire un compliment aussi prodigieux que celui qu'il me fit ? Nous venions de traiter maints sujets graves. « Quand on adhère à un sol aussi fortement que moi, lui dis-je, que l'on sent de son devoir de participer de son mieux à la tâche générale, que faire ? dans mon cas particulier, pour aussi peu qu'il me reste à vivre, que puis-je faire de mieux, certaine de bien faire pour mon pays, sans faillir pour moi ? »
- Ecrivez, répondit-il.
C'est tout. Jamais personne ne me prodigua un encouragement aussi précis. Il sait bien que je ne suis pas une artiste. Mais, ainsi qu'il le précisa un instant après, le peu que je dis, a un mérite, c'est d'être sans mensonge, sans malentendus.
J'ai tant souffert que, dernièrement encore, j'étais, dans mon désespoir, résolue à ne pas donner suite à mes projets testamentaires, au legs de mes cahiers à Robert, aux fins d'éventuelles publications vers l'époque où le livre sera devenu un objet de musée ! Mais voici que ce mot, ce seul mot, m'incite à laisser subsister ces pages sans valeur littéraire. Elles ne contiennent aucuns faits d'époque marquants. Mais comme la sensibilité est en voie de disparition, que, si mes cahiers sont un jour publiés, l'humanité de ce temps-là en sera à faire extraire ainsi qu'appendice inutile son reste de sensibilité malade, opération déjà commencée depuis vingt ans par les psychanalystes et qui donne les résultats stérilisants que nous connaissons, il se pourrait que mes pages offrissent alors aux curieux cet intérêt que présentent pour les spécialistes «l'homme de je ne sais où d'il y a quatre mille ans ».
Pourquoi suis-je aussi faible et aussi peu un ange ? Pourtant c'est ici qu'ils viennent, nombreux (d'autres que moi, en justice, le diront peut-être un jour ?), chercher appui, conseils, amitié. C'est ici que les êtres viennent puiser, toujours. Qu'ils l'analysent ou non, je suis pour eux « une petite chaleur vivante ».
[...] C'est ainsi qu'en plus des douleurs occasionnées par mes os infirmes, le microbe contracté [en 1936] aux Nouvelles-Hébrides, réveillé par un accès de fatigue ou un coup de froid, me réduisit à l'état de loque. Les accès de fièvre se sont succédés avec leur kyrielle céphalique, intestinale, et, le pire, les complications dentaires. [...] Personne au monde ne m'attend nulle part. J'attends d'amitiés, quelques êtres dispersés dans le monde depuis 1940. Mais je ne puis rien pour eux. Ils ont changé. Leur vie est orientée différemment. [...] Si vous le lisez un jour, Robert, mon ami silencieux, pensez alors que cette nuit je pense à vous plus tendrement encore. J'écrirais trop mal pour oser l'écrire, tout ce que je voudrais vous dire.
1. René Huyghe [1906-1997], conservateur du musée du Louvre.
2. Il s'agit d'André Malraux. La France n'étant pas encore libérée, Champigny, par prudence, évoque ses amis maquisards par leurs initiales ou par leur pseudonyme dans la Résistance.
21 juillet 1944. Si l'ange de la fulgurance m'accordait un moment à son prochain voyage, ce serait merveilleux. J'imagine de l'entendre développer sa pensée sur le cas Rimbaud. Je n'ai ouvert ce cahier que pour y noter ce désir ; ainsi je m'en souviendrai peut-être à temps (1).
1. Il s'agit toujours de Malraux, qui lui a promis une nouvelle visite le 25 juillet. Mais, le 22 juillet, il fut arrêté à Gramat puis emprisonné à la prison Saint-Michel de Toulouse.
[23 juillet 1944], 23 heures. Depuis des semaines, je ne sais rien des rares personnes avec lesquelles je restais encore en contact. Ce n'est guère un temps propice à l'amitié. J'ai tant médité une réponse à la dernière lettre de Robert (1), qu'il me semble par instants l'avoir réellement écrite, postée, et je vais, m'étonnant d'être encore sans réponse. Puis je me ressouviens que l'Europe, le monde, sont toujours en guerre.
1. Il s'agit toujours de la « lettre-testament » du 29 mai 1944 qu'elle a évoquée le 11 juin, mais elle ne sait plus si elle y a, ou non, répondu.

Nuit, 24/25 juillet 1944. Tristesse - tristesse, « l'ange de la fulgurance » n'est peut-être plus, je n'en puis écrire davantage. Peut-être n'ai-je jamais autant déploré mes deux grands accablements (1) que depuis 24 heures. Etre pauvre et infirme c'est beaucoup, toujours et parfois beaucoup trop. Libre d'argent, il eût bien fallu que je découvrisse un moyen qui suppléait à l'impuissance de mon infirmité, qui me permît de me déplacer.
Je n'ai pu que me ronger à attendre ceux que j'avais dépêchés par conscience, non par espoir, à la recherche d'un cheval et d'une carriole. Toute la nuit j'ai pensé que si je pouvais me rendre aux environs des lieux d'où l'ange disparut, j'aurais retrouvé ses traces... appris s'il était vraiment mort ; ce que, mort ou blessé, il était devenu.
Hélas, je suis là - personne n'est venu - je ne sais rien de plus (2). L'après-midi, je me remémorai tout ce qu'il a dit ici, d'abord le soir de cet étonnant revoir, à l'arrivée, au cours du dîner tardif et au long de la veillée qui suivit, ensuite, durant les heures qu'il me consacra l'après-midi du 12 juillet.
Je voudrais pouvoir, non pas retranscrire ses mots, c'est impossible (je crois qu'une excellente sténo ne le suivrait pas, il faudrait un dictaphone enregistreur), mais ne pas laisser perdre l'esprit qui l'animait. Il fut d'abord caustique avec une pointe de gavroche. La chaumière lui plut tellement qu'il exprima aussitôt l'espèce de charme qu'il ressentait parmi les livres. Il mangea peu - il était au début assez nerveux - je fus en partie étrangère aux entretiens du repas, du moins, je restai silencieuse jusqu'au dessert. Ces quatre hommes avaient à se dire des choses importantes. Je ne commis pas l'indiscrétion de les importuner par une curiosité indiscrète.
Je m'évertuai à les servir de mon mieux. Je n'entendis que des bribes et ne retins rien. J'ai une merveilleuse faculté d'oubli. Quant à la conversation générale, elle eut la gaieté, le décousu forcés - le dessert à peine achevé, ils regardèrent des livres. L'Ange les tirait un à un de leur place ; d'un coup d'oeil rapide il avait tout vu, tout détaillé. Il fut dans l'enchantement lorsque je lui présentai l'édition des Fables de La Fontaine (avec planches) de 1688 (3). Tout à coup sur le bahut il vit un Livret du Mandarin (4).
- Que deviennent-ils, fit-il en se retournant et nommant les Doyon ?
- Pareils à eux-mêmes, toujours ; en plus, ils crèvent de faim.
Il se recueillit un instant, je vis qu'il évoquait tout un passé chargé.
- Si jamais vous revoyez Marcelle, me dit-il, vous lui direz combien je lui ai gardé d'amitié, d'estime. Oui, fit-il encore, et même, d'attendrissement.
Le mot me frappa. Je ne répondis pas qu'il pourrait l'assurer lui-même un jour de ses sentiments. Entraînée dans le sens de ses souvenirs, je rendis à mon tour hommage aux vertus de Marcelle.
Après le dîner, quand ses trois amis furent installés dans la chambre jaune, il vint s'asseoir avec moi, devant l'âtre, sur l'inconfortable banc. Il me demanda des explications au sujet de la lettre qui lui avait été remise peu de jours auparavant. Je les lui donnai - ce qui nous engagea dans une conversation sans cesse entrecoupée de parenthèses.
Quand j'en vins à lui dire comment l'on était venu fin janvier 1938 me solliciter d'intervenir auprès de lui dans le but de l'amener à consentir à se vendre, lui, sa plume, à la cause capitaliste pour faire subir à son journal des transformations qui eussent influencé l'esprit des masses - je n'eus à ajouter aucun commentaire.
Je lui « révélais » ces faits d'importance, mais alors, je l'avais trop estimé pour seulement le mettre au courant de ces propositions honteuses. Cet homme-là a été accusé des choses les plus basses, par des gens aussi faux que lâches. On a traîné sa personne devant les tribunaux et tant sali son nom, que l'on est arrivé non à répandre le discrédit sur lui, mais à laisser peser sur sa personnalité un doute pour les uns, pour d'autres une certitude de vénalité (5).
Aussi, combien fus-je récompensée, moi qui, par tous les détails appris sur place, en Extrême-Orient, le savais innocent, quand il tourna vers moi un visage éclairé par le rayonnement d'un regard que je ne lui avais jamais vu, un regard de lumière, de pureté, de force et de foi, qui était, j'en jurerais, celui de ses plus belles heures d'adolescent. Il ne répondit un seul mot - il sourit... de lui, de contentement de moi, je le sentis, mais aussi de la vie, des hommes, oui, il y avait beaucoup dans ce sourire-là.
Je dus ensuite lui expliquer comment, pourquoi, j'avais quitté Montmorency et mes travaux au printemps de 1938. Il ne fut pas trop surpris par l'écriture qui avait fait l'objet d'une analyse et de mille tourments à compter du 2 février (Chandeleur) de 1938. Forcément, ces sujets nous entraînèrent bien loin - après quoi il tenta de résumer ce qui, dans la Résistance, me paraissait tellement contradictoire.
Il aborda en quelques minutes tant de questions politiques, économiques, militaires, qui toutes m'étaient plus étrangères les unes que les autres, que j'eus une peine infinie à en saisir une faible partie, à en retenir et comprendre quelques fragments. Il esquissa un bref résumé de sa vie depuis 1940 et nous revînmes nous joindre à ceux de la chambre jaune qui se divertissaient avec des numéros de L'Amour de l'Art. Art, peinture, littérature, s'emparèrent à nouveau de nous.
Comme il sortait de leur rayon les Cahiers du Contadour (6), nous parlâmes fatalement de Moby Dick et de Melville (7). En cet instant il lança un nom avec sa fulgurance verbale habituelle - j'eus à peine loisir de l'entendre. Je me promettais de le lui faire répéter. L'un des « trois autres » se souviendra-t-il, saurait-il me dire de qui il parlait en me précisant que, selon... X...,
« Il y avait 4 grands livres à lire, 4 personnages foudroyants, surhumains, qui s'étaient un instant dépassés dans le génie, et, précipitamment, il cita Marx, Zarathoustra (je suis certaine qu'il dit Zarathoustra et non Nietzsche), Lawrence et lui - lui s'appliquait au Melville de Moby Dick. Bien que je considérasse l'énumération comme une boutade, j'interrogeai : « Celui des Sept piliers de la sagesse » ? Oui, me répondit-il (8).
Et il ajouta d'un ton inoubliable : « Quel génie... » Je sentis mieux encore tout ce que cette époque représentait pour lui et dans quel sens à la fois mystique et constructeur il lui avait fallu participer directement à l'action. Ils me quittèrent tard dans la nuit après bien des tasses de café et un joli chiffre de cigarettes.
Il revint seul, le 12, l'air plus reposé que le soir précédent, plus jeune, plus jeune que dix ans plus tôt, le veston jeté sur les épaules, la démarche légère, le tic rare, alors que le soir du dîner : fatigue, énervement, ou combinaison des deux, il avait été constamment affecté par son tic. Ah, j'ai oublié de dire que, tandis que je préparais le café, il m'avait, le soir, parlé de sa première femme (9) avec un rien d'agacement, beaucoup de vraie, de solide camaraderie affectionnée et un parfait dévouement. Je comptais lui en obtenir des nouvelles, mais il en eut avant moi.
1. Le premier est une scoliose qu'elle traîne depuis l'âge de trois ans. Le second, un « microbe » ramené en 1936 de son voyage aux Nouvelles-Hébrides, qui lui a toujours causé des migraines, des nausées et des pertes de connaissance.
2. André Malraux, « colonel Berger » dans la Résistance, a été arrêté par la Wehrmacht à Gramat, le 22 juillet. Il a ensuite subi plusieurs interrogatoires avant d'être transféré à la prison Saint-Michel de Toulouse.
3. Il est curieux que cette édition ancienne se trouve toujours chez Champigny en juillet 1944. Plus loin elle écrit qu'à son retour de Paris, le 27 février 1943, elle offrit à Denoël une pochade de Loutreuil : « J'y ajoutai plus tard la belle édition Elzevier des Mémoires de Ph. de Commynes, l'originale des Fables de Gay et une jolie édition avec planches des Fables de La Fontaine ». Plus tard ? son ultime rencontre avec Denoël date de mars 1944.
4. La revue de René-Louis Doyon [1885-1966], que Champigny connaissait de longue date, parut de 1923 à 1963. Malraux avait travaillé en 1919-1920 aux Editions de La Connaissance appartenant à Doyon.
5. Il doit s'agir du vol d'oeuvres d'art kmer à Angkor en 1923, pour lequel Malraux a été condamné le 21 juillet 1924. Mais puisque Champigny a appris « sur place » qu'il était innocent... L'allusion aux démarches de 1938 est beaucoup moins claire.
6. Revue dirigée par Jean Giono, qui parut de juillet 1936 à mars 1939.
7. Le roman de Melville, traduit par Lucien Jacques et Jean Giono, a été publié en 1941 chez Gallimard.
8. L'ouvrage de T.E. Lawrence a été publié pour la première fois en français en 1936 chez Payot, dans une traduction de Charles Mauron.
9. Clara Goldschmidt [1897-1982], une juive allemande qu'il a épousée en 1921 et dont il divorcera en 1947.
[25 juillet 1944 : elle poursuit son récit]. Il entama tout de suite avec clarté, avec précision, avec une compréhension et une lucidité rares, le chapitre de ma vie et de mon attitude dans le présent. En effet, j'en étais venue à me demander si j'avais raison de vouloir maintenir en ces temps troublés mon attitude de liberté individuelle, ma conduite hors de tout clan, de tout groupe, de tout parti.
En somme, il possédait sur mon être intime si peu de données, en bref, que savait-il de ma vie ? Autant dire rien. Mais son génie pénétrant avait tout décelé, tout compris. Il me conseilla de rester celle que je suis, obscure, seule, si seule. Il dévissa pour m'en expliquer le maniement, ce jeu de « mécano » politique qu'il connaît si parfaitement. Il me démontra les avantages des groupements, me parla de la force des individus embrigadés, solidaires les uns des autres, astreints à une discipline comme assurés d'une protection. Après quoi il précisa : « Votre place n'est pas parmi eux - ils ne vous pardonneraient jamais d'être ce que vous êtes, car vous êtes ça, fit-il, désignant d'abord le Bouddha, puis les livres indous (car rien ne lui avait échappé). Or, entre « ça » et le reste, il n'y a pas de lien. »
- C'est bien, lui dis-je, ce que je supposais dans mon ignorance. Je lui expliquai alors ma solitude spirituelle, une longue partie de ma vie, jusqu'à ce que j'eusse rencontré par Romain Rolland et Vivekananda, la philosophie religieuse indoue. Comment, dans un labeur honnête, j'avais, en dépit de la maladie, retranchée de presque tous les contacts humains intellectuels, vécu une existence souvent proche de l'absolue sérénité et, en tout cas, sur la route qui me paraissait à tout jamais tracée. Je lui dis même quels étaient les projets d'un stage à Pondichéry, quand les circonstances, pour moi comme pour tous, vinrent tout changer.
Je tentai de lui exposer succinctement mais clairement mes angoisses morales, quand, après juin 1940, je dus sortir de cette vie morale, de cette ligne spirituelle que je m'étais assignée, parce que, en même temps, je me sentais adhérer à ce sol par mes plus profondes racines et que j'inclinais à penser, après le sage Salou, que lorsque l'on appartient à un pays, et que celui-ci est en danger, c'est une lâcheté de se dérober ou bien d'opter - que je ne pouvais qu'opter, en dehors de toute politique, dans le sens de la recherche des libertés humaines, dussent ces dernières mettre encore dix mille ans avant de s'instaurer.
Attentif, il écoutait. Je me libérais. Il y a si longtemps que ce cas de conscience m'étouffait. Mais néanmoins, lui dis-je, en cette vie-ci, et pour autant que je n'y sois point forcée, s'il me fallait renoncer à ces idées si difficilement acquises et qui me semblent pour l'instant la justification de tout, je ne pourrais.
- C'est pourquoi, répondit-il, je vous ai dit tout à l'heure : « Ecrivez ». Ce que vous faites et deviez faire, c'est cela. Certes, vous seriez utile, mais on vous demandera trop, on exigera de vous une adhésion que vous ne pourrez apporter - ce qui est votre vérité leur paraîtrait folie - vous ne savez que continuer votre tâche modeste d'aider par votre parole, vos avis, vos interventions à tous ceux auxquels vous pouvez rendre des services.
- Mais vous, l'interrogeai-je, écrivez-vous ?
- Non. Il n'y avait pas pour moi deux formes d'aventure possible en ces temps - il n'y avait que l'action - j'y suis tout entier. Ecrire ?... plus tard - peut-être... si...
Il me dit alors des choses passionnantes, pleines de ces aperçus nouveaux qui ne sont que de lui. Il me traça un résumé des événements mondiaux, politiques, militaires, depuis juin 40. « Cela ne prête pas à l'épopée, il n'y a d'épopée, dans la Résistance, que, çà et là, des tableaux fragmentaires tels que ceux que je vous contais l'autre soir. Au cinéma, il y aurait place - oui - la Résistance en film pourrait atteindre à l'épopée - à l'écrit, non. »
Dans les explications lumineuses qu'il appliqua à ma personne, à mon cas, je pus voir combien il était au-dessus des doctrinaires, des partis, des formules. Combien, même militant, même militaire, il restait avant tout l'Ange de la Fulgurance verbale au service de l'esprit tout puissant, de l'intelligence souveraine, l'artiste marqué jusqu'au sang par l'amour du beau, le lettré au cerveau bouillonnant de rêves, de pensées, de souvenirs, qui écrirait aussi un pilier de sagesse si l'avenir lui en était laissé.
Pour nous reposer de cet entretien, diversion gaie, je l'invitai à boire mais d'abord à moudre mes dernières cuillerées de café - ce qu'il fit gentiment - il reparla de la maison avec une énorme sympathie - nous bavardâmes sur mille sujets - la santé de sa petite fille - ce qu'avait préconisé Mondor (1). Sur quoi j'indiquai chiropractique et chiropractor.
Les livres nous reprirent. Il me demanda si Jacquemont dans cette bibliothèque, La Campagne (2), était là d'un hasard ou d'un choix - choix - il me fit une haute appréciation de Jacquemont - ce qui m'amena à lui parler de la fatalité - de l'utilité des horoscopes bien faits. Il eut ce mot souverain : « Je ne veux pas avoir de rapport avec mon destin autrement qu'en l'affrontant chaque jour ».
Il partit un instant après, dit, joyeux : « Je reviendrai dans douze jours ». Dans l'allée il y avait deux roses roses - je les lui tendis « parce que venant du jardin du chien ». Il les prit, en souvenir du chien. Désireux de rester longtemps, il avait renvoyé sa voiture. Il s'en fut à pied, allègrement. De la fenêtre Ouest de la chambre jaune je vis disparaître sa jeune silhouette, bouleversée par le passage rayonnant de cette intelligence magnifique.
Et maintenant ? Pourquoi faut-il qu'infirme, vieille, inutile, je sois ici, vivante, et qu'il soit froid, mort, perdu pour nous, désincarné, ce qui fut lui gisant pas loin d'ici sans doute. Ce qui fut vraiment lui, l'âme, la force, l'esprit, mystérieusement incorporés déjà à d'autres forces. J'aurais donné ma vie en riant pour qu'il vécût encore (3).
1. Henri Mondor [1885-1962], chirurgien et historien, résistant de la première heure.
2. M.S. Jacquemont : La Campagne des zouaves pontificaux en France (Plon, 1872).
3. A cette date, sans nouvelles fiables, elle croit que Malraux a été abattu par la Wehrmacht. Deux jours plus tard, elle apprendra qu'il est à la fois prisonnier et blessé.
Nuit du 28 au 29 juillet 1944. Le travail de Broche me permit un bref moment de croire que Catherine (1) allait se ressaisir. Qu'elle prendrait conscience des réalités, s'il lui fallait gagner sa vie. Qu'elle apprendrait à respecter les êtres. Qu'elle désirerait retrouver sa dignité perdue.
Ce que l'on appelle sa chance fut au contraire un lourd malheur. « Sa chance » ?... Ce fut d'abord l'argent de sa cousine, Germaine (2), l'arrachant au labeur si sain de la culture pour la précipiter dans la si tentante (pour elle) ignominie du marché noir. Quand Germaine et son groupe commencèrent à plier, sa « chance » fut l'argent de Robert ; dès le printemps 1943, le plan de Catherine s'établit.
Très précisément le 13 mars [1943] au soir. Nous revenions de Gourdon. J'avais échappé de justesse aux geôles vichyssoises ! Une lettre de Robert m'attendait à la maison, pleine de bonté, de compréhension. Je la lus avec douceur. Catherine, qui sait admirablement manoeuvrer ma mécanique d'ailleurs sans secret, m'arracha sans peine l'aveu que si j'avais connu à Paris quelques semaines de répit matériel, c'avait été grâce à Robert, à la générosité avec laquelle il m'était seul venu en aide.
Catherine n'avait revu Robert ni Cécile depuis plusieurs années, ils ne correspondaient même pas. Quand je lui dis combien la vie de nos amis était transformée, quand j'expliquai que Robert n'était plus l'éditeur inconnu, chargé de dettes, mais un éditeur lancé, riche, heureux, je vis luire dans ses yeux la mauvaise flamme rapide qui, sans doute, n'éclaira jamais que mon seul esprit.
Sur la seconde, je fus fixée. J'aurais pu, sans craindre de me tromper, d'exagérer, dire comment Catherine allait s'y prendre. Il y avait de l'argent chez Robert ? Bon, elle était donc persuadée de s'en procurer. Elle possède flair et ruse ; elle sait flatter, entrer dans le jeu, feindre d'entrer dans les sentiments et idées du partenaire. Cette même semaine de mars, les Allemands venaient de supprimer les ausweis ; il redevenait facile de voyager. Catherine ne perdit pas de temps.
Elle et ses amies passèrent à la chaumière la nuit du 16 au 17 - à Broche la journée du 17 (le temps pour Olga de préparer la valise du couple horrible Martine-Catherine). Le 18 au matin, elles partaient pour Paris. Là, elles prirent juste le temps de se requinquer un peu chez Germaine, afin de se présenter à Robert un peu lavée, un peu habillée, très souriante (!), dans la meilleure forme possible.
Et tout naturellement elle obtint de Robert la somme qui lui était nécessaire pour se lancer à fond, à bloc, dans la spéculation du temps de guerre. Robert m'a vu travailler. Dieu sait !... Avant de quitter Paris, j'avais osé le prier de m'aider sérieusement, de m'avancer une somme suffisante pour réorganiser une existence modeste dans le travail. Je lui avais proposé de m'acheter la chaumière afin que je pusse essayer d'écrire sans être harcelée par l'épouvantable angoisse quotidienne du « lendemain ». Or, cela, à moi qui suis labeur et honnêteté, Robert l'avait refusé (3) ! A Catherine dont il eût pu connaître la paresse, il accorda sur le champ la facilité de soi-disant cultiver les siens.
Par la suite, jouant la grande comédie du « retour à la terre », de « l'agriculture aux mains des femmes », le courage de Catherine consista à lancer dans toutes les directions, Olga, Martine et Yvette, sa bonne promesse au grade d'acheteuses par la fausse terrienne. Le travail de la terre ? Quelle bouffonnerie pitoyable ! Il consistait à rafler dans tous les villages environnants, les denrées disponibles ; à faire instantanément monter les prix partout en proposant des sommes que nul par ici ne pouvait payer. Comme tous les gens sont par-dessus tout sensibles, non à la valeur de leurs semblables, mais à leur apparente réussite, le clan de Germaine, ébloui par la montée vertigineuse de la fausse fermière, rentrèrent dans la ronde avec un entrain renouvelé.
[...] Je l'avertis dès juin 1943, qu'un temps viendrait où le marché noir serait du jour au lendemain suspendu ; mes conseils, mal accueillis, eurent pour résultat immédiat la cessation de nos rapports. Je suppose qu'elle avait alors encore un reste de pudeur. Lancée dans la jouissance de posséder, elle ne désirait qu'augmenter ses gains et non, sur mon avis, modérer ses spéculations ; elle ne voulait que jouir plus, et si sottement. Elle n'avait pas honte de ce qu'elle faisait ; elle ne supportait pas que je lui fisse honte. Elle préféra me rayer, tout simplement. Depuis, tout s'est réalisé dans le sens de mes prévisions.
Maintenant elle ont des dettes de tous côtés. Il leur sera malaisé de vendre le produit de leurs récoltes aux prix excessifs de l'an passé. Même si, grâce à la famine qui menace les villes, elles pensent dans deux mois avoir quelques rentrées d'argent, une grande partie de ces sommes devra acquitter les dettes.
Mais tout cela est en dehors de la vie normale. C'est un des milliers d'aspects de la folie collective. Cet argent n'est pas le bénéfice d'un travail solide, sérieux, constructif. Broche ne leur appartient pas. Ce sont des terres louées. Si un semblant d'ordre renaît dans le pays, elles ne seront nullement en mesure de vivre, en terriennes, du produit de leurs terres.
Elles continuent à dépenser fort au-delà de leurs moyens réels. Catherine, déjà déséquilibrée quand elle ne sombrait que périodiquement dans ses catastrophiques beuveries, avec l'aboutissement fatal d'une coucherie avec un charretier quelconque, semble maintenant perdue, anéantie. Mal nourries par désordre, par paresse, par manque d'organisation ; ivres, aussi souvent qu'elle peuvent se procurer la quantité de vin nécessaire à leurs « veillées », gorgées de romans policiers, gonflées d'orgueil maladif, elles glissent vers le drame en bolides.
1. Catherine Mengelle, son ex-compagne, vit à Broche (à 8 km de Mézels) avec une amie, et se livre, dit Champigny, à un honteux marché noir.
2. Germaine Cellier [1909-1976], sa cousine parfumeuse.
3. Champigny ne dit pas à quel moment elle lui a fait cette demande, mais c'était apparemment en février 1943, avant qu'elle quitte Paris pour retourner à Mézels, et un mois avant la visite, rue Amélie, de Catherine Mengelle.
Nuit 4 H 30, lundi à mardi [1er août 1944]. J'ai de plus en plus souvent une ardente envie d'écrire. Je continue pourtant à vivre des heures distribuées entre le mal, l'abrutissement, les travaux ménagers et le « service », puisque je ne vois nul autre terme approprié pour désigner le temps dévoré par des gens qui paraissent avoir besoin de moi. Quand je pense à toutes ces années haletantes d'incertitudes, de soucis du lendemain, d'insécurité - au rêve qui fut fait puis par force abandonné d'écrire régulièrement.
L'hiver 42/43, lorsque R.D. témoigna de l'intérêt pour mes cahiers, je repris confiance au point d'échafauder de merveilleux sujets !... si humbles - si simples. Si Robert avait consenti, par exemple, ainsi que je lui proposais, d'acheter la maison du chien, ou s'il eût consenti à me fournir une mensualité fixe, ce qu'il a fait pour tant d'auteurs qui valaient bien peu et n'étaient même pas ses amis, j'aurais pu m'organiser une existence modeste sans me tuer physiquement. - prendre une domestique et me consacrer au travail littéraire.
Robert refusa - il m'aida après qu'il eût traité avec Thibon (1) une affaire de papier - il m'aida sans que j'eusse aucune certitude - il me dit en une ou deux lettres que je pouvais compter sur lui. Reconnaissante de son geste alors, je n'eus malgré ma confiance en lui aucune sécurité pour l'avenir. En effet, Robert arrêta son aide, sans motifs, ainsi qu'il l'avait apportée - par oubli - par caprice - par influence subie ? un peu du tout sans doute.
Et qu'aurais-je escompté puisque, loyalement, il ne s'était point senti le goût d'aider (ce qu'il pouvait seul faire) à réaliser mes voeux de travail en établissant entre nous une situation nette qui m'eût délivrée de la constante angoisse, et qui m'eût épargné de me reclaquer sans merci à des besognes au-delà de mes forces. Je puis bien noter ici que j'ai éprouvé une peine amère, exempte de jalousie mais non pas de révolte, quand je sus dans quelle mesure Robert avait fait pour Catherine ce qu'en toute justice il eût pu faire pour moi.
Elle n'avait pas un centime, rien que des dettes quand elle l'alla trouver. Evidemment il trouva cela héroïque d'avoir des dettes - il lui avança sur l'heure de quoi payer ses dettes, c'est-à-dire qu'elle lui vendait à de tels prix (d'amis !), qu'elle gagna sur lui en un seul mois de quoi acheter le terrain du Bavre [?] au-dessus de Tourrettes - elle n'eut qu'à jouer la comédie devant lui - elle lui raconta cent lanterneries à dormir debout - il goba tout et Cécile en fit autant de son côté. A eux deux ils mirent Catherine à flots - elle jouait son rôle de cultivatrice ! La bouffonnerie du retour à la terre.
A l'époque, le dur travail de la terre consistait à lancer Martine, Olga, Yvette, sur le pays - elles raflaient tout, partout, la folle enchère. Au prix d'amis, Catherine expédiait à Paris des jambons de 4 à 6000 frs - elle les achetait 1800 à 2200 selon le poids. Toutes les autres denrées étaient achetées et revendues dans les mêmes proportions. L'huile à 110 F le litre revendue 680 puis 1000. Puis vint la spéculation sur le tabac. Je rougirais d'inscrire ces détails dans mon cher cahier s'ils étaient personnels (2).
Le mal fait ne se répare jamais - jamais rien ne compensera ma peine de ce dernier éloignement immérité de Robert, après, comme par hasard, qu'il eût revu Catherine. Je souhaite seulement qu'il comprenne un jour que je vivais ici une humble et courageuse vie - que mes forces étaient si limitées qu'il m'eût fallu pour travailler en quiétude l'assurance du lendemain. Avoir donné à C.M. [Catherine Mengelle] la possibilité de mener une vie orgiaque dans le temps même où il aurait pu m'assurer une mensualité modeste n'est pas une preuve de sagesse masculine, ni de connaissance humaine, ni de bon sens psychologique.
Mais bien pis, c'est une preuve de mésestime envers moi. Robert, sachant que je lui léguais mes papiers, eût dû me donner la possibilité de les améliorer, de les classer, de les annoter. J'ai brûlé tant de cahiers et de manuscrits en juillet 1942 quand la police de Vichy me harcelait. Et j'avais tant à dire, tellement besoin d'écrire avant de mourir - dans la pauvreté, j'ai lutté jour à jour simplement pour exister. Il faut me voir vivre ici pour comprendre combien ce lieu préféré moralement à tout autre est dur pour un corps d'infirme. Cette année, j'en suis arrivée au point où mon désespoir est si grand que je suis tentée de tout brûler.
[...] Une folle m'a envoyé un poème sur le village de Vayrac avec une lettre personnelle pour le général de Gaulle et un mot pour le colonel Remy ! le tout pour que j'acheminasse ces papiers jusqu'aux mains respectables de leurs destinataires - j'ai bien ri (3).
1. Jacques Thibon [1900-1974], directeur de la Société des Papeteries Job. Il avait épousé Marguerite Delsol [1902-1981], l'amie d'enfance de Jeanne Loviton. Le 17 octobre 1946 Thibon déclara à un commissaire de police : « A la fin du mois de juin 1945 M. Denoël, que je connaissais
depuis plusieurs années, m’a demandé de lui prêter 300 000 frs pour la
bonne marche des Editions de la Tour. » Interrogé par le même policier, le 31 janvierv 1950, Albert Morys précisa : « Mr Denoël traitait des affaires de papier au marché noir,
notamment avec Mr Danheisser et les Papeteries Job, ceci même peu avant
sa mort. »
2. Denoël demandait donc à Catherine Mengelle les mêmes services qu'à Jean Rogissart ou Jean Proal, précédemment, mais au prix fort, apparemment.
3. L'anecdote est cocasse mais elle montre que les liens de Champigny avec la Résistance sont connus dans la région.
[Cahier brun n° 3] 10 septembre 1944. Troisième des Cahiers bruns. Le premier est actuellement déposé chez Denoël. Je suis affectionnée à ces cahiers bruns. Je les fis faire à Nérac, pendant l'exode, par le relieur triste, protestant, d'une branche protestante portant l'étrange nom de « plumatiste » sur laquelle nul ne fut capable de me fournir la moindre explication. Semblable à ce personnage de Dostoïevski (Stephan Trofimovitch, je crois) (1), j'espérais sans doute que sur d'aussi beaux cahiers, j'allais édifier un monument littéraire défiant l'humidité, les mites, les rats et la critique contemporaine et future ! Non pas. Je les destinais à être ce qu'ils furent, ce qu'ils sont, les compagnons de ma solitude, toujours heureux quand j'évoque d'autres compagnons, humains, ou quand je m'attarde à redire à mon chien doux que son regard m'était ciel et lac.
Le beau papier de ces cahiers m'avait été offert par Robert Denoël en 1934. Il avait écrit sur la première page : « C'est pour écrire le roman ». Obéissante, je pensai longtemps écrire les amours de Sophie Violante. Ma bonne volonté était telle que le paquet de papier me suivait au cours de tous mes déplacements. On ne sait jamais !... Soucieuse qu'une nuit l'ange du génie m'eût frôlée de son aile, que j'eusse éprouvé l'inspiration impérieuse, senti son jaillissement, écrit... d'un jet, d'un trait, d'un élan, « le roman », enfin... que j'eusse dû l'écrire et que le papier m'eût manqué. Le papier suivait donc, le génie était moins proche.
1. Stepan Trofimovitch Verkhovensky, personnage du roman Les Démons (1871).
[2 octobre 1944] Maintenant... où est Robert (1) ? Devant le nom de chaque homme qui me fut ami, je reste hésitante, inquiète, troublée, quand ce n'est triste ou désespérée. Longtemps j'ai vécu dans le sentiment de l'attente. Je regardais fondre les mois, songeant : un jour viendra bien où enfin les amis seront là, présents. Les années ont été lourdes pour tous. Je suppose que tous m'ont oubliée.
1. [Ajout marginal :] Robert, menacé d'être arrêté, paraît-il, est sans doute caché. Il n'a pas cru devoir se manifester à mon affection depuis que la roue a tourné. Mon coeur plaide pour lui, ma raison le juge sans le condamner, ma tendresse le plaint et regrette.
[26 octobre 1944] Ils ont brûlé, les cahiers précieux qui relataient les bonheurs du temps où je me crus sauvée de tout, sauvée de moi-même, digne de partir un jour vers l'Inde... les cahiers de ma grande aventure spirituelle, dont seule, la chère, la respectée, la vénérée Manon connaissait les détails. Ils ont brûlé en juillet 1942, avec les liasses de lettres, les travaux graphologiques, les manuscrits ébauchés (1).
1. Dans le cahier précédent Champigny écrit : « J'ai brûlé tant de cahiers et de manuscrits en juillet 1942 quand la police de Vichy me harcelait. » Je suppose qu'elle veut dire que c'est en raison des menaces de la police vichyssoise qu'elle a commis cet autodafé.
Dimanche soir 18 décembre 1944. L'an passé je fus malade de bouleversement ; moi qui jamais ne connus envie, jalousie, je fus, des semaines entières, mordue au foie à la lecture de Lanza del Vasto (1). Il a en somme tout frôlé (parfois dangereusement) en amateur (je voudrais intercaler ici la critique sentimentale que je fis de ce livre pour R. Denoël), en amateur, oui, sans aller au fond (2). Et il put réaliser ce voyage, accomplir ces pèlerinages, pourquoi, mon Dieu, pourquoi : «parce qu'il jouissait d'une exceptionnelle vigueur ». Pour moi, je n'ai pas tellement besoin - à part sentimentalement - plus d'un lieu que d'un autre. Dès l'enfance, mon isolement vint de ce que ma foi éperdue ne pouvait se communiquer à quiconque.
Dans leur sens, ils ont raison de mépriser ma vie. Ce peu par quoi je ne me sens peut-être point tout à fait méprisable, ils ne le conçoivent même pas. Que je poursuive la nuit des souvenirs, que je cherche à affermir une pensée sans aide et sans maître, que j'enferme en mes cahiers ces riens de vérité, d'erreurs, qui tant me firent aimer, saigner, souffrir, quel intérêt cela présente-t-il ? Ce n'est pas un roman ! Ce n'est pas littéraire. C'est aux antipodes de l'art, vie, simple vie, pauvre, nue, avec çà et là les fulgurances audacieuses des souvenirs d'un temps qui s'appelait la jeunesse, un temps où le mot « Inde » m'apparaissait déjà, sans pressentir pourquoi, le but magique.
1. Le Pèlerinage aux sources, publié par Denoël en décembre 1943. Champigny en parle dans son cahier n° 2 à la date du 1er février 1944 (voir plus haut).
2. Si ce compte rendu existe, il n'a pas été retrouvé.
23 décembre 1944, 22 heures. Acte de justice réparateur (1), je dois noter que Caillard me télégraphie qu'il vient de vendre mes toiles, a répondu par une avance immédiate de dix mille francs. Il faudrait que je puisse lui parler. Qui m'aurait dit jadis que nous serions si divisés. Sans doute mourrais-je sans le revoir ; même le revoyant il ne comprendrait pas.
Dès qu'en 1932 il s'écarta trop moralement, je tentai de le rapprocher - en conscience, je fis effort des années - les âmes dénuées d'amour vrai sont pauvres. Ainsi il suffit à un homme d'être passionnellement occupé par un chétif bout de viande malsain (comme Lulu) pour être incapable parallèlement d'oser, garder, avoir, manifester une amitié - « sa paix », disait-il. Pour cette paix il a vécu douze ans avec une idiote. Et il appelait cette vie de constant mensonge « sa liberté ».
[...] Dieu, que j'ai souffert de cette défection, de cette perte d'un esprit que je croyais mon frère, mon proche, mon allié en toutes circonstances. Alors que je suis naturellement si peu encline à la rancune, je lui en ai voulu - voulu plus que tout justement de m'avoir rendue plus dure. Comme il bénéficie d'un Karma de repos, que le ciel en cette existence-ci lui a tout donné, santé, talent, beauté, réussite, il s'attribue le mérite de toutes les facilités de sa vie. Il n'y a donc aucune chance qu'il comprenne jamais, sauf le cas improbable mais pas impossible d'un choc qui déclencherait en lui une évolution spirituelle qui lui donnât accès à la sensibilité universelle. Peut-être alors soupçonnerait-il combien sa conduite dont il était si fier, si audacieusement orgueilleux, m'écorcha des années durant au vif de l'être. Il faut qu'à distance, je meure en paix avec lui, la pensée de lui. Il faut que je parvienne à surmonter. S'il pouvait une seule heure sortir de son maladif orgueil, voir quelques faits qui nous divisèrent, dans leur réalité, dans leur exactitude, s'il pouvait une fois admettre qu'aveuglé, oublieux, il a - sans doute involontairement - été effroyablement injuste envers moi, la paix descendrait en mon âme. Mais je dois savoir qu'il ne sera jamais capable de cette si simple humilité.
Je dois parvenir à accepter d'être en sa pensée ce grotesque personnage auquel il donne mon nom. Je dois parvenir (non pour lui à qui peut en chaut) à éliminer jusqu'à la plus petite trace d'amertume car les douleurs du couple Caillard Champigny ont empoisonné mon esprit, se sont amassées en toxines pernicieuses [...] Je veux mourir propre. Je veux mourir comme Doudou. Je veux mourir, ayant tout pardonné, mais surtout tout admis. Je veux mourir en disant à tout ce que j'ai aimé : j'aime. Et que ce soit sans réserves, sans arrières-pensées.
1. Le 19 avril 1944 elle se plaignait amèrement de Caillard : « Il me laisserait mourir plutôt que vendre à mon profit quelques toiles de Loutreuil » (voir plus haut). Caillard règle apparemment tous leurs comptes en souffrance. Le 8 mars 1945 Jean Brunel, qui gère les affaires de Champigny, lui écrit : « Christian est venu jusqu'à l'étude un jour où je n'étais pas là. Il a déposé pour vous une somme de 19.250 F qu'il restait vous devoir - a-t-il dit - sur la vente des toiles de Krémègne. »
[7 janvier 1945] J'ai brûlé des liasses de chansons, prières ou poèmes dont plusieurs dossiers jamais communiqués à personne sauf quelques pages à Robert Denoël en 34 ou 35 [...] à part les cahiers de clandestinité brûlés par force à mi-42, tout fut détruit par désespoir, solitude intellectuelle, absence de la moindre sollicitation, du plus modeste intérêt ; Robert D., qui me demanda pardon en 42 pour m'avoir écrasée si longtemps, pour avoir compris si tard, Robert, par ses demandes, son intérêt tardif, est seul responsable des rares cahiers qui restent.
Maurice Loutreuil. Peintre, artiste-peintre, mort à 39 ans. Cet âge paraissait énorme ; l'homme, très vieux. 39 ans... Je crois me souvenir qu'il mourut le 21 janvier 1925. Un beau janvier. Pas froid. Il mourut seul, dans une chambre à quatre lits du triste, du si vilain hôpital Broussais. Sa bonté profonde fit qu'il feignit devant nous de croire en sa guérison prochaine.
Pendant les courtes visites (elles sont toujours trop courtes pour le malade) il ébauchait des projets. Mais je compris plus tard qu'il ne les faisait que par extrême courage. Il se savait perdu. Son bref testament n'est pas le banal raccourci de l'homme qui sait qu'il peut mourir... un jour... mais l'impérieux document de l'homme certain qu'il va mourir tout de suite. Ce qui fut.
Sur Maurice Loutreuil, j'avais beaucoup à dire. Mon tort fut de vouloir le dire trop tôt. Influencée par Christian Caillard, peintre, et Eugène Dabit, encore peintre alors, bien qu'en voie déjà de virer vers la littérature, il me fut impossible de m'exprimer librement. Je faisais tellement cas d'eux. Ils faisaient si peu cas de moi... Parce qu'ils étaient plus proches du Loutreuil-peintre que je ne le pouvais être, j'accordais, bien à tort, une prééminence à leurs dires. Alors qu'humainement, j'étais plus proche qu'eux du Loutreuil-homme. Non seulement parce que j'étais leur aînée de trois ou cinq ans, mais en ce que j'avais en commun avec Loutreuil l'expérience qui l'avait réduit, broyé, celle de la douleur et du doute de soi, à force d'échecs.
Je me mis à l'ouvrage avec enthousiasme et ferveur. J'employai mes heures libres parisiennes de 1925 à épouiller l'atelier, 61 bis ; je réunis les moindres papiers écrits par M. Loutreuil. J'entrai en correspondance avec les rares personnes qui lui avaient marqué de l'intérêt et desquelles sa maladie et sa sauvagerie ne se défiait pas.
C'est ainsi que je connus maître Henri Brunel (1), notaire à Paris, qui entassait dans son atelier (de la rue Capron, près l'ancien hippodrome devenu la salle de cinéma Gaumont) des peintures achetées à bas prix mais qu'il avait le mérite d'acheter par goût, non par esprit spéculatif, ainsi que cela devint de mode dès 1920.
Mais avant que d'oser me lancer dans une tâche pareille, consciencieuse, j'accumulais les documents. Je copiais à la machine les lettres de Loutreuil, celles de ses correspondants. Plus tard, en 1929 ou 1930, avec non moins de conscience, je rendis à Christian Caillard tous les dossiers établis sur Loutreuil.
Christian Caillard a, au plus haut degré, l'indifférence de la chose écrite. Loin de ranger pieusement (pour en tirer plus tard des enseignements et des conclusions plus intelligentes que mes balbutiements) ces papiers qui avaient en outre une valeur de souvenirs, d'authenticité, d'époque, il les abandonna dans le grenier de la petite maison attenante au 61, restaurée après la mort de Loutreuil qui la lui légua, et devenue en 1925 « la maison rose ».
Sans doute, les rats, l'humidité, eurent raison de ce que les occupants successifs ne détruisirent pas. En 1925, quand j'eus, pendant des mois, copié tous les papiers du peintre ; quand je fus imprégnée de ses peines, pénétrée de ses idées, je me mis à « la vie de Loutreuil ».
C'était le temps où ma propre vie bouleversée, après des années de labeur, de croyance en une stabilité promise à laquelle j'avais aspiré par-dessus tout, voyait se rompre un compagnonnage qui m'était plus qu'amour. « J'ai saigné à toutes les misères du coeur », avait écrit, crié, le pauvre Loutreuil. Ces mots éveillaient une tragique résonance. Je pressentis, dès lors, que j'entrais de plain pied, nue, démunie, dans un avenir prometteur de souffrances ; qu'un jour, pour résumer succinctement mais très exactement ma vie, il n'y aurait rien à ajouter à la phrase déchirante du peintre ; c'est fait... J'ai saigné à toutes les misères du coeur.
Parler de Loutreuil ? Je ne faisais que cela. N'avais-je pas, cédant aux instances impérieuses de « mon compagnon », créé en plein centre de Paris une petite galerie de peinture ! Moi, ignorante de tout, mais par-dessus tout de la peinture, haïssant le commerce ; or, une galerie n'est pas moins une boutique ! J'avais eu ce courage. Refoulant tous mes désirs, contrecarrant tous mes goûts, étouffant toutes mes aspirations, renonçant aux projets conformes à mes capacités limitées, j'avais monté, ouvert, tenu une galerie de peinture.
Avec de l'enthousiasme et de l'honnêteté, en guise de commanditaire. Cela, en pleine période de fin de prospérité ; dans un milieu où d'impitoyables affairistes à l'affût guettaient l'innocent maladroit, prêts à le dévorer, tels les requins qui suivent les bâtiments en mer, sûrs que le moment viendra où tomberont à l'eau les détritus de la vie du bord, ou, par chance, de la bonne vie toute fraîche d'un homme !
Lancée tout de go, sans préparation, sans connaissances d'aucune sorte dans la haute mer du marché international de la peinture, avec l'oeuvre d'un inconnu pour embarcation, ma seule honnêteté pour vivres et ma juvénile confiance en la toute puissance de l'Art pour boussole, qu'ils étaient précaires mes moyens ! qu'ils furent grands, nombreux, mes efforts. Et combien inutiles. Pour de maigres réussites, que de défaites. En moins de deux ans, le mince petit capital si durement, si laborieusement gagné auparavant fut englouti.
Christian Caillard était le conseiller technique de la maison. Encore tout imbibé par les théories de Loutreuil, intransigeant, il exigeait que j'exerçasse ce métier de marchande de tableaux comme si j'avais été libre mécène et non modeste boutiquière, ayant pignon sur rue et taxes de luxe à payer.
Si j'avais l'humeur à rire, il y en aurait long à conter sur ma puérile entreprise de la rue Sainte Anne. J'en sortis plus pauvre que je n'y étais entrée. Mes efforts avaient momentanément « situé » (comme l'on disait) le peintre Loutreuil, et permis à la jeune école dite « groupe du Pré St Gervais » (2) d'être constamment en contact avec un public à vrai dire indulgent.
A mes récriminations souvent amères, Christian Caillard objectait : « Mais... tu as vécu ! » Il oubliait qu'auparavant, j'avais, ma foi, vécu aussi. Il oubliait, lui qui jouissait d'une absolue liberté d'action, que très jeune, j'avais dû gagner ma vie ; qu'en travaillant de 1922 à 1925 durement, joyeusement, j'avais chaque jour tout supporté, animée par l'espoir du moment où j'organiserais une vie de travail bien à moi, une forme de travail qui m'assurerait un peu de liberté pour écrire. Car tel était le rêve : écrire...
Lui, autour de moi, ne comprenait pas que pour écrire, il m'eût fallu un peu de ce qu'ils avaient tous : du répit, du repos, et surtout, avec un peu de sécurité matérielle, la stabilité morale sinon sentimentale. Si Eugène Dabit, au lieu de bénéficier de l'assistance de ses parrains de guerre protecteurs, avait continué à faire fonctionner l'ascenseur de la place des Abbesses ; s'il avait dû, pour exister, tenir l'Hôtel du Nord, au lieu d'y observer les pensionnaires aux soirs où il lui plaisait de manger à la table familiale, sans doute ses révoltes, ses étouffements, auraient nui au développement de sa sensibilité et peut-être, plié aux dures conditions de cette pauvreté redoutée à laquelle il avait échappé, n'eût-il jamais écrit le Petit-Louis (3) qu'il portait pourtant en lui quand je le connus. Oui, écrire était le rêve.
Plus jeune, pénétrée de mon ignorance, je ne me serais pas même permis d'y prétendre. Quand je compris qu'après des années de patient travail, je pourrais peut-être oser exprimer une parcelle de ce qui m'oppressait, j'assumais la responsabilité des travaux Caillard-Champigny, en une association qui (sauf deux ou trois mois, je crois) requerrait de Caillard trois heures de travail quotidien, tandis que mes jours étaient absorbés, usés, jusque tard dans la nuit, d'un bout de l'année à l'autre.
1. Notaire à Paris dès 1910, Henri Brunel [1871-1942] fut aussi sénateur du Cantal sous l'étiquette de la Gauche démocratique. Son fils Jean, qui connut Champigny dès 1934, reprit son étude et se chargea ensuite de la plupart de ses affaires.
2. [Ajout marginal postérieur :] Je reviendrai une fois sur cette appellation. J'en revendique la création, un jour d'épiphanie, sans Caillard, absent... comme toujours... à l'Hôtel du Nord, alors inconnu. Un petit beaujolais inspira mon fou rire ; toutes mes prophéties se réalisèrent. Les critiques raffolaient des étiquettes. André Warnod, charmant, charmé, sauta sur la mienne et lança le Groupe du Pré St Gervais.
3. Le livre est paru chez Gallimard en 1930 mais l'auteur y travaillait depuis plusieurs années : c'est, en réalité, son premier roman.
[7 janvier 1945, suite] C'est du 61 bis que je veux écrire. Et pour un début, écrire la vie de Loutreuil ! Témérité ? Bien sûr. Ah, certes, j'étais pleine de mon sujet. Peut-être même une dizaine de pages auraient-elles mérité de demeurer sur le nombre de celles écrites à Tavaux et Pontsericourt? Je ne cessais d'en parler à Eugène Dabit, à Christian Caillard, à Robert Denoël, à Georges André Klein. Chacune de mes lettres était la copie d'un morceau de mon informe et scrupuleux travail ! Que d'inquiétude, quelle peur de mal faire ; quelle totale absence de confiance en soi... Si j'ai commis hier des actes regrettables, accompli force erreurs, du moins je retrouve avec plaisir les traces de cette lucidité - pas un instant je ne m'envisageai autrement que comme un obscur manoeuvre.
J'avais connu Loutreuil ; j'avais étudié sa vie ; dévouée à sa mémoire, je ne désirais pour le bien servir qu'être vraie ; exposer tout ce que j'avais compris de lui, ainsi que je soumettais ses toiles, en m'effaçant, en le laissant parler. Mais... Caillard et Dabit étaient là ! Certainement, la subtilité de leur sens pictural, leur avait permis de comprendre mieux que moi l'oeuvre du disparu. Mais l'homme ? Non. Il n'avaient pas approfondi ; ils étaient d'ailleurs encore trop jeunes, trop neufs ; ce qui avait formé, pétri Loutreuil, c'était la douleur. Comment eussent-ils alors senti de Loutreuil les plus lourds secrets, eux qui n'avaient rien souffert ? à peine vécu.
Ma confiance en eux était grande. Depuis des années j'étais accoutumée d'être traitée par eux en inférieure. Toujours. Déjà accablée de complexes d'infériorité, entre eux, je désespérais de moi. Evidemment, puisque j'étais une « mécanique » au service du « groupe », je devais écrire la vie de Loutreuil. Je le devais pour le faire connaître. Mais il n'était pas question que j'écrivisse librement, que je tentasse de peindre l'homme tel que j'avais vu vivre ; d'exprimer sur lui l'ensemble de ce que j'en avais compris. Il fallait que j'écrivisse Loutreuil selon Caillard et Dabit !
Aux épouvantables difficultés d'une débutante sans culture, sans métier, se greffaient les complications de malentendus déprimants car, chaque fois que je hasardais une page qui me semblait l'expression la plus fidèle, la plus serrée, je trouvais en mes critiques, non deux amis désireux de m'aider, mais deux terribles adversaires. En sorte que, si la rupture avec Caillard, l'abandon, par manque de capitaux d'une galerie trop pauvre d'abord pour subsister, puis pour résister à la crise financière de l'hiver 1926/1927, n'eussent été suffisants pour briser ma fragile tentative, mes « amis » s'en fussent chargé. Je sortais de nos entretiens ainsi qu'un boxeur vaincu du ring ; tuméfiée, chancelante, navrée.
Je revois un certain soir, rue Sainte Anne, j'étais désespérée. Plus rien n'avait de sens. Les années de ce compagnonnage avec Caillard... tant de sacrifices consentis, n'avaient servi à rien. J'avais cru en lui, en nous, en « notre » avenir. Pour un désir qui lui était né au temps des vacances, pour une jeune fille qu'un peu plus tard il jugerait « idiote », il n'avait pas hésité à exiger sa liberté totale, à me pousser au point désiré d'exaspération, afin que je prisse initiative et responsabilité d'une rupture que lui seul souhaitait. Nous étions séparés. C'était fini (1).
J'étais là, dans cette galerie créée à force de courage fou ; cette entreprise étrangère à mes goûts, contraire à mes besoins, et au-dessus de mes forces, dans laquelle j'avais mis, en sus de mon piètre avoir, ma santé déjà compromise, mon temps, mon travail. La galerie m'était devenue odieuse. Je n'avais pas, en pleine crise sentimentale, la ressource de me jeter dans le travail puisque cette galerie était la seule volonté du compagnon d'hier..., l'aboutissement de quatre années de vie commune (une vie que je croyais exemplaire, qui l'était peut-être... qui le fut, je crois, jusqu'à ce qu'il m'eut écrasée avec les théories, mal interprétées, mal assimilées, du pauvre Loutreuil).
La galerie ? C'était lui, c'était Loutreuil, c'était « le groupe »... C'était la négation flagrante de tout ce que j'avais cru supérieur, grand, pur et beau... Georges André Klein arriva. Le bon terre-neuve. Pourquoi à cette heure tardive ? Il arriva. C'est tout. Pour assister à l'autodafé de ma jeunesse. Le travail sur Loutreuil, les nombreux cahiers intitulés les uns après les autres « journal de bord » étaient en cendres. Je n'étais que larmes, que douleur. Si Klein n'était arrivé, il est certain que les toiles, la galerie, tout aurait brûlé. J'avais perdu tout contrôle.
Il me semblait que pour arracher tant de souffrance, il fallait détruire, détruire, effacer les traces, les souvenirs de tant de travaux, de rêves, d'héroïsme et d'amour inutiles. Puis, finalement mourir. Klein eut des mots d'apaisement. Il convint que l'on brûlerait tout... bien entendu... mais tout à l'heure... Il me conduisit dans un petit bistrot du voisinage. Je fumais des Thee Castle, je buvais de la limonade, j'écoutais sans comprendre la voix de cet ami qui s'est ainsi plusieurs fois trouvé sur ma route à des bifurcations décisives ; un ami très bon, très fidèle, très valable, qui ne connut guère autre chose de moi, je le crains, que cette faculté de désespérance, ces accès de renoncement à tout par désespoir de tout, ces crises au bout desquelles l'on est étonné de se retrouver vivant.
C'est ainsi que périt par le feu mon « grand » travail sur Loutreuil ! Plus tard, c'est surtout afin d'éviter avec Caillard des conflits d'amitié que je me bornai à cette mauvaise préface impersonnelle qui figure en tête de l'édition Firmin-Didot des lettres de Loutreuil (2). Tantôt, j'ai reçu un affectueux mot de Klein. « Je viens, disait-il, de relire votre beau livre sur Loutreuil». Mais cher Klein, entendez-moi, il y a les lettres de Loutreuil ; il y a quelques lignes qui ne disent, ni ce que je dirais maintenant, ni ce que j'aurais pu dire alors ; je suppose même que ces riens de paragraphes disent plutôt le contraire de ce que je croyais. Je n'inscris pas « penser » mais « croire »...
Pas même cela ; je n'osais pas. Caillard et Dabit étaient si supérieurs, si sûrs d'eux ! N'avaient-ils pas toujours raison ? Voyons, c'était avéré; ils étaient infaillibles. Et, tout aussi aisément que Dabit convainquit son public qu'il était « humain, compatissant », lui, l'homme le plus égoïste qui fût ! lui et Caillard me convainquirent de ma nullité en général, et, dans le cas particulier, de mon ignorance, de mon « incompréhension » de Loutreuil, au point que je leur donnai raison.
J'avais, sans le vouloir, ouvert une galerie ; il le fallait pour Loutreuil, pour Caillard, pour « le groupe » ; il fallait publier les correspondances ; je devais les présenter ; je le fis, mal, comme tout ce que l'on fait timidement. A la réflexion (elle est ancienne), Dabit eût été mieux qualifié que moi. Il n'était pas encore littérateur. Il l'était néanmoins plus que moi. Il avait ce besoin d'audience qui caractérise le vrai littérateur ; j'en suis dépourvue. Il avait la connaissance picturale. Il aurait pu, par admiration pour l'oeuvre du mort, se pencher ainsi que je le fis, sur les moindres détails de sa vie, de sa pensée, de ses pauvres, si pauvres amours.
Pourquoi donc n'a-t-il jamais arraché aux rats du Pré St-Gervais, les tristes pages copiées, annotées, classées ? J'avais proposé en 1925 que nous fissions ce livre en commun, les amis et moi, certaine que Loutreuil eût goûté cette forme. Lui, Loutreuil, qui avait organisé une exposition d' « anonymes », aidé par Perrin, le mi-fonctionnaire mi-peintre, et par Roger Dévigne, le poète journaliste (3).
[...] Quant à ceux de ma génération, ainsi que ceux du « groupe », il n'y a que moi qui végète dans l'ombre. Presque tous ont imposé leur personnalité, leur nom. Ils furent eux-mêmes, non des outils. Nécessairement, l'Atelier 61 bis, c'est avant tout Loutreuil. Bien que du temps de Loutreuil, j'aie en somme franchi peu de fois les marches inégales qui y conduisaient.
Par ironie sur le sort de mes écrits ; note pour le futur lecteur inconnu. [...] Je tenais scrupuleusement, pour un compagnon tyrannique, souvent absent, un journal minutieux, dans lequel tout se mêlait : effusions, reproches, projets, détails des travaux, comptes de maison... J'avais lu Proust dès 1919 ; je ne devais le comprendre qu'en 1924. Avec toutes les sottises et les préjugés du sentimentalisme spécifique aux natures ardentes, mystiques, désaxée par la mauvaise interprétation d'un catholicisme de série, l'horrible maladie qu'est la jalousie m'apparaissait en 1922 l'un des inévitables attributs de l'amour ; j'étais même - je le confesse - assez sotte pour croire qu'il n'était point d'amour sans jalousie.
L'on m'eût alors bien étonnée en me démontrant que certaines natures pouvaient au contraire endurer toutes les affres de la jalousie sans éprouver la douceur de l'amour. Le cas de Christian Caillard tenait entier dans ce dilemme. Or, comme il fallait avant tout respecter sa paix, assurer sa quiétude, faire que le plus léger souci ne vint troubler sa sacro-sainte activité d'artiste, je pris l'habitude de ces notations régulières. Etait-il seulement à l'académie, je laissais à l'atelier, pour le cas où il rentrerait avant moi, les puérils bulletins « d'emploi du temps », j'ai fait ceci, je vais là... vous trouverez telle chose, etc. - d'où, sans affectation, les « livres de bord » - tous brûlèrent. De rares pages furent arrachées à quelques uns.
Note pour le futur lecteur inconnu (suite !) Parmi les papiers qui doivent à ma mort entrer en possession de Jean Brunel (qui n'aime ni ne comprend aucun de mes écrits) (4), un gros volume broché, couvert de velours marron taillé dans une robe de jadis, fermés d'élégantes agrafes pour bleus de mécanos, est pourtant inscrit sous cette dénomination périmée. Mais c'est parce qu'il fut écrit lui aussi d'heure en heure au Pré Saint Gervais, dans la véranda accotée à l'atelier 61 bis.
1. Ailleurs, Champigny précise qu'elle vécut avec Christian Caillard du 1er mai 1922 à la fin de 1926.
2. L'ouvrage, tiré à 635 exemplaires numérotés, parut en avril 1930.
3. Champigny paraît confondre deux expositions distinctes. En janvier 1921 Loutreuil, avec l'aide de Charles Vildrac, organisa à la Galerie Devambez un Salon de l'Œuvre Anonyme qui réunit une centaine d'artistes. En février 1921 il participa à une exposition collective du Groupe de l'Encrier, réalisée avec l'aide de Roger Dévigne.
4. Champigny est injuste pour son ami Jean Brunel, l'un des seuls qui l'ait encouragée à faire publier ses écrits, et intervenant à plusieurs reprises auprès de Robert Denoël pour le pousser à les éditer.
[Cahier brun n° 4] Une nuit, sans doute celle du 4 au 5 décembre 1945. J'écris - il est tard - des trains roulent sur le viaduc « d'entre les deux Martel »... Et voici que je suis encore là un peu vivante - et voilà que Robert est mort - J'ai ouvert au hasard la radio - sans savoir l'heure ni chercher un poste - j'ai ouvert sur : «... diteur Denoël a été abattu au revolver au coin de la rue de Grenelle et de... L'on ignore encore les mobiles du crime. »
L'éditeur Robert Denoël , en dépit de tous les malentendus : un ami, mon ami. En dépit de ses oublis apparents, dictés par l'orgueil, je l'aimais - « Abattu », oui ce mot - pas un autre - l'on aurait pu dire tué, assassiné ; non : abattu. Alors ? Alors ce ne serait pas Cécile ? La passion ? Les folles colères de jadis ressuscitées ?
Abattu ? par un juif pour venger tous les juifs ? par un « patriote » ? un déporté ? Il aimait tant la vie, sa vie, telle qu'il l'avait façonnée, tumultueuse, aventureuse, audacieuse, téméraire, parfois équivoque, jamais monotone - il aimait tant d'êtres divers - ma pensée fait le tour. J'entrevois dans la nuit tous ces gens pour lesquels la nouvelle brutale, terrible, va réveiller des souvenirs merveilleux, des espoirs ou des haines. J'éprouve une toute particulière pitié pour son fils et, si même la main de Cécile a tenu l'arme, guère moins de pitié pour elle. Les orgueilleux sont si faibles, ils requièrent toutes les compassions. Mais... Dominique ? Oui, Dominique. Ce ne serait guère moins dans sa ligne qu'à Cécile (1) ! Robert n'avait pas d'ennemis. Il se fit aimer par des êtres bien plus dangereux que des ennemis...
Ce soir, l'on jouait je ne sais où, une symphonie de Serge Moreux, qui disait en 1928 à Marseille : « Moi, dans 15 ans, tu verras, je composerai une grande machine comme ça » [...] Certaine que l'optimisme de l'un s'imbriquerait dans les rainures enthousiastes de l'autre, je réunis ces hommes. Je crois que leur amitié dura (2).
J'imagine Serge ce soir - un Serge triomphant, un peu, rien qu'un peu, aveugle, rayonnant. Ça y est - après des années de travail, il a composé son grand tralala. Il a dit à Robert : « Tu viendras ». Ils ont ri, les yeux clos. Ils ont ri, mais hier (je crois) Robert a été « abattu » - ainsi dit-on des animaux de boucherie, des bêtes malades. A l'angle de la rue de Grenelle... et de la rue Amélie sans doute (3). Son grand corps s'est peut-être effondré dans la vitrine japonaise, parmi les joujoux ?
A terre, Europe ou Amérique, en mer peut-être, alors, en Orient, Bernard Steele a appris, va apprendre (4). Il aimait Robert, il le pleurera. Il avait tant, tant d'amis, pauvre cher Robert. Que de tourments, de querelles, de tendres retrouvailles entre nous, de 1926 à cette nuit.
Je pense à Guitte Thibon (5) dont l'amitié loyale toujours prête à endurer le mal du moment avec ses intimes, va la précipiter chez J.V. [Jean Voilier], si elle n'y est déjà. Mais je ne plains pas cette « J.V. », poupée en son, poupée de quatre sous. Sans sa fortune, son élégance, ses relations, elle ferait piètre figure - Sale milieu - chiqué, pourri par tous les vices - à part Guitte, qui est parfaite et « Titi » (6)...
Les femmes du « clan Voilier » sont de la pire espèce - « l' S.V.P.», par exemple, cette espionne... (7). A quoi utilisa-t-elle Jacques (8) ? Car elle se servit de lui sans qu'il s'en doutât, sinon elle l'aurait fait arrêter dans la clandestinité. C'était pratique. Elle savait tout. L'expérience m'amusa...
En mars 1944, le gentil snob Gérard André (résistant rose, mais enfin « patriote », encore qu'il ait surtout du sang polonais et ressemble à un prince du sang de la famille impériale de Hué), pour l'orgueil et la joie d'approcher le pouette, le poète, le divin poète Va-lé-ry... Gérard André se mit à fréquenter assidument le petit hôtel de la rue de l'Assomption (9), où il y eut toujours, paraît-il, assez de réserves de champagne pour délier un nombre appréciable de langues.
« Casse-cou, lui dis-je, ne blaguez pas. Attention, sous leurs petites allures mondaines, ces chipies vont vous sacrifier ». Il sourit. Comment résister ? Valéry lui écrivait, lui dédicaçait un volume... Ce sont là attraits dangereux... Je crois que Guitte était bien bernée. Elle est trop honnête. Elle ne savait certainement pas le puissant ressort des chipies... Par contre, sa chérie Voilier savait sûrement et devait être d'accord avec la Dornès, d'S.V.P., la Simone de Brinon (Mittre) (10) et autres...
Car tout en disant six mois plus tard à Robert, devant Guitte et son mari : « Comment peut-on s'abuser à ce point ? », réduisant ainsi l'attitude pro-allemande de Robert à une petite erreur d'optique. Je sais pertinemment que jamais Robert n'eût confié sa peau en l'an 1944, à l'une des innombrables amitiés dont il disposait : Robert disposait d'une incroyable quantité d'amis vrais, sincères. C'était connu comme un clavier - il jouait en virtuose.
Il avait obligé lui-même si souvent, parfois très sérieusement - entre toutes les possibilités de « retraites » qui se présentèrent à lui en 44, il ne fixa pas son choix d'après des considérations sentimentales. Des sentiments, des sous, du plaisir, des joies, il avait tout cela depuis des années, après la fiévreuse jeunesse endettée, quoi qu'il ait pu dire par la suite à ou devant Jacques ; simulant, quand tout était perdu pour les Allemands, indifférence pour le nazisme et sympathie pour ces « bêtas » de résistants ; je connais par coeur toutes ses idées sur la question ; j'en retrouve cette nuit des preuves, en plongeant par tendresse dans nos correspondances.
Jamais l'amour, l'amitié, la tendresse, ne parvinrent à altérer ma lucidité, bien au contraire ; il semble que, plus je tiens à un ami, plus je le vois tel qu'il est, avec tous ses éléments, et telle que moi-même me découvre et me juge, avec tous mes défauts. A d'autres, qu'on aille le dire.
R. Denoël, si germain par certains côtés, devint pro-nazi dès l'apparition de Céline, en épousant la frénésie antisémitique de Louis-Ferdinand... Ce sont là des hommes, des cas, qui seront plus tard analysés. Jamais nous ne fûmes plus intimes, proches, Robert et moi, qu'en cet hiver 1942/1943 au cours duquel, en plus des maux physiques, il me fallait soutenir la lutte écoeurante de l'ignoble procès en correctionnelle (11).
Robert fut parfait pour moi : de bonté, de douceur, d'attentions. Lui seul m'encouragea. D'ailleurs il est l'un des très rares hommes ayant eu envers moi des comportements d'homme, l'un des rares qui sut découvrir, bien que cachée profond, une féminité qu'il disait « enfantine ».
Si l'on songe que je n'avais pas vu Robert depuis les environs de Munich (12), que j'étais, par amour de la liberté et plus encore, s'il se peut, de la justice, résistante avant même d'entendre en juin 40 le nom de de Gaulle, que j'étais hérissée, révoltée contre Vichy, au courant des camps de tortures, etc. ; que, de son côté, Robert avait commencé son action en publiant Bagatelles pour un massacre, dont il me suppliait, en décembre 42, d'écouter des passages afin de me bien convaincre que les Allemands étaient suaves et mansuets (13), les sémites, cause du mal mondial ; si quelqu'un avait pu assister à nos entretiens, Robert me contant l'entrée secrète d'Hitler dans Paris, seul en voiture avec le sculpteur Arno Breker, prenant possession de la ville convoitée avec une ferveur d'amant serrant sa maîtresse (à l'étouffer, en passant...)
Robert reprenant pour la centième fois l'argument impropre tel que : « Vous qui êtes une femme intelligente, comment ne comprenez-vous pas que les Allemands sont déjà maîtres de l'Europe, qu'ils sont obligés de gagner la guerre, que le national-socialisme appliqué aux états unis d'Europe est le seul système capable d'assurer la paix, le progrès... » (Comme si le fait de me décerner un brevet d'intelligence dût nécessairement m'obstruer l'entendement au point de me faire ingérer le reste sans secousses et assimiler sans nausées !) Je luttais, je niais... J'alignais, non des arguments, mais des faits réels, connus de moi dès février 1938 à Montmorency - nous discutions ferme.
Il m'appelait sa meilleure ennemie, m'assurait, avec un rien de pitié badine, que j'étais « un enfant ignorant », puis reprenait bientôt sa thèse favorite : une charge à fond contre l'URSS. Eloquent, il dépeignait à faire frémir un coeur sensible (je ne le suis pas) les horreurs à venir ! Les armes secrètes, les invasions, les bombardements, les pays ravagés, les camps de torture et d'expériences, le monde entier croûlant dans l'ignominie fatale (eh oui...) si l'on empêchait le plus grand génie du monde, Hitler, à sauver ce monde (14).


Pages du journal de Champigny, 5 décembre 1945
1. Il est surprenant que Champigny, qui n'ignore rien des menaces qui pesaient depuis deux ans sur l'éditeur, pense d'abord à un crime passionnel.
Dominique Rolin était, depuis juillet 1942, sa maîtresse épisodique, mais il a rompu avec elle en mai 1945, ce qu'elle doit ignorer.
2. Serge Moreux [1900-1959] était présent aux obsèques de Robert Denoël, le 11 décembre 1945.
3.
Champigny n'a pas entendu clairement l'annonce radiophonique, qui situait l'agression à l'angle de la rue de Grenelle et du boulevard des Invalides. Elle croit qu'elle eut lieu à l'angle de la rue de Grenelle et de la rue Amélie, à deux pas des Editions Denoël, ce qui explique qu'elle pense d'abord à un crime passionnel.
4. Champigny a perdu tout contact avec Bernard Steele depuis qu'il a quitté la France en mai 1940. Elle ignore qu'il est rentré à Paris depuis la Libération, qu'il occupe un bureau à l'ambassade américaine, place de la Concorde, et qu'il a revu Denoël à plusieurs reprises au cours des semaines qui ont précédé sa mort.
5. Marguerite Delsol [1902-1981], l'épouse de JacquesThibon, était l'une des seules amies d'enfance de Jeanne Loviton.
6. Non identifié.
7. Yvonne Dornès [1910-1994], la maîtresse de Jeanne Loviton, était directrice de « S.V.P. », société de services créée en 1935 par Georges Mandel.
8. Jacques Thibon [1900-1974], le mari de Marguerite Delsol, était directeur des Papeteries Job.
9. Le domicile de Jeanne Loviton à Passy.
10. Simone Mittre [1897-1981], était rédactrice au Journal des débats, où Jeanne Loviton publia ses premiers articles. Durant l'Occupation, elle fut la secrétaire de Fernand de Brinon. On connaissait les relations mondaines de Jeanne avec l'ambassadeur de Brinon, mais on ignorait le lien qui les unissait : c'était sa secrétaire, une autre « chipie » du « clan Voilier » que Champigny dévoile ici.
11. Champigny passa en chambre correctionnelle à Gourdon le 16 mars 1943.
12. C'est-à-dire en septembre 1938, date des « accords » signés entre l'Allemagne et trois pays européens.
13. Néologisme forgé à partir de « mansuétude » : indulgents.
14. J'ai du mal à imaginer Robert Denoël se lançant dans une telle diatribe, d'autant qu'il avait connu, adolescent, les « bienfaits » de l'occupation allemande à Liège. Il est vrai que les succès guerriers des Allemands n'avaient jusqu'alors pas connu d'éclipse. A partir de février 1943, date de la défaite de Stalingrad, les collaborateurs et « attentistes » se firent plus prudents.


Robert Denoël en 1928 et en 1944
[5 décembre 1945, suite] Quand nous étions enfin las de discuter, nous nous embrassions tendrement, non sans rire, et nous lancions dans les délices de la conversation. Nous ne nous sommes jamais lassés de parler ensemble. Comme j'aime la conversation par-dessus tout, hormis la lecture - que je suis incapable de goûter les réunions nombreuses, les jeux, les divertissements salonniers, j'éprouvais un plaisir sans mélange avec quelques hommes qui possédaient alors, autant que moi-même, l'appétit de longs contes que chacun fait à l'autre.
Ce mode de plaisir exige nécessairement du temps - peu de gens savent parler - mais encore savent écouter. Je fus toujours étonnée par la tristesse qui se dégageait d'un cercle de gens, au demeurant point trop imbéciles, qui, réunis, dépassent rarement dans leurs propos les genres patronnage, voyageur de commerce... C'est simplement qu'ils n'ont point le goût du dire - nous l'avions - il avait plus de lecture que moi - j'avais plus d'expérience - l'accumulation d'aventures réellement vécues, partageables par le récit ...
Quand nous nous revîmes en 42/43, retranchée depuis des années de la société, de toute activité, n'étant plus en contact qu'avec un très petit nombre d'individus, je n'apportais plus ces contes fous d'autrefois, renouvelés au jour le jour par le seul dépôt de la vie... Lui qui avait gagné en activité, endossant mon rôle de 1926 à 1932, il contait des anecdotes, mais la vie de Paris, les écrivains, les journalistes, l'édition, le monde, le théâtre, les aventures amoureuses, les drames aussi... le tout agrémenté d'un peu de psychanalyse...
A moins de puiser dans les richesses passées, et Dieu sait qu'il en était encore de magnifiques, d'inexploitées, délaissant la vie, les aventures... C'est toute mon expérience de solitude recueillie, de recherches spirituelles, de tourments mystiques, que je lui confiais ou exposais, sans oublier les lectures... Nous nous quittions trop tôt à notre gré, toujours ; empressés à nous revoir.
En général, j'aimais de lui écrire les nuits qui suivaient nos entretiens. J'inscris ici, puisque je vis toutes ces heures depuis hier avec son souvenir, qu'il me donna bien des joies. Lorsque Catherine, Cécile ou d'autres, soulevèrent des incidents entre nous, nos faiblesses voulurent que nous fissions ainsi que si nous étions stupides ou ennemis. C'étaient réactions de colère chez moi, d'amour propre blessé chez lui.
Il nous plaisait au contraire de constater que jamais nous n'avions eu un grief absolument personnel. Nos injustices et invectives récriproques rempliraient des volumes. J'eus souvent tort par véhémence verbale ou écrite. En acte, je ne peux rien me reprocher envers Robert. Par contre, lui m'offensa cruellement par de petits accrocs que j'élargissais sans indulgence au lieu de les minimiser.
Mais il est sans exemple au cours de cette durée amicale, parfois tumultueuse, qu'il n'ait pas tenté de réparer, ou même très bien réparé, les peines qu'il m'avait faites, en général pour avoir la paix avec Cécile, autrefois, ou quand son amour propre était irrité. C'est ainsi qu'en 42, apprenant que je suis à Geoffroy St Hilaire (1), il m'écrit qu'il n'est pas mon ami !
C'est l'époque où j'ai vu tour à tour, tous ceux sur lesquels je comptais le plus, m'oublier, me renier. Ceux qui, naturellement, exposent haut et bien en vue, la beauté de leur attitude, leur grandeur envers ma misère !!! Je ne veux citer personne cette nuit, ni préciser davantage. Les survivants qui me connaissent « pour de vrai » sauraient, s'ils lisaient ceci, que je dis vrai.
Donc Robert écrit qu'il n'est pas mon ami - en pneu - ça va plus vite - Mais il me téléphone avant que je reçoive le pneu. Le lendemain, il arrive, précédé de livres, bourré de cigarettes, accompagné de fleurs. Nous pleurons d'abord - mais sentons que nulle parole de nous, nul jugement d'autrui ne changera l'essentiel, qui est de nous aimer, d'avoir un passé plein de souvenirs, de presque tout savoir et comprendre l'un de l'autre.
Tout de suite nous sentons que nous sommes heureux, si heureux d'être ensemble, qu'il faudra pour le « temps de Paris » nous efforcer d'y être (ensemble) le plus possible. Ce qui fait qu'après la clinique, il me loua une chambre à deux pas de chez lui (2), à deux pas de... cet angle de la rue de Grenelle où l'autre soir, sa vie a pris fin, ainsi qu'en 1928 finissaient les cauchemars qui lui donnaient la fièvre.
Il luttait, se débattait, souffrait : c'était la prison. Il parvenait au réveil plutôt qu'il s'éveillait. Il ouvrait des yeux glauques, d'agonisant, nous regardait sans nous voir, puis se resaisissait en murmurant que c'était effroyable, que l'on tentait de l'assassiner... Comme il menait alors une vie follement déréglée, qu'il était couvert de dettes, ses soucis lui donnaient plus d'une hantise. Mais j'attribuais surtout son cauchemar, toujours pareil, si épouvantables qu'en fussent les variantes, à son goût morbide, ridicule, pour les romans policiers (3).
Jusqu'ici, mes observations (insuffisantes parce que le nombre me manque) ne me livrent pas mourant de maladie un seul homme goûtant cette abjection écrite qu'est un roman policier. Si l'on me répond que ce goût est répandu, je peux rêvasser longtemps, faute de savoir compter sur les millions de morts dare dare des années 40 à 45, et ça va continuer. Mourir dare dare, voilà, éviter la maladie, le vieillissement, les horribles sujétions physiques et morales, de l'âge. Mais c'est merveilleux...
Je plains Robert quand je pense qu'il désirait mourir à 80 ans, tout environné de femmes et d'enfants ainsi qu'un patriarche (4). L'espace de quelques secondes, son regard glauque dut contenir le désespoir absolu. Mais il a échappé à tant d'autres douleurs qui le guettaient... Je voudrais tout savoir de ce qui s'est passé. A moins d'un hasard, je ne saurai rien pourtant. L'on faisait un tel silence sur lui depuis juin 44... Il était dans des épaisseurs de brouillard cotoneux. Va-t-on maintenant reparler de lui ?
Fin mai 1944, exactement, le lundi de la Pentecôte, il m'écrit assez longuement : « Je vous écris tout cela, qui a un air de confession ou de testament » (5). Je viens de relire encore cette lettre tant prémonitoire. Mes sentiments pour Robert, l'immense peine de me dire que c'est fini, je croyais si bien mourir sans le revoir, et voici qu'il me précède...
Je n'avais rien écrit, rien remémoré depuis des mois... Parce que je pressens que sa mort est liée à tout un réseau de mystères, je veux inscrire ici en son entier la lettre de Pentecôte. Si je savais dessiner, j'esquisserais des silhouettes.
C'est fini - il n'y a plus de Robert Denoël ; dans le petit mot qu'il me fit passer fin 44 (6), toute une amertume qui lui était jusqu'alors étrangère. Nul ne fut plus optimiste, confiant, ni ne se considérait plus comblé. Des ennemis ? possible. Je crois qu'il sera surtout regretté. Barjavel coeur de rose ne m'a pas écrit depuis près de 18 mois. A qui donc mieux que moi pourrait-il parler de notre ami ? Mon coeur, si las, est lourd d'une peine nouvelle. L'univers est bien changé depuis hier. Je ne le concevais pas sans Robert.
1. Champigny a séjourné à la clinique Geoffroy St Hilaire du 13 octobre au 8 novembre 1942.
2. Denoël lui avait loué, du 9 au 30 novembre, une chambre au Grand Hôtel Leveque, 29 rue Cler, entre la rue de Buenos-Ayres, où il habitait, et la rue Amélie, où il avait ses bureaux.
3. Voilà une information inattendue. A aucun moment, Denoël n'a manifesté un goût particulier pour les romans policiers. Son catalogue en est complètement dépourvu. Mais il en vendit entre 1928 et 1930 dans sa librairie des Trois Magots, avenue de La Bourdonnais, que Champigny évoque ici. On voit, rétrospectivement, quelle autre carrière éditoriale il aurait pu mener, s'il avait rencontré Georges Simenon à ses débuts... Le romancier liégeois avait de toute façon un autre plan de carrière qui était de confier ses premiers romans à un éditeur bien en place, et non à un débutant désargenté, même compatriote.
4. C'est, exactement, l'image de son père, Lucien Denoël, entouré de ses quatorze enfants au début des années vingt.
5. Ces mots se retrouvent en effet dans la lettre que lui adresse Denoël, le 29 mai 1944 [voir Correspondance]. Champigny l'a encartée à cet endroit de son journal.
6. J'ai publié cette petite lettre, encartée à la suite de la précédente, en la datant de septembre 1944 : une lettre à Jean Rogissart datée du 20 septembre contient les mêmes éléments [voir Correspondance]. C'est le dernier courrier qu'elle reçut de lui.

Ultima verba, septembre 1944
Nuit au 28 au 29 février 1946. Que dire de tous ceux qui brandissaient bruyamment le terme « ami » ? Quelle conjuration du sort voulut qu'unanimement, qu'ils se connussent ou s'ignorassent, tous adoptassent envers moi une attitude pire que l'oubli, celle qui me laissait aux rares nouvelles, sans entendre des reproches ?
Quand je pense à d'Aubigné (1) à Paris ne me visitant même plus quand j'étais malade, me rebuffant avec une incroyable dureté le jour où je lui demandais un certificat pour mon camarade parachutiste, puis, plus tard, accueillant à bras ouverts - sous les auspices de Christian Caillard - une Catherine qui ne voyait qu'à travers Robert Denoël les événements tragiques de ces années, une Catherine qui hurlait ici « Heil Hitler ! »... qui gueulait contre « ces salauds d'Anglais et ces salopards de maquisards »...
Une Catherine qui, par des aventures saphiques, feignait provisoirement le ton résistance. Dérision ! Mais voilà, son sourire lorsqu'elle n'est pas ivre est encore charmant ; sa silhouette était plaisante sous les vêtements de Françoise ; n'ai-je donc jamais connu un homme de réelle valeur puisque je n'en connus jamais un seul assez de sang froid, assez intelligent, assez psychologue, pour discerner le valable de la comédie.
Christian lui-même... Nos conflits personnels n'égaraient pas mon jugement ; ses qualités me restaient précieuses ; je m'y accrochais ; toute mon estime de lui y était suspendue. Je le savais avare. Bon. Mais je le croyais d'une intégrité absolue, je supposai longtemps qu'il avait gardé la cristalline pureté de la jeunesse.
Il méprisait Germaine Cellier au point d'être affreusement injuste envers elle. Il ne voyait pas, se refusait à voir les réelles qualités de coeur de Germaine. Mais, lorsque Germaine Cellier, entraînée dès 1933 ou 34 dans sa liaison avec Pierre Schaub (le metteur en scène maintenant « Olivodien ») dans le tourbillon parisien qui assoiffe d'argent les petites filles faibles, lorsque Germaine Cellier, fille de paille de tout le marché noir des laboratoires honorables Roure Bertrand (Grasse, Argenteuil, Neuilly), devint une habituée des meilleurs restaurants clandestins, gagna beaucoup d'argent, arrosa de parfums exquis et ruineux des coquettes qui auraient pu se les payer mais étaient flattées de les recevoir, lorsque Germaine (logée 19 rue de Lille chez le peintre Jean Oberlé (2), si secourable aux Français, leur chantant de la chère B.B.C. londonienne les spirituels couplets du petit Van Moppès) (3), donnait à souper au capitaine allemand Philipp et devint, de ce fait, utile aux chercheurs d'ausweis, alors, à ma stupéfaction, le même Christian s'avisa que Germaine était une bonne fille ! qui devint par la suite une fréquentation assidue car elle répandait l'argent, était bien habillée, donnait de fins soupers.
L'hiver 1942/43, Robert Denoël me rendit, et me rendit seul, d'appréciables services d'argent et m'entoura de tendresse, un comble de prévenances. Avant de quitter Paris, je lui offris en échange - encore qu'il s'en défendît très fort, mais j'y tins - la pochade sur panneau de bois par Loutreuil représentant une vieille femme que j'aurais pu devenir (mais j'ai vieilli autrement !) faite en 1924, je crois, au Pré St Gervais. J'y ajoutai plus tard la belle édition Elzevier des Mémoires de Ph. de Commynes, l'originale des Fables de Gay et une jolie édition avec planches des Fables de La Fontaine. Il n'en reste pas moins que Robert n'attendait rien, protesta affectueusement devant la « somptuosité » des dons, en regard du peu qu'il estimait avoir fait. Ce peu était énorme. Il m'avait donné un grand mois de repos absolu dans le confort si rare durant l'Occupation, et plusieurs mois d'assistance.
Robert, donc, après une coupure de quatre années dans nos relations, coupure due en apparence aux disputes autour de mon vieux manuscrit mort-né « Ecris-moi » mais, en réalité, issue des blessures d'orgueil de sa vie conjugale, Robert avait, cet hiver-là, pris le parti de m'arracher (c'était sa volonté et je cite ainsi son mot) à mes angoisses, afin que je travaille un peu dans le calme. C'est pourquoi, bien que peinée de quitter Paris le 1er mars 1943 dans le but d'affronter l'aventure correctionnelle à Gourdon, je réintégrai Mézels pleine d'espoir, résolue à me mettre avec feu aux travaux prévus, envisagés avec Robert Denoël à Paris si je n'étais condamnée par le Tribunal de Gourdon pour les imbécillités de Vichy.
1. Le docteur Robert Merle d'Aubigné [1900-1989], chirurgien qui eut à soigner Champigny entre 1931 et 1942.
2. Jean Oberlé [1900-1961] était l'un des
speakers de Radio-Londres, à qui l'on doit le slogan fameux : «
Radio-Paris ment, Radio-Paris est allemand ».
3. Maurice Van Moppès [1904-1957] intervenait dans l'émission « Les Français parlent aux Français » pour laquelle il écrivait des chansons « patriotiques ».
[29 février 1946, suite] Le jour fatal de Gourdon arriva. C'était le 16 mars [1943]. Pendant 12 jours je vis alors Catherine plus souvent qu'en dix ans. J'avais alors la chance de posséder 8 pilules de cyanure, 6 pour moi, 2 pour Doudou ; je n'avais pas pour rien répandu le tract « Comment ils les tuent » (1).
Dès alors et depuis longtemps, je savais sinon tout - il fallut à chacun 1945 pour savoir - mais assez, des camps allemands. Condamnée par Vichy, c'était leur être livrée en franchise. Je ne me sentais pas le courage d'affronter pareil enfer. Catherine le savait. Elle assista à tous mes petits préparatifs d'ordre.
Papiers brûlés, dossiers rangés, rédaction du testament. La chaumière de Mézels et tout son modeste contenu lui étaient destinés. Elle assista à tout, très intéressée. Elle ne joua nulle comédie sentimentale, et, je lui en rends justice, n'éprouvant nulle tendresse, du moins n'en joua pas la feinte. Son amie Martine (la couplée d'alors et mère de celle qui suivit) était allée à Paris porter à mon avocat des papiers urgents impossibles à transmettre autrement, la « ligne » existant encore. Catherine et Olga passèrent ici la nuit du 15 au 16. Le soir du 16, après l'ignoble séance en Correctionnelle (atroce pour moi mais ignoble pour la magistrature française, séance dont j'écrivis les détails brûlés plus tard, quand je risquais l'incursion de la Gestapo) la Maison du chien nous accueillit.
Une lettre de R. Denoël était arrivée l'après-midi. Je la lus. Elle était réconfortante. Emue, je racontai alors toutes les affectueuses bontés prodiguées par Robert au cours de ce triste hiver. Catherine, fort pauvre alors, couverte de dettes, résolut sur l'heure de l'aller trouver. Il la reçut avec tendresse. Il lui assura aussitôt un appui financier qui lui permit de se lancer dans le marché noir, ce qu'elle appelait pompeusement son labeur de retour à la terre ! Tous marchaient... ou faisaient semblant puisqu'ils étaient ses clients, heureux d'être ravitaillés.
Aussitôt, Robert cessa de m'écrire ; espaça ses lettres, plus exactement, changea de ton ; oublia nos projets de travail. Pour moi... il ne s'agissait tout court et pas moins que de ma vie. Presque rien, quoi. Catherine, certaine de ma désapprobation, espaça ses visites. Je ne la revis plus que pour assister à quelques uns de ses drames sentimentaux.
L'hiver vint. Robert, désenvoûté de l'influence de Catherine, se ressouvint de nos projets. Je repris espoir. Mais quand je revis Robert à Paris en mars 44, encore écrasée par la perte de Doudou, Catherine venait précisément de faire un stage chez lui. En sorte que je me heurtai à un ami encore une fois influencé, transformé. Je dus même, sans sourciller, l'entendre parler du labeur admirable de Catherine - lequel consistait à stocker des jambons de 1800 F pour les revendre 6000, et tout à la même échelle -, de son courage, de ses responsabilités, de ses risques !
Le courage ? Jossling Reuling (2), l'écrivain hollandaise, ex-amie de Catherine, était arrivée à Paris avec une amie juive. La juive avait rejoint Genève. Caillard et Germaine avaient procuré de fausses cartes d'identité. Ce qu'ils n'eussent pas fait pour moi, résistante, travaillant seule depuis 1941 à mes « risques » (oui) à un moment où j'avais tellement besoin d'aller en Suisse ! La juive avait un peu d'argent. Le change se fit aisément. Caillard implanta solidement une Catherine admirable résistante, recevant des réfractaires étrangères !...
Chez les Merle d'Aubigné, un banquier ami de Merle, changea l'argent. Catherine encaissa. Au cas où cela eût été insuffisant, les Merle ouvrirent tout grand leur bourse et leur coeur à la résistante Catherine mais il ne leur serait pas venu à l'idée de m'envoyer des médicaments nécessaires, ne leur coûtant rien. La modestie de ma vie et de mes actions leur eût fait ranger ce don dans le domaine d'une sensiblerie personnelle hors de saison, tandis qu'avec Catherine, Dieu merci , l'on était dans le social ! Ah ! la bonne plaisanterie.
Pour des centaines de faits de ce genre dont j'eus la faiblesse de souffrir et le mauvais goût de le confesser, s'est créée la fameuse légende de Champigny-la-persécutée. Le suis-je ? Suis-je tout à fait folle ? En quoi ai-je démérité ? [...] La nuit, la vie, se terminent. J'ai aimé pour rien. Souffert de tout, par tous, pour rien. Nul esprit attentif n'est en souci de cette vie endolorie. Pas une tendresse ne dirige sur moi son élan. [...] Je n'ai plus de chien. Je n'ai pas d'amis. Je meurs lentement d'absence de tendresse et de joie, mais je puis encore tracer un nom avec des larmes qui ne sont que de douceur.
1. Ailleurs dans ses cahiers, Champigny précise qu'elle a répandu ce tract « au cours de l'été 1942 ».
2. Josine Reuling, née le 29 septembre 1899 à Amsterdam, fut l'amie de coeur de Catherine Mengelle entre 1936 et 1940. Elle revint à Paris en 1942 en compagnie d'une amie juive, et retrouva Catherine à Broche. Il semble qu'elle eut quelques activités dans la résistance lotoise : Champigny, qui l'accueillit chez elle en juillet 1944, parle de « Josseline Reuling, dite Dinning, dite alors Simone X ». On la retrouve à la Libération au consulat de Hollande à Paris. Elle est morte dans une maison de repos d'Amsterdam le 19 octobre 1961 [renseignements dus à Michel Fincoeur].
[Avril 1946] [...] Il est impossible, qu'unanimement, tous les êtres se soient détachés de moi sans raison ; depuis 1935 à ce jour, j'ai presque constamment vécu éloignée de Paris, où se trouvaient réunis tous ceux qui composaient mon univers affectif ; comme tous étaient beaucoup plus jeunes que moi, il est difficilement admissible de croire que les complexions de l'âge soient entrées pour beaucoup dans leur changement ; pour plusieurs, les modalités d'existence furent grandes ; les riches se virent appauvris, redoutèrent de devenir vraiment pauvres... d'autres, au contraire, connurent une soudaine opulence succédant à une médiocrité tranquille ; motifs insuffisants, encore qu'il soit fâcheusement courant, « humain » (dit-on) d'écarter de sa route ceux qui connurent vos humbles débuts.
Ainsi Robert Denoël évoquait avec des ravissements amusés ses années de dèche ; entre nous, dans l'intimité de ce tête-à-tête qu'il exigeait si jalousement, je ne m'y trompais pas. Si j'avais été bien portante, bien habillée, parée d'un rien de ces imbéciles succès d'une saison, à l'aide desquels on bluffe dans le monde pendant dix ans de suite, en spéculant sur l'universel snobisme, Robert m'eût présentée avec fierté à tous les gens en vogue qu'il fréquentait depuis qu'il n'était plus harcelé par les huissiers.
Mais ma pauvreté, mon obscurité, insultaient comme une tache sur un bel habit neuf aux réussites du jour, et Robert me tenait bien cachée ! alarmé que je puisse, sans indiscrétion, attirer l'attention sur son passé miteux rien qu'en osant badiner sur un détail de rien. [...] Il faut appliquer à presque tous ce que j'énonçais plus haut sur Robert Denoël. Je l'ai maintes fois noté, le trait par laquel se ressemblent les hommes de notre époque, si différents que soient leur caractère, leur milieu d'origine, leur éducation, est la lâcheté.
D'où que vienne le concours de faits qui accablèrent mes dernières années, l'injustice en est telle que, me voyant repoussée de tous, honnie par tous, je me suis abandonnée moi-même donc condamnée. Je ne meurs pas des deux catastrophes physiques : l'accidentelle vertébrale qui comprime la moëlle épinière, la bacillaire avec ce [?] des Nouvelles Hébrides qui me ronge le cervelet (1) - je meurs de désespoir.
1. Paludisme, tétanos, choléra, fièvre typhoïde, les bacilles rapportés des îles du Pacifique par les Européens ne manquent pas. Pour Champigny, qui le désigne sans doute d'un nom indigène, on ne sait exactement lequel l'a infectée en 1936.
[Mai 1946] Je ne sais pas ce que devint Robert Denoël à partir d'août 1944. Tant que je le vis les dernières années, il avait gardé ce goût de la conversation qui n'est point bavardage mais réellement échange. Non, pourtant. En mars 1944, menacé, soucieux à juste titre, il était déjà un peu différent.
Le mari de Marguerite (1), le type de l'honnête bourgeois sans vraie culture, mais intéressant jusqu'alors par son côté actif, moderne, d'homme d'affaires, bon vivant, gai, joyeux partenaire, agréable camarade - lui, s'est tellement pris au sérieux pendant la clandestinité - il a... bourgeoisement, patriotiquement résisté - ouais - en utilisant pratiquement l'autre tableau - fin 1941 il était encore drôle, gai, secoué de rire autant que d'emphysème. En 1943, tout changé déjà - plus une conversation possible - nos derniers rapports en 45 se bornent à deux visites qu'il eût pu faire longues (2). Il monta l'allée du jardin, parlant de départ avant de m'avoir saluée - joua chaque fois 1/4 d'heure avec mon chien, s'en alla sans qu'une parole sensée eut été échangée entre nous...
1. Jacques Thibon [1900-1974], directeur de la Société des Papeteries Job, avait épousé en 1936 Marguerite Delsol [1902-1981], l'amie de jeunesse de Jeanne Loviton. En octobre 1946 Thibon déclara à la police qu'il connaissait Denoël « depuis plusieurs années » et qu'il lui prêta, en juin 1945, une somme de 300 000 frs « pour la bonne marche des Editions de la Tour », somme qui lui fut restituée « fin novembre ». Albert Morys affirma au même policier que Denoël « traitait avec lui des affaires de papier au marché noir », ce qu'il devait bien savoir puisque c'est lui qui s'occupait de cette maison d'édition.
2. Jacques et Marguerite Thibon habitaient Meyronne, à 15 km de Mézels.
[Début juin 1946] Je crois que Lanza del Vasto, si j'avais l'heur de le rencontrer une seule fois, me sauverait, me libérerait - en dépit des disciples esthètes, il est pur, pur ; des gens comme Barjavel qui peut-être l'apprécient partiellement sans faire cas de sa lumineuse personnalité, le voient tous les jours... (1)
1. Après Le Pélerinage aux sources, en novembre 1943, Denoël a publié Principes et préceptes du retour à l'évidence en septembre 1945. René Barjavel était, depuis 1945, directeur littéraire des Editions Denoël.
Soir du 29 au 30 juin 1946, 23 H 37. [...] Je voulais écrire à Barjavel. Je le sens si amer, touché par ces six années qui aboutirent pour lui à la perte de Robert - à la perte de son tendre amour (1). J'ai autrefois si durement, si violemment combattu son mariage idiot que la pudeur m'oblige à la plus grande réserve... Tiens, ai-je jamais connu, rencontré, un couple réellement heureux ? Non.
1. René Barjavel a épousé Madeleine de Wattripont [1915-2005], d'origine belge, le 10 octobre 1936, mais ce n'est pas d'elle dont il s'agit ici. Le 25 février 1944 il écrivait à Champigny : « En décembre dernier, j'ai rencontré une petite fille rieuse, passionnée, vivante, intelligente, à qui je n'ai pas besoin de dire deux mots pour qu'elle me comprenne. Je n'ai rien su cacher à ma femme. Hélas, je ne sais pas mentir. Drame, scandale. Départ. Et loin de mes enfants je me suis senti perdu. Et quand je rentre chez moi j'y retrouve la solitude et la tristesse. [...] Peut-être cet amour d'adolescent qui m'a si brusquement empli le coeur s'éteindra-t-il, et je retrouverai la paix dans le travail. S'il dure, si la petite fille que j'aime s'en montre digne, je finirai pas m'en aller de chez moi, pour essayer de revivre, quand les circonstances plus paisibles ne me laisseront pas l'impression d'abandonner mes enfants en pleine tempête. »
[Début juillet 1946] A Paris, quand le docteur Chabassus (1) me soigna au cours de l'hiver 42/43, le droguage massif qu'il m'imposa me redonna rapidement une éphémère vitalité. Bien que toutes les prises de sang eussent donné des résultats négatifs, il s'entêta (et je consentis) à me faire une série de piqûres anti-syphilitiques ! prétendant qu'il était impossible qu'un cerveau travaillât dans une telle constante surtension sans que cette exaltation à froid fût le signe d'une parcelle microbienne héréditaire ; il avait tort et raison.
Le bacille n'était pas celui de la syphilis mais celui que charriait mon sang empoisonné par le shizente de [un mot illisible] precox (dit des Nouvelles Hébrides) que nul alors en France ou ailleurs ne savait soigner - le microbe ainsi combattu, j'eus l'étonnement d'assister en moi à une sorte de renaissance cérébrale.
Tout ce que j'écrivis alors est perdu puisque, sur sa demande, j'écrivais presque exclusivement pour Robert de longues pages, des cahiers parfois, écrits d'un seul jet, au cours d'une nuit, que je lui remettais quand il arrivait le soir, tendre, joyeux et si amicalement protecteur. Je peux bien le dire, ces cahiers l'enchantaient ; il ne se lassait pas de lire, de découvrir ce monde d'idées que je remuais, il se promettait d'en utiliser beaucoup... (2)
Je retrouvais une activité intellectuelle, je me croyais à nouveau (quelle illusion) capable de travailler régulièrement. Malheureusement, le traitement du docteur Chabassus ne jouait pas exluisivement sur mon mental ; parallèlement aux soins susdits, un autre traitement, non moins massif, glandulaire celui-là, redonnait à mon personnage croûlant une dangereuse jeunesse.
Le traitement glandulaire ne s'était pas borné à réactiver des surrénales déficientes. Ce mélange frais d'hypophyse, thyroïde, ovaire, avait du même coup relancé la créature dans son expression la plus intense, dans sa véritable façon d'être du temps où elle était vraiment ; je m'étais, du jour au lendemain, vue submergée d'abord par des bouffées puis par des vagues d'amour.
Si je m'étais enfoncée dans la solitude, si j'avais sincèrement cru que c'était choix délibéré, c'est au contraire que j'avais tout simplement obéi par force aux lois physiques de mon désordre organique, c'est que les opérations subies, mutilant mon corps, le vieillissant vingt ans avant la norme, avaient tari mes sources affectives. Ce ne fut pas sans effroi que je me découvris amoureuse ! et amoureuse d'un homme qui m'avait tour à tour aimée, détestée, qui avait désiré ma jeunesse, qui aimait encore d'une délection toute particulière un esprit auquel il prêtait quelque charme et beaucoup d'intérêt.
Mon état d'amour se posa sur Robert, seul être avec lequel j'eusse une véritable intimité morale, seul homme qui se conduisit envers moi en homme, me traitant, en dépit de l'âge accru par mille souffrances, ainsi qu'il eût traité une femme jeune et désirable. Je ne lui célais pas des sentiments tardifs, issus d'un état déterminé.
Nous en parlions sans feinte ni gêne, bien qu'avec infiniment de pudeur. Je n'étais pas dupe de mon état sentimental. J'aurais pu lui cacher qu'il m'advint même d'éprouver des désirs tant le traitement Chabassus avait renormalisé ma féminité déchiquetée, anéantie par des interventions chirurgicales inutiles, inappropriées, et des années d'existence anormale.
Heureusement, bien que jeune, il avait acquis à la faveur de la psychanalyse une expérience qui lui permettait de comprendre les problèmes en question, de les situer à leur véritable place, transposant sur son personnage actuel mes énergies amoureuses du moment, ainsi que le psychanalisé sur son psychanalyste. Je lui écrivis en détail, à la suite d'un rêve très joli, tout ce que j'éprouvais, avec un navrement amusé.
Bien qu'il vît presque aussi clair que moi dans l'aventure, qu'il sût et comprît que je subissais un réveil organique qui sublimait des instincts sexuels refoulés par seize ans qui n'avaient rien accordé aux sens, murant toutes les poussées de la libido en une apparence d'amour, il ne put s'empêcher d'en être ému, touché ; notre amitié s'en nuança de tendresse, ainsi que cela nous était déjà arrivé quelques jours en 1935, la semaine d'août (3) où je vis sur Paris un si beau météore et, tant que Catherine n'intervint pas entre lui et moi pour brouiller nos rapports (en quoi elle excellait, je lui ai maintes fois rendu en passant cette justice !), Robert garda pour moi et me témoigna cette forte tendresse qui subsiste parfois après l'amour entre certains amants devenus avec le temps de véritables amis.
En 1943, sachant trop bien que mon physique ne gardait plus aucun charme capable d'inspirer à un homme une parcelle de désir, sachant aussi que l'homme d'Occident est incapable d'amour en dehors du désir, sachant donc que j'étais à tout jamais retranchée d'une forme de vie normale, je me gardai bien de poursuivre plus avant la méthode Chabassus ; certes, elle revalorisait ce qui me restait de vie mais à quoi bon entretenir un état capable de susciter des désirs sans aboutissement possible.
Lorsque j'entrepris seule la téméraire désintoxication de 1945, j'eus recours à nouveau pour tenir debout, aux glandes, mais non plus tranformées déjà par la dessication à froid et prises en cachets, mais, sans contrôle, sans mesure, par l'avalage abject, à cru, de ces produits puissants, ce fut épouvantable. Nulle présence ne s'offrait qui pût sublimer cette fois les instincts, muer les poussées exigeantes et complexes de la libido en sentimentalité amoureuse, voire même en simple état d'amour. Revigorée physiquement, affamée après des mois de jeûne, je subis, épouvantée, un état qu'à nul au monde je ne pouvais confier. Les rêves les plus lubriques et les plus fous désespéraient mes réveils.
Dormir si peu et dormir pour ça ? Quelle punition ! Moi qui avais pu chérir des êtres de toutes mes forces, de tout le meilleur de moi, sans être à leur côté animée par les désirs sexuels, moi qui avais dû certainement décourager l'homme en sa virilité parce qu'incapable de feindre et incapable d'éprouver ce plaisir dont on ne sait pourquoi l'homme s'ennorgueillit tant, voilà qu'il me fallait, vieille, laide, assoiffée de sagesse, de chasteté, de spiritualité, connaître tous les démons qui font du solitaire maniaque un misérable malade. Ah quelle période, quelles luttes, quel dégoût, quelles souffrances, et combien je sais tout ce qu'exprime le mot désespoir. Mieux valait tout, mieux valait mourir.
1. En octobre 1942, le docteur Chabassus a traité Champigny à la clinique St-Hilaire, 59 rue Geoffroy-Saint-Hilaire, Paris Ve.
2. Une sorte de pacte a été scellé en décembre 1942 entre Champigny et Denoël, qui se promettait de publier ces cahiers. Une note de décembre indique : « Toutes les pages qui manquent ici, non détruites par moi, ont été perdues chez Denoël ».
3. Les lettres que Denoël envoie à Champigny en août et septembre 1935 montrent en effet qu'une amitié amoureuse s'est nouée entre eux (voir Correspondance).
[Juillet 1946] [Champigny énumère ses amis, ses amours disparus :] [...] Robert, auquel je laisse le nom d'ami en dépit de son dernier « repli » depuis l'été 44 (1). Mort ou vivants, pour tous, tendresse et paix.
1. Champigny ne pardonne pas à Denoël d'avoir trouvé refuge chez Jeanne Loviton, « cette élégante faisane mûre » qu'elle a en horreur, alors qu'elle lui avait proposé de l'héberger.
[12 décembre 1946] Un ami de mon père fréquentait assidûment notre maison de Buzançais où je suis née. Ruiné par son père, il n'avait pu opter librement pour la carrière de son goût. Il peignit pour sa seule joie jusqu'en son extrême vieillesse de petites peintures poétiques signées « Georges Ay », nom sous lequel je le connus toujours. Il venait chez mes parents presque tous les jours. Tandis que ma mère et « Bédine » préparaient le dîner, que mon frère jouait, Georges Ay dessinait le modèle toujours sage que j'étais.
Un soir où Georges Ay dessinait le bébé assis dans la chaise haute à courroies, je dis soudain pour la stupéfaction générale, tendant les bras vers l'objet de mes premiers désirs : « Un crayon pour écrire ». Les mots furent certainement écorchés. Néanmoins ils étaient nets, compréhensibles. J'aspirais à un crayon et, bien que je visse Georges Ay dessiner, je savais déjà qu'un crayon sert pour écrire ; je ne désirais pas le tenir, je désirais écrire ! Ma destinée entière était inscrite en mon cerveau neuf (1).
Un groupe humain avait possédé tous les secrets de mon enfance, comme tous ceux de ma famille. Mais, à l'époque où je vécus mêlée à ce groupe, dans une extraordinaire atmosphère de bohème familiale, j'étais trop petite, trop sotte, trop apeurée, trop prisonnière. La famille Bourdier habitait Buzançais. Après son veuvage Béguet, c'est-à-dire Mme Bourdier, vint à Paris avec ses quatre enfants [...] rue de Charenton où j'étais reçue du samedi au lundi matin, chaque semaine, et pendant les vacances, de 1906 à 1908 je crois, période succédant à la provinciale existence vécue chez ma tante depuis la mort (2) de ma mère (1900) jusqu'à l'été où j'écrivis à mon père (1905 ou 1906) qui « m'enleva » de Senlis (il avait le goût des enlèvements !), me fit entrer, interne, au pensionnat « Jeanne d'Arc » à Maisons Laffitte ; excellent établissement, garni de fillettes de toutes les nationalités, ce qui influença très jeune mon penchant international, développa la curiosité des pays d'origine de mes compagnes, curiosité déjà si fort alimentée par les relations de voyages en vogue aux alentours des années 1900.
Bien que je l'aie noté ailleurs, ce me semble, je veux aujourd'hui revenir sur le fait auquel je dois sans doute tout le déséquilibre de ma vie, parce qu'il me semble être, de tous les accidents, sinon le premier, si l'on veut appeler accidents les banales maladies infantiles, du moins le premier qui creusa la première petite faille sournoise dans mon organisme.
Nous descendions l'escalier. Mon frère sautait de marche en marche, criant « hop là ! » ; avais-je deux ans, trois ? - pas plus certainement, puisque j'avais trois ans lorsque nous habitions avenue Daumesnil à Paris (3) ; ma mère tenait un objet ; de l'autre main, soutenant sa fille ; elle m'aidait à descendre ; mue par ce désir d'imitation qu'ont à un si haut degré les singes et les femmes-enfants, pour lesquels vivre est à tout instant apprendre, expérimenter, je m'élançai hardiment et... manquai la marche ; par réaction de peur ma mère, qui était la douceur même, me retint d'un geste si brutal que je me mis à hurler. Elle ne voyait rien mais je criais tant qu'elle comprit vite que je ne criais pas de peur, mais souffrais réellement d'un mal qu'elle ne discernait pas.
J'avais tout simplement le bras gauche cassé. Peu de temps après, tandis que si précocement condamnée à une partielle immobilité, préfigurant dès l'enfance les longues années où tout mon corps deviendrait prisonnier de la douleur, l'on s'aperçut que, du même côté, le gauche, m'était venue une hernie inguinale (4).
Etais-je trop petite pour que l'on m'opérât, remit-on à plus tard simplement parce que la chirurgie intervenait moins souvent que de nos jours ? Cela, je l'ignore. En tout cas, on ne fit rien, remettant à plus tard le port d'un bandage qui impressionna mon enfance pudique, me démoralisa précocement ; l'assujettissement de cette « ceinture » indispensable me causait une sorte de honte, me faisait (en imagination, en tout cas) différente des autres, et fit naître et multiplier une foule de complexes sur lesquels j'aurai à revenir en raison de l'importance qu'ils prirent sur mon mental aux années de la puberté et dont je ne pus me défaire que tard, très tard ; sans parler des conséquences physiques immédiates ; cette hernie, constamment rappelée, m'empêchait de participer aux jeux des autres enfants, aggravait ma faiblesse, et eut pour résultat de déclencher un besoin d'isolement qui devait confiner plus tard à la sauvagerie.
[...] Je croyais encore qu'après ma mort, quelques rares amis s'intéresseraient à mes écrits si directs. Dans la folie aberrante d'un orgueil qui, par ailleurs, me fit tant défaut ! j'allais jusqu'à croire qu'après ma mort, certains de mes écrits seraient publiés ! Tous les entretiens sérieux avec Robert Denoël au cours des soirs d'hiver 42/43, avaient développé cette idée séduisante, jusqu'à en faire une quasi certitude.
J'avais supplié Robert pour le « tout ou rien » - à savoir ne pas se permettre des mutilations à tort et à travers. Avec la connaissance de son métier, il avait acquis parallèlement un peu d'expérience humaine. Il convenait de bonne foi que quand dix personnes lisent un manuscrit, chacune, selon son goût, se permet de dire que tels passages ou chapitres sont indésirables, impossibles ; ces mêmes pages sont, par un autre lecteur, considérées soit les meilleures, soit les seules valables ! En sorte que l'écrivain, artiste ou non, a raison de s'obstiner, surtout lorsqu'il s'agit non d'un roman au développement trop lourd, mais de pages très intermittentes, abordant de front, sans préparation, les sujets les plus divers et, pour mon cas personnel, contenant plus de souvenirs, d'analyses de sensations que d' « actions ».
J'accordais pleinement à Robert, qui goûtait et comprenait mes écrits dans les dernières années de sa vie brève, le droit de corriger des vulgarités, des fautes de syntaxe ; je l'avais prié de laisser vivre certains de ces mots, vides de sens pour lui, si germain d'esprit, mots journellement usités chez nous dans le centre de la France avant 1914 [... ]
Mes papiers passant aux mains de Robert, j'avais confiance en sa compréhension tardivement, lentement venue, de ce qui constituait le plus clair de ma modeste vérité. Un point restait délicat. Il eût fallu le temps, son évolution personnelle, ou que la question fût traitée par moi avec ordre, logique et tous les développements nécessaires.
Jugeant presque tout et tous d'après l'angle psychanalytique, Robert ne pouvait se rallier aisément aux conflits spirituels qui m'agitaient depuis des années. Quand il avait, comme bien d'autres, dit : « Ma chère, vous êtes avant tout une mystique», il croyait avoir tout dit, tout tranché. C'en était loin. Ce que, par manque de talent (en moi bien sûr), il avait jusqu'alors débattu, rejeté, il commença de l'entrevoir à travers Lanza del Vasto.
Quand je revis Robert, juste après la publication du Pèlerinage aux sources, c'était en mars 1944, après la mort de Doudou. Entrevues brèves, sans l'intimité possible des longues heures de conversations de la rue Clerc, de la rue de Grenelle (5), obsédé par sa situation dangereuse, affolé, quoiqu'il en voulût parler en... riant des menaces quotidiennes qu'il recevait concernant « sa mort décidée ».
Soucieux pour sa maison d'édition, son travail, son personnel auquel il était fort attaché ; lassé par les drames avec Cécile et prisonnier déjà de la rose prison mondaine qu'il s'était choisie, en optant dès alors, en cas de fuite nécessaire, pour l'asile de Jean Voilier alias Jeanne Frondaie, dont il répugnait à me parler, certain que je le connaissais trop bien pour me leurrer une minute, accepter l'idée d'amour pour cette élégante faisane mûre - lui qui adorait la jeunesse ! Rien ne se prêtait vraiment à la reprise de ces échanges intellectuels que je goûtais si agréablement en sa compagnie. Le cas « Voilier », sur lequel il me mentait, créait une gêne entre nous (6).
Personnellement j'étais déprimée par le dénouement Doudou jusqu'à l'effondrement. Je n'eus pas même l'énergie de mettre au point l'accord de « rente sur les cahiers secrets », laquelle, assurément, se serait éteinte avec lui... (7)
1. C'est peut-être le vrai drame de Champigny, qui est d'avoir cru que sa destinée était d'écrire. C'est pourquoi elle garde une rancune tenace à Christian Caillard, à Eugène Dabit, à Robert Denoël, d'avoir bridé ses élans littéraires. Objectivement, quand on lit aujourd'hui son journal rempli de mots rares, d'interminables tournures précieuses, et d'imparfaits du subjonctif, on se dit que son style s'est fixé vers 1920 et n'a plus évolué. C'est dommageable à la lecture car ce style ampoulé enlève à son témoignage toute spontanéité, alors qu'elle s'efforce réellement de raconter objectivement les faits.
2. Emérantine Basset, sa mère, est morte « à 27 ans 1/2 d'une méningite tuberculeuse ».
3. Dans une version datant de 1943, elle écrit : « J'avais environ deux ans. Je ne savais encore bien marcher, ou monter ou descendre des marches. » L'avenue Daumesnil traverse le XIIe arrondissement, de la place de la Bastille jusqu'au château de Vincennes : c'est l'artère la plus longue de Paris (6 km).
4. Deux ajouts interlinéaires : « et deux hernies inguinales », puis, un peu plus loin : « l'autre se développa après ». Dans la version de 1943 elle écrit : « j'eus le bras gauche cassé, deux hernies, la colonne vertébrale déviée. »
5. A sa sortie de la clinique Geoffroy Saint-Hilaire, Champigny a, en novembre et décembre 1942, séjourné au Grand Hôtel Leveque, 29 rue Cler, puis, jusqu'au 5 février 1943, dans un appartement du 63, rue de Grenelle.
6. Par qui Champigny avait-elle appris, dès avant mars 1944, que Denoël avait choisi de se réfugier chez Jeanne Loviton, « en cas de fuite nécessaire » ? Probablement par leur amie commune, Marguerite Thibon, qui habitait non loin de Mézels.
7. L'accord tacite passé entre Denoël et Champigny ne faisait donc pas l'objet d'un contrat passé au nom des Editions Denoël. Cela n'a rien de surprenant : l'éditeur a toujours confondu les deux trésoreries, ce qui, après sa mort, a causé bien des déboires.
[Décembre 1946] En vérité, la vie n'était qu'une succession de bonheurs, de plaisirs, dans la plus absolue liberté, à compter du printemps 1914, jusqu'au jour où je dérivai du destin assigné pour vivre aux côtés de Caillard une existence qui comporta une certaine noblesse, beaucoup d'intérêt, mais m'écrasa moralement du jour au lendemain. Rien ne me prédisposait à partager la vie d'un peintre. Pour lui, pour son « calme », sa « paix », pour apaiser ses jalousies rétrospectives, je fis ce que j'ai plus tard inconsidérément reproché aux autres ! Je vécus à Belleville des années, aussi prisonnière qu'une femme au fond d'un gynécée arabe.
Je dus abandonner les secrétariats instructifs qui me faisaient vivre parmi des esprits que je goûtais. Confinée dans l'atelier bellevillois, je travaillais ainsi qu'une ouvrière en usine. Je ne sortais jamais. Je ne voyais personne d'autre que les très rares amis de Caillard, qui venaient le dimanche et, quotidiennement hélas, Dabit.
Ma vie devint grise, terne, pauvre. Usée de travaux trop durs dès 1922, je dus affronter narcoses, opérations... Par «économie », l'essentiel de l'enseignement Caillard consistait à m'apprendre à compter, compter encore, compter toujours, à « l'économie »... Par économie, c'est un sagouin de la chirurgie qui commença la belle entreprise de démolition que d'autres, par la suite, devaient parfaire.
Atteinte dans ma santé, étouffée dans le gris des peintres (Dieu, qu'ils m'ont fait haïr le gris), je perdis dès alors ces quelques riens de qualités gentilles qui étaient l'expression de ma nature. Quand je repense aux années de compagnonnage avec Caillard, je me demande par quelle démence j'ai poursuivi cette aventure jusqu'à en être brisée, au lieu de m'arrêter à temps, de reprendre ma joyeuse vie errante.
Je poursuivis sur la voie du renoncement ; je continuai à être la petite machine à travailler au service de quelques peintres et de l'un d'eux, plus particulièrement, certaine de sa parole, de son honnêteté, et, dans ma sottise, assurée que du moins nous étions des compagnons pour la vie entière ! J'avais alors pour Christian une estime mêlée de respect. Je l'admirais sincèrement. Oser douter de sa parole ? Mais le ciel eût croulé sur nos têtes !
Lorsque je le vis, pour le premier désir troublant ses sens, faire fi de toutes les théories dont il me gavait depuis quatre ans, théories qui, je l'avoue sans aucune honte, m'étaient sacrées, tant j'étais à la fois sotte et puérile bien que me croyant intelligente et expérimentée (!), mon étonnement fut encore plus grand que mon chagrin. Si jamais l'univers bascula sous mes pas, c'est bien alors. Je ne me remis jamais du drame Caillard. C'est sa manie de dériver les êtres de leur destin.
Au cours de ces quatre années quasi maritales, il m'avait fallu jour à jour créer, composer un personnage qui ne correspondait en rien à ma vérité, à mon tempérament, à mon caractère. Si la rupture me fut si déchirante, c'est que je me trouvais devant la pire des faillites. J'avais cru en lui, en sa supériorité - j'avais fait mourir, étouffées dans « leur gris », les dernières années de vraie jeunesse. J'avais perdu tout ce qui jadis faisait ma force : l'insouciance, la gaieté, la confiance en moi... Désaxée à ce point, je ne pouvais plus que faire des sottises. Je les accumulai toutes. Je ne doute pas qu'en sa superbe, il soit assuré maintenant encore que ces quatre années représentent la beauté de ma vie !
Recluse à Mézels depuis le 27 juillet 1940, hiver 42/43 à Paris, clinique, police Vichy. Presque deux mois de vrai, de sublime repos grâce à R.D. (1). De ce repos, j'avais tiré plus de bénéfice que des « soins » conjugués de cinq ignorants qui achevèrent sur ma peau l'assassinat commencé en 1929 par les « trois sommités médicales » de Nice. Seul Merle d'Aubigné avait sauvé en partie mon squelette de Noël 1931 à l'été 1932. Hiver 42/43, le docteur Chabassus me prodigua des soins intelligents, efficaces. Depuis ? Tous les accidents. De soins, point. De trêve, point. De joie ? pas une bouffée.
1. Champigny a séjourné du 13 octobre au 8 novembre 1942 à la clinique Geoffroy St Hilaire, du 9 novembre 1942 au 8 janvier 1943 au Grand Hôtel Leveque, du 9 janvier au 5 février 1943 dans un appartement de la rue de Grenelle. Elle a donc passé plus de quatre mois à Paris mais ce dont elle se souvient avec émotion, ce sont les deux mois durant lesquels Denoël lui a rendu visite presque chaque jour.
[16 mars 1948] Un jour, en 1927 à Marrakech (palais du douar Graoua), je surpris Eugène Dabit occupé à feuilleter mes papiers. J'avais honte pour lui. Lui, sans gêne, me dit : « Oh Champigny, votre vie, quelle matière quand vous serez morte. » Ce disant, ses doigts pétrissaient l'air comme s'il eût tenu de la glaise. « Alors, répondis-je, pourquoi vous étonnez-vous que cela me plaise d'en parler moi-même ? » - « Parce que vous êtes sans pudeur, vous dites tout, vous donnez tout, vous vous dispersez. Vous n'êtes pas une artiste ». - « Je n'y prétends pas. Si j'écris une chanson, c'est par joie, ainsi qu'enfant, l'on ne peut par instants s'empêcher de crier. Ce cri m'équilibre. Je n'en fais aucun cas, je sais que c'est sans valeur. »
Une longue discussion sur l'Aââârt suivit. Ce jour-là ou un autre, il m'avoua : « Moi, quand j'écris une lettre, je m'efforce d'être gris, neutre, banal, je ne vais pas mettre dans une lettre ce qui peut avoir place dans un livre. Si j'avais une sténo, je pourrais dicter comment naquirent par mes seuls efforts populisme et populiste. » (1) Il avait « tant besoin d'audience », ce prurit de l'édition qu'ont presque tous les écrivains [...] Quand je repense à tout ce que je brûlai en 1942... J'avais, de 1927 à 1942, beaucoup écrit. Depuis 1944, il est rare que j'écrive volontairement.
1. Il est douteux qu'Eugène Dabit ait fait en 1927 une telle déclaration, puisque L'Hôtel du Nord n'a été publié qu'en novembre 1929. Chez Champigny, après 1945, les dates se télescopent souvent, mais les propos restitués sonnent toujours juste. Comme elle l'écrit : «Ce jour-là ou un autre »...
Fin février 1952. Déjà sont fleuries les violettes, déjà les lauriers sont fleuris. La nature entière, de lumière éclaboussée. Partir. Vers du morne et sinistre Paris. Partir ? Quand j'avais seulement besoin de soins, d'un traitement minimisant mon état chronique, incurable, parvenu je le sais en sa phase dernière . Pourtant je partirai. La cause est mon secret. Je pleurerai les souvenances. Je pleurerai le présent gris. Ainsi tout sera fini.
Avant que d'enfermer ces pages, je dis un adieu d'âme à la maison du chien. Le printemps est là, aux portes d'Occident. Je ne le verrai pas et mourrai un jour de printemps, un « dimanche ». Disparus, attendez-moi. A bientôt, un « dimanche » (1).
1. Irène Champigny est morte à Mézels un mardi 13 mars 1956.
*
Correspondances
Dans le fonds Champigny figurent quantité de lettres dont quelques unes éclairent ou complètent son journal. J'y ai sélectionné celles de :
* René Barjavel [1911-1985], son protégé, engagé par Denoël en octobre 1935.
* Abel Blanchard, psychiatre marseillais. Champigny avait séjourné trois mois dans sa clinique en 1928.
* Henri Brunel [1871-1942], père de Jean, notaire et homme politique, son chargé d'affaires entre 1927 et 1934.
* Jean Brunel [1906-1980], notaire, son chargé d'affaires à partir de 1934 et son exécuteur testamentaire.
* Irène Champigny. Plusieurs lettres à différents destinataires.
* René-Louis Doyon [1885-1966], éditeur, son ami de longue date.
* Henri Larrieu [1893-1967], préfet de la Somme, résistant à partir de 1942.
* Bernard Steele [1902-1979], l'associé de Robert Denoël entre 1930 et 1936.
* Pour mémoire, les lettres de Robert Denoël se trouvent dans le chapitre Correspondance.
Elles montrent que Champigny ne fut pas toujours grabataire, comme pourrait le laisser croire son journal. Cette femme a beaucoup vécu, en bien des endroits inattendus, et toujours passionnément.
1927
Lettre de Champigny à Christian Caillard, 16 février 1927
Tantôt j'étais absente. Zamaron vient - emballé sur Loutreuil. Il paraît, dit-il, que Driguet a acheté une petite fille de Loutreuil exposée ici. Je ne sais pas, répond cet ahuri de Denoël, et Zamaron s'extasie sur la fillette du chevalet, et Denoël, au lieu de le chauffer, de lui montrer celle de Driguet, lui dit que celle-là est à vendre 12.000, qu'il ne voit vraiment pas ce que Driguet a acheté.
Il était presque fier de son ânerie, je l'aurais tué. Il est gentil, mais si stupide en affaires que j'en suis navrée. La vente Driguet a été faite devant lui. La toile en question était encore en vitrine. J'espère que Zamaron reviendra, mais quelle gaffe de lui donner l'impression que Driguet n'avait pas acheté (1).
1. Lettre conservée aux Archives départementales de la Sarthe sous la cote 102J23.
Lettre de Champigny à Sonia Jablonska, 9 octobre 1927
Ce qui m'est arrivé après ton départ a été affreux, cela a commencé par des crises de ventre plus abominables que jamais, je ne mangeais plus rien et je prenais nuit et jour du dyal et du sédol (1) ; j'étais depuis une semaine en cet état quand Christian est venu me voir ; le soir même j'ai dit : demain je serai guérie...
Le lendemain je suis allée à pied de toute ma volonté à Carennac (2) avec tout le monde, j'ai déjeuné, bu du vin et un peu d'alcool, tout ça sur 8 jours de drogue et de jeûne ; alors j'ai été comme foudroyée ; et depuis je suis comme convalescente d'une maladie ; tu peux croire que je mets toute ma volonté à lutter, je me lève, je viens à table, je mange, je prends du fortifiant, mais mes jambes sont encore si faibles qu'il m'arrive de trébucher partout et tant, tout ainsi que si j'étais perpétuellement ivre.
A cela s'ajoute une fatigue cérébrale qui fait en moi des trous, des moments où la mémoire tout soudain se dérobe, où malgré moi des crises de larmes me secouent, des cauchemars me font sortir du lit encore endormie, bref une série de phénomènes physiques impliquant un déséquilibre navrant.
Avant d'être opérée, et plus jeune quand j'étais moins malade, j'étais plus pourvue de force que n'importe quel être au monde, et toute celle que j'admire en toi est semblable à celle, insolente, que portaient mes 20 ans ; actuellement je suis cassée, j'ai eu trop de chocs, ils ont tous, mais tous tu entends, eu des retentissements physiques tels, que bien longtemps après qu'est revenu mon aplomb moral, je reste anéantie.
Je pars par le bateau du 22 à Marseille ; je serai à Paris jeudi matin, impossible de rester plus longtemps ici à me soigner car j'aurai trop de choses à faire à Paris ; ne te lève pas à cause de moi, je dirai à Denoël de venir à la gare, ensuite j'irai chez toi (3).
1. Antispasmodiques et analgésiques. Le sédol est extrait de l'opium.
2. Village situé à dix kilomètres de Mézels.
3. D'origine polonaise, Sonia était, avec Catherine Mengelle, l'un des modèles de Christian Caillard.
1928
Lettre de Champigny à Me Henri Brunel, Marrakech 3 janvier 1928
J'ai reçu ici, envoyé par le père de Christian, un papier bleu concernant le divorce (1), naturellement je n'y ai rien compris. Je pense n'avoir rien à faire qu'à attendre... j'ai pourtant un peu d'angoisse, ayant été avertie par la tante de mon mari, que celui-ci quittait la France le 10 janvier ; vais-je être longtemps condamnée à rester Champigny-Jossinet comme devant ? Cela contrarierait beaucoup mes projets , je vais d'ailleurs m'en ouvrir à monsieur Lecointe auquel je dois beaucoup grâce à votre inépuisable gentillesse.
Avec le temps mon chagrin se fait sage, presque profitable, malheureusement après tant de chocs successifs, c'est la santé qui ne veut pas revenir. Je travaille de mon mieux, c'est beaucoup pour mon état actuel, c'est insignifiant et très mal en comparaison de ce que je voudrais. Votre fils vous dira mes sages projets, car il faut penser à gagner bientôt ma vie, encore quelques mois de répit, après, voyez mes ambitions.
1. Son divorce avec François dit « Joë » Jossinet, que Champigny avait épousé le 2 avril 1927.
1930
Lettre de Champigny à Catherine Mengelle, s.d. [début septembre 1930]
Hier passé tout le jour avec Steele et Artaud (1). Ah ! quel trio sublime et invraisemblable nous formions. Je ne veux plus rien, je souffre, je souffre. J'entends : « Tant que je serai près de toi, tu ne mourras pas ». Adieu chérie. Je n'avais que toi. Je suis seule d'âme. Bénis Steele d'être présent et compréhensif. Mézels encore plus tout en haine. Steele parti, j'y serai bloquée, sans rien.
1. Antonin Artaud a sympathisé avec Denoël dès 1926 ; pourtant c'est avec Bernard Steele qu'il fera amitié en 1929. Quant à ses relations avec Champigny, on peut en deviner la nature par une dédicace sur un exemplaire de L'Art et la mort : « Pour Madame
Champigny, un des voyantes de ce temps ».
Lettre de Champigny à Catherine Mengelle, 11 septembre 1930
[Elle a été victime d'hallucinations à son réveil :] Et c'est seulement quand je remonte pour te dire cela, que je me souviens que je suis seule à Mézels et de tout ce qui s'est passé. Denoël sait bien, lui (1), tout ce que cela peut me faire ressentir ; j'en ai eu le vertige, puis malgré ma lassitude, je ne me suis pas recouchée [...]
1. Note marginale : « Denoël seul qui me vit après la 1ère commotion cérébrale de 1927, après l'accident avec Joë. » Champigny évoque à plusieurs reprises cette commotion qui eut lieu au printemps 1927, et toujours en l'associant à un accident avec Joë Jossinet.
Lettre de Champigny à Catherine Mengelle, 16 septembre 1930
Je vois que tu rencontres à Paris mille difficultés, pourtant tu continues à t'aveugler au point de me dire que tu veux «aider ma vie », alors que, mon pauvre petit, tu le vois, il est déjà si difficile de gagner la tienne.
Comment aurais-tu fait, pauvre chérie, ces quelques jours, si tu n'avais eu Armand pour t'habiller, Robert et Cécile pour te mettre à l'abri de tout (1) ?
Tu ne peux rester ainsi chez les Denoël, tu es trop faible pour entrer dans le travail au moment précis où le secours de tout ce que tu as rejeté de moi te manque. A Paris, il faut beaucoup d'argent puisque nous n'avons plus le pré St Gervais.
Je pense aussi qu'aussitôt que tu serais de nouveau avec moi, tu recommencerais par jalousie et incompréhension à détruire. Il te faut réfléchir à tout cela. Je le disais à Robert, ce n'est pas l'orgueil qui me fait ne pas t'appeler ; c'est la peur. Il n'y aucune raison pour que tu aies changé en huit jours.
Si le docteur Syreijol n'était venu au matin me faire une piqûre d'androstine (2), je n'aurais pu faire partir cette lettre de la nuit, que je n'ai même pas eu temps de relire.
1. Armand Movschowitz, son ami diamantaire. Catherine a passé deux semaines chez Denoël, qui lui écrit, le 19 septembre, que ce séjour « s'est passé d'une manière parfaite ».
2.
Médicament hormonal destiné à renforcer la production de testostérone. Il est indiqué pour soigner des troubles d'origine génitale, et l'anxiété et le nervosisme résultant de carence sexuelle. Il était utilisé aussi pour traiter les cas de neurasthénie résultant d'une hystérectomie. Dans tous les cas, les traitements par androstine sont liés à des troubles ovariens.
Lettre de Bernard Steele, 19 septembre 1930
Catherine vous aura raconté que la boutique est en pleine transformation (1). Parti, ce gentil aspect intime qui la caractérisait ; parti, son cachet particulier ! Maintenant, c'est une vague boutique, quelconque, froide, qui ne se distingue en rien de toutes les autres librairies générales. Si toutefois on pouvait y gagner de l'argent ! Cela aussi, ce serait un beau rêve!
Et puis, une nouvelle tuile nous tombe... notre gérant (2) se dégonfle, prétextant une maladie de sa femme. C'est peut-être vrai, après tout. En tout cas le contretemps est plutôt malencontreux. On croisera [les doigts] - on verra et tout finira par rentrer dans l'ordre. Sauf avis contraire, nous nous installerons rue Amélie d'ici quinze jours (3).
En attendant, il devient de plus en plus difficile de travailler ici. On est dérangé à chaque instant, à un tel point que j'ai dû m'y reprendre par trois fois avant de pouvoir achever cette lettre.
La chose la plus importante, je l'ai négligée ! Champy (4), mon amie - au nom du ciel, je vous en supplie - n'hésitez plus à vous faire opérer. Il en est encore temps - bientôt il sera trop tard. Si vous tenez à la vie, et j'ai des raisons qui me portent à croire qu'il en est ainsi - il faut vous faire opérer maintenant, le plus tôt possible. Vous avez à peu près assez d'argent - n'ayez pas de scrupules à vous en servir. Vous pourrez si aisément le rembourser quand vous serez guérie ! Caillard (5) comprendra - la vie de son amie vaut bien quelques pauvres billets de 1000 francs !
1. Il s'agit de la Librairie des Trois Magots, 60 avenue de La Bourdonnais, et non des locaux du 19 rue Amélie, en pleine réfection, eux aussi.
2. Aloÿs Bataillard [1906-1956], poète d'origine suisse.
3. Loué en mars, l'immeuble de la rue Amélie, qui aurait dû accueillir les éditeurs dès juillet, ne sera accessible qu'en octobre.
4.
Diminutif affectueux (que n'utilise jamais Denoël). René Barjavel et Jean Brunel écrivent « Champi ».
5. Le peintre Christian Caillard [1899-1985] dont Champigny a partagé la vie entre 1922 et 1926, et avec lequel elle avait ouvert en 1925 sa galerie d'art, 39 rue Sainte-Anne.
Lettre de Bernard Steele, 27 septembre 1930
Vous n'avez pas eu de nouvelles de moi depuis quelques jours, et je vais tout de suite vous en donner la - ou plutôt « les» raisons. Primo, l'édition devient de plus en plus accaparante. On travaille comme des forcenés pour sortir les nombreux livres que nous allons mettre en vente avant octobre (1). C'est un effort continuel et on se trouve aux prises avec des détails nombreux qui demandent à être réglés et expédiés.
D'autre part, je suis très occupé en ce moment à chercher un moyen d'extraire Denoël du pétrin dans lequel il se trouve. Et c'est très compliqué ! Je ne sais pas si j'y parviendrai, car ses affaires sont dans un tel état qu'un clairvoyant lui-même aurait des difficultés à s'y retrouver. Cependant, je sais une chose... qu'il faut qu'il s'en sorte, et que cette sortie, si j'ose dire, devrait s'effectuer à très bref délai. Je ne désespère pas, mais... mais... ce ne sera pas facile. En tout cas, ça me fait un tracas de plus et je n'en avais pas précisément besoin.
Quand même, si on peut trouver une solution, ce sera une bonne chose, car Denoël pourra consacrer son activité à un travail productif, au lieu de s'esquinter le tempérament comme il le fait à l'heure actuelle.
Cécile est encore malade - évidemment ! Elle a de grosses fièvres et hier nous l'avons trouvée, évanouie, dans la cuisine, où elle était restée sans connaissance depuis on ne sait combien de temps. Allendy vient aujourd'hui et on espère qu'il pourra faire quelque chose pour elle (2).
1. Outre deux albums pour enfants et deux livres pour bibliophiles, Denoël et Steele annoncent quatre romans pour la rentrée d'octobre.
2. Cécile Brusson souffrait de crises de paludisme, une affection qu'elle avait ramenée d'Afrique du Sud en 1919. Le docteur René Allendy [1889-1942] était son analyste.
Lettre de Champigny à Catherine Mengelle, s.d. [fin septembre 1930]
J'ai vu le docteur Syreijol ce matin. A partir de lundi il passera tous les matins à Mézels pour m'y faire l'androstine dont j'attends du bien. J'ai porté mon corset orthopédique (1). J'ai supporté passablement les inévitables examens féminins.
Mes projets de vie future. Quelle vie ? Nous ne sommes jamais sûres du lendemain, le présent nous le détruisons. Tu dis que tu seras avec moi pour l'opération, c'est faux, c'est impossible. Si tu avais dû être avec moi, tu y serais maintenant.
Quand je t'ai prise avec moi en juillet 1928, j'étais mue par bien des sentiments. Le désarroi de tes 16 ans évoquait assez bien les plus faibles heures d' « Aimée Bellamy » (2). Il y a des misères vécues à cet âge-là qui restent si intactes que je n'eus guère de mérite à m'agenouiller devant toi la première nuit, te pardonnant tout, comprenant tout avant que tu eusses parlé.
Lundi dernier, le soir, quand j'expliquais que je ne saurais me passer de toi au moment de l'opération, tu as dit devant Steele et Cécile : « C'est bien ça ! on me fera venir quand on aura besoin de moi.»
1. En janvier 1925 Champigny écrit à Christian Caillard qu'elle vient d'acheter à Montparnasse « son instrument de torture ».
2. [Ajout marginal :] « Aimée Bellamy ». Histoire de ma jeunesse. Manuscrit brûlé en 1942. Vichy. »
Lettre du docteur Abel Blanchard, 13 octobre 1930
Je vous envoie ce mot à Mézels, pensant qu'il vous suivra, si vous l'avez quitté. Je ne m'excuserai pas de mon silence. Il est impardonnable. Croyez bien cependant que j'ai souvent pensé à vous et que j'ai été très peiné en apprenant votre état de maladie. La lettre de Catherine me donnait beaucoup de renseignements ; néanmoins je n'ai pas pu me rendre compte exactement de l'affection dont vous souffrez. Quoi qu'il en soit, j'espère que les complications médullaires (1) ont pu être évitées.
J'ai reçu « Les Vardot » avec une dédicace aimablement amicale de Stéphane Manier (2). Je voudrais le remercier. Dites-moi où je pourrai lui envoyer un mot, ignorant son adresse. J'ai trouvé son livre bien. L'évolution des moeurs sous l'influence de la guerre y est décrite dans une note qui m'a paru très juste.
Souvent, dans des revues médicales, il est parlé du « Grand Vent » (3) avec beaucoup d'éloges. Cela me fait un grand plaisir. Et votre « Loutreuil » (4), vous compense-t-il de vos efforts ? Je le désirerais tant pour vous.
Vous serez bien aimable dans votre lettre de me dire à quelle adresse je pourrai renvoyer les quatre toiles qui me restent de vos amis du Pré St Gervais. J'ai honte de ne m'être pas encore acquitté de cette moindre politesse. Et Caillard, en avez-vous des nouvelles ? Comment va-t-il ? Est-il content, comme je le pense, de son voyage ?
1. Médullaire : qui concerne la moëlle épinière ou osseuse.
2. Le premier roman de Stéphane Manier est paru le 20 mai chez Denoël et Steele.
3. L'ouvrage de Champigny a été publié par Robert Denoël en novembre 1929.
4. La correspondance de Maurice Loutreuil publiée par Champigny est parue chez Firmin Didot au début de l'année 1930.
Lettre de Bernard Steele, 14 octobre 1930
Commençons par la santé : je suis tout à fait ravi que vous soyez tombée entre les mains d'un « chiropractor » américain. En effet, ces guérisseurs sont très nombreux aux Etats-Unis où ils ont même une faculté extrêmement importante dans l'Etat de l'Iowa, si je ne me trompe. Il est un fait certain que ce genre de traitement réussit très souvent, alors que la médecine s'avère incompétente.
Cependant il ne faut pas croire que le soulagement se manifestera immédiatement. D'après ce qu'on dit, le traitement est excessivement long, parfois assez douloureux ; mais en général les résultats sont satisfaisants. J'espère que ce sera le cas pour vous ; mais ne vous impatientez pas si les résultats se font attendre.
Tenez-moi au courant des progrès de votre traitement car ce procédé m'intéresse beaucoup. Si, en effet, cela peut vous éviter une onéreuse et douloureuse opération, ce sera évidemment un grand bienfait pour vous, car cela vous épargnerait un choc dont votre système nerveux n'a pas précisément besoin en ce moment et une bousculade de trésorerie dont vous pourriez, également, facilement vous passer.
A ce sujet, j'ai eu l'occasion hier de voir Manier (1), qui m'a dit que vous lui aviez fait savoir que vous aviez un besoin d'argent urgent et il m'a demandé s'il n'était pas possible pour nous de faire quelque chose dans ce sens. Je ne vous cache pas qu'à l'heure actuelle nous avons besoin de toutes nos ressources pour le lancement de nos nouveaux ouvrages et j'ai été obligé de lui dire que je ne pouvais rien pour lui. En d'autres circonstances c'eût été avec plaisir, mais en ce moment je n'en vois pas la possibilité ; quoique je sache que si vous n'aviez pas un besoin urgent, vous ne lui auriez pas demandé ce service.
En ce qui concerne vos chansons, je ne suis pas du tout qualifié pour rentrer dans tous ces détails, étant donné que je ne faisais pas partie de la maison au moment de leur édition (2). Vous connaissez mes appréciations sur tout ceci et il n'est pas besoin que je vous les répète. En tout cas, maintenant qu'elles sont éditées de la façon dont vous savez, il ne s'agit pas de perdre son temps en atermoiements, mais il faut les écouler et dans les meilleurs conditions possibles. Tout ce que vous faites dans ce sens en ce moment est excessivement bien et nous vous en savons gré. On vous envoie dès aujourd'hui les exemplaires que vous nous demandez.
En ce qui concerne l'harmonisation, je crois que Denoël a dû vous expliquer ce qu'il en était. Moi, je vous l'avoue très humblement, je n'y pige que dalle, tellement il y a des questions d'inscriptions à la chambre syndicale des musiciens et autres balivernes de ce genre. Je crois qu'il serait beaucoup mieux pour vous et pour Mme Séverin-Mars que vous vous adressiez directement à Denoël pour toutes ces questions. Je crois néanmoins pouvoir vous dire qu'il n'a jamais été question d'une rémunération pour le « musicien pas exigeant », mais enfin s'il en était ainsi, il serait beaucoup mieux que ceux qui ont commencé le travail s'en occupent.
Je ne dis pas que je ne m'en occuperai pas personnellement, mais pour cela il faudrait que j'arrive à débrouiller toute cette affaire et au jour d'aujourd'hui, avec tous les multiples embêtements qui encombrent ma vie, je ne m'en sens pas du tout le courage. En tout cas, je ferai l'impossible pour que la musique des chansons parvienne à Mme Séverin-Mars avant le 30 octobre, afin qu'elle puisse donner son concert (3).
Nous avons eu la semaine dernière la visite de votre aimable Papa (4). Celui-ci nous a proposé d'éditer un ou des romans de lui, basés sur des scénarios qu'il a écrits. Tout cela est très bien, seulement il prétendait avoir un contrat pour ces ouvrages avant que ceux-ci ne soient même ébauchés. Nous lui avons écrit que ceci était contre tous les usages de l'Edition, réponse qu'il n'a pas semblé trouver à son goût. En tout cas, s'il vous écrivait, vous sauriez ce qu'il en est et ceci vous éviterait de porter un jugement.
1. Romancier français [1899-1943] qui a publié deux livres chez Denoël et Steele. C'était aussi un ami de longue date de Champigny.
2. Le Grand Vent a été publié en novembre 1929 par la Librairie des Trois Magots.
3. Denise Severin-Mars était comédienne et chanteuse. Elle avait promis d'interpréter des chansons tirées du livre de Champigny lors de l'unauguration des locaux de la maison d'édition Denoël et Steele.
4. René Champigny était chansonnier, scénariste et romancier.
Lettre de Bernard Steele, 22 octobre 1930
La réception de votre lettre m'a bien douché ! Que de désespoirs ! Quel cafard ! J'espère que tout ça est bien passé maintenant et que vous êtes de nouveau toute à votre joie de vivre. Surtout, ne lâchez pas votre travail, comme vous me l'aviez fait pressentir - n'en faites rien ! Je voudrais tant voir « Ecris-moi » (1) terminé !
Avez-vous reçu la partition des Chansons ? Denoël a écrit au musicien, et celui-ci devait vous [envoyer] toute cette musique tout de suite.
Gotterdamm - on est toujours Av. de la B[ourdonnais] ! On dirait qu'il y a un sort qui nous empêcherait de déménager. Enfin, je crois que la boutique sera liquidée dans le courant de cette semaine, et à ce moment-là, adieu les 3 Magots ! Ce ne sera pas trop tôt ! On en est tous malades !
Il y a quantité de choses dans votre dernière lettre que je considère comme nulles et non avenues - notamment les parties se référant à « Ecris-moi ». Vous avez dû avoir une crise de cafard ce jour-là, sans cela vous n'auriez même pas pensé à laisser choir ce travail. Ne vous laissez pas décourager...
1. Dans son journal du 29 février 1946, Champigny parle de ce manuscrit « mort-né », celui-là même qui causa sa rupture avec Denoël, en 1938.
Lettre de Champigny à Catherine Mengelle, 29 novembre 1930
Pense en commençant ta journée qu'il en reste seulement 9 avant l'opération. Pense que je t'aime de tout le meilleur de moi. Pense qu'il faut à tout prix pour un mieux possible, que j'arrive au 7 décembre en état de paix d'esprit absolue. Evite les cris, les reproches, les griefs, les gros mots, les éclats de voix inutiles qui n'entraînent jamais que dans de la laideur. Si tu veux que je vive et guérisse, aide-moi par tes actes et ta pensée. J'ai besoin de concentration, de recueillement. Je t'en supplie, fais que j'arrive à ce jour-là, calme, calme, calme.
Lettre de Bernard Steele, 9 décembre 1930
Décidément vous tenez à nous épater ! Qu'est-ce que c'est que ces façons de se faire opérer comme cela, sans crier gare ! Qu'est-ce que c'est - mais qu'est-ce que c'est ? Les deux télégrammes de Catherine nous sont bien parvenus, et aujourd'hui nous avons reçu une longue lettre d'elle dans laquelle elle nous fait savoir l'essentiel, c'est-à-dire que tout va bien et que l'opération est une réussite (1). Nous félicitons ces messieurs de la « toubiberie » ! Ils ont fait un sacré bon travail. Et maintenant vous allez voir ce que vous allez voir - tous vos troubles vont disparaître et vous allez pouvoir vous remettre à goûter toutes les joies de la vie qui vous ont été si longtemps soustraits. Je partage votre joie, entièrement, pleinement !
Vous souvenez-vous de certain soir, à St-Céré, où je vous disais que vous vous feriez opérer, et que rien n'était à craindre ? Je voyais clair, n'est-ce pas - pour moi, tout cela ne faisait pas de doute. Et je suis heureux d'avoir eu raison. Pour le reste - c'est-à-dire votre colonne vertébrale - tout s'arrangera de la même façon heureuse, grâce aux soins de votre chiropractor. J'ai grande confiance en ces gens-là - ils opèrent des guérisons vraiment remarquables - j'ai souvent eu l'occasion de le constater.
Nous nous sommes réunis chez Dabit dimanche soir pour entendre vos chansons chantées par Mme Séverin-Mars. Elle a une voix magnifique et imprime exactement le cachet qu'il convient à ces complaintes. Nous avons, du reste, l'intention de lui demander d'en chanter quelques unes à l'occasion de l'inauguration de nos nouveaux locaux.
En passant, je dois vous dire que Dabit a eu le suprême mauvais goût d'être absent de cette réunion qui eut lieu chez lui, et dont les invitations étaient signées de lui. C'est du Dabitieux intégral, sans commentaires.
Nous travaillons comme des brutes, mais les résultats commencent à se manifester. En effet, les albums pour enfants (2) marchent admirablement bien et tout porte à croire que nous aurons une année passable en dépit de la crise. La librairie étant maintenant en gérance, et Denoël sorti de la plupart de ses em...ents, il peut se consacrer plus entièrement aux éditions, ce qui est une bonne chose.
1. On n'a pas d'information sur cette opération subie à Nice, mais on sait par son journal que ce fut un fiasco intégral, car elle ne changea rien à sa colonne vertébrale luxée depuis plus de trente ans.
2. Deux albums d'Henri-Paul Pecqueriaux [1889-1935] parus en octobre et décembre 1930.
1931
Lettre du docteur Abel Blanchard à Catherine Mengelle, 5 février 1931
J'aurais préféré de meilleures nouvelles pour Champigny. Cependant je me réjouis de savoir que l'opération a donné d'excellents résultats. Cette réaction douloureuse qu'elle ressent actuellement à la piqûre que sans doute, inutilement, elle est allée se faire faire, n'aura certainement pas de conséquences graves et j'espère que notre amie en sera quitte avec un peu de frousse et beaucoup de douleur. Mais que Diable aussi, court-elle tous les médicastres et ne suit-elle, ou plutôt ne prend-elle pas conseil, avant de faire quoi que ce soit, de l'excellent médecin qu'elle a avec Morisson-Lacombe ?
Je voudrais que cette fâcheuse aventure fusse pour elle un avertissement pour sa conduite à venir, bien que je comprenne parfaitement son désir d'en finir avec les souffrances qu'elle endure depuis si longtemps et que la soi-disant médecine éclairée s'est, je le reconnais, montrée impuissante jusqu'ici à soulager. Mais il faut se méfier de beaucoup de médications préconisées par les uns ou les autres et c'est pour son bien que je dis cela. Elle me comprendra, j'en suis convaincu, et ne m'en voudra si je me permets de la gronder un peu.
Qu'elle ne se laisse donc pas démoraliser par cette réaction fébrile. La confiance en soi est un des meilleurs facteurs de lutte contre le mal. Et surtout qu'elle écoute, n'écoute que Morisson-Lacombe qui prend un grand intérêt à elle.
Lettre d'Antonin Artaud, 23 mars 1931
Je n’oublie pas. Je n’oublierai jamais la touchante façon dont vous m’êtes venue en aide au cours de mon incursion (!!!!) dans le Lot (1). Je vous adresse en même temps que cette lettre un exemplaire du Moine enfin paru (2), réussi je pense par saccades et raté par saccades aussi. Toutefois je vous estime assez pour vous dire que cette lettre est intéressée. Je vous écris dans un besoin urgent de secours et comme un homme mentalement, psychiquement, comme moralement à toute extrémité.
On me dit que vous connaissez un guérisseur ou plutôt une sorte de devineresse guérisseuse qui opère sur une mèche de cheveux. La mèche de cheveux est dans l’enveloppe qui accompagne cette lettre. Je vous avouerai que je suis pressé, car mes maux n’attendent pas.
S’il faut de l’argent, je vous en enverrai (dites exactement combien) au reçu d’un mot de vous mais pourrais-je vous demander de transmettre la mèche avec une demande de diagnostic au reçu de ma lettre sans attendre que je vous aie envoyé l’argent, ce qui par le jeu des aller et retour nous mènerait à huit jours d’ici.
Puisque vous lisez dans les écritures, le lecture de cette lettre vous rendra je pense un compte exact de l’affreux état dans lequel présentement je me trouve.
Pour un écrivain qui a besoin de sa tête, cette destitution, cette ruine de l’esprit, qui s’effrite et s’effondre et croule de l’intérieur, par décomposition de son système entier, est un désastre, pour un non écrivain le désastre serait aussi fort ! Il ne s’y mêlerait pas la torture morale du néant et du ratage complet d’une vie.
En bref si on ne me redonne pas le moyen de rentrer en possession de mon organisme spirituel je suis foutu. [...] J’ai eu de vous d’excellentes et surprenantes nouvelles qui m’ont sincèrement et cordialement réjoui. Je fais des voeux pour que cela continue.
1. En septembre 1930, Champigny écrivait à Catherine Mengelle : « Hier passé tout le jour avec Steele et Artaud. Ah ! quel trio sublime et invraisemblable nous formions. » [voir plus haut].
2. Le Moine est paru le 15 mars 1931 chez Denoël et Steele.
Lettre de Champigny à Antonin Artaud, 29 mars 1931
Artaud, je viens de lire votre lettre ; merci. Mais elle m'arrive à Mézels, un dimanche... je vais écrire à Madame Cadéot (1), villa Maria, La Trinité-Victor (Alpes maritimes) et lui envoyer l'enveloppe qui contient vos cheveux, mais, je vous en prie, au reçu de ma lettre, si l'enveloppe que je lui adresse ne contient aucun détail sur votre état, envoyez-les lui par lettre exprès. Devineresse, certes... mais de loin, avec une seule mèche de cheveux, le fluide magnétique n'est pas aussi fort que de près. Dites-lui votre âge, vos souffrances, et quand vous recevrez sa réponse, écoutez-la, en dépit de tous les avis contraires.
Je suis bien coupable envers vous, Artaud. En arrivant à Nice à l'automne, je m'enquis de Daltour dont je vous avais parlé. Mais il avait disparu de la région, ou du moins était devenu invisible ; et plus tard, quand je connus madame Cadéot, je n'ai pas une seconde eu le souvenir de vos maux, qui me sont proches, et que je sens, car chez moi la moelle épinière atteinte cause des ravages (en plus petit) seulement, le siège de la douleur est dans les vertèbres lombaires.
Madame Cadéot m'a ordonné un traitement que je ferai aussitôt que je serai en mesure de le faire, car actuellement encore je suis inapte à tout ; l'opération a merveilleusement réussi, mais elle n'a rien changé à la colonne vertébrale et chaque effort, si petit soit-il, me cause d'intolérables douleurs, qui disparaîtront j'y ai foi, en faisant ce que l'occulte a prescrit.
Artaud, ne désespérez pas ; le corps ne peut plus lutter quand l'esprit lâche, ne vous abandonnez donc pas ; vous avez trop d'âme pour ne point sentir que l'on peut vivre avec la douleur. Aux maladies qui ne pardonnent pas, nous devons nous allier et faire, comme disent les Arabes : « baiser la main que l'on ne peut couper ».
Si quelque chose peut calmer vos douleurs physiques, madame Cadéot vous le dira. Mais - à vous je peux le dire - ce ne sont point tant les simples qu'elle ordonne qui agissent. Cet être merveilleux a surtout le don de communiquer la Foi. Elle possède un don inouï de compréhension, elle lit en vous en quelques secondes, et calme vos angoisses ; après, l'on se dit : comme c'est simple, pourquoi n'avais-je pas pensé cela plus tôt ! Elle a un sens si sûr pour guider l'âme que vous ne pourriez pas ne point l'aimer si vous la connaissiez ; elle m'a été d'un secours immense, et je voudrais qu'elle devienne pour vous une source de réconfort psychique où vous pourriez puiser chaque fois que le découragement vous toucherait.
Et cela sera, je n'en doute pas un instant ; il n'est vraiment que de croire pour être sauvé ; puis aussi d'accepter. [...]
Au revoir, je suis avec vous bien fraternellement, ayez confiance, moi j'ai confiance en vous, et votre écriture ne m'inspire pas d'inquiétude en ce moment, au contraire. La paix viendra.
1. Manon Cadéot était voyante et guérisseuse.
Lettre de Champigny à Antonin Artaud, 5 avril 1931
Je vous aime bien Artaud de m'accueillir aussi simplement. J'allais vous écrire, afin de savoir si vous aviez reçu à temps la réponse de ma meilleure et plus proche amie, madame Cadéot. J'avais un mot d'elle au courrier d'hier (à Mézels il n'y a qu'un courrier, le matin), le voici :
« Ma bonne amie, j'ai écrit moi-même une lettre inspirée par l'occulte à votre ami Artaud expédiée immédiatement en exprès par la poste de Nice et je lui ai fait envoyer la tisane des jardins nécessaire à son traitement. J'espère en la Divine Providence pour lui apporter le soulagement qui lui est dû. Dieu n'abandonne pas les siens. »
J'étais ainsi en partie rassurée ; je ne l'étais pas sur le sort du Moine, je craignais qu'adressé à Nice il se fût perdu. Il m'arrive ce matin de Pâques. [...] Nous avions aussi un oeuf que la poule avait bien voulu pondre aux aurores ! Et voilà, que par surcroît arrive votre lettre et votre livre. La dédicace de l'un, les mots de l'autre, me vont pareillement au coeur, vous ne pouvez imaginer le réconfort que j'éprouve dans mon inutile vie actuelle, lorsque je peux (indirectement) aider un être qui souffre. Vous me demandez ce que j'ai dit à madame Cadéot. C'est bien simple, je lui avais copié textuellement votre lettre. Et je vous copie textuellement aussi ce que j'y ajoutais :
« J'aurais mille choses à vous dire, mais je ne vous écris pas pour moi. Dans les pages qui suivent, vous allez lire la copie d'une lettre que je reçois ce matin ; adressée à Nice elle me revient assez vite, mais quand même je vous supplie de faire toute diligence pour y répondre. C'est un être qui a tellement besoin de secours. Bien mieux que du talent, c'est sans doute du génie qu'il aurait, s'il n'était depuis des années les trois quarts du temps à moitié fou de douleurs ; c'est un écrivain qui ne peut écrire beaucoup du fait de son état. La syphilis, héréditaire je crois, a causé chez lui des ravages terribles ; il s'achemine vers la paralysie et a tout fait comme traitements pour tâcher d'y échapper ; il dit que dans ses douleurs il sent son cervelet se désagréger (excusez, Artaud, cette phrase imbécile qui résume pourtant un peu ce que vous me disiez fin septembre en revenant des Sysies). Je crois qu'il doit avoir 33 ans, je ne suis pas certaine (1) ; pour supporter ses souffrances il se drogue depuis des années et prend chaque jour plusieurs grammes de laudanum.
Je vous sais bonne pour tous, mais je vous supplie de prier Dieu de vous éclairer tout particulièrement pour cet être-là, non seulement à cause du secours qu'il attend de vous par mon humble intermédiaire, mais à cause aussi du retentissement que cela pourrait avoir sur ceux qui l'entourent intellectuellement et qui auraient grand besoin d'être éclairés... sauvés. Artaud est un mystique, j'en suis certaine ; il y a plusieurs années, en lisant son écriture, je lui avais dit qu'il n'y avait de recours pour lui que dans la Trappe. C'est un homme d'une complexité et d'une singularité extrêmes. Il a atteint à de telles souffrances qu'il ne lui manque, je crois, que d'être aidé à retrouver le chemin de la pureté initiale pour pouvoir supporter tant de douleurs ; en paroles il est cynique et passe parfois pour méchant ; il dit des choses atroces, [fin de la copie].
1. Artaud avait alors trente-quatre ans.
Lettre de Henri Larrieu, 18 mai 1931
J'ai vu il y a quelques jours Cécile Denoël qui m'a parlé de vos nouveaux malheurs. Je savais par votre dernière lettre vos actuelles souffrances. Ce n'était pas assez. Il a fallu la maladie de Catherine et les blessures de votre petite auto. Ainsi donc vous êtes une fois encore en proie à toutes les malchances. Madame Denoël m'a réservé un accueil charmant. Elle n'a pas oublié Mézels, je vous assure. C'est un pays qu'elle aime au point, m'a-t-elle dit, d'avoir sérieusement pensé à acheter une maison sur le Causse près de Carennac.
Vendredi dernier, j'étais invité rue Amélie à une conférence d'Alin Laubreaux sur les poètes de la table (1), et je ne vous cache pas que, malgré un excellent déjeuner absorbé ce jour-là, j'ai senti progressivement la faim renaître, ainsi que le désir de boire autre chose que de l'eau, lorsque le conférencier, bonne humeur en personne et bien gras, vous récitait avec gourmandise les poèmes gratinés de Villon ou Raoul Ponchon.
1. « Le vendredi 8 mai 1931 à 21 heures, conférence d'Alin Laubreaux, auteur de L'Amateur de cuisine, sur les poètes de la table (de Villon à Raoul Ponchon) » [L'Homme libre, 7 mai 1931]. L'Amateur de cuisine a été publié en mars 1931 par Denoël et Steele.
1935
Lettre de René-Louis Doyon, 20 juin 1935
Ma chère et céleste Champigny, je te sais grâce d'avoir songé à m'aider, fut-ce pour la petite part. Si ce projet de conférence est viable, je peux traiter :
1° une conférence sur Barbey si l'on y conjoint extérieurement une exposition livresque et iconographique.
2° une sur Pierre Louys.
3° une sur la musique andalouse avec audition de disques, etc... (1)
Je ne multiplie pas les sujets littéraires ou musicaux mais en aucune façon de l'actualité, pour la bonne raison qu'elle m'écoeure, m'épouvante et me la fait presque nier malgré ses cuisantes contingences. Pour le prix, j'accepte ; le séjour m'est indifférent ; je ne resterai certainement pas plus de 2 à 4 jours.
1. La foire-exposition de Vichy se déroula du 29 août au 3 septembre 1935. Le sujet de conférence choisi par Doyon fut la musique andalouse. Celui de Robert Denoël, qui parla le 30 : « Editeurs et gens de lettres ».
Lettre de René-Louis Doyon, 1er octobre 1935
Ton ami a eu tort de cacher son article (1) ; je le trouve chaud comme une résonnance et bien sincère ; je viens de lui écrire de m'en envoyer une dizaine car il me plaît et je le garderai, tandis que j'ai fait beaucoup de fumée avec celle des louanges.
1. Denoël et Doyon se sont donc rencontrés pour la première fois en septembre 1935 à Vichy, grâce à Champigny. L'article évoqué est celui de la conférence de Denoël, « Editeurs et gens de lettres ».
Lettre de René Barjavel, s.d. [fin 1935]
Quand vous avez dit, le soir, en vous levant de votre fauteuil : « Il ne faut pas que je manque mon départ », il y avait dans vos yeux tout un grand désespoir que j'ai vu. Comme quand on enjambe le parapet du pont. Parce que vous sentiez que c'était un grand départ, peut-être le premier vrai départ de votre vie, et que vous ne saviez pas où il vous mènerait (1)
Champi, j'y ai beaucoup pensé, et je vais vous parler avec mon coeur de rose, parce que je crois que je suis votre vérité. Si je me trompe, vous n'aurez qu'à jeter ma lettre au feu avant la troisième page, et vous dire que je suis un enfant.
Voici : vous êtes partie là-bas pour écrire, je ne crois pas que vous le ferez. C'est trop peu pour vous. Vous êtes partie vers quelque chose de plus grand que ça. Champi, vous êtes faite pour aimer et pour vous donner, et je ne crois pas que vous avez le droit ou la possibilité de penser à vous et de vous reposer. Vous souffrez parce que vous vous dites que vous avez droit au repos et parce que vous ne pouvez pas le trouver. Je pense que si vous vous dites bien que vous n'avez pas droit au repos, qu'il n'est pas fait pour vous, vous ne sentirez plus la fatigue.
Vous avez passé votre vie à donner. Vous devez continuer. C'est votre sens. Mais il n'est plus temps de donner à un être, ou à un autre, ou à quelques uns. C'est à Tous. C'est ça votre grand départ. Vous êtes ma soeur que j'aime, et je vous comprends avec mon coeur, et c'est avec mon coeur que je vous parle.
Champi vous devez aller vers les Hommes, et non plus vers des hommes, vous devez aller vers les Hommes, et leur dire leur vérité. Il y en a un qui commence à leur parler et à leur montrer du doigt. C'est Giono. Votre place est à ses côtés. Vous êtes de la même race, vous et lui, et vous avez le même devoir à remplir.
Champi il ne faut pas songer au repos enfin gagné, votre vie commence. Avant, c'était rien. Vous étiez une femme, non pas comme tant d'autres, mais quand même rien qu'une femme. Maintenant vous devez être celle qui ira vers les hommes et qui leur dira ce qui doit leur être dit, sans l'envelopper. Cette force d'amour qui vous crève, c'est eux qui en ont besoin.
Champi, ils sont bien malheureux, et vous pouvez tant leur donner. Je ne sais pas comment ça se fera, mais si je devine bien, si je vous connais bien comme je vous aime, je sais que vous le ferez.
Robert a trouvé ce qu'il fallait aux M.H. [Messageries Hachette] et chez Lang. Il commence à redevenir lui-même, mais il avait plongé très profond.
1. Champigny est sur le point d'entreprendre un long périple de quatre mois dans les îles du Pacifique.
1936
Lettre de Jean Brunel, 29 janvier 1936
Je suis désolé des nouvelles désagréables que vous m'avez données de vous et de votre maison (1). La demande de dégrèvement a été envoyée.
Comment va Barjavel (2) ? Lui serait-il agréable que je lui fasse signe pour le rencontrer ? Une réponse franche, il m'est très sympathique mais je n'aimerais pas l'embêter.
1. « La Mézellerie » a été ravagée par un incendie quelques jours plus tôt.
2. René Barjavel a été engagé par Robert Denoël en octobre 1935 sur la recommandation de Champigny. Il habite un petit appartement 41 rue Lecourbe (XVe) et se plaint de la solitude dans une grande ville inconnue où il ne connaît personne.
Lettre de Bernard Steele, 10 février 1936
Où en es-tu ? As-tu pu faire le point ? (Je mets des points d'interrogation, mais c'est pour la forme : tu répondras ce que tu voudras). J'ai été si content de ce voyage et de ce séjour auprès de toi (1) ! En aurais-tu retiré autant de réconfort que moi ? Tout a été simple - mais il n'y a que le simple qui soit miraculeux. Je ne te remercie pas - il faudrait trouver d'autres mots pour exprimer le sentiment que je ressens.
J'ai pensé aussi à ton horoscope : il doit y avoir une erreur d'heure de naissance. L'ensemble est bon, mais le facteur principal manque. Rien que quelques minutes peuvent suffire à rendre tout faux. Pour bien faire, il serait bon d'envoyer à ton astrologue une série de dates importantes, afin de lui permettre la reconstitution de ton horoscope.
Par un processus de rétro-rotation, il peut alors retrouver exactement l'heure de la naissance. C'est un long travail pour lui, mais il n'y perdrait pas sa peine. Donne-lui une vingtaine de dates, très marquantes, et espacées sur une période de 15 ans. Cela lui facilitera son travail. Surtout, n'oublie pas de lui indiquer, très exactement, le moment où tu vis Catherine pour la première fois, ainsi que le moment de son départ définitif. La date, et si possible, l'heure de ton opération - enfin des points culminants - tu vois le genre. Surtout n'oublie pas les dates où tu faisais des voyages sur l'eau - les autres ont, pour toi, moins d'importance (2).
1. Steele a passé une quinzaine de jours à Mézels, chez Champigny.
2. On savait Steele versé dans la psychanalyse mais ses connaissances en astrologie impressionnent, d'autant qu'il s'adresse à quelqu'un qui n'ignore pas le sujet, puisque Champigny tire régulièrement les cartes et les tarots à ses amis, et se passionne depuis longtemps pour la graphologie.
Lettre de René Barjavel, 16 février 1936
Et ces temps-ci je suis tellement un inconnu pour moi-même ! Je souffre beaucoup moins de ma solitude. J'y ai trouvé un équilibre. Je travaille à François (1). Je suis content. Cela me permettra d'attendre et de ne pas me jeter sur n'importe quelle nourriture sentimentale. Je suis toujours affamé, mais je n'ai pas l'impression que je vais en crever, comme pendant quelques jours. J'ai encore de l'impatience, mais plus d'inquiétude. Je sais que je rencontrerai, le jour venu, celle dont j'ai besoin et qui a besoin de moi.
Vous comprenez, Champi, il faut que je devienne un homme, pour moi et pour Robert, qui commence à s'énerver de me voir peiner à sortir de mon enfance. Vous savez, vous qui me connaissez si bien, combien je suis enfant sauvage, le petit paysan de Nyons. Il faut que je m'en guérisse ou que je retourne à la terre qui adhère encore tant à mes semelles.
1. « François le Fayot », un roman écrit au retour de son service militaire, resté inédit, mais dont une partie se retrouve dans Tarendol (1946).
Lettre de Bernard Steele, 19 février 1936
Une vie, mon petit, mais une vie dont on ne peut pas se rendre compte ! Je ne fais que galoper, du matin au soir, depuis la Chambre des Députés jusqu'au Ministère de l'Intérieur, en passant par les bureaux des chefs de service, etc, etc. J'ai alerté tout Paris pour ta bicoque (1), et si je ne réussis pas, ce sera vraiment qu'il n'y a rien à faire. Mais j'ai bon espoir : peut-être pas pour toute la somme, mais au moins pour une partie.
Quoi qu'il en soit, de ma vie je n'ai jamais vu autant de fonctionnaires, de députés et de ministres. Et moi qui, depuis treize ans que j'habite Paris (2), n'avais jamais mis les pieds à la Chambre ! Enfin, c'est pour le bon motif - et c'est cela qui compte.
Tu trouveras ci-inclus la copie de la lettre adressée au Préfet du Lot. C'est la même que j'ai adressée à Monsieur Sarraut (3) qui la recevra de deux côtés différents. Il faudra peut-être, puisque je fais toutes les démarches pour toi, que tu me donnes une procuration, dûment paraphée, en vertu de laquelle tu m'autorises à tout faire, tout signer etc. en tes lieux et place. Le papier doit être légalisé à la mairie.
Si j'en ai besoin, je télégraphierai « Envoie procuration ». A ce moment-là, il me faudra le papier dans les 48 heures, et cela t'indiquera que je suis sur le point d'aboutir. Pour l'instant, j'ai de l'espoir, mais sans plus. Pourtant, j'aimerais tant pouvoir te rendre ce service !
Je te remercie de toutes tes bonnes lettres qui me font un plaisir énorme. Mais je suis un peu inquiet de ta santé - faut qu'ça change, ma fille ! J'espère que ta prochaine lettre m'apportera de meilleures nouvelles.
Quant à moi - j'ai réussi à parer le premier coup qui s'est transformé en une victoire éclatante. Le deuxième coup est tombé comme prévu - c'est plus dur. Si j'arrive à m'en sortir (de cette deuxième passe d'armes) tu pourras te vanter de ton Bernard - il aura réussi quelque chose ! Malheureusement, tout ceci retarde mon voyage. Si tout va pour le mieux, aussi bien pour ta maison que pour mes petites affaires personnelles, le plus tôt que je pourrais songer à partir serait vers le 6 mars. Et pourtant, ce voyage est indispensable pour mon affaire. Mais je ne suis qu'un seul homme et ne puis, par conséquent, m'occuper de trop de choses en même temps (4).
1. Un incendie a ravagé sa maison de Mézels en janvier, et Bernard s'efforce de lui obtenir une intervention de l'état. Une lettre de Denoël datée du 28 août 1936 lui annonce qu'un mandat du Gouvernement de 4.000 francs est arrivé pour elle rue Amélie.
2. Un rapport des Renseignements Généraux daté du 30 juin 1935 indique que Bernard Steele est « arrivé en France au début de mai 1925, nanti du passeport américain n° 468.717 visé au consulat de France à New York le 19 août 1924 ».
3. Albert Sarraut [1872-1962], président du Conseil et ministre de l'Intérieur.
4. Bernard Steele a des projets personnels qui ne concernent plus l'édition, mais on n'a pas d'informations à ce sujet.
Lettre de René Barjavel, s.d. [février 1936]
Champi, vous n'êtes pas quelqu'un à qui on écrit n'importe quand. Parce qu'on ne vous écrit pas pour vous dire simplement « Comment allez-vous ? » Vous êtes la soeur et l'amie, vous êtes le coeur tout près du nôtre. On ne vous écrit que parce que c'est bon pour moi ou pour vous. Mais pour vous, Champi, c'est si difficile. Je pense que je peux quand même quelque chose. C'est au cas où votre maison ne pourra plus vous abriter, au cas où Mézels lui-même vous chasserait. J'écrirais à Buis et mon frère vous trouverait sans doute un toit. Vous seriez moins seule, bien que vous n'aimiez pas les enfants, et vous ne seriez pas loin de Giono (1).
Je vous remercie pour la chienne blonde, Champi, mais je n'en veux pas, pas plus que je ne désire une chatte de Doyon (2). J'ai besoin d'un être à l'épaule de qui je puisse parfois, aux moments de trop grande lassitude, confier ma tête, quelqu'un dans mes bras, le soir, pour m'endormir. Je n'ai pas fini de chercher ma mère (3), Champi. Je la chercherai, je crois, toute ma vie.
L'autre soir, chez Robert, j'ai fait la connaissance du Dr Laforgue (4). J'ai eu la surprise de voir Robert perdre devant lui toute son assurance, être devant lui en admiration comme un enfant, comme moi je le suis devant Robert. Et pourtant, Champi, Robert vaut mieux que lui. Il ne m'a pas emballé du tout, ce brave psychanalyste. Mais je pense que chacun de nous, Robert peut-être plus que quiconque, a besoin d'avoir quelqu'un à admirer.
1. La maison a de Champigny a été incendiée en janvier. Emile Achard, le demi-frère de Barjavel, né en 1902, était ingénieur civil et habitait Buis-les-Baronnies, dans la Drôme.
2. Dans sa première lettre Barjavel se plaignait de sa solitude, « sans même un chien ». Champigny lui a proposé une petite chienne, et René-Louis Doyon [1885-1966], qui travaille par intermittence rue Amélie, une petite chatte.
3. Marie Barjavel-Paget est morte le 29 mai 1922, alors que Barjavel n'avait que onze ans.
4. René Laforgue [1894-1962] dirigeait, depuis 1931, la collection « Bibliothèque Psychanalytique » chez Denoël et Steele. Il était aussi l'analyste de Denoël.
Lettre de Bernard Steele, s.d. [mars ? 1936]
Je ne puis pas t'expliquer le « pourquoi » de ma rentrée à Paris - il fallait que j'y fusse à l'heure dite, et, une fois de plus, mon instinct ne m'a pas trompé. Sache pourtant que je suis menacé, très menacé, et que les deux coups - dont l'un s'était déjà produit (j'attends l'autre de seconde en seconde) - pouvaient facilement m'annihiler ! Pas moins !!
Il me faut rester encore le temps de poser le second coup - après - je pourrai peut-être partir. Si cela se trouve, ce serait peut-être là la seule issue. Il ne s'agit pas d'une fuite - peu s'en faut - mais d'un refus après le plus dur combat que puisse mener un homme. Tu en auras des nouvelles, mais de vive voix seulement. Il est des choses que l'on n'écrit pas !
D'ici lundi soir, tu auras de moi un télégramme. De deux choses l'une : ou je pourrai partir tout de suite, et en ce cas, je te fixerai rendez-vous, ou il me faudra rester un temps impossible à prévoir. S'il me fallait rester, vas, toi, dans le midi - on verra après. Quoi qu'il en soit, ne t'occupes pas de moi - je suis actuellement imperméable [?] et... seul.
Lettre de Jean Brunel, 6 avril 1936
J'espère que votre voyage s'est bien passé et que la première étape, pour courte qu'elle soit, a été sans histoires (1). Je suis heureux pour vous du magnifique voyage que vous entreprenez. Je crois que ce sera pour vous un enrichissement et, je le souhaite vivement, le point de départ d'une période heureuse de votre existence.
Pour vos papiers, je sais ce que vous voulez faire et vous adresse le modèle d'une lettre, mais avez-vous songé à prendre des dispositions pour Mézels et pour votre fortune mobilière (tableaux, livres etc...) Si oui, dites-moi vos désirs et je vous donnerai la formule (2).
Si, au passage, vous trouvez des objets intéressants ou curieux, et que le prix n'en soit pas exagéré, achetez-les pour moi. Je vous enverrai une petite provision à Papeete car mes fonds seront alors en meilleur état. Tâchez de me faire la collection d'un type intelligent qui ferait le tour du monde, sans grande monnaie en poche. Vous m'enverrez les objets au fur et à mesure.
1. Champigny a entrepris en mars un long périple en Polynésie française. Elle visitera successivement Papeete, Bora-Bora, Nouméa.
2. Elle a demandé à Me Brunel de rédiger son testament.
Lettre de Bernard Steele, s.d. [printemps 1936]
En ce qui concerne le voyage - rien à faire pour l'instant. Je suis bloqué à Paris au moins jusqu'à la Pentecôte, car maman (1) est là. C'est tout dire.
Ne viendras-tu pas ici ? Nous en avons des choses à nous dire... bon Dieu, quinze jours de 24 h ne suffiront pas. Enfin, on verra, on avisera. Mais le temps me semble bien long depuis Mézels, février 1936, par pleine lune. C'est un des plus beaux souvenirs de ma vie !
1. Beatrice Hirshon restera à Paris bien au-delà de la Pentecôte : le 30 décembre 1936, elle cède à Robert Denoël 125 parts sociales qui lui appartiennent dans la Société des Editions Denoël et Steele.
Lettre de Jean Brunel, 12 août 1936
J'ai été aujourd'hui voir votre père à l'Hôpital Broussais où il est soigné à la suite de l'agression dont il a été victime avant-hier au soir (1). Il va aussi bien qu'il se peut. J'ai vu l'interne qui était de garde lors de son admission et qui l'a opéré. Il n'est nullement inquiet. Votre père avait une fracture du crâne.
Voici ce qui s'est passé. Dans la nuit du 10 au 11, il a été réveillé par un malfaiteur qui s'était introduit dans sa chambre. Celui-ci avait pris l'argent (17.000 fr) qui se trouvait dans son gilet, voyant votre père éveillé, il l'a assommé à coup de hachette. Votre père a dû s'évanouir, il s'est réveillé plus tard, a alerté ses voisins, il croyait alors avoir rêvé. Il a pu, sans perdre connaissance, aller au commissariat puis à l'hôpital, où il a été conduit pour une « plaie du cuir chevelu ». Tout aussitôt l'interne a diagnostiqué une fracture du crâne. Il a enlevé les esquilles qui s'étaient formées. Je vous répète qu'il n'est pas inquiet.
Tous les journaux s'étant emparé de l'aventure, je l'ai appris ainsi. J'ai aussitôt été à Broussais où j'ai vu votre père, que j'ai été étonné de trouver aussi bien. Il se préoccupe beaucoup de vous. Je lui ai dit que je vous préviendrais. Il dit connaître son agresseur. Je lui ai reproché d'avoir cette somme sur lui (reliquat Koenigsmark), il m'a dit l'avoir retiré du Crédit Lyonnais à cause d'Hitler et du Front Populaire ; à ce sujet il enfourchait les théories que vous lui connaissez : c'est vous dire qu'il va bien.
1. Le 10 août au soir, René Champigny a été victime chez lui, à Montrouge, d'un cambriolage qui a mal tourné. Le 28 août Denoël lui écrit aussi à ce sujet, et pour la rassurer.
Lettre de Jean Brunel, 27 septembre 1936
J'ai passé avec Marianne moins de temps que je ne pensais à la Retirance (1), ayant été obligé de rentrer à Paris avant le jour prévu, mais j'y ai passé des jours pleinement heureux. Il y avait du soleil et je ne vivais que de lecture et de soleil. Les Caillard et Mme Denoël ont été fort aimables mais ils avaient laissé la maison dans un état de saleté indicible. Nous n'osions rien toucher. Nous avons aussitôt fait venir une femme de ménage qui a eu besoin de plus d'une journée pour établir une propreté relative.
Vous ai-je dit que j'avais vu, quelques jours avant mon départ, Barjavel ? Il m'a paru plus assis, plus homme qu'auparavant - je le lui ai dit. Il en a paru content et comme encouragé. J'espère qu'il aura été content - comme moi - du moment passé ensemble. Je dois voir incessamment Denoël, qui a manifesté le désir de m'entretenir. Je vous tiendrai au courant.
J'ai su que vous aviez été horriblement malade. Qu'avez-vous au juste ? Que devenez-vous ? Etes-vous mieux ? Quand rentrez-vous ?
1. « La Retirance était une petite maison extrêmement modeste, dans le Malvent, entre Saint-Paul-de-Vence et Cagnes-sur-Mer, que Cécile et Robert avaient achetée, mais dans laquelle ils laissaient les occupants, leurs amis Manon et Adrien Caillard » [Albert Morys : « Cécile ou une vie toute simple » [mémoire inédit, 1982]. Il semble que cette petite maison appartenait en réalité à Champigny, qui en percevait les loyers. Le 18 mai 1936 Jean Brunel lui avait écrit : « je me suis mis d'accord avec les Caillard pour la Retirance (mois de septembre : 500). »
Lettre de Jean Brunel, 25 octobre 1936
Je n'ai pas eu de nouvelles de votre père depuis le mois de septembre, époque où il me disait se remettre bien physiquement sinon moralement, il était chez ses amis de Raincy. Il doit donc continuer à bien aller, sans cela j'aurais de ses nouvelles. Je ne sais nullement ce qui s'est au juste passé. J'ai l'impression que votre père, lui, ne l'ignore pas et que la version qu'il a donnée de son aventure n'est peut-être pas la vraie.
Jusqu'à présent je pensais qu'il avait tenu dans un café (celui où il allait jouer aux cartes sans doute) les théories que nous lui connaissons sur le Front Populaire etc... et qu'il s'était vanté de garder son argent sur lui pour qu'on ne lui prenne pas. Il n'était pas difficile alors de l'aborder, de dîner avec lui, de le faire boire et de tenter le coup. Enfin votre père ne se laissant pas faire, d'où bagarre et blessures. Voilà ce que j'avais imaginé.
Je vous parlais de la mort de votre ami Brun (1) dans une des lettres que vous n'avez pas reçues. Voici ce que j'en ai appris. Ayant à me rendre à Vichy pour le 14 juillet, j'écrivis quelques jours auparavant pour retenir une chambre. J'appris alors qu'il était en traitement à Lyon, ayant eu une crise subite de dérèglement mental. Son directeur ajoutait qu'il avait pour lors une congestion pulmonaire.
Barjavel me dit vers la fin du mois qu'il était mort. C'est au cours d'une réunion entre patrons et employés de l'industrie hôtelière que cet accident lui arriva. C'était vers le début de juillet, lors des grèves. Il est probable qu'il avait été impressionné par ce mouvement social, qu'il en ait prévu des répercussions funestes pour son affaire qui n'allait déjà pas et qu'il a eu une rupture brusque d'équilibre. D'après ce qui m'a été dit, il serait presque aussitôt devenu furieux. J'imagine qu'il a été mal soigné parce que trop violemment et par douches, ce qui a dû déterminer une congestion pulmonaire après celle du cerveau.
Puisque nous en sommes au chapitre des morts, vous avez sans doute su celle de Dabit, qui est mort en septembre durant le retour d'un voyage entrepris en U.R.S.S. avec Gide. Je ne sais pas si c'est d'une scarlatine ou d'une typhoïde. Cette mort m'a moins troublé que celle de Brun, qui était un si brave type.
Depuis mon retour j'ai appris le mariage de Barjavel par une lettre ainsi conçue : « Cher ami, je ne veux pas que ce soit un simple faire-part qui vous apprenne la nouvelle. Je suis marié depuis hier (2). Ma femme s'appelle Madeleine. Elle est jeune, blonde, douce, aimante. Nous nous aimons fort, nous serons heureux et nous aurons beaucoup d'enfants ! » et les formules de politesse. Je ne l'ai pas encore revu, ni par-là même sa femme ! Dès que cela sera, je vous écrirai mes impressions. Pour l'instant je suis heureux pour lui.
Je devais voir Denoël il y a une dizaine, mais nous nous sommes manqués. Je ne sais ce qu'il désirait me dire. Il a sorti un journal qui s'appelle L'Assaut (3) et qui est anticommuniste (qu'il dit) mais surtout atrocement réactionnaire et croix de feu. C'est abominable. J'imagine qu'il va se casser les reins d'une manière éclatante. Ce qui plus est, c'est un journal mal fait - cela s'améliorera peut-être. Mais quelle pauvreté intellectuelle, quelle gaffe ! Aussi suis-je bien peu pressé de voir Denoël, qui me demandera sans doute mon opinion. J'aurai du mal à la lui cacher.
Combien de temps restez-vous chez Sonia (4) ? Où allez-vous ensuite et où faut-il vous écrire ? Ce qui me ferait une joie magnifique, ce serait de pouvoir être avec vous à Yunnanfou. Dites-le à Sonia, dites-lui que je pense à elle et à son mari.
1. Maurice Brun, directeur de l'hôtel « Les Célestins » à Vichy, où Champigny a résidé durant l'été 1935. Denoël avait publié, à sa demande, un article de lui intitulé « L'Hôtellerie devant l'impôt », qui parut dans sa revue Le Document d'octobre 1935.
2. Le mariage de René Barjavel avec Madeleine de Wattripont [1915-2005] eut lieu le 10 octobre 1936.
3. Le premier numéro de cet « hebdomadaire de combat politique et littéraire » dirigé par Alfred Fabre-Luce parut le 13 octobre 1936.
4. Au cours des années vingt, Sonia Jablonska, d'origine slave, fut, comme Catherine Mengelle, l'un des modèles de Caillard, puis sa maîtresse. Elle avait épousé un ressortissant polonais, avec qui elle vivait à Yunnanfou en république populaire de Chine, aujourd'hui Kun Ming.
Lettre de Jean Brunel, 29 novembre 1936
Je devais aller voir Denoël, j'y ai été, je suis arrivé en retard (c'était le 13 octobre). Il était parti. Depuis je n'y suis pas retourné, son journal L'Assaut me faisant horreur. Je n'aurais pu que le lui dire, ce n'était vraiment pas la peine.
Lettre de Bernard Steele, 8 décembre 1936
Ne crois pas qu'il y ait eu interférence entre nous. Je t'ai souvent vue et entendue - j'ai également reçu deux lettres de toi. Je n'ai pas pu te répondre - il y a, chez moi, comme tu le sais, des périodes d'incommunicabilité. Ce n'est que maintenant que j'en sors un petit peu, et pour peu de temps. Cela me joue de vilains tours, mais je n'y puis rien.
Le chambard de ma vie est complet. Je viens de quitter les Editions et j'ai vendu L'Anthologie (1). Tu devais le pressentir, après Mézels. Personne ne saura jamais ce que cela m'a coûté en souffrances. Il est, cependant, des souffrances salutaires! Mon avenir est maintenant devant moi, libre de tous encombres. Je ne sais pas encore ce que j'en ferai.
Cet été, au mois de septembre, je suis allé dans le Quercy. La Mézellerie (2) est encore debout et intacte. Ton jardin est un désert recouvert de ronces. J'ai pleuré tes rosiers. Il n'y avait pas un fruit. J'ai essayé d'entrer dans la maison, mais je n'ai pas pu. Où est la clé ? Je m'y serais volontiers installé quelques jours si j'avais pu.
1. « L'Anthologie sonore » est une S.A.R.L. fondée en octobre 1934 par Bernard Steele et Maurice Dalloz, un disquaire parisien. Durant deux ans elle édita des disques classiques de grande qualité. Un bureau de vente se trouvait au 19 rue Amélie, c’est-à-dire à l'adresse des Editions Denoël et Steele. Le 30 décembre, Bernard a donné verbalement sa démission en tant que gérant des Editions, puis cédé toutes ses parts dans la société. Il semble que sa décision de quitter la rue Amélie était déjà prise à Mézels, en février 1936.
2. Nom de la maison de Champigny à Mézels, déserte en son absence.
Lettre de Jean Brunel, 14 décembre 1936
Je n'ai pas été voir Denoël pour les raisons que je vous ai données dans une lettre passée, mais je sais qu'il a édité un bouquin de Louise Hervieu : « Sangs » (1), qui fait grand bruit. Je ne l'ai pas lu mais la publicité que je juge infâme faite autour de cet ouvrage me console de ne pas vous voir éditée par votre ami. Qu'est-ce qu'il aurait fait de votre vie ?
1. Le roman est paru chez Denoël et Steele le 25 octobre, et a été couronné par le prix Femina le 8 décembre. Il a bénéficié d'une campagne de presse importante mais on ne voit pas trop ce que cette publicité pouvait avoir d'infamant. Rien de ce qu'entreprend Denoël ne trouve grâce aux yeux du notaire.
Lettre de Jean Brunel, 28 décembre 1936
La lettre arrivée ce matin de Yunnanfou m'a causé beaucoup de joie. J'écris aujourd'hui même à Barjavel. Je lui demande un rendez-vous pour savoir un peu ce qu'il a dans le ventre.
Je vous ai dit dans des lettres précédentes pourquoi je ne tenais pas beaucoup à voir Denoël. J'ai reçu dernièrement une invitation de Mme Denoël adressée à Marianne et à moi, invitation à une vente de charité où Mme Louise Hervieu dédicaçait son dernier livre (1). Je n'ai pu y aller, j'ai envoyé un louis et n'ai même pas reçu de remerciements ou, tout au moins, d'accusé de réception.
1. Cette séance de dédicace eut lieu le 11 décembre à l'Hôtel George V.
1937
Lettre de Champigny à Sonia Jablonska, 2 janvier 1937
Voyons un peu pour ma part ce que j'étais quand je t'ai connue. Une femme de trente ans (1), encore jeune au physique ; très marquée moralement ; une femme ayant fort vécu, beaucoup aimé, beaucoup agi, et frôlé assez d'êtres et de milieux divers pour avoir acquis une partie de ce qui manquait à mon instruction.
J'avais consacré mes dernières années à un homme (2) en lequel j'avais cru avec une foi absolue. Certainement je l'avais aimé comme un amant ; bien sûr j'avais parfois souffert en femme maîtresse. Mais cela, c'était l'anecdotique de notre liaison. La réalité était plus émouvante. Je le considérais comme un compagnon. Ensemble nous avions travaillé pour conquérir notre indépendance ; ensemble nous avions lutté pour imposer des idées ou des oeuvres ; ces efforts-là avaient tressé autour de nous à notre insu une trame plus solide que tout, un lien que le temps, les gens, les évolutions différentes non plus que les sentiments extérieurs à nous ne peuvent rompre, même avec les années.
En 1926, à l'automne, cet homme, séduit par une très jeune fille, émet le vouloir que nous restions dans la vie des compagnons mêlés par le travail et l'idéal, à condition que je consente à sa totale liberté qui consiste à aimer la jeune fille qui passe. Cela débute l'été à la campagne et se poursuit à l'automne précoce d'octobre. Durant des nuits nous discutons. Je l'ai aimé ; je l'aime encore d'une affection très profonde mais je ne peux ni ne veux plier devant ce qu'il attend alors de moi. Je déclare que je préfère une séparation. Cette séparation me déchire. Même quand tout l'amour est usé, c'est une partie de notre jeunesse qui craque et meurt quand nous vivons une rupture.
C'était la Toussaint. Je quittai Paris pour la province où résidait Joë (3). Trois jours de vacances, trois jours éclatants. Trois jours sans excès intellectuels, sans discussions nocturnes plus épuisantes que des nuits d'amour. Et durant ces trois jours, telle avait été ma métamorphose que ce qui m'eût déchirée de peine huit jours avant, était accueilli par moi avec la plus totale sérénité.
Je mis naturellement Christian au courant ; j'avais trop accoutumé de tout lui dire pour lui cacher cela. Il en eut les nerfs à fleur de peau et cette huitaine-là fut dure ; les tiraillements entre nous recommencèrent. Si je lui disais tout, lui par contre me parlait en somme peu de ses rencontres féminines. Quand cela arrivait, il me parlait de Germaine (4) si frêle, si pure, si immatérielle !
Ma vie avait bifurqué à angle droit et, après des années d'idéalisme, je venais d'entrer dans l'unique période de ma vie où j'ai été une femelle. Je pensais à Joë, je parlais de Joë, j'aimais Joë, je débordais de Joë, et cela devait même être plutôt inconvenant pour un homme qui, peu de jours avant, m'avait vu sangloter de désespoir parce que notre vie à deux était finie.
Or, ce que nous avions voulu (lui, spécialement) par influence de Loutreuil, c'était la liberté absolue, y compris celle des sens, à condition qu'une franchise absolue elle aussi, enlevât à cette liberté tout caractère équivoque. Dès lors, les partenaires éventuels pouvaient croire qu'ils étaient des pions sur un jeu d'échecs, ce que crut Joë quelques mois plus tard, par exemple quand, après les premiers mois d'excessive animalité, il se rendit compte que si j'étais sa femme, si je partageais sa vie, ses soucis, si je payais ses dettes et couchais dans son lit, je n'en étais pas moins la compagne d'esprit de Christian !
En son absence, ma galerie que j'abandonnais trop pour Joë, périclita, l'argent nécessaire à la soutenir filait trop vite. Joë était malheureux de mes absences inévitables, je résolus donc de céder et de l'épouser, afin de vivre une vie dans le genre de celle que tu as choisie maintenant.
J'avais des remords, un peu, envers les peintres ; pourtant je trouvais que depuis des années, j'avais fait plus pour tous les artistes morts ou vivants qui m'entouraient que pour moi-même. Je pensais sagement qu'il était juste temps de faire ma vie, qu'après il serait trop tard ; je m'ouvris de tout cela à Christian, auquel j'écrivais beaucoup ; il m'approuva, et je me suis mariée le 1er avril (5), en l'absence de Caillard, toujours au Maroc.
Comme nos intérêts étaient aussi liés (6) que nos esprits, il n'était pas très argenté, cette année-là ; les bonds de la livre et ma perte sur le bail avaient anéanti la galerie, ou presque. Je ne possédais plus ce mois-là, grâce à la conduite de Joë, que quelques tableaux, ma machine à écrire, ma maison, et 16.000 frs sous séquestre que je ne pouvais toucher.
J'étais après coup désespérée à cause de Joë. Ce n'est qu'après plusieurs semaines, quand j'eus réalisé pleinement l'abandon de ma liberté, le don de tout ce que j'avais fait pour tirer Joë d'affaire, la perte de ma galerie, donc de ma liberté de travail, etc., que j'entrai de plein pied dans la douleur de cette rupture basée, je l'ai su plus tard, sur une lâcheté.
Je dois dire que Francis (7), à cette époque, fut utile et secourable. Un jour que Denoël me reprochait à juste titre Francis, je lui répondis qu'au milieu d'un champ de roses, le chien qui se sent empoisonné ne va pas manger des roses mais du chiendent. Colson était un veule, un escroc, un maquereau, mais Colson avait le don des dévouements opportuns, et je lui rends au passage cette justice qu'alors il fut un ange de patience à mes côtés. Je ne voulais qu'une chose : parler nuit et jour de Joë. Il eut la patience d'écouter. Je pus ainsi aller au bout de mon obsession et en sortir partiellement ; après quoi je revins à Paris, au Pré-Saint-Gervais.
Je partis au Maroc ; c'est à Marrakech, après tant de chocs physiques et de commotions nerveuses, que se déclenchèrent les histoires vertébrales sous la forme première ; j'étais à bout, je ne pouvais plus marcher.
J'ai présenté Catherine à Christian, la veille de quitter Paris avec elle. Je ne sais plus si tu étais présente au pré [Le Pré-Saint-Gervais]. Je venais tout soudain de décider que cette adolescente (8) allait partager ma vie. Oui, tu y étais, ou alors je confonds avec une autre date, car je revois un soir où nous avons dîné ensemble, toi, lui, Catherine, les Denoël et moi, dans le quartier du Champ de Mars.
Un jour il m'emmena sur la rivière pour me parler ; ses objurgations à lui tendaient à me convaincre que vivre à deux femmes était une gageure, une vie fausse, que cela ne me menait à rien, que je devais me séparer de Catherine. Mais toi, lui dis-je, es-tu donc insensible à son charme, à sa jeunesse ? Non, répondit-il après un temps de réflexion, puis il ajouta avec tristesse : mais jamais je n'aurai le courage d'attacher à ma vie un être aussi absorbant, aussi parasitaire, ce serait renoncer à ma peinture.
1. Les deux femmes se sont donc rencontrées en 1925.
2. Christian Caillard.
3. François Jossinet dit Joë habitait Liesse-notre-Dame, près de Laon, dans l'Aisne. Comme Denoël, il avait fait son service militaire dans le service de santé (sergent infirmier en 1928, lieutenant médecin en 1932, dans l'armée de réserve).
4. Germaine Cellier, la future parfumeuse parisienne. Née à Bordeaux le 26 mars 1909, elle s'est trouvée dès 1926 à Paris, en compagnie de sa cousine Catherine Mengelle. Elle suit des cours de chimie et habite chez ses parents, à Argenteuil. Mais elle pose à l'occasion pour Caillard, qui peint son portrait à cette époque. Maîtresse de plusieurs artistes comme Chas-Laborde ou Jean Oberlé, elle a longtemps fréquenté les milieux artistiques. Elle est morte en 1976, dix ans après sa cousine Catherine.
5. Champigny et Joë Jossinet se sont mariés le 2 avril 1927 à la mairie du Ier arrondissement.
6. Caillard et Champigny ont ouvert en novembre 1925 leur galerie de la rue Sainte-Anne. Si c'est Champigny qui en est la gérante et qui paie le loyer, l'apport de Caillard est essentiel puisque, en tant que légataire universel de Maurice Loutreuil, il détient près de 200 toiles et plusieurs centaines de dessins et aquarelles de son ami disparu le 21 janvier 1925.
7. Ce Francis Colson m'est inconnu. Denoël en parle en 1928 dans deux lettres à Champigny, sans aménité.
8. Catherine Mengelle avait alors seize ans.
Lettre de Jean Brunel, 21 mars 1937
Je commence à être inquiet de vous. Je n'ai rien reçu depuis votre retour en France. Votre dernière lettre trahissait une grande lassitude. J'espère que vous retrouvez en ce moment forces et courage. Donnez-moi de vos nouvelles, ne serait-ce que par un mot très court. Je pense que vous êtes bien chez les Caillard (1), et non pas déjà repartie.
J'ai vu Barjavel, qui est vraiment un garçon bien, quoiqu'il n'ait pas été chic de vous laisser sans nouvelles. Je le lui ai d'ailleurs dit comme je le pensais. Sa femme, que j'ai vue aussi, est gentille.
1. En rentrant de voyage à Marseille, Champigny s'est donc rendue à « La Retirance », à Saint-Paul-de-Vence, et non chez elle, à Mézels. Invitée par Jean Brunel, elle a passé ensuite quelques jours chez lui à Saint-Poncy, dans le Cantal, avant de rejoindre « La Mézellerie ».
Lettre de Bernard Steele, 4 juin 1937
Je viens de recevoir ta longue lettre et te dirai que je ne m'aurais pas attendu [sic] à cette jérémiade. Tu m'accuses d'un tas de trucs que je n'énumérerai pas, mais qui me semblent bien nombreux pour être réunis sur la tête d'un seul et même individu.
En effet, je sais que tu es venue à Paris pour travailler ; moi aussi, imagine-toi ! Cet hiver j'ai quitté mes occupations antérieures et j'ai mis plus de six mois avant d'avoir pu songer à faire un travail utile. Je ne pense pas que ce travail me rapportera quoi que ce soit, avant que six mois de plus ne se soient écoulés.
Je te laisse le soin de tirer la morale de ce petit exposé. Je sais à quel point tu es démunie des biens de ce monde et je t'avais dit que je ferais mon possible pour te venir en aide ; j'ai essuyé un refus en ce qui concerne le voyage en Espagne ; pour ce qui est des deux autres affaires que nous avons envisagées, elles ne sont pas mûres et ne le seront certainement pas avant trois mois.
J'aurais eu plaisir à te voir avant ton départ pour Mézels, mais avec mes déplacements à l'étranger et mon déménagement, je puis te garantir que je n'ai pas eu une minute pour moi ; il m'arrive souvent de rentrer chez moi à 9 h 30 le soir, après avoir travaillé toute la journée (1).
Je ne te mésestime nullement, ni au point de vue de ta valeur spirituelle, ni au point de vue de ta valeur matérielle. Tu sais assez bien que je fais tout ce qui est dans mon pouvoir pour te venir en aide. Je pense que mes actes antérieurs auront été les meilleurs garants de ma bonne foi.
Cependant, étant dans la nécessité absolue de gagner ma vie (comme nous le sommes tous) et cette lutte étant extrêmement dure à l'heure actuelle - j'ai tout juste le temps de travailler, de manger et de dormir. Si je puis rendre service aux êtres que j'aime dans le cadre normal de mes activités, tu sais fort bien que je ne m'en prive pas.
Cependant, me demander à l'heure actuelle un effort extraordinaire risquerait de se heurter au non possumus inévitable. Si l'une des affaires que nous avons envisagées ensemble se réalise, je t'en informerai aussitôt et tu jugeras alors toi-même de l'utilité qu'il y aurait de venir à Paris. Pour ce qui est d'un déplacement pour moi, je n'en vois aucune possibilité à l'heure actuelle.
1. La lettre est à l'en-tête imprimé de Bernard Steele, 33 Champs-Elysées, Paris. Tél. ELY.66-01.
Lettre de Jean Brunel, 20 juin 1937
J'ai été heureux d'avoir de vos nouvelles. J'espère que votre crise de malaria est terminée (1). Avez-vous un temps agréable ? L'atmosphère de la campagne doit être reposante et fortifiante.
Je vois avec plaisir que vous vous êtes mise au travail. Je suis persuadé d'une réussite mais il faut quelques mois de calme et de tranquillité. J'ai grande confiance dans le recueil de nouvelles (2), tout ce que j'en connais est fort bien et toujours émouvant.
1. Ce virus contracté aux Nouvelles Hébrides n'est pas celui de la malaria (voir son journal) mais les symptômes en sont identiques.
2. Le manuscrit de son recueil « Ecris-moi », qu'elle soumettra peu après à Denoël.
Lettre de Jean Brunel, 26 juin 1937
Vous allez recevoir une lettre d'une jeune femme que je connais : Madeleine Amiot. Elle m'a entendu parler de vous et vos dons de graphologue ; elle voudrais, je crois, une analyse. Elle peut payer et vous demandera sans doute comment le faire dès la première lettre, je suis sûr d'elle sur ce point (1).
1. Denoël, Brunel et Doyon envoient à Champigny des clients férus de graphologie mais, aussi sérieuses soient-elles, ces analyses ne peuvent lui assurer des revenus suffisants pour vivre.
Lettre de Jean Brunel, 27 juin 1937
Votre décision et votre méthode de travail me séduisent beaucoup, j'ai l'impression que vous allez arriver à quelque chose de très bien. Il était nécessaire, pour mettre sur pied un livre, de tailler, de reconstituer, de reprendre, d'écrire à nouveau, en un mot de composer. Lorsque vous vous présenterez avec un livre fait, il sera impossible à certains de se dérober et vous aurez vous-même beaucoup plus de courage pour vous imposer.
Je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'emploi des mots techniques, n'hésitez pas à les employer, surtout ceux qui font partie de notre vieille langue : ce sont tous ceux des métiers et ceux des marins. Quant à Denoël, je m'en fiche comme d'une pomme, et je ne peux arriver à avoir de la sympathie pour lui. Si votre livre ne lui plaît point, ne vous troublez pas, on vous trouvera un autre éditeur (1).
Un écrivain doit tout de même travailler son style. Vous écrivez naturellement bien et vous le soulignez vous-même, le fonds de votre langue est paysan donc ancien. Vous avez pourtant parfois à modifier, à remanier dans votre sens, mais en respectant tout de même certaines règles qui sont celles que l'usage a établies et que nos grands écrivains n'ont pas trouvé indignes d'eux de suivre.
1. Champigny a proposé sans succès ce recueil de nouvelles à Robert Denoël. Si d'autres éditeurs ont été sollicités, aucun n'a édité l'ouvrage.
Lettre de René-Louis Doyon, « Lundi je ne sais quoi de juin » [1937]
Les jours se suivent, les événements se poursuivent et se chevauchent. Je ne veux rien voir de ce qui se passe, convaincu que nous sommes sur les rives d'un tournoiement maëlstromien.
Pour un lundi matin, après 5 heures de sommeil, et un lever sur les 4 heures, voila qui promet mal pour la journée, d'autant que je vais tout à l'heure chez Denoël avec qui nous sommes d'accord sur des points différents ; d'abord mon entrée ferme chez lui (1), ensuite mon travail entrepris (et qui s'étend) sur un essai d'argot typographique du pauvre et amenuisé P. Chautard (2). On va en faire quelque chose de propre et d'habile.
Enfin nous sommes d'accord sur la vente à sa librairie d'un fonds de livres préparés pour un tiers, qui a claqué à la dernière minute sur un engagement de 25.000 francs (3). Si j'avais réalisé ce solde avant mon entrée, je t'eusse envoyé quelques sous pour des os à ta chienne. Mais c'est toujours vivre au jour la journée pendant quelques mois encore.
1. Une lettre de Denoël à Champigny, que j'avais datée fautivement du printemps 1937, et qui doit dater de mai ou de juin, montre que Doyon s'est déjà installé rue Amélie.
2. Le Glossaire typographique d'Emile Chautard mis en forme par Doyon (en fait entièrement rédigé par lui sur base des notes désordonnées du vieux typographe) est paru chez Denoël fin novembre 1937.
3. Le catalogue de l'éditeur paru en décembre 1937 comporte 51 titres parus entre 1926 et 1932 aux Editions de la Connaissance.
Lettre de Bernard Steele, s.d. [été 1937]
Personne ne m'a rien dit de tes coups de téléphone ! je ne comprends pas ! Quoi qu'il en soit, je n'ai plus de secrétaire, je viens rarement au bureau (1) (juste pour prendre le courrier), et je n'ai plus de voiture, l'ayant vendue.
Ma mère est ici en ce moment, ce qui fait que je ne suis guère à la maison que pour dormir. Ce n'est pas une vie, mais qu'y faire ? En vue de ce que je viens de te dire, je ne puis que te donner un conseil : « Ecris-moi ».
Qu'est-ce qui t'arrive avec R.D. ? Il ne t'a pas payée ? Il se dégonfle (2) ? Enfin, quoi ? Ecris-moi. Lorsque maman sera partie - après Pâques - on pourra se voir en toute tranquillité. Pour l'instant, rien à faire.
1. La lettre est à l'en-tête imprimé de Bernard Steele, 116 bis Champs-Elysées, Paris, Tél. ELY.33-69.
2. Allusion au désaccord qui a surgi entre Denoël et Champigny à propos de son manuscrit « Ecris-moi ».
Lettre de Jean Brunel, 5 juillet 1937
J'ai vu Barjavel à qui j'ai rappelé ce qu'il devait faire pour Ce Soir (1), il m'a promis mais l'a-t-il fait ? Il devait vous donner réponse aussi pour la dactylo.
Vous êtes terrible d'avoir brûlé des pages si vivantes et si intéressantes, je pense que vous pourrez les reconstituer (2).
1. Quotidien communiste dirigé par Louis Aragon et Jean-Richard Bloch, auquel collaborait alors René Barjavel. L'allusion à une dactylo pourrait concerner son recueil « Ecris-moi ».
2. Champigny commet ici un premier (?) autodafé : il y en aura d'autres.
Lettre de Jean Brunel, 26 juillet 1937
Vous avez très bien fait de dire à Denoël que j'étais à votre disposition pour la correction de vos épreuves, c'est l'expression même de la vérité. Je me demande seulement si je serai à la hauteur.
Lettre de Jean Brunel, 28 juillet 1937
Pour Denoël j'ai lu attentivement la copie de sa lettre et les explications que vous me donniez. Je suis persuadé comme vous qu'il désire ne pas être engagé en tant qu'éditeur, qu'il ne veut pas laisser considérer les fonds à vous remis comme des acomptes d'un éditeur à un auteur. Je suis fâché de voir aussi qu'il refuse - car au fond c'est cela - de vous éditer, aussi bien les nouvelles que le surplus (1).
Cela est ennuyeux mais non catastrophique, vous trouverez sans nul doute un éditeur ; lors de ma dernière entrevue avec Christian, nous en parlions et nous étions tombés d'accord sur ceci : qu'il était nécessaire que vous mettiez au point ce que vous désirez voir publier, et que si Denoël refusait de vous publier, tous vos amis uniraient leurs efforts pour que votre chance ne vous soit point refusée. Cela est toujours valable (2). Vous pouvez en attendant compter sur moi pour vous aider dans la mise au net, comme vous me le demandez.
1. Le 24 juillet Denoël a écrit fermement à Champigny qu'il se refusait à publier en l'état son recueil « Ecris-moi », mais je ne sais rien du « surplus » évoqué ici.
2. Jean Brunel paraît assuré qu'en cas de refus de Denoël, les amis de Champigny se cotiseraient afin de payer le prix du tirage de son livre.
Lettre de René-Louis Doyon, 10 août 1937
J'ai pris ici le 2 août contact et travail, et je fais de mon mieux, avec une modestie sans feinte et un calme sans réserve. Il fait d'ailleurs fort chaud. Tu es dans l'erreur de croire à la vérité littéraire et de compter sur elle, tant pour te coiffer de lauriers que te couvrir de francs.
A quoi correspond cette préoccupation, à toi qui vois clair dans le monde des pensées et te peux placer au-dessus de ce présent ? A quoi donc un contrat, 60 articles de presse, la plupart inexacts, 25 de gratuits, feront à ton génie et à ton besoin de voir ? Allons. Le problème ne m'a pas touché par cet aspect, et en vrai mâle, j'ai oublié les enfants dont je doute même d'avoir formé les foetus. Alors, en toute occurrence, tout ce qui sera possible de moi le sera pour toi, mais ce qui est sera ; qua scripta scripta (1)
1. Champigny a confié à Denoël le manuscrit d'un recueil de nouvelles qu'il se refuse à publier tel quel, et elle à le remanier. Elle s'en est plainte à Doyon, virtuellement en faillite, qui ne peut rien pour elle et son manuscrit. Cette querelle durera plusieurs mois et aboutira à une rupture entre les deux amis, qui durera quatre ans.
Lettre de Jean Brunel, 11 août 1937
Je ne sais rien de votre correspondance avec Denoël depuis la lettre dont vous m'aviez adressé copie (1). J'ai correspondu il y a quelques jours avec lui, il m'avait envoyé « un de ses auteurs » comme il dit pour un tuyau que j'ai donné.
1. Celle dont Me Brunel lui accuse réception le 28 juillet.
Lettre de René-Louis Doyon, 19 août 1937
Bon, bon, des mots mal compris ou mal venus, cela ne change pas la nature des faits quand on ne les prend pas comme injure ou comme excitant à des susceptibilités trop épidermiques. Ce que je regrette pour toi, c'est que tu n'aies pas rendu ta retraite confortable quand tu le pouvais et qu'elle ne t'ait longtemps servi d'habitacle possible contre tout événement possible et même de refuge, à ceux qui un jour pourraient avoir besoin de fuir l'abomination de la désolation. Enfin, n'en parlons plus.
Lettre de Jean Brunel, 23 août 1937
Vous aurez une chambre au Lutèce et votre malle à votre disposition. Je n'ai pu voir Steele samedi mais lui ai laissé un mot, il est donc prévenu. Voulez-vous me confirmer votre arrivée exactement, je viendrai à la gare vous attendre. Combien de temps resterez-vous à Paris (1) ?
1. Le but de ce séjour furtif est peut-être de rencontrer Denoël à propos de son manuscrit « Ecris-moi ». Jean Brunel ignore sans doute que Bernard Steele a quitté la rue Amélie.
Lettre de Jean Brunel, 3 septembre 1937
Je suis heureux de vous savoir dans un beau pays, près de la mer (1). Reposez-vous, reprenez des forces et mettez-vous au travail.
1. Champigny séjourne alors en Bretagne.
Lettre de Jean Brunel, 12 septembre 1937
Je comprends bien votre désir de départ et les vers de Baudelaire s'y appliquent exactement ; mais ces départs toujours renouvelés et cette vie jamais stable ne vous permettront pas de mener à bien une oeuvre littéraire, travail qui demande du temps, du calme et de la patience. Enfin je sais bien que vous choisirez la vie plutôt que son interprétation (1).
Félicitez Caillard pour moi, je suis très heureux que le succès récompense son talent (2).
1. Jean Brunel résume parfaitement le dilemme posé à Champigny depuis dix ans : voyager ou écrire. Elle finira par choisir l'écriture parce qu'elle n'est plus capable de voyager, mais ce qu'elle écrit après 1942 n'est pas publiable de son vivant, elle en conviendra.
2. Christian Caillard expose alors ses oeuvres à la Galerie Bernier, 4 rue Jacques Callot (VIe).
Lettre de Jean Brunel, 20 septembre 1937
Merci de votre carte de Sizun (1). J'ai commencé la lecture de vos papiers. J'ai été prodigieusement intéressé, regrettant seulement vos destructions. Il y a tout un aspect de vous qui m'était inconnu. Etes-vous contente de votre voyage ? Croyez-vous qu'il faille vraiment vendre vos livres ? J'ai l'impression que nous verrons de plus hauts cours (2).
1. Champigny poursuit son périple en Bretagne.
2. Il s'agit de la monnaie anglaise.
Lettre de Jean Brunel, 1er octobre 1937
J'ai reçu un mot très gentil de Barjavel qui avait appris mon opération (1) par Denoël. Avez-vous le prospectus du bouquin de Chautard ? On sent que René-Louis est là. Voilà enfin de la typographie (2).
1. Jean Brunel a été opéré de l'appendicite le 7 septembre à la clinique Ambroise Paré, à Neuilly.
2. Le Glossaire typographique d'Emile Chautard, mis en forme et préfacé par René-Louis Doyon, est sorti de presse chez Denoël en novembre. Depuis le 2 août 1937, Doyon est attaché à la maison d'édition de la rue Amélie, et son Glossaire est en effet une réussite typographique. Jean Brunel n'est pas seul à remarquer l'amélioration apportée à la confection des volumes, rue Amélie. Jean Bourdel écrit, le 23 juillet 1938 : « La maison Denoël s'est mise en tête de séduire le public, en présentant ses livres - tout comme des produits de beauté - sous un " conditionnement " extérieur attrayant. » Le journaliste évoque alors Les Oraisons amoureuses de Jeanne-Aurélie Grivolin, paru en mai 1938, et il conclut : « On peut laisser traîner dans un salon ou dans un boudoir un livre pareil : il ne dépare pas ; il embellit. » [Juvénal, 23 juillet 1938].
Lettre de Jean Brunel, 4 octobre 1937
Vous travaillez admirablement pour vos amis, Champigny. Comment se fait-il que vous ne puissiez trouver pour vous des choses aussi merveilleuses, ou que vos amis (les autres et moi), nous ne puissions enfin être pour vous les bons génies comme vous avez été pour nous tous le bon génie ?
Barjavel m'a écrit et m'a envoyé des livres. Cette attention m'a fait plaisir. Dans les livres envoyés, il y avait Les Beaux Quartiers d'Aragon (1). Que les romanciers d'aujourd'hui sont donc curieux. Ils entremêlent trois ou quatre intrigues essayant de restituer l'atmosphère d'une époque. Pour moi, je n'aime point cette façon de faire, surtout là, et je trouve le but manqué. Dans ce genre j'aime mieux Les Hommes de bonne volonté de Romains.
Aragon a poussé la peinture de la bourgeoisie trop au noir, tout de même. Il ne faut rien exagérer, cela sent trop le système, la thèse et l'image d'Epinal à usage communiste.
Quant au style ! Il faudra que nous passions un moment à lire ensemble quelques passages. Ce charabia semble être voulu, recherché. J'ai vu et entendu Aragon. Il parle une langue correcte et qui n'est pas sans qualité, alors pourquoi ce mépris de la simplicité, de la clarté et même parfois de la grammaire ? Il a pourtant un art de conteur évident, certaines scènes sont parfaites. Je suis là comme devant un mystère.
1. Paru début novembre 1936 chez Denoël et Steele, le roman a été couronné le 9 décembre par le prix Renaudot.
Lettre de Jean Brunel, 10 octobre 1937
Je viens de relire la lettre de Barjavel, il dit bien avoir appris par Denoël, qui l'avait su par vous, que je venais d'être opéré. Ah ! petitesse !
Lettre de Jean Brunel, 17 octobre 1937
Je compte aller demain au Vélodrome d'Hiver à la représentation du spectacle de Jean-Richard Bloch : « Naissance d'une cité » (1). J'ai un peu peur car c'est la Maison de la Culture (Centre officiel communiste de littérature - Aragon et C°) qui invite et par-là même produit le spectacle. J'espère tout de même que ce sera une fête de l'esprit à cause de Jean-Richard Bloch.
J'ai acheté un petit livre de Valery Larbaud : « Allen » (2) parce qu'en l'ouvrant je lus les mots : « forêt de Tronçais ». C'est une des plus jolies ou plutôt des plus belles forêts de France. J'y ai rencontré le mot de Retirance que l'auteur prétend n'avoir entendu qu'en Bourbonnais. J'ai aussitôt songé à la Retirance et à vous.
C'est vous sans doute qui aviez ainsi baptisé la maison des Caillard. Ce doit être aussi un terme berrichon, n'est-ce pas ? A propos des Caillard, que devient le couple C.C. ? Cette aventure dure-t-elle toujours (3) ?
J'ai lu aussi « Une enfance » de Marouseau (4). C'est bien. L'auteur - qui est, je crois, professeur en Sorbonne - se souvient avec simplicité d'une enfance qui en fut empreinte. Il dit les choses comme il les fit et comme il les sentit.
1. Pièce commandée par le Front Populaire dans le cadre de l'Exposition universelle, dont la première eut lieu au Vel' d'Hiv' en octobre 1937.
2. Paru en 1928 chez Gallimard. Jean Brunel visite alors des librairies anciennes et d'occasion.
3. Liaison entre Cécile Denoël et Claude Caillard, le fils de Manon et Adrien Caillard, que Robert connaissait, mais que Champigny a longtemps ignorée.
4. Récit de Jules Marouzeau [1878-1964], professeur de philologie latine à la Sorbonne, paru en juin 1937 chez Denoël.
Lettre de Jean Brunel, 25 octobre 1937
Je vous envoie Clémentine et Le Miracle de Jean (1). J'ai relu ces pages avec un grand plaisir. Le Miracle forme un tout bien composé et rend bien une atmosphère et un état d'âme. Clémentine me paraît plutôt comme un passage qui serait détaché de vos souvenirs, sans autant de cohésion et d'unité.
Que vous écririez de jolis souvenirs ! Que ce soit sous forme de roman ou autrement, vous avez une matière abondante, mais pourquoi ne pas les écrire simplement, comme vous les sentez en vous souvenant (2).
1. Titres de deux nouvelles de Champigny que Jean Brunel a relues et annotées.
2. Champigny avait en effet de quoi composer plusieurs recueils de souvenirs : elle a préféré la formule du journal, qu'elle n'a pas su écrire simplement.
Lettre de Jean Brunel, 28 octobre 1937
J'ai vu Christian et Klein hier chez Bernier (1). Christian a été content des nouvelles que je lui donnais de vous et de votre travail. Son exposition est belle, sa peinture me paraît toujours plus profonde, très au coeur des choses ; il me faut du reste un moment pour la bien apprécier, surtout pour la bien voir.
1. Christian Caillard exposait, en septembre et octobre 1937, à la Galerie Bernier, 4 rue Jacques Callot (VIe). Leur ami commun, Georges-André Klein, avait fait partie, dès l'origine, du groupe du Pré St-Gervais. En décembre 1930 Denoël écrivait à Champigny : «J’ai vu Klein, hier. Il nage dans l’or mais vous garde une amitié
attentive. Vous aviez raison : c’est lui le meilleur de tous. »
Lettre de Jean Brunel, 4 novembre 1937
J'ai vu Christian hier chez Bernier. Je lui ai fait part de mon admiration pour votre travail. Je lui ai dit l'effort par vous fait, je lui ai indiqué le sujet et l'esprit du livre. Je lui ai dit aussi que vous ne vouliez pas subir des critiques de la part de Denoël, j'ai comparé votre travail à un tableau de lui qu'un directeur de galerie lui démolirait et lui demanderait de recommencer.
Je lui ai donc signalé qu'il se poserait un problème d'édition, je lui ai dit d'y réfléchir car vous ne négligeriez pas son avis. Je n'ai pas voulu le placer devant une décision prise, je crois avoir bien fait.
1938
Lettre de Jean Brunel, 5 janvier 1938
J'ai regretté de ne pas vous avoir vu lors de votre dernière venue à Paris, mais je suis très heureux de savoir que vous avez pu vous entendre avec Denoël, je pense que vous aurez bientôt mis le « dernier point final » à votre travail (1).
1. Champigny n'a pas dû lui dire qu'elle avait en réalité rendez-vous avec Denoël à propos de ce manuscrit qui traînait chez lui depuis des mois.
Lettre de Jean Brunel, 17 janvier 1938
J'ai relu le « Vitrohon ». Je trouve cela extrêmement valable. Vous pouvez le terminer et en faire une oeuvre intéressante. J'ai lu ou relu des passages de « Province » où il y a le meilleur de vous. J'ai trouvé vos dimanches de Clavière et la tendresse de votre enfance. Vous aviez là une matière admirable dont vous pouvez tirer quelque chose.
J'ai fait déposer votre manuscrit chez Denoël, je ne l'ai pas porté moi-même pour deux raisons : la première parce que je n'avais pas le temps, la seconde parce que je croyais cela plus habile pour vous, Denoël n'ayant pas pour moi une sympathie particulière et regrettant déjà que j'aie eu connaissance de « Ecris-moi » avant lui (1). J'ai indiqué dans un mot que vous étiez désireuse d'avoir une réponse rapide et que c'était votre seul exemplaire corrigé.
Pendant les quelques heures où je l'ai eu entre les mains, je l'ai en partie relu et mon opinion est toujours la même. Je crois que vous avez réussi. Vous avez su garder à chaque lettre du marin et de la femme sa personnalité et ce ton de véritable lettre, avec tout ce qui fait le charme du commerce épistolaire.
Chez vous, il n'y a pas d'intrigue à proprement parler, il y a développement de sentiments chez les auteurs des lettres, il ne s'agit point pour le lecteur de retrouver des faits mais de comprendre, de pénétrer dans l'intimité du marin et de la femme. Et c'est là, à mon sens, qu'était la difficulté et c'est là que je vois la réussite.
1. Ce sont là des titres de manuscrits que Champigny a déjà proposés, sans succès, à Denoël. Est-ce que Jean Brunel, par amitié, les trouve publiables, ou est-il incapable de mesurer leur qualité quant au marché actuel ? Sa culture est essentiellement classique et, quand il s'entretient de littérature avec Champigny, c'est à propos d'auteurs des XVe et XVIIe siècles, qu'il affectionne. Pour celui qui porte le titre « Ecris-moi », ce sera le détonateur d'une rupture entre Denoël et Champigny, qui durera quatre ans.
Lettre de Jean Brunel, 18 janvier 1938
Je n'avais pas ce soir la plume à la main pour vous écrire lorsque m'est parvenue votre lettre (1), mais je l'ai prise aussitôt.
Je n'aime pas ce mot de « lâcheté » parce qu'il est faux, archi-faux. J'exècre votre ami Denoël (2), son esprit, son milieu, et je suis le plus mauvais ambassadeur que vous puissiez trouver.
Or, aujourd'hui, par le fait de vos conventions avec lui, il faut se présenter devant lui avec figure de suppliant. Même si vous niez cette évidence, vous la sentez si bien que vous ne voulez pas le faire vous-même et vous m'envoyez à votre place. Car, permettez-moi de vous le dire, pour bien faire, il était nécessaire que vous lui écriviez vous-même, j'aurais alors porté volontiers votre travail.
Si, au lieu de sonder mes complexes et mes intentions, vous examiniez les vôtres, vous verriez que la vérité est là et que l'envoi d'un messager n'était qu'une manière de fuite. Au surplus, si j'avais cru cela vraiment utile, j'aurais pris sur un tempo dont je ne suis pas le seul maître pour aller chez Denoël.
Vous savez combien je me garde de rectifier vos dires ou jugements, même lorsque je les trouve hâtifs ; j'aurais aimé aujourd'hui encore ne rien dire puisque vous souffrez, mais je croirais manquer à la vérité, donc à notre amitié. Si je mérite des reproches, je suis prêt à les accepter mais je ne me complais pas dans la fustigation même morale ; songez aussi à ce que peut-être ma vie (bien anxieuse, je vous le jure) pour comprendre que je dispose pas de mon temps comme d'une chose absolument à moi, et soyez moins prompte dans vos jugements.
1. La rencontre Denoël-Champigny a eu lieu la veille, rue Amélie, et s'est mal terminée : Champigny a rompu violermment avec lui.
2. L'évolution des sentiments que Jean Brunel porte à Robert Denoël est intéressante. En octobre 1936 il lui reproche de cautionner L'Assaut, un hebdomadaire qu'il juge abominablement réactionnaire ; en décembre 1936 il juge sévèrement la campagne publicitaire faite autour du roman de Louise Hervieu : Sangs, prix Femina 1936, qui fait grand bruit. Le 27 juin 1937 il écrit : « Quant à Denoël, je m'en fiche comme d'une pomme, et je ne peux arriver à avoir de la sympathie pour lui ». Ce 18 janvier 1938, il concède : « J'exècre votre ami Denoël ». Qu'a pu faire Denoël pour mériter autant d'antipathie, sinon d'avoir connu Champigny avant lui, et d'être aimé d'elle, il le pressent ? Cette correspondance montre la fragilité de Jean Brunel qui, presque jour après jour, s'inquiète de n'avoir pas de réponse de sa conseillère psychologique. Ici, il se cabre, et on comprend mieux la nature de leurs relations : « Si, au lieu de sonder mes complexes et mes intentions, vous examiniez les vôtres ? »
Lettre de Jean Brunel, 29 janvier 1938
J'ai rencontré Christian il y a deux ou trois jours, nous avons parlé de vous, de vos démêlés avec Denoël : il vous approuvait entièrement et comprenait votre attitude (1).
1. Christian Caillard approuve l'attitude de Champigny mais n'ira pas jusqu'à faire publier son manuscrit à ses frais, ce qu'il avait proposé naguère, selon Jean Brunel (voir sa lettre du 28 juillet 1937).
Lettre de Jean Brunel, 16 mai 1938
La traite Denoël a été protestée (1). Puisqu'il désire de la procédure, il va en avoir. J'avoue que j'aurai un certain plaisir à faire payer quelqu'un d'aussi mauvaise foi.
1. Denoël est en mauvaise posture financière depuis le départ, en décembre 1936, de son associé et bailleur de fonds américain, Bernard Steele. Plusieurs traites ont été protestées en 1937 et 1938, qui concernaient Louis-Ferdinand Céline et Jean Rogissart. Celle-ci est d'autant plus inattendue qu'il ne paraît pas y avoir eu de véritable contrat entre Denoël et Champigny pour son recueil de nouvelles, mais une lettre d'accord datée du 1er février 1938.
Lettre de Jean Brunel, 21 mai 1938
J'ai vu Christian, comme je vous l'ai déjà écrit. Il a beaucoup travaillé et est content de son travail. Il pense à vous et s'inquiète du sort de votre livre. Je lui ai dit, ainsi qu'à Klein, combien Denoël avait été immonde à votre égard, la patience et le courage dont vous aviez fait preuve depuis le début de cette aventure, je leur ai rappelé mes appréhensions - qui se sont trouvées justes - et que vous m'aviez confiées lors de ma visite à St Marc.
Ils ont convenu que vous aviez vu clair, mais ils ne peuvent encore comprendre la raison de l'attitude de Denoël, et vous savez qu'ils aiment avoir des explications de toute chose.
A propos de Denoël, j'ai fait protester la traite, j'attends l'échéance de mai, je ferai protester et aussitôt après : procédure qui aboutira sûrement au paiement, quelque soit le temps qu'il y faille consacrer. Je pense que vous êtes bien d'accord.
Lettre de Jean Brunel, 30 mai 1938
Pour vous, ce qui me désespère c'est de vous voir dans un état de grande incertitude. Votre vie n'est pas ordonnée. Je sais bien que tous vos efforts de ces dernières années tendent à l'ordonner et à la stabiliser, je sais que vous avez beaucoup lutté. La dernière aventure : celle de vos démêlés avec Denoël, vous aura coûté beaucoup de temps, d'énergie et par-là même d'argent. Il me semble pourtant qu'il y a une leçon à en tirer : qu'un effort littéraire n'assurera pas à lui seul votre existence.
Alors c'est toujours le grand problème : Quoi faire ? Je ne crois pas qu'il soit bon pour vous de continuer à vous disperser comme vous avez été contrainte de le faire ces dernières années. Il me paraît quasi indispensable de retrouver une occupation, un travail, un gagne-pain. Les inconvénients sont multiples et votre santé en premier lieu vous gêne, mais les avantages ne seraient pas non plus négligeables, vous retrouveriez surtout un élément de stabilité.
Lettre de Jean Brunel, 4 juin 1938
Pour Denoël, ne vous troublez pas. Il sera bien obligé de payer les deux traites. Après, si vous publiez ailleurs, il sera peut-être tenté de faire un procès, mais alors ce sera à lui d'attaquer, d'avancer les frais et à mon avis sans grande chance de succès. Je conserve précieusement les documents que vous m'avez adressés (1).
1. La raisonnement est contestable. Si les deux traites protestées puis réglées tardivement constituent des avances sur droits d'auteur, le contrat signé par Champigny fait autorité - mais de quel contrat s'agit-il ?
Lettre de Jean Brunel, 9 juin 1938
Je viens de recevoir le protêt de la seconde traite qui n'a pas non plus été payée. J'envoie ce soir même les pièces à l'avoué. Il va faire le nécessaire pour obtenir un jugement et dès que nous l'aurons, nous tenterons de l'exécuter, au besoin même en pratiquant une saisie, parce que Denoël en prend vraiment trop à son aise.
Lettre de Jean Brunel, 28 juin 1938
La nouvelle de votre accident m'a navré. Comment avez-vous fait votre compte ? Faites-moi donner de vos nouvelles. J'ai vu Christian et Klein hier au soir. Je les ai prévenus de votre accident par Armand (1) que j'ai rencontré à midi rue de la Paix.
1. Un accident parmi d'autres : Champigny s'est luxé le poignet à Mézels. Armand Movchowitz, leur ami diamantaire.
Lettre de Jean Brunel, 30 juin 1938
Je souhaite vivement que votre poignet ait été bien remis et que vous ne souffriez pas trop. Pour les livres, j'ai le Loutreuil (1). Quand au Grand Vent (2), les Messageries Hachette qui ont comme vous le savez l'exclusivité des Editions Denoël (3), ont répondu : « Pas paru ». C'est pas mal, hein ?
J'enverrai quelqu'un directement rue Amélie et peut-être en vendront-ils un exemplaire sans se soucier d'Hachette.
1. Correspondance de Maurice Loutreuil présentée et annotée par Champigny (Firmin-Didot, 1929).
2. Publié en novembre 1929 par Robert Denoël à l'enseigne des Trois Magots.
3. Depuis le 1er janvier 1938.
Lettre de Jean Brunel, 4 juillet 1938
Pour les traites, l'affaire suit son cours, ces choses-là ne vont jamais vite. C'est Lecointe (vous le connaissez) que j'ai chargé de l'affaire (1). Dès que j'aurai du nouveau, je vous préviendrai.
1. L'avocat Lecointe avait déjà été chargé du divorce de Champigny, en 1927.
Lettre de Jean Brunel, 9 juillet 1938
J'espère que vous ne souffrez pas trop et que votre guérison sera plus rapide que vous ne le pensiez au début. J'ai reçu un coup de téléphone de Merle d'Aubigné qui m'a dit qu'il vous écrirait. Il demande, si vous avez des radios, que vous les lui adressiez, il ne paraît pas en principe inquiet pour une fracture du poignet. Quelle guigne pour vous, tout de même, juste au moment où vous pouviez songer à travailler pour Giono.
En ce qui concerne Denoël, un jugement conforme à la demande a été obtenu par défaut (ce qui veut dire que Denoël ne s'est pas défendu). Il va être nécessaire de le rendre définitif pour après en obtenir l'exécution. Espérons que d'ici là, la maison ne sera pas en faillite et qu'il sera possible de récupérer.
Lettre de Jean Brunel, 17 juillet 1938
Vous trouverez sous ce pli une lettre de Denoël dont il a pris soin de m'adresser copie. Je ne voudrais pas beaucoup vous en parler pour ne pas peser sur votre décision. Deux constatations s'imposent pourtant : Il est très embêté par les poursuites. Il sera obligé de payer. Ne parlons pas pour l'instant de l'exposé des faits qui est aussi mensonger que possible.
La solution proposée aurait l'avantage de nettoyer complètement la situation, ce qui est un avantage sérieux. Vous auriez plus de liberté dans vos mouvements vis-à-vis d'un nouvel éditeur. Par contre je crois que sa menace est très vaine. Quels droits peut-il avoir à faire valoir ? La lettre d'accord du 1er-2-38, votre lettre du 30 mars 38 sont assez claires pour que votre position soit bonne dans un procès. Enfin dites-moi ce que vous décidez et ne répondez pas directement avant que je n'aie regardé avec l'avoué la réponse à faire - s'il y a lieu - et la façon de procéder. C'est dans ces sortes de négociations qu'il est préférable de ne pas faire de faux-pas.
Lettre de Jean Brunel, 22 juillet 1938
J'ai reçu ce matin votre lettre recommandée. J'ai lu attentivement la lettre à Denoël ; je crois qu'il est préférable de ne pas la lui adresser maintenant. Il ne faut pas qu'il ait entre les mains un papier de vous admettant que les deux affaires : restitution du contrat - paiement des traites, puissent être liées. Dès que vous me direz la décision prise par vous, je verrai Lecointe et nous essayerons de transiger si vous le voulez.
J'ai vu Christian le 12, juste avant son départ pour la Bretagne, et lui ai dit la lettre de Denoël ; lui penche pour la transaction. Je crois qu'il y aurait intérêt à prendre une décision assez rapidement parce que, si on doit arrêter la procédure, mieux vaut le faire tout de suite pour éviter des frais.
L'histoire du commerçant et de la Chambre de Commune est une « rigolade » de première catégorie. Il n'y a pas 36 moyens de faire payer une traite, mais celui que nous avons employé : assignation devant le Tribunal de Commerce.
Je suis désolé de savoir que vous vous êtes fatiguée à travailler votre manuscrit rapidement alors que le lecteur de Grasset (1) n'arrivera que plus tard.
1. Champigny, ou l'un de ses amis, a donc aussi pris contact avec l'éditeur de la rue des saints-Pères.
Lettre de Jean Brunel, 27 juillet 1938
J'ai bien reçu avant-hier votre longue lettre. Le soir même j'ai téléphoné à Denoël pour lui dire que j'acceptais sa proposition à condition qu'il paie les frais. Il m'a demandé le montant que je n'ai pu lui fournir exactement. Je lui ai indiqué que le règlement se ferait par l'intermédiaire de Lecointe.
Il est convenu avec ce dernier d'un rendez-vous vendredi matin. Il y convoque Denoël à qui nous demanderons :
1° le remboursement des frais
2° le contrat
3° une lettre indiquant que vous n'avez aucun engagement pour votre production littéraire, soit envers la Société Denoël et Steele, la Société Denoël, lui-même ou tous tiers avec qui ces sociétés ou lui auraient pu traiter. [manque la suite]
Lettre de Jean Brunel, 29 juillet 1938
Au rendez-vous de ce matin chez Lecointe, il n'y avait que le secrétaire (1) de Denoël, à qui nous avons dit ce que nous voulions. Il est reparti prendre des instructions. Ce que voudrait surtout son patron, c'est une lettre : n'écrivez donc pas.
Dans quelques jours nous serons fixés. Si nous n'avons pas une réponse rapide, je continuerai la procédure.
1. A cette époque, il devait s'agir de François Dallet [1914-1940], qui était surtout secrétaire littéraire.
Lettre de Jean Brunel, 4 août 1938
Comme je téléphonais à Lecointe, votre lettre est arrivée. Denoël n'a pas envoyé le projet de lettre promis, ni donné signe de vie. Dans ces conditions j'ai demandé à Lecointe de continuer les poursuites. Je pense qu'ainsi vous aurez satisfaction.
Lettre de Jean Brunel, 26 septembre 1938
Je m'attends à être appelé d'une minute à l'autre car on mobilise à tour de bras (1). Nous prendrons ce soir une décision pour Marianne. Pour vous, je lui passe la consigne, tant pour vos papiers que pour l'argent. Je préviens aussi à l'étude, où je laisse une note explicative.
1. La crise des Sudètes a entraîné une première mobilisation partielle à partir du 23 septembre.
Lettre de Jean Brunel, 6 octobre 1938
J'ai déjeuné avec Christian et Klein, qui ont été très gentils, nous avons beaucoup parlé de vous. Je leur ai expliqué l'affaire Denoël dans le détail. J'ai pris soin ensuite de conduire Christian à l'étude pour lui faire lire les lettres. A bientôt plus longuement.
Lettre de Jean Brunel, 7 octobre 1938
Je reçois à l'instant une communication téléphonique du secrétaire de Mr Denoël, qui demande de reprendre la négociation. J'ai répondu oui. Je lui ai dit de remettre à Lecointe :
1° le contrat
2° la lettre de dégagement
3° le montant des frais.
J'ai donné des instructions très précises à Lecointe. Espérons donc. Je vous demande de me faire parvenir la lettre suivante, que je considère normal de lui remettre en même temps que les traites :
A Monsieur Denoël
Monsieur,
Je vous confirme volontiers que je considère - vous personnellement et la Société des Editions Denoël - comme dégagés de toute obligation envers moi relativement à l'édition de mes oeuvres littéraires.
Je pense qu'il va céder car maintenant qu'il se voit contraint de payer, il profite de la démarche de Klein, à qui il avait pourtant dit que la question d'argent lui était indifférente. N'empêche qu'il sera agréable pour vous d'avoir votre liberté.
Lettre de Jean Brunel, 12 octobre 1938
Le secrétaire de Denoël m'avait envoyé une lettre à votre adresse qui ne me donnait nulle satisfaction, car elle ne parlait que des manuscrits à venir, et n'était pas signée par Denoël ; j'ai aussitôt écrit à Lecointe pour lui préciser très exactement ce que je voulais. Je peux trouver ce soir à Luc un mot de lui et un de vous.
Lettre de Jean Brunel, 15 octobre 1938
J'ai reçu une lettre de Lecointe. Denoël lui avait fait tenir la lettre suivante :
Madame Champigny
aux bons soins de Me Lecointe
pour être remis à Mr J. Brunel, 4 rue de la Paix, Paris
Madame,
Pour conclure les négociations en cours, je vous confirme que vous n'avez envers les Editions Denoël et Steele, dont j'ai été gérant, les Editions Denoël dont je suis gérant, ou moi-même ou tout tiers avec qui les dites éditions et moi-même aurions dû traiter, aucun engagement pour votre production littéraire.
Vous êtes donc à partir du 12 octobre 1938 dégagée des conséquences du contrat synallagmatique (1) qui nous unissait.
Pour prévoir toute éventualité, nous stipulons cependant que la vente de vos livres édités par nos soins et les opérations commerciales que ces livres pourraient provoquer, seront régies par les termes du contrat qui nous a unis.
Recevez Madame, mes salutations
Robert Denoël
J'ai répondu ce soir même à Lecointe :
1° Je n'admets pas l'alinéa 3, qui ne rime à rien (2).
2° Je demande dans l'alinéa 2 la suppression de « à partir du 12 octobre 1938 ».
3° Je demande dans l'alinéa 1 la correction de « dû » en « pu ».
Je pense que vous êtes d'accord. J'espère arriver à un bon résultat, mais que d'embarras avec ces personnages. Il serait préférable de ne pas parler de cette négociation avant son terme.
1. Contrat synallagmatique ou contrat bilatéral : convention par laquelle les parties s'obligent réciproquement l'une envers l'autre. Dans ce type de contrat, la cause de l'engagement d'une partie repose sur l'obligation de l'autre et réciproquement. Chaque partie est donc à la fois créancière et débitrice de l'autre. Leurs obligations sont interdépendantes.
2. Denoël a édité en 1929 Le Grand Vent de Champigny qui a dû faire l'objet d'un contrat (dont on ne connaît pas les termes). L'ouvrage figurera au catalogue des Editions Denoël jusqu'en juillet 1941.
Lettre de Jean Brunel, 24 octobre 1938
J'espère que votre état de santé est meilleur, et que vous êtes sortie de votre crise. C'est désespérant de vous savoir malade, d'autant plus que Caillard, Klein et moi nous avions espéré vous voir revenir à Paris pour tenter un effort qui vous garantirait votre indépendance. Voilà à quoi nous avions songé.
Nous avions pensé qu'il était possible de commercialiser l'oeuvre de Loutreuil, c'est-à-dire de le relancer et d'en vendre. Vous seule, à tous points de vue, êtes qualifiée pour le faire. Il ne nous est pas apparu qu'il soit nécessaire de reprendre un effort comme celui du passé et de tenir une galerie, nous savons que vous n'en avez ni le goût ni la possibilité, mais bien plutôt d'essayer un regroupement d'amis, de relations, d'amateurs.
Je verrais assez bien quelque chose comme les Champs. Vous pourriez aussi vendre des Caillard, qui m'a affirmé ne pas avoir de contrat avec Bernier, de même pour Klein. Ils seraient tous deux heureux de cette solution.
Il y a alors évidemment un grave problème préliminaire qui se pose : celui de la vie quotidienne pendant la période du démarrage. Nous avons le ferme espoir de pouvoir, si cette idée vous agréait dans l'ensemble, vous garantir, avec le concours de vos amis, un an de vie à Paris. Voulez-vous y réfléchir ?
Nous savons bien qu'il peut y avoir des difficultés et que ce n'est pas le rêve, mais tout de même cela vous permettrait sans doute de gagner votre vie et de rendre encore service, et à Loutreuil et aux autres. Si vous pouviez dans un temps relativement assez court, tirer un capital de l'oeuvre de Loutreuil, vous seriez à même d'envisager un genre d'existence conforme à vos idées, à vos besoins et à vos goûts (1).
1. Cette lettre importante montre que ses amis parisiens se préoccupent de lui venir en aide, ce dont le journal ne témoigne pas du tout. C'est son état de santé calamiteux qui fera échouer ce projet généreux.
Lettre de Jean Brunel, 5 novembre 1938
J'ai vu l'autre soir Christian et Klein. Je suis désolé de vous savoir là-bas, loin de tout et de tous, en pleine souffrance. Je pense comme eux qu'il serait bon que vous veniez pour consulter Merle d'Aubigné (1). Lui qui vous a soignée peut seul sainement juger de votre état et vous donner les remèdes convenables.
1. Robert Merle d'Aubigné [1900-1989], le chirurgien qui eut à soigner Champigny en 1931.
Lettre de Jean Brunel, 7 novembre 1938
J'estime qu'il est indispensable que vous vous soigniez et que tout au moins vous sachiez exactement où vous en êtes physiquement.
Pour Denoël, la phrase transmise par Catherine m'a paru incompréhensible. Je crois qu'il faut en terminer et récupérer votre liberté. Il a expliqué que le paragraphe ajouté par lui et relatif aux livres édités par ses soins ne visait que Le Grand Vent, aussi m'a-t-il paru bon de reprendre l'ensemble et de préciser.
La lettre que j'ai préparée et qui, j'espère, aura votre agrément, me paraît mettre les choses au point ; pour Le Grand Vent je crois que cet accord ne serait que la consécration d'un état de fait. Si vous êtes d'accord, ce que j'espère, voulez-vous signer la lettre ci-jointe et me la retourner ? Je la lui ferais remettre contre remise de la lettre demandée, dont le texte est recopié, et du contrat.
Lettre de Jean Brunel, 28 novembre 1938
Pour D. [Denoël], Lecointe a revu son secrétaire qui accepte notre rédaction et a promis de revenir incessamment avec la lettre, pour qu'on en puisse terminer.
Lettre de Jean Brunel, 6 décembre 1938
Il faut maintenant que je vous dise : « Vous êtes étonnante ! » Vous ne pouvez pas douter un instant du ton de ma conversation sur l'affaire Denoël avec Mme Delpech. J'ai dit entièrement ce que je pensais de lui et de votre attitude ; j'ai expliqué pourquoi c'était la seule possible, la seule convenable, la seule digne ; j'ai dit que Denoël s'était conduit comme un goujat.
Lettre de Jean Brunel, 16 décembre 1938
La situation extérieure me paraît d'une gravité toujours croissante. Je crains fort que dans le courant de l'année 1939 nous nous retrouvions devant un ensemble de préoccupations aussi dramatiques que celles de septembre 1938. La folie des hommes est infinie. Les armements massifs auxquels le monde procède mineront tous les pays ou conduiront inévitablement à la guerre, car il faudra bien masquer cette ruine et l'inutilité de tout cet appareil guerrier.
Lettre de Jean Brunel, 23 décembre 1938
J'ai eu aujourd'hui la lettre signée par Denoël. Je vous en adresse sous ce pli copie. Dites-moi si je dois vous envoyer l'original ou le garder. Enfin vous voilà libre ! Mais que ne vous a-t-il coûté.
Lettre de Bernard Steele, s.d. [1938]
Nous partons tous pour Nice le 13 - c'est donc rue de la Buffa (1) qu'il faut écrire à partir du 15. J'ai parlé avec Mary dans le sens de notre dernière conversation - c'est bien ce que je pensais - il faut attendre, et ce sera peut-être davantage de 6 mois. Mais la fin, parfois, justifie et les moyens, et le temps qu'il faut pour y parvenir.
Ai vu R.D. il y a quelques jours - je me suis arrangé avec lui en ce qui concerne les questions d'intérêts, mais là, je suis beaucoup moins certain de la fin ! Autrement, il n'y a rien de changé - je t'en parlerai quand nous nous revoyons.
Il m'a dit : « Tiens, vous revoyez Champigny ? Comme c'est drôle - justement, nous sommes brouillés ». Autant en emporte le vent !
1. Adresse de la société Radio-Azur (26 rue de la Buffa à Nice), « Fournitures pour la radio et l'électricité », appartenant précédemment à un M. Y. Popovitch, que Steele a rachetée.
1939
Lettre de Jean Brunel, 9 janvier 1939
Pour votre livre que pensez-vous faire ? Il faut faire quelque chose. Giono pourrait-il le publier dans ses Cahiers (1) ou mieux, vous ouvrir les portes d'un éditeur enfin honnête ? Je pense très sérieusement que vous ne devez pas abandonner cette lutte, vous avez enfin votre liberté - si chèrement acquise - il serait bon que votre livre paraisse tel qu'il est avec ses défauts sans doute, que nous verrons mieux lorsqu'il aura pris la forme d'un livre, mais aussi avec ses magnifiques qualités, car il a de magnifiques qualités de style et de composition, que nous verrons mieux aussi lorsqu'il sera imprimé. Le plus dur est fait, il faut poursuivre car c'est le destin des oeuvres que de paraître.
1. Les Cahiers du Contadour étaient publiés par Jean Giono et Lucien Jacques depuis juillet 1936, mais ils cessèrent de paraître en décembre 1938.
Lettre de Jean Brunel, 6 février 1939
Je pense avec joie que vous allez passer des jours heureux au Contadour. Pour « Ecris-moi », c'est bien, je fais des voeux pour que Grasset le prenne.
Lettre de Bernard Steele, Nice, ce lundi [février 1939]
Chère vieille bourrique, je suis tellement content d'avoir de tes nouvelles que je ne vais pas t'engueuler comme j'en avais l'intention. Mais... sache quand même que tu as un peu exagéré. Comment ?? Je t'envoie à Manosque voir Giono, tu y vas (1), tu as de bonnes nouvelles, et tu ne m'envoies même pas un petit mot (timbres = 50 cmes) Ah ! alors ! Je te retiens. Enfin, puisque tu es heureuse...
Pas de voyage en perspective, sauf quelques jours jours dans le Var à Pâques - peut-être Paris au moment de la Foire, et 6 semaines aux U.S.A. en juillet-août. Mais rien de tout cela n'est certain - exception faite pour le Var.
1. Le journal ne mentionne pas cette visite à Jean Giono.
Lettre de Bernard Steele, ce samedi, s.d. [printemps 1939]
Je reviens de St-Paul où j'ai repris le manuscrit de Bonds (1). Miss Smith a eu le tact de ne me poser aucune question, aussi n'ai-je fourni aucune explication. Une fois en possession du manuscrit, je l'ai lu de suite. Bon - tu me connais depuis longtemps, et tu sais que l'amitié ne joue aucun rôle chez moi lorsque je suis appelé à passer jugement sur une oeuvre littéraire.
Pour en revenir à d'autres choses, j'ai eu l'occasion de revoir Giono. Il me dit n'avoir rien de nouveau à dire au sujet d'Ecris-moi (2). Le manuscrit est chez Grasset, et Brun l'avait trouvé bon. Je suis désolé de ne pouvoir te donner d'autres nouvelles. Il faut attendre, c'est tout.
As-tu lu le dernier de Giono ? Batailles dans la montagne (3). A mon sens, c'est un bouquin inégal, mais il y a dedans de la vraie grandeur, et certains passages atteignent au génie. Il y a un autre livre que tu dois lire, et qui s'appelle L'Amour et l'Occident de Denis de Rougemont (4). Quand tu l'auras lu, tu auras su pourquoi je te le conseille.
1. Champigny a envoyé le manuscrit d'une pièce de théâtre portant ce titre à un éditeur de Saint-Paul- de-Vence, qui ne lui a pas répondu : elle a donc chargé Bernard de le récupérer. Mais il s'agit de l'oeuvre d'une autre, peut-être Américaine, puisqu'il ajoute : « Je vais donc te faire part de ce que je pense - tu transmettras mon appréciation à l'intéressée, ou non, à ta guise. [...] A mon avis, cela ne présenterait pas grand intérêt pour le public américain, qui, en général, ne mord pas beaucoup à la " psychologie de l'amour ". Mlle Smith me dit que Roulelli a presque terminé la traduction française ».
2. C'est toujours le manuscrit refusé en 1937 par Denoël, qu'elle a envoyé à Giono et chez Grasset.
3. Paru en 1937 chez Gallimard.
4. Paru en 1939 chez Plon.
Lettre de Bernard Steele, 29 juin 1939
Voici ce que je puis te dire de mon beau domaine : il s'appelle « St. Pierre et Ruban Vert » (parce que sur 2 communes). Le bout principal (St. Pierre) est sur la commune de TOURTOUR. Le domaine faisait partie, en 1120, du monastère cistercien de Florielle ou Florièye, qui en est éloigné de 2 km 500. La maison état, dit-on, le lieu de « repos » des moines. Elle est située de telle sorte qu'il est impossible de la photographier de face, car elle est cachée, devant, par un grand saule pleureur, et de côté, par un platane dont le tour de tronc est de 3 mètres. De plus, elle est adossée à une falaise de tuf. Le domaine comporte au cadastre 153 hectares - mais le cadastre est plane. En vérité, si l'on tient compte des vallonnements, il y en a 200.
Tu aimerais cette vieille baraque, en cour de ferme, avec une tour ronde (escalier) et une tour carrée (pigeonnier). Il y a, naturellement, l'étable, un grenier pour 20.000 kgs de foin, des bauges, et deux bergeries, suffisantes pour 180 moutons. C'est à la fois vaste et tout petit.
Oui, tu as raison - notre voyage à Manosque était pour beaucoup dans cet achat, de même que toutes nos longues conversations. Il faut bien que je te le dise - je suis né amoureux de la terre de France - mais c'est avec toi que je l'ai connue. Et que de choses tu m'a apprises !
Et que de métamorphoses tu a vues chez moi - août 1930, février 1936, juin 1938, juin 1939. Vois les étapes : simulacre de vie de 1930 à 1936 - agonie de 1936 à 1938 - renaissance en 1939. Et toi, à quelques mois de décalage, tu as suivi une voie parallèle. Bizarre ! J'ai acheté St-Pierre le 6 juin 1939.
Lettre de Bernard Steele, 12 juillet 1939
Avant toute chose, je veux te parler de Mézels, car je me rends compte que sur ce chapitre, j'ai été un peu bref dans ma dernière lettre. Il ne faut pas que tu te fasses du mauvais sang - quand tu sauras ce que j'ai voulu dire, peut-être en auras-tu du contentement.
Voici - mon premier contact avec la pleine campagne française a eu lieu à Mézels. Je pense t'avoir souvent parlé de la très forte impression que j'ai ressentie lorsque, pénétrant pour la première fois sous ce toit, je te vis assise dans ta cheminée. Depuis lors, bien des liens se sont noués dans cette maison - sous ton égide, j'ai appris à connaître pourquoi j'aime notre terre, et peut-être, comment il faut s'y prendre pour être aimé de retour. Or, toi, la maison, le jardin, la rivière, tout le Lot, et par-delà - tout cela forme pour moi une synthèse, a la valeur d'un symbole.
Beau symbole d'ailleurs - symbole maternel et protecteur, rempli du plus bel amour - l'amour du sol, de la lumière, de la Nature et des créatures que Dieu y a mises. Cette maison, j'y pense très souvent, j'y étais attaché comme on est attaché à la demeure qui vous a vu naître (Et c'est un peu mon cas, ne t'en déplaise).
Le petit choc qui m'a servi de repère est donc le suivant - il a marqué le moment précis où je me suis lancé tout seul vers la destinée qui sera la mienne. Quand Catherine aura Mézels, Mézels ne sera plus le symbole - mais ce dont je ne m'étais pas rendu compte, c'est que déjà, longtemps avant que cette chose n'arrive, ce vide aura été comblé par une construction faite entièrement de ma main.
Voilà pourquoi je te disais que c'est bien ainsi. Dans ma vie, Mézels a changé de destination - au lieu d'être un symbole auquel il fallait s'accrocher de peur de tomber dans le vide, il est devenu ce que normalement il doit être, un splendide et joyeux souvenir - un point de départ au lieu d'un but en soi.
Est-ce clair, tout ceci ? Il est des sentiments que l'on ne met sur le papier qu'au prix d'un gros effort. Et une fois ça y est, on craint un peu d'être mal compris, de n'avoir pas su bien s'exprimer. Enfin, j'ai fait ce que j'ai pu.
Merci de tous les tuyaux sur ma région, dont j'ignorais tout. Tout ce que je savais, c'est que tout, là-haut, m'enchante. [...] La propriété ayant été quasiment abandonnée depuis de nombreuses années, il n'y reste que bien peu d'arbres fruitiers [...] Mon intention est la suivante - je veux planter, sur trois terrasses à côté de la maison, des pêchers, des pruniers et des pommiers. Je pense pouvoir en caser 2 ou 3 cents. Je remplacerai les cerisiers, et peut-être achèterai-je une mince bande de terre à mon voisin, où se trouvent une vingtaine d'oliviers.
Ton idée de tenir un journalier est excellente - je la mets en pratique dès ce soir. La littérature, je m'en balance, mais il me semble qu'un tel journalier était tout d'abord un excellent aide-mémoire, et me fera plaisir à parcourir par la suite.
Lettre de Jean Brunel, 20 juillet 1939
Je suis étonné et écoeuré de ce que vous me dites au sujet de Giono. N'y a-t-il vraiment pas eu erreur ? N'a-t-il pas transmis votre manuscrit ? Pour un sale coup, cette fois encore vous êtes servie.
Lettre de Jean Brunel, 28 août 1939
C'est accablant, la censure instaurée aujourd'hui (1) ne permet pas de connaître la simili-vérité de ces jours derniers. Quoiqu'on dise et quoi qu'il arrive (momentanément) je reste persuadé que nous approchons du dénouement et qu'il sera sanglant.
1. Instaurée ce 28 août 1939, en effet.
Carte-correspondance de Jean Brunel, 4 septembre 1939
Je vais bien et le moral est parfait. Je n'ai pas de nouvelles de vous depuis votre télégramme. Avez-vous des nouvelles de Christian et de Klein ? Donnez-moi l'adresse de Catherine, j'aimerais lui écrire. Mon adresse jusqu'à nouvel ordre : Lt Brunel, Nme Armée. C.H.T.S. Orléans - Loiret (1).
1. Jean Brunel est mobilisé depuis le 2 septembre. C'est aussi le cas de Christian Caillard.
Lettre de Jean Brunel, 22 septembre 1939
Vous avez, je pense, reçu la lettre dans laquelle je vous indiquais que j'avais vu Christian à Orléans. Les événements récents (intervention russe en Pologne) ont dû, dans le fond de lui-même, le pétrifier (1) ; mais il n'avouera jamais car c'est son habitude. Déjà à Orléans il pensait que la conclusion de l'accord du 23 août n'était qu'une feinte habile de Staline. Dire que c'est grâce à la duplicité de Moscou que la guerre a pu avoir lieu. Enfin nous aurons le loisir de reparler de tout cela après la guerre !
1. Les sympathie de Christian Caillard pour l'URSS sont connues.
Lettre de Jean Brunel, 2 octobre 1939
Vous dites que vous avez le désir de rejoindre Paris pour travailler. Je comprends cela, mais avez-vous trouvé comment s'emploierait votre activité ? En ce qui concerne les tableaux de Caillard, je pense que mon père ne lui refuserait pas si Caillard le lui demandait (1).
J'ai emporté des Editions de la Pléiade : Montaigne, Rabelais et Diderot. Je compte bien au fur et à mesure des jours, en faire venir d'autres.
J'ai laissé, en ce qui concerne vos fonds, des instructions au caissier : Mr Delmotte, à qui vous pouvez écrire directement, 4 rue de la Paix, si c'est urgent, sinon dites-le moi et je transmettrai vos ordres.
1. Sans doute, en cas de conflit, de mettre à l'abri les tableaux qui se trouvent dans l'atelier du peintre.
Lettre de Jean Brunel, 10 octobre 1939
J'imagine l'automne bien installé à Mézels, les brouillards et le froid ont dû venir aussi. Avez-vous des projets pour l'hiver ? Je trouve du reste bien imprudent d'en faire en ce moment car nous ne pouvons pas présager du cours des événements. La véritable guerre n'est pas encore commencée et nul ne peut savoir quelle tournure elle prendra. Je trouve particulièrement imprudents les gens qui rentrent à Paris en ce moment lorsqu'ils n'y sont pas indispensables ou utiles.
A propos de déguisement, j'ai aussi vu la caravane des envoyés spéciaux correspondants de guerre. Eux aussi se sont fait confectionner des uniformes avec de belles casquettes. C'était magnifique de voir ces ruines (membres de l'Académie ou vieux journaleux) dans cet accoutrement. Il y a tout de même de bons moments où la rigolade reprend tous ses droits.
Lettre de Jean Brunel, 12 octobre 1939
Les poursuites contre les communistes me comblent d'aise. Quand je pense que ces lascars voulaient nous faire battre il y a trois ans dans la malheureuse Espagne pour combattre l'hitlérisme et qu'aujourd'hui où nous sommes engagés à fond contre cet hitlérisme, ces messieurs se paient le luxe d'être pacifistes et même de déserter. C'est ignoble. J'espère bien que le camarade Thorez ne sera pas raté.
Quelle doit être la déconfiture morale de ceux qui, naïvement, croyaient à Staline et à L'U.R.S.S. Vous rappelez-vous la discussion avec Christian rue Jules Chaplain ?
Lettre de Jean Brunel, 21 octobre 1939
Je ne vous aurais point fait l'injure de croire que vous alliez à Paris par simple caprice, je connais trop votre conscience. Mais dans quel sens cherchez-vous du travail ? Ce ne doit guère être pratique de trouver.
Province (1) revu et reconstruit doit être très attachant. J'ai grand' hâte de le lire. C'est exactement ce qu'il faut en ce moment. Cette littérature de vraie fraîcheur est celle qui est utile et nécessaire à ceux qui sont au coeur de la tourmente. Ce sera la source d'eau claire et vive rencontrée dans l'obscurité d'une forêt.
1. Autre essai littéraire de Champigny soumis sans succès à Robert Denoël en 1938 puis, retravaillé, en 1944.
Lettre de Jean Brunel, 27 octobre 1939
J'ai grand' hâte de lire Province. Je suis persuadé que j'y trouverais tant et tant qui me ferait du bien. Cette vision saine du passé, de notre passé d'enfant. Le rappel de ce qui fut notre vie, de ce qui nous marque loin des cités.
Lettre de Jean Brunel, 7 novembre 1939
Je suis désolé de savoir que vous avez eu encore des phénomènes d'amnésie. N'y a-t-il pas à Paris un médecin capable de vous soigner ?
Lettre de Jean Brunel, 28 décembre 1939
A mon retour plusieurs paquets m'attendaient [...] Mais le plus beau était le vôtre, sans contestation possible. Il contenait le manuscrit de « Province ». Tout aussitôt j'en ai commencé la lecture et ne l'ai pas lâché avant d'avoir terminé. L'ensemble est d'une très belle qualité, surtout de style. Je le trouve plus dépouillé et plus solide. Il m'a semblé que bien des pages avaient été écrites à nouveau depuis la lecture que j'avais faite.
Je ne sais pourquoi vous ne voulez pas confier ce manuscrit à un éditeur, et je comprends encore mal pourquoi Denoël s'est donné tant de mal pour vous décourager, alors qu'il lui aurait fallu beaucoup moins d'efforts pour vous lancer. Il est vrai aussi que cet ouvrage, comme le précédent (1), a un intérêt très puissant pour vos amis et que je puis être trop pris par le côté personnel de l'oeuvre, mais je suis tout de même sûr que cela est très bien.
1. Probablement « Ecris-moi », qui a causé la rupture avec Denoël en janvier 1938.
1940
Lettre de Jean Brunel, 8 janvier 1940
Bien entendu je respecterai vos volontés si je suis moi-même encore de ce monde lorsque vous le quitterez, ce qui n'est pas pressé. Seulement je ne saurais trop vous conseiller de rédiger deux papiers : l'un où vous direz vos volontés pour ce qui vous appartient (maison, mobilier, etc) et l'autre où vous direz ce que vous voulez pour l'incinération ou autres cérémonies. Lorsque ces papiers seront écrits, datés et signés par vous, il vous suffira de me les adresser.
Voici bientôt revenue la date du 7 février, c'était il y a cinq ans que je rencontrai Marianne chez vous, rue Notre-Dame des Champs. Cinq ans, et aujourd'hui c'est la séparation, c'est la guerre ! Quand nous retrouverons-nous tous les trois, autour d'une bonne table ? Quand pourrons-nous rire ensemble et pour rien ?
Lettre de Jean Brunel, 3 mars 1940
Je ne me rappelle plus si je vous ai dit dans ma dernière lettre que j'avais lu le roman de Ph. Hériat qui a eu le prix Goncourt (1). Le sujet paraissait magnifique : la bourgeoisie et l'argent. Hélas, le roman est fort conventionnel et assez plat. Le style en est par contre vif et agréable. Ce n'est à vrai dire qu'une nouvelle un peu disproportionnée.
1. Philippe Hériat. Les Enfants gâtés. Roman publié chez Gallimard en juillet 1939 et couronné par les jurés Goncourt le 6 décembre 1939.
Lettre de Bernard Steele, 14 mars 1940
Bien reçu ta carte qui me démontre que tu es arrivée à bon port, ce dont je me réjouis (1). Tu me demandes de te parler de Tourtour... Volontiers ! Lorsque j'y suis monté, la semaine dernière, il y avait déjà de grands changements. [...] D'autre part, je viens d'acheter un nombre incalculable de plants et de graines, ce qui fait que, si Dieu le veut, nous aurons une abondance de légumes et de fleurs. Je t'écrirai plus longuement de là-haut sur ce qui se passe à la campagne. Radio-Azur se porte bien et tout son personnel te dit un amical bonjour.
1. Sa lettre est adressée à « Mme Champigny, 65 Allée d'Albret à Nérac (Lot et Garonne) ».
Télégramme de Bernard Steele, 29 mars 1940
Peux-tu loger famille en cas de besoin - envoie réponse à Tourtour - affectueusement.
Lettre de Bernard Steele, 18 avril 1940
Je viens de passer un mois de cafard et d'angoisse tels que je n'en avais encore jamais passé. Je t'épargne les détails, mais je n'avais jamais été aussi découragé, ni aussi paralysé - c'était affreux. Mais maintenant la crise est passée, et je remonte le courant. Ce n'est pas trop tôt. Ainsi que je te le disais, nous avons passé 15 jours à St-Pierre, pendant les vacances de Pâques.
Je pense me lancer dans une nouvelle affaire. J'aimerais de mettre un gérant à Radio-Azur, et de monter une affaire de transports et camionnage dans le Var, avec 4 ou 5 grands et petits camions. La chose est d'actualité, et répond à un besoin. Mais tout est encore à l'état de projet, en attendant d'avoir résolu la question de la main d'oeuvre. J'ai, cependant, bon espoir.
Ci-inclus, une lettre que Robert m'envoie, et qui concerne Le Grand Vent. Si tu es inscrite à la SACEM, vas-y ; sinon, fais-le (1).
1. Dernière lettre connue de Bernard Steele à Champigny. Quelques semaines plus tard, les menaces de guerre se précisant, il quitte la France avec toute sa famille pour les Etats-Unis. Son domaine de Tourtour sera occupé durant la guerre par le docteur René Laforgue.
Lettre de Jean Brunel, 27 mai 1940
En ce qui concerne votre argent, je sais qu'il en reste, mais je ne sais plus combien exactement. Je le demande par ce courrier. Dois-je vous faire tout envoyer ?
Décidément notre temps est fertile en événements sensationnels. La trahison du roi des Belges (1) prouve que l'amoralité s'est partout répandue. La confusion des valeurs morales ou spirituelles est complète. Je pense d'ailleurs que cette trahison n'aura pas d'effet désastreux sur les opérations, mais elle aura eu un large retentissement sentimental et moral.
1. Le 28 mai, Léopold III a ordonné la reddition de son armée, qui est perçue par ses alliés comme une félonie.
Lettre de Jean Brunel, 7 juin 1940
Cette fois la bataille est terriblement engagée et nous ne pouvons qu'attendre, attendre avec confiance certes, mais parfois aussi avec angoisse en pensant à tous ceux qui se sacrifient pour que les forces du mal ne prévalent point.
Et vous, que faites-vous ? Votre compte était créditeur de 3.082 F. Je vous ai fait envoyer 1.000 F, que vous avez dû recevoir maintenant. Lorsque vous voudrez le surplus, vous n'aurez qu'à me le dire. Envoyez-moi vos listes de bouquins, je vous dirai ceux qui ont de l'intérêt. A bientôt, du moins espérons-le.
Lettre de Jean Brunel, 30 juin 1940
Je suis, après des jours d'errance, à Meyronne (1) où vous pouvez m'écrire chez Madame Lachèze à Port de Creysse par Souillac (Lot). Je viens de vivre des jours affreux dont je vous parlerai lorsque nous aurons la joie d'être réunis ; pour l'instant, je n'aurais pas le courage.
Nous étions campés dans les conditions les plus déplorables sur le Causse, je me suis donc mis à la recherche d'un cantonnement dans la vallée. Je suis passé à Mézels où j'ai vu votre maison parfaitement en ordre et votre jardin assez bien entretenu.
1. Jean Brunel se trouve alors à 25 kilomètres de Mézels.
Lettre de Jean Brunel, 10 juilllet 1940
Je suis extrêmement étonné de savoir que vous n'avez pas reçu le mandat de 1.000 F que j'avais demandé à l'étude de vous faire parvenir. Je vous en envoie un autre de même somme aujourd'hui et j'écris au caissier pour avoir des tuyaux, mais l'étude est complètement désorganisée. Papa, le principal et le caissier sont en Auvergne, et la boîte est donc fermée. Je ne sais quand il sera possible de rouvrir.
Lettre de Jean Brunel, 27 juillet 1940
J'ai reçu hier votre lettre du 16 qui m'a suivi de Meyronne ici. Je suis effrayé. Comment votre père a-t-il pu se laisser aller à un tel geste (1) ? Je sais que vous souffrez de cette mort, malgré certaines distances qui vous séparaient moralement de votre père, aussi ma pensée va-t-elle vers vous, plus ardente et plus chaleureuse. Je suis démobilisé depuis avant-hier. Je remets un peu d'ordre dans mes idées et dans mes affaires.
1. René Champigny s'est suicidé le 12 juin, mais j'ignore comment. Je n'en ai pas trouvé trace dans la presse de l'époque.
1941
Carte postale de Jean Brunel, s.d. [début 1941]
La succession de votre père va bientôt être réglée. J'attends incessamment les fonds de la banque et de la Société des auteurs. Je réglerai ensuite avec le fisc. Je pense que l'actif net recueilli après le paiement des droits s'élèvera à environ 22.000. Il y en aura donc 11.000 pour vous, que je compte vous faire parvenir avant la fin du mois de la manière que vous m'indiquerez.
Carte postale de Jean Brunel, 30 décembre 1941
J'ai reçu votre carte relative à Madame Bess. Je me mets sans retard en rapport avec elle pour vous donner satisfaction, mais il est probable que nous aurons besoin de vous envoyer un papier à signer car la procuration que j'ai de vous n'avait pour objet que le règlement de la succession de votre père. Ce règlement est maintenant terminé et je vous envoie par le même courrier la somme vous revenant, soit la moitié de l'actif net : 10.888,65.
Avez-vous su que deux Loutreuil faisant partie de la collection Fénéon (1) avaient été vendues 10.000 environ ?
1. Le critique d'art Félix Fénéon [1861-1944] vendit sa collection en plusieurs vacations à l'Hôtel Drouot. La première, contenant 48 tableaux signés de noms prestigieux, eut lieu le 4 décembre 1941.
1943
Lettre de Jean Brunel, 12 mai 1943
J'ai bien reçu le chèque de 10.000 F dont le montant est à votre crédit à l'étude. J'ai reçu en outre un chèque de 1.000 F de Mme Delpech pour votre compte. Je lui ai donné la même destination. Je peux vous envoyer ce qu'il vous faudra quand vous voudrez.
J'ai écrit à Denoël selon votre désir pour qu'il intervienne d'abord auprès de Firmin-Didot (1) et en me mettant à sa disposition le cas échéant.
1. Editeur en 1929 de la Correspondance de Maurice Loutreuil annotée par Champigny.
Lettre de Jean Brunel, 24 mai 1943
J'ai eu une communication téléphonique avec Denoël. L'édition nouvelle annoncée de votre livre sur Loutreuil n'existe pas. C'est une annonce faite pour écouler les invendus de la première édition. Vous voyez quelles sont les moeurs de l'édition et comme il est après cela facile d'établir une bibliographie exacte d'un auteur !
Ceci n'empêche pas Didot de vous devoir de l'argent sur la vente de la 1ère édition. Le mieux, de l'avis de Denoël, serait que vous leur écriviez et leur demandiez votre compte.
Lettre de René-Louis Doyon, 28 juin 1943
Veux-tu s'il te plaît me dire si ta science correspond à mes intuitions concernant la scriptrice de ce bafouillage ; mon opinion est arrêtée mais tu peux la modifier avec les horizons que tu perçois (1).
1. Comme Denoël, Doyon soumet à Champigny l'écriture de cette nouvelle collaboratrice pour étude graphologique.
Lettre de Jean Brunel, 10 juillet 1943
J'ai bien reçu de Madame Delpech un chèque à la fin de chacun des mois d'avril, mai et juin - de telle sorte que votre compte se trouve créditeur de 13.000 F sur lesquels je vous envoie par mandat une somme de 10.000 F.
J'ai aussi reçu - et vous l'ai déjà écrit - 3 tableaux de Loutreuil dont le portrait de Caillard. Il est bien entendu que si vous veniez à disparaître, ce dernier serait remis au Louvre (1), mais c'est surtout dans votre testament qu'il faut inclure cette disposition.
1. C'est ce qui fut fait par Me Brunel le 27 juin 1956, trois mois après la mort de Champigny.
Lettre de René-Louis Doyon, 11 juillet 1943
Je me réjouis que ta vie soit paisible et possible à l'écart des grandes convulsions dont le monde et le nôtre sont la scène périodique et souvent l'enjeu de quelque idéologie qu'on étiquette les courants et les spasmes qui agitent les masses humaines. Leur mystère n'en est pas mieux éclairé et leur misère jamais amoindrie.
Ce que je fais ; en ce moment, rien. [...] on me découvre une hernie inguinale et me voici menacé d'une charcuterie délicate, ce qui est de toute façon ennuyeux et financièrement inopportun. J'attends une solution providentielle comme souvent, et il se peut qu'elle advienne, vers la fin août, après, si je le peux, une embardée sur Bruxelles.
Lettre de René-Louis Doyon, 5 août 1943
Je trouve cette annonce dans la dernière Biblio. Ne sont-ce pas les deux collaborateurs du Bonheur des tristes (1) ? En tout cas, L'Apprentissage de la ville m'a déçu. Ce milieu de toxicomanes, de faiseurs et de faisans plus ou moins titrés, cet amour enfantin, poétique, et qui finit en eau de bidet, cette tendance volontaire à faire du flou, du moral, de l'esthète, tout cela ne m'a laissé qu'une impression de travail systématique et de construction concertée. Je ne lui en ai pas accusé réception tant je suis embarrassé et cela remonte à un ou deux ans (2).
1. L'annonce n'a pas été conservée mais il s'agit de Dialogue de l'amitié, que Luc Dietrich et Lanza del Vasto ont publié à Marseille chez Robert Laffont. On note en passant que Doyon, très au fait des questions d'édition, sait que Le Bonheur des tristes, paru en septembre 1935 chez Denoël et Steele, n'est pas dû à la seule plume de Luc Dietrich.
2. Le second roman de Dietrich est paru chez Denoël en février 1942. Doyon n'a pas été dupe : il y a retrouvé les mêmes défauts d'écriture, c'est-à-dire deux mains au lieu d'une.
Lettre de Jean Brunel, 16 octobre 1943
J'ai reçu le chèque habituel de Madame Delpech au début de septembre et un autre au début de ce mois de 2.500 F : 1.000 F pour le mois de novembre et 1.500 F pour ce mois car, me dit-elle, elle vous a fait faire une analyse (1). J'ai donc pas mal d'argent à votre compte : 16.500 F environ. Dites-moi ce qu'il vous faut, je vous l'adresserai aussitôt.
1. Les analyses graphologiques assuraient à Champigny quelques rentrées d'argent.
Lettre de Jean Brunel, 13 novembre 1943
Vous devez savoir que Christian a organisé une exposition de Loutreuil (1). En voici le catalogue. Les journaux ont dit avec beaucoup de phrases creuses les mots qui leur avaient été soufflés et votre nom n'a point été prononcé. J'en ai eu de la peine et compte bien le dire à l'organisateur lorsque je le verrai.
1. Cette exposition eut lieu en octobre et novembre à la Galerie de France, 3 Faubourg St-Honoré. Champigny évoque cette injustice dans le journal. Seul, Denoël réagit en donnant à un journal une interview pour rétablir son nom.
1944
Lettre de Jean Brunel, 25 janvier 1944
Mon long silence n'est pas indifférence, loin de là, mais je ne sais trop comment je vis, alors je n'avais guère envie de l'expliquer ou même d'y faire allusion. Vous auriez été là, je vous en aurais entretenu, mais écrire alors que tout est encore en crise, je ne pouvais. Rien d'ailleurs n'est intervenu et je ne sais comment j'en sortirai. Essentiellement, les sentiments que j'avais pour Marianne ne sont plus, ou ont tellement changé que j'ai cru devoir lui dire, et depuis ce temps c'est chaque jour un peu plus d'éloignement entre nous. Elle en souffre, je suis malheureux qu'il en soit ainsi.
Lettre de Jean Brunel, 23 février 1944
De Catherine je n'ai jamais eu de nouvelles depuis la visite de la « vieille folle », comme vous dites. J'avais eu alors l'impression que leur organisation agricole consistait surtout à trafiquer à de très gros prix. Je vois que je ne m'étais pas trompé (1).
1. Champigny évoque dans le journal (29 février 1946) ce marché noir organisé par Catherine Mengelle et ses amies. La « vieille folle » est probablement Josine Reuling, l'écrivain hollandaise qui vivait alors avec elle à Broche.
Lettre de René Barjavel, 25 février 1944
Chère Champi, si je ne vous écris jamais, c'est que j'aurais besoin de vous écrire des lettres de quinze pages, et je ne trouve jamais le temps, ni surtout le courage. J'aurais tant de choses à vous dire ! Si vous étiez là, que je puisse parler, j'en aurais au moins pour une nuit à en venir à bout.
Je vais vous dire simplement ceci, qui résume tout : depuis deux mois, j'ai quitté trois fois mon foyer, ma femme, mes enfants, et trois fois je suis revenu à l'attache, retenu par de petites mains, et par le remords de faire du mal. J'ai vécu seul sept ans, près d'une femme qui m'est étrangère, et qui ne sait pas rire. Je l'aime bien pourtant, comme si elle était le premier de mes trois enfants (1). Mais le mot que vous avez écrit pour la désigner est justement celui qui ne lui convient pas. Elle n'est pas ma compagne. Pendant sept ans je me suis tu. Je n'ai pas dit un mot de ma solitude, même à Denoël.
Et puis, en décembre dernier, j'ai rencontré une petite fille rieuse, passionnée, vivante, intelligente, à qui je n'ai pas besoin de dire deux mots pour qu'elle me comprenne. Je n'ai rien su cacher à ma femme. Hélas, je ne sais pas mentir. Drame, scandale. Départ. Et loin de mes enfants je me suis senti perdu. Et quand je rentre chez moi j'y retrouve la solitude et la tristesse.
Voilà le drame, Champi. Je ne sais comment il se dénouera. Peut-être cet amour d'adolescent qui m'a si brusquement empli le coeur s'éteindra-t-il, et je retrouverai la paix dans le travail. S'il dure, si la petite fille que j'aime s'en montre digne, je finirai pas m'en aller de chez moi, pour essayer de revivre, quand les circonstances plus paisibles ne me laisseront pas l'impression d'abandonner mes enfants en pleine tempête.
Champi, vous êtes toujours celle à qui on ouvre son coeur. Excusez-moi de vous ennuyer avec mes tourments, vous qui êtes si loin, si seule, si accablée de souffrances. Dieu sait quand je vous écrirai de nouveau ! C'est si pénible de faire avouer à sa plume toutes ces choses. C'est si facile quand vous êtes là !
Champi de mon coeur, je vous envoie ce Voyageur imprudent (2), qui va vous arracher pour quelques instants à notre temps calamiteux. Le soir même où il m'a apporté ce prix (3) dont vous avez entendu parler dans votre désert, j'ai rattrapé ma femme qui enjambait la fenêtre de notre septième. Elle est très malheureuse, parce que je suis tout pour elle. Je la quitte, elle s'écroule. Je m'arrête, Champi. Vous connaissez tout ça par coeur.
1. Barjavel a épousé Madeleine de Wattripont [1915-2005] le 10 octobre 1936. Ils ont eu deux enfants : Renée en mai 1937, Jean en 1938.
2. Paru tout d'abord en feuilleton dans Je suis partout [24 septembre 1943 - 14 janvier 1944], le roman a été publié chez Denoël le 21 janvier 1944.
3. Couronné le 29 janvier 1944 par le « Prix des Dix », créé par dix fantaisistes pour remplacer le Goncourt, dont les académiciens avaient refusé de décerner leur prix, cette année-là. Cette parodie de prix littéraire fut répercutée par toute la presse et même sur les écrans parisiens.
Lettre de René Barjavel, 2 juin 1944
Champi de mon coeur, c'est de l'hôpital que je vous écris. Un érysipèle avait transformé le coeur de rose en gratte-cul, mais j'ai été soigné avec dévouement et une grande gentillesse par les soeurs de St Joseph de Cluny, et voilà que j'ai repris figure humaine, sauf que je pèle encore un peu, comme d'un vieux coup de soleil. Ma femme et mes enfants sont à la campagne, j'étais seul chez moi quand le mal m'a pris, aucune clinique n'a voulu de ce contagieux, mais l'Hôpital Pasteur est une petite île de paix entourée de verdure, et j'ai été ici aussi bien que n'importe où.
J'ai revu souvent Cuny (1), et je suis désolé de ce qui vient de lui arriver. Vous savez qu'il jouait Andromaque (2) avec Jean Marais. Le préfet de police a interdit la pièce, et des communiqués à la presse et à la radio ont mis cette petite saloperie de Marais et Cuny dans le même panier pédérastique.
Je suis assez mal au courant des détails. J'ai appris tout ça dans mon lit. Dès que j'ai pu prendre le stylo, j'ai écrit partout où j'ai pensé que c'était utile pour prendre sa défense. Mais je ne sais pas ce qu'il a fait lui-même. Il risque d'être marqué pour la vie par cet incident. Le voilà embarqué de force sur la même galère que des gens qu'il hait. Que fait-il pour s'en sortir? Fait-il seulement quelque chose ?
Champi, il y a en lui quelque chose qui me décourage, une sorte de goût du malheur, de manque d'appétit de la vie, qui me déconcerte. Parfois, après l'avoir « remonté » et engueulé pendant deux heures, je m'aperçois que tous mes mots ont été inutiles, et qu'il est exactement pareil qu'avant. Peut-être je ne sais pas frapper à la bonne porte, dire les mots utiles.
Vous qui me connaissez, vous savez que toutes mes complications viennent au contraire d'un trop grand amour de la vie, d'une avidité, d'une gourmandise d'enfant pour tout ce qu'elle m'offre. Un tempérament comme celui de Cuny me déconcerte. Il a tous les dons de l'intelligence et du coeur, et il reste dans son coin, dans l'attitude d'une poule malade. Et pour une fois qu'il bouge, il met le pied dans la merde ! Vraiment, c'est un cas curieux et tragique.
1. Champigny a fait la connaissance d'Alain Cuny [1908-1994] en mars 1944 à Paris, grâce à Barjavel ou à Denoël.
2. Pièce mise en scène par Jean Marais et créée le 22 mai 1944 au Théâtre Edouard VII. Elle fut interdite le 30 mai 1944.
Lettre de Jean Brunel, 25 septembre 1944
J'ai bien reçu votre lettre confiée à Mr Huyghe (1). J'essaye de vous faire parvenir un mandat, qui partira de l'autre zone - puisqu'il y a encore une zone. Espérons que la circulation sera bientôt normale. Je compte bien venir vous voir dès que je passerai de l'autre côté. Cela est difficile mais j'espère pouvoir le faire grâce à mon ami Pascal Copeau (2), qui est maintenant un homme au pouvoir.
Je ne vous ai point écrit les derniers temps, car je vous croyais dans le maquis (3). Votre lettre du mois de juin me le laissait supposer. Et depuis, le courrier ne partait plus.
1. René Huyghe [1906-1997], conservateur du musée du Louvre.
2. Ami d'enfance [1908-1982] de Jean Brunel, membre influent de la Résistance.
3. L'adhésion de Champigny à un mouvement de résistance du Lot est avérée, mais sans qu'on sache quel rôle actif elle y a joué. Sa maison était un lieu de rencontre des maquisards, qui y émettaient des messages radio.
1945
Lettre de Jean Brunel, 20 janvier 1945
Comme vous me l'aviez demandé, j'avais fait le nécessaire pour vos manuscrits auprès de Barjavel. Il m'en a fait remettre deux. Quant à celui de Province, il vous l'a fait tenir par le Louvre, m'a-t-il dit. Ils sont donc chez moi dans mon coffre à l'abri et ils y resteront jusqu'au jour où j'aurai la joie de vous revoir et de vous les remettre moi-même.
Lettre de Jean Brunel, 8 mars 1945
J'ai vu votre docteur. Je pense qu'il vous aura envoyé un peu de Povéron. Son avis est extrêmement net. Il ne croit nullement à une paralysie possible pour vous. C'est vous dire qu'il n'accédera pas à vos demandes en ce qui concerne une médication par augmentation des doses et qu'il n'alertera pas le docteur de Vayrac. Il pense qu'il conviendrait pour vous d'entrer en maison de cure pour désensibilisation d'abord et désintoxication ensuite, tout en palliant à vos douleurs.
Je sais qu'un tel programme ne vous paraîtra pas intelligent, et que le docteur Chabassus qui le préconise, et moi qui vous propose de le réaliser, nous allons avoir droit aux mêmes épithètes que les médecins du Lot. Tout cela me désole car votre lettre que j'ai communiquée au docteur prouve à quel point vous êtes engagée dans cette voie sans issue.
Christian est venu jusqu'à l'étude un jour où je n'étais pas là. Il a déposé pour vous une somme de 19.250 F qu'il restait vous devoir - a-t-il dit - sur la vente des toiles de Krémègne. Que dois-je faire de cet argent ?
Dans ma dernière lettre je vous ai parlé de Province et vous en aviez parlé vous-même dans votre précédente. Dites ce que vous comptiez faire et en quoi nous pourrions vous aider à publier. Je suis persuadé que cela est possible.
Lettre de Jean Brunel, 14 mars 1945
Je continue à penser que le mieux pour vous serait de venir à Paris. Dans la conversation que j'avais eue avec le docteur, il m'avait laissé entendre qu'il pourrait trouver une maison de cure pour vous dans les environs immédiats. Pourquoi avez-vous commencé aussi brutalement ? J'imagine que c'est la nécessité qui vous y a contrainte.
Lettre de Jean Brunel, 1er juin 1945
Oui, les Editions Denoël continuent mais sans lui, tout au moins au départ puisqu'un administrateur avait été nommé et que cet administrateur était Maximilien Vox. Quant à Barjavel, je ne sais quel rôle exact il joue dans la maison (1). Dans les premiers jours de la Libération, il était question de blâme et d'index pour lui (2).
1. Maximilien Vox a été nommé administrateur provisoire des Editions Denoël le 20 octobre 1944, après l'éviction de Robert Denoël. René Barjavel y a été nommé directeur littéraire en 1945.
2. Barjavel a en effet figuré sur une première « liste noire » en septembre 1944, mais en a été retiré le mois suivant.
Lettre de Jean Brunel, 26 juin 1945
J'ai vu Huyghe il y a une dizaine de jours. Il a vu Gallimard qui paraît décidé. Nous avons convenu de nous occuper de vous ensemble. La première besogne est de faire taper votre manuscrit d'une façon présentable et lisible. Je le fais faire. Aussitôt après nous le remettrons et j'espère une réussite.
J'ai relu attentivement votre texte. J'ai retrouvé ma première et ancienne impression. Province est très valable. Ce sont des pages attachantes, elles peuvent plaire. Ceux qui vous connaissent et qui vous aiment sont peut-être mauvais juges car c'est vous qu'ils cherchent et qu'ils découvrent dans ces souvenirs d'enfance. Mais je ne crois pas me tromper : d'autres que vos amis peuvent être des lecteurs séduits.
Dans la conversation Huyghe me demandait si je n'avais pas de vous des pages qu'il pourrait publier dans Quadrige (1) ; peut-être celles que vous supprimeriez ainsi pourraient-elles lui convenir, à moins que vous ne vouliez lui envoyer autre chose. Vous ai-je dit que Huyghe alerterait Luc Dietrich pour les photos (2) ?
1. Revue d'art dirigée par René Huyghe qui parut de juin 1945 à 1948.
2. La référence à Luc Dietrich, romancier et photographe ami de Denoël, est surprenante : il est mort le 12 août 1944.
projet de contrat [30 septembre 1945] (1)
Entre les soussignés
Madame Irène Champigny, sans profession, demeurant à Mézels, commune de Floirac (Lot)
et Monsieur Jean Brunel, notaire à Paris, y demeurant rue de la Paix n° 4
Il a été convenu ce qui suit :
Madame Champigny promet de vendre à Monsieur Brunel ou à toute personne ou société qu'il lui plairait de se substituer, la maison, le jardin et les terres qu'elle possède à Mézels (Lot), en obligeant ses héritiers fussent-ils mineurs ou autrement incapables
La décision de la dite vente ne pourra avoir lieu que dans les six mois qui suivront le décès de Madame Champigny. La demande de réalisation pourra avoir lieu par simple lettre recommandée. La vente aura lieu aux charges et conditions ordinaires et moyennant un prix de cent vingt mille francs.
Monsieur Brunel s'engage à verser sur ce prix à nue concurrence une somme de soixante mille francs (60.000 F) payable à raison de dix mille francs à compter du premier novembre mille neuf cent quarante-cinq.
Dans le cas où Monsieur Brunel ne voudrait pas demander la réalisation de cette promesse, Madame Champigny engage ses héritiers et représentants à lui abandonner, pour le rembourser des avances par lui faites, les trois toiles de Loutreuil qu'elle lui a remises en gage et les livres qu'elle possède.
Fait et passé à Luc (commune de Saint-Poncy) le trente septembre mille neuf cent quarante-cinq.
Lu et approuvé
Jean Brunel Champigny
1. La première page est barrée de cette inscription : « Annulé par Jean Brunel le 20 mai 1946 qui n'a rien à réclamer. Jean Brunel ».
Lettre de Champigny à Cécile Denoël, 22 décembre 1945 (1)
Ma petite fille,
Dans quatre jours, il y aura donc dix ans que tu étais si belle, si heureuse. Je te revois, toute blanche, éclatante de fraîcheur, de jeunesse dans tes satins fleuris. Je « Vous » revois (2).
Trois mois plus tard, il y aura dix ans que tu m’étreignis fraternellement sur « Eridan », sans que je me doutasse que ce geste était un adieu (3). Ta silhouette sur le quai.... Ton image : mon dernier beau souvenir de France, de l’Europe, du passé. Dix ans, que je ne sais quel atroce malentendu m’enleva injustement cette grande sœur maternelle que tu étais ? Je n’ai jamais compris. J’en ai beaucoup, beaucoup souffert. Seul Robert savait ma peine. A chacun de nos revoirs, j’interrogeais. Toujours pour apprendre que tu ne voulais pas me revoir.
Oh, Cécile, Cécile, Robert était aimé de tant de gens. Il avait su se faire tellement d’amis. Il t’en avait donné beaucoup. Je suis donc certaine qu’en ces horribles jours de douleur, tu auras été entourée. Que de partout des gens seront arrivés t’aider, te soutenir, partager avec toi une douleur rendue encore plus cruelle par la brutalité des circonstances qui t’enlevèrent ce compagnon chéri, le père de ton enfant. Mais j’ai beau me répéter que tu es entourée, je ne me console pas d’avoir été loin de toi, de n’avoir pu vivre à tes côtés ce que j’ai vécu ici seule, le chagrin de lui.
J’étais une fois de plus aux confins de la mort, au-delà de la démence après seize mois plus martyrisants que tous les autres depuis 1929.
Toujours seule dans ma chaumière, je n’avais pas ouvert l’appareil de radio depuis bien des semaines ; quand, le lundi, sans savoir l’heure... sans regarder, sans chercher un poste, mue par un geste forcé, j’ouvris pour entendre le milieu de la phrase sans espoir " ...diteur Robert Denoël a été abattu hier... " Je restai là, hébétée, ne sachant pas bien si je ne venais pas une fois de plus d’être empoignée par l’une de ces hallucinations (visuelles ou auditives) qui sont le pire de mes souffrances quand mon cerveau malade frôle la folie...
Je me mis à guetter les pas sur la petite route, ne pouvant marcher, donc sortir, j’envoyai porter un papier au téléphone pour demander aux garagistes de Vayrac de courir acheter les journaux... ils le firent... appelèrent la cabine le soir, puis encore le lendemain pour dire : rien...
Le mercredi une lettre de Mme Delpech (l’amie de Tosi) disant : " Je ne veux pas, sachant combien vous aimiez Denoël, que vous appreniez par des journaux hostiles ou indifférents la terrible nouvelle. " Elle me disait " que tu étais seule, que l’on t’avait appelée en pleine nuit pour aller le reconnaître ".
Mon Dieu, mon Dieu... jamais je n’ai autant pleuré sur ma misère, mon impuissance. J’aurais voulu sauter dans un train, courir vers toi, te téléphoner, te voir, pleurer avec toi... Mentalement je rédigeais des télégrammes. Je ne savais même pas ton adresse personnelle, que par discrétion je n’avais jamais demandée.
J’eus la sottise de croire que, du bureau, quelqu’un se souviendrait, m’écrirait la vérité... Je pouvais faire cette supposition, car enfin, c’est à moi que Tosi dut d’entrer travailler aux côtés de Robert. Mais surtout Barjavel, Barjavel qui connut Robert par moi. Lui que je proposai à Robert en 1935, lui qui aimait tant ton mari, lui qui savait qu’en dépit des orages qui secouaient parfois nos rapports, je tenais immensément à Robert Denoël avec un attachement fidèle toujours plein d’amour, de tendresse, de gratitude ; je n’entends pas ici la simple reconnaissance pour les preuves tangibles de dévouement qu’il me donna, particulièrement en 1930 et l’hiver 42/43 quand il me revit à la clinique Geoffroy St-Hilaire, mais la gratitude pour un esprit qui comprenait absolument le mien.
Caillard, qui ne m’avait pas écrit depuis un an, m’écrivit pour me dire que, " sans relations avec vous les dernières années, il n’avait osé se permettre d’aller te voir, très gêné parce qu’il vous savait en instance de divorce ". En instance de divorce ! Je le savais aussi... je n’y croyais pas. J’avais vu Robert en mars 1944 à Paris.
Je venais de perdre l’unique tendresse, la seule présence de ma vie, la compagne de toutes mes années solitaires : Doudou. En mars 1944 j’avais trouvé Robert soucieux ; il y avait de quoi. Tu venais d’être malade d’une infection intestinale ; il me parla de ta santé avec le même souci qu’auparavant. Il m’écrivit deux fois ensuite ; d’abord au sujet de mon " Province " qu’il voulait éditer, me trouvant pessimiste parce que je l’assurais que c’était trop tard, puis à propos de plusieurs cahiers à lui confiés qu’il voulait faire taper.
A l’époque, je voulus une dernière fois le mettre en garde socialement, le conjurant de comprendre qu’il se trompait. Dans la même lettre je lui répétais que nos divergences d’opinions ne domineraient jamais mes sentiments. Que, tout en regrettant son attitude, je le priais de se souvenir à temps que je lui étais dévouée, qu’il pouvait compter sur moi et arriver ici (non dans l’idée qu’il y restât mais j’étais à même de cacher qui je voulais et très sûrement, à Nérac).
Il me répondit une fort longue lettre, le lundi de Pentecôte 44. Amené en m’écrivant à un retour sur lui-même, bilan de sa vie, me disait-il en propres termes, " le ton confessionnel et testamentaire ".
Je n’ignorais pas ce que tu avais souffert en 1942. Un soir de cet hiver-là, tu lui avais écrit de la gare d’Austerlitz, au moment de prendre le train pour Souillac, une lettre qu’il ne put achever de lire sans que lui montassent les larmes et il me l’avait alors tendue. Je la lus, car je venais d’écrire dans mon cahier secret d’alors un " portrait de Cécile " que j’avais tenu à lui lire. Portrait si exact, qui lui restituait toutes vos belles années, remettait en lumière les côtés de toi qu’il adorait. Et comme, en conclusion, je disais en ces pages mon espoir que tu fusses " malgré tout " heureuse alors de ton présent, que cette lecture tombait juste quand tu t’enfuyais de Paris pour quelques heures, sans doute après une scène triste, si je compris bien sans l’interroger, c’est alors que Robert m’avait répondu : " Non, elle souffre, mais je l’aime toujours, je tiens à elle, je ne l’abandonnerai jamais". Et je revois son geste. Il sortit ta lettre, commença de lire, eut les yeux embués, la voix cassée, puis me tendit ta page de femme déchirée dans son amour. Ah ! si tu avais seulement désiré me revoir, chère Cécile, quand je ne demandais qu’à t’aider...
Vint l’année 1944. En déclinant mon offre amicale, Robert m’expliquait ses travaux, ses projets " au cas où il serait contraint de quitter la rue Amélie " et il me précisait : " je me suis ménagé de suffisantes retraites ".
Le silence s’abattit à l’époque prévue ; je fus longtemps en peine de lui. J’écrivis à Barjavel et à Tosi, sachant que Barjavel était aussi dans le cas d’avoir cherché " retraite ". Excuse-moi si je te note un détail personnel, ce n’est que par nécessité de clarté pour toi, pour ce qui va suivre et non que je veuille te faire prendre intérêt à ce qui me concerne.
A l’automne 1944 je vis que les Editions continuaient, qu’il n’était pas question de mon travail alors que Robert me précisait (Pentecôte) qu’il avait envoyé mon manuscrit à l’imprimeur, qu’il allait m’envoyer les premières épreuves avec la copie de l’un de mes cahiers. Donc, on sortait les livres en route et pas le mien... Il se trouva une chance inespérée pour moi de sortir ce livre en vitesse, puis, de publier des poèmes écrits dans les cahiers confiés à Robert. M. Huyghe, le premier conservateur du Louvre se présenta aux Editions, où il fut mal reçu... Les jours passaient, cassant mes faibles chances et j’étais aussi jaune que malade. J’insistai auprès de Tosi qui fut... à peine courtois.
Après des mois, quand l’Américain qui désirait acheter ferme un manuscrit de moi et faire publier mes poèmes (car dès 1941 l’on avait publié des lettres de moi à New York sous le titre " La France parle à l’Amérique "), quand cet homme fut en Rhénanie avec Eisenhower au lieu d’être à Paris, alors Tosi et Barjavel firent l’immense effort de faire rendre mes papiers à mon camarade Jean Brunel, le notaire. Lui, confiant dans les Editions, fit un reçu pour 3 manuscrits ! en effet, d’aspect, il y avait 3 choses.
Mais, alors qu’à Barjavel et Tosi j’avais décrit en détail : 1° le manuscrit " Province " puisque, malgré les engagements de Robert, vous ne l’éditiez pas, je le vois ; 2° un cahier brun, en cuir ; 3° un volume broché portant imprimé : in-8 jésus... etc. et titré à la main : " le livre des jours comptés ". Il firent remettre à Brunel " Province ", le cahier brun, et un petit dossier dactylographié, remis avenue Ch. Floquet en 1934 !!! [manquent 2 mots] à leur mauvais vouloir alors que (abstraction faite d’amitié, côté Barjavel) ces deux hommes me devaient moralement beaucoup pour avoir été les collaborateurs de Robert, Robert avec lequel ils étaient en contact... qu’ils auraient pu interroger... qui leur aurait dit chez quelle copiste était cet ouvrage douloureux.
C’est au cours de ces échanges de lettres avec Tosi (toujours craignant que Barjavel fût suspect ou surveillé) que je fis proposer à Robert de rencontrer Brunel, intime d’enfance avec Pascal Copeau, du Comité de Libération. Je n’ai jamais su si ton mari avait été avisé de cette offre ! Tout ce qui précède, pour en venir à ceci : quelque temps, j’avais cru Robert hors Paris. Quand je reçus (enveloppe écriture inconnue) le billet suivant :
" Il faudrait avoir la tête libre pour vous répondre convenablement. Je n’ai en ce moment ni bureau, ni domicile fixe. Je vis en bohémien, en attendant des événements qui ne peuvent pas être très agréables. Cécile est chez des amis à Paris, le Finet est en son village de Mayenne où pas un coup de fusil n’a été tiré. Je ne sais pas si demain je pourrai encore exercer mon métier. Il n’est pas tout à fait sûr que je ne sois pas expulsé. Tout cela n’est pas très excitant. Si dans trois ou quatre mois les choses ont pris une tournure plus favorable, je ne demande qu’à rencontrer votre ami. Peut-il attendre ? "
(L’ami, un jeune homme qui rêvait de travailler avec lui. Lui, Robert, qui m’avait écrit que malgré leur affection, il serait obligé de se séparer de Barjavel, lequel ne voulait plus qu’être littérateur du matin au soir.) Suite du billet sans date de Robert :
" Je me découvre en ce moment une quantité d’ennemis fort agressifs. Dans l’ensemble, assez répugnants, les amis ne sont pas au pouvoir ou ceux qui y sont se révèlent comme des planches pourries. Bref ma situation est noire pour plusieurs mois. Je ne peux avoir aucune correspondance. Cécile non plus (j’avais proposé que tu uses de Mezels si besoin était). N’écrivez pas. Je pense à vous plus tendrement qu’il n’y paraît dans ce mot. Et je vous embrasse. R. "
Ces simples lignes, anxieusement attendues depuis des mois, au lieu de me faire plaisir me cassèrent de peine. Au moins 4 fois en 20 ans j’avais pu nous croire brouillés. J’eus souvent des mots durs, amers ; je n’ai pas à me reprocher un seul acte méchant contre lui. Après l’amitié renouée en 42/43, la bonté qu’il me témoigna alors, il me semblait que plus jamais je ne douterais de Robert. Et voilà que ce court billet détruisait tout, m’apparaissait comme une affreuse trahison.
Peinée d’abord qu’il pût escompter dans les mois à venir que les événements prissent " une tournure favorable ", ce qui impliquait alors pour la France occupée, alors en guerre, un revirement au bénéfice des Allemands et nécessairement en ce cas la défaite des alliés, c’est le mensonge entier caché dans ce message qui m’épouvanta pour lui, pour les suites de sa vie, en même temps qu’il me dérobait la foi dans mon ami le plus tendrement aimé (4).
Car, en ce pays perdu où ma solitude défie tout ce que tu pourras jamais imaginer, entre mes dernières lettres à Barjavel et Tosi (restées sans réponses) et le billet de Robert, j’avais appris qu’il n’avait pas quitté Paris et, très exactement où il était - comme j’avais, d’autre part, appris ton séjour à l’hôtel louche de la rue de Lille, très " fiançailles avec un colonel allié " etc, etc... Je n’y avais pas cru, aux fiançailles. Vous ayant d’abord supposé d’accord sur le choix de vos retraites, j’imaginais de ta part un jeu capable d’éveiller un peu la jalousie de Robert...
Je savais que Robert voyait Catherine. Si mon cœur pardonne tout, mon lucide esprit juge. Catherine a poussé assez loin de 1929 à ... le fameux " diviser pour régner "... Soit afin que je ne n’apprisse pas ce qu’elle tenait à me cacher, soit pour que d’autres ignorassent ce qu’elle redoutait (à tort) qu’ils apprissent par moi, avec une adresse consommée elle sut, non seulement écarter de moi des amitiés chères, mais me faire perdre l’estime de ceux qui ne m’étaient pas des intimes. Tous ceux qui étaient mes amis très chers et qu’elle tint de moi quand je l’imposais et la défendais, elle les écarta.
Quand Robert fut si chic envers moi en 42/43, il ne l’avait pas revue depuis Tourettes avant la guerre. Le jour où je passai en correctionnelle à Gourdon, je racontai à Catherine que Robert était devenu l’éditeur en vogue. Il est riche ? demanda-t-elle. A ma réponse qu’il gagnait beaucoup, je vis dans ses yeux une lueur particulière, de moi bien connue et je me dis : elle courra le voir sous huitaine. Je me trompais, elle y partit 24 heures après...
Dès lors, son marché noir eut un commanditaire-client et elle cessa du jour au lendemain de me voir... elle l’avait persuadé, ainsi que toi, de son " retour à la terre " !
Plaise à Dieu que ses expériences se fussent déroulées loin d’ici. Incontinent, le ton de Robert changea envers moi. Quand je le vis en mars 44, il était encore sous le charme de son héroïsme pour l’histoire hollandaise. Dinning ne m’aime pas. Elle a quelques raisons de m’estimer... si elle t’a revue ou te revoit un jour, tu sauras sans doute des choses que je préfère taire. Ce passage de Catherine et Cie à Paris en 44 modifia l’attitude de Robert. Elle vit aussi les d’Aubigné... Et le temps passe, et mon immense confiance est une fois de plus touchée. Robert se cache de moi. Dans cette " retraite ", il revoyait nécessairement des amis à moi, qu’il avait connus par moi, pour affaires. En août 44, je vois ces amis, ici. Nous sommes intimes. Puis... silence.
Je me torturais à chercher pourquoi quand j’apprends où se trouvait Robert. Et je me dis : c’est un sort... tous mes amis réunis m’abandonnent alors que je n’ai une ombre à me reprocher envers eux ! Enfin, l’été dernier, apprenant que mon amie Marguerite [Thibon] était à 12 km d’ici, chez elle, je lui écrivis : " si vous avez un grief, dites-le... si vous ne me voyez pas pour me cacher où est Robert, inutile, je le sais depuis telle date. " Elle accourut, toujours aimante et dévouée. En effet, elle avait dû jurer de me cacher la situation : " surtout que Champigny ignore ".
Me connaissant, elle savait que silence pour moi égale mensonge. Je tus mes sources d’informations. Par elle je ne connus qu’un détail : le jour exact de la retraite de Robert en cet asile. Et cela me réconfortait pour toi car s’il l’avait aimée, juste ciel, il aurait pu te quitter pour elle. Non pas. Il est allé chez elle poussé par la nécessité. Uniquement.
Quand je sus qu’il avait expressément imposé que j’ignorasse son abri, je compris qu’il ne m’avait [pas] écartée de lui, laissée dans l’ombre, pauvre, pauvre Robert chéri. Qu’ainsi qu’il lui arriva de se cacher de moi une ou deux fois avant ton arrivée à Paris, lorsque ses actes, sa vie, étaient en désaccord avec sa conscience. C’est parce qu’il aurait eu honte devant moi, qu’il me laissa dans un oubli apparent. Et moi, recluse, malade et si pauvre, puisque l’on m’avait dit : " n’écrivez pas ", je gardais le silence.
Je devais faire semblant d’ignorer, pour lui, pour tous ; je le fis, sauf devant Guitte [Marguerite Thibon] qui était bien forcée de savoir tout, puisque l’autre est sa plus intime amie depuis la petite enfance. Elle me conta sa stupéfaction. Elle avait en tiers dîné plusieurs fois avec Robert et son mari. Quand, à son premier voyage, après la Libération, elle arrive à Paris, court chez son amie et trouve Robert qui connut J.V. [Jean Voilier] dans le monde. Au fond de mon cœur, je blâmais Robert.
Lui, si désintéressé, si généreux, je trouvais que c’était pousser le sens pratique fort loin qu’avoir choisi en plein écroulement de ses efforts un havre qui présentait l’avantage des plus puissantes relations parisiennes, un pied dans l’édition, etc...
J’ai souvent pensé qu’avec son goût du risque, il eût mieux fait de risquer six mois de Fresnes. Grâce à la puissance occulte de J.V. [Jean Voilier] et de ses entours, certes, son nom ne fut jamais prononcé, son dossier fut enfoui, le non-lieu décrété. Mais, dans un procès, il avait tant de chances de son côté. Il ne faisait pas de politique, il avait édité des auteurs de tous les bords et cela, bien avant 1939, même avec Le Document ses travaux mêmes plaidaient sa cause. La fatalité de son destin voulut qu’il résolut de se cacher au lieu d’admettre qu’il s’était trompé et avait perdu.
Mais personne ne me fera croire que c’est vrai, que vous étiez en instance de divorce, ou alors, c’est que tu étais consentante (5). Que Robert m’ait trahi d’amitié d’août 1944 à sa mort - mais qu’il ait vraiment résolu de se séparer de toi, je ne le puis croire. Que, par intérêt, pour se sauver, il ait forcé ce jeu avec l’autre, ce n’est pas joli... mais c’est possible. L’on peut cesser d’aimer un être, en aimer un autre. Mais je peux comprendre, j’ai assez accumulé d’âge, d’expérience, de douleurs... S’il l’avait aimée, alors il n’y avait rien d’irrévocable, il n’aurait pas eu honte devant moi ?
Cécile ma chérie, si je fais l’effort surhumain en mon état d’écrire lentement, toute une nuit, c’est que je désire t’apporter précisément cela. J’espère, je souhaite que tu sois plus au courant que moi des moindres pensées qui animaient Robert, mais, au cas où tu en saurais moins que moi, je veux te redire l’importance du soir de ta lettre (hiver 1942). Quand Robert, bouleversé, m’assurait qu’il t’aimait, qu’il ne romprait jamais son union avec toi. Or, à l’époque, tu ne souffrais pas pour rien. Il était alors poussé, enivré, dans un tourbillon de nécessités, d’ondulations. Il était amoureux. Mais il savait bien que c’était un enivrement, que ces orages s’abattent sur nous, que nous en sommes les jouets, mais que ce qui compte, c’est la vie à deux.
Vous avez eu vingt ans de compagnonnage. Il t’aimait, Cécile. La mort te l’a arraché. Atrocement, mais jamais personne ne t’avait déracinée de son cœur. Comment l’aimerais-je mieux, moi son amie fidèle, qu’en te parlant ainsi ? Comment te prouverais-je mieux la valeur d’une tendresse que tu as délibérément écartée, qu’en t’assurant bien fort de son amour ?
Ma pauvre petite fille, j’ignore tout de ta vie. Si, dans la sincérité de ton cœur, tu n’éprouves pas le désir de me parler, je pardonnerai ton silence ; j’ai l’habitude de mâcher des chagrins injustes. Si, au contraire, tu éprouvais en me lisant le désir d’évoquer les plus belles heures de ta vie, ce temps du Moulin-Vert, parle-moi, écris-moi. Si tu as besoin de calme, de répit, de silence dans un paysage dont tu connais la beauté sauvage et bénéfique, viens. Je n’ai pas honte de ma misère. Mais alors... viens vite... les commotions cérébrales de plus en plus graves, ce n’est pas possible que beaucoup d’autres crises soient supportées.
Dire que je suis là, inutile, si déchirée de douleurs et que Robert n’est plus - parle-moi de ton fils, je voudrais tout savoir de vous. Ah si seulement Billy avait pu te rejoindre. Quand j’ai su la date reculée des obsèques, j’ai pensé que c’était pour attendre Billy. Certes, je ne doute pas que tous t’auraient entourée d’affection, ta maman, la famille de Robert, mais j’ai confiance en Billy. Il était le fils spirituel de Robert, Billy, lui seul pourra t’aider à élever ton enfant. C’est un cœur capable d’amour. Il a une âme. Billy ne fera jamais rien de médiocre. Dis-moi qu’il est près de toi ou que tu vas l’avoir bientôt. Que ne puis-je te voir...
Je ne suis qu’une vieillarde usée de peine, mais j’ai cette saine gaieté des solitaires. A force de recherches, j’ai réussi à trouver le moyen de tout pardonner et admettre - Je suis sereine d’esprit autant que ravagée corporellement. Cécile, il n’y a pas de mots pour consoler. On peut seulement aimer ceux qui pleurent. Je pleure avec toi. Je l’aimais trop, il me fallait te dire qu’il t’aimait. N’en doute jamais. C’est assez de souffrir son absence, je voudrais t’embrasser, ma pauvre petite fille, embrasser ton fils.
Champigny
1. Cette lettre de sept pages dactylographiées évoque
différents événements survenus entre elle et les Denoël durant vingt ans. Je ne sais si
Cécile lui répondit - car elle avait rompu avec Champigny en 1935 -
mais elle la confia à son avocat, Me Armand Rozelaar, qui la fit
parvenir, le 26 janvier 1949, au juge Ferdinand Gollety, en raison des
précisions qu’elle apportait sur la vie de son mari.
2. On ne sait quel événement heureux eut lieu le 26 décembre 1935, peut-être la fête de Noël que Champigny aurait passée avec Robert et Cécile Denoël.
3. En mars 1936 Champigny embarqua sur le paquebot « Eridan » pour un périple de trois mois qui allait la mener de Marseille à la Nouvelle Calédonie. Sa fiche technique sur le site des Messageries maritimes précise qu'il fut lancé le 3 juin 1928 par les chantiers de La Ciotat, qu'il mesurait 142 mètres, et, qu'à partir de 1935 il assurait la liaison Marseille - Nouvelle Calédonie par le canal de Panama. Il pouvait emporter 619 passagers.
4. La courte lettre que lui envoie Denoël en septembre 1944 n'implique aucunement qu'il souhaite la défaite des Alliés : il songe à sa situation personnelle précaire et se demande quand il pourra réintégrer sa maison d'édition. Un arrêté du 20 octobre 1944 lui ôtera tout espoir de ce côté : un administrateur provisoire est nommé à sa place, rue Amélie.
5. Une procédure de divorce par consentement mutuel a bien été entamée en juin 1945.
1946
Lettre de Jean Brunel, 6 mai 1946
Je ne comprends pas comment vous avez pu penser qu'il y ait une relation quelconque entre mon silence épistolaire et les envois de fonds que j'ai pu vous faire. Vous savez que l'argent n'a pour moi de valeur qu'autant qu'il peut me permettre de vivre d'une part, et d'aider les autres à vivre d'autre part. Nous avions convenu que je vous aiderais à passer une période de six mois où vous aviez l'espoir de pouvoir travailler, c'était donc sans arrière-pensée que j'ai exécuté notre accord.
Vous aviez voulu en outre me donner une garantie, je l'ai acceptée pour ne pas vous désobliger, mais j'ai bien l'intention de n'en pas profiter et je compte vous retourner, après l'avoir annulé ou détruit, le papier que nous avions signé (1). Vous pourrez donc disposer librement de votre maison et tenter d'obtenir un prêt si vous le jugez à propos.
Vous vous imaginez bien que je ne voulais pas faire une affaire avec vous, et je suis heureux de penser que j'ai pu pendant un moment vous rendre service. Je ne vous cache pas que cela a été pour moi assez lourd et qu'il m'est impossible de continuer.
1. Il s'agit du contrat du 30 septembre 1945 (voit ci-dessus).
Lettre de Jean Brunel, 14 juin 1946
Voulez-vous trouver sous ce pli les relevés récapitulatifs de répartitions que vient de m'adresser la Société des Auteurs.
Je vous adresse, par mandat-carte séparé, la somme de 1.849,90 F que j'ai encaissée pour le compte de la succession de votre père (1).
1. René Champigny était auteur-compositeur de pièces de théâtre dès avant la Grande Guerre.
Lettre de Jean Brunel, 29 juin 1946
J'ai eu une grande joie à recevoir votre lettre du 5 à laquelle j'aurais déjà voulu répondre. Surtout ne soyez pas bouleversée. Ce que j'ai fait, j'ai pu le faire et je l'ai fait avec joie puisque je vous aidais à mieux passer des jours durs. Vous avez bien fait de me demander des précisions car je croyais vous avoir remis seulement 60.000 F et je vous ai remis 70.000 dont 10.000 à vous.
Voici d'ailleurs :
Recettes : 3-5-45 en compte 19 250
26-11-45 reçu de Mr Berne 1 000
11-6-46 reçu Soc. Auteurs 1 849, 90
___________
22.099,90
Dépenses : 21-8-45 réparation machine 557
5-9-45 envoi et frais 5 012
17-6-46 envoi et frais 1 859,90
votre compte à l'étude a en outre été débité
de frais d'envois de sommes 57
_________
7 485,90
je vous ai remis à Aurillac 10 000
_________
17.485,90
Recettes : 22 099,90
Dépenses : 17 485,90
_________
4.614
C'est la somme qui vous reste à l'étude et que je vous fais adresser lundi prochain. D'autre part je vous ai adressé en octobre, en novembre, en janvier, en février, en mars, en avril 10.000 F soit ensemble : 60.000 F.
Je vous demande de ne plus parler de dette à mon égard. L'argent est si peu et tant de choses à la fois. J'en avais assez et il est naturel que j'aie contribué à rendre meilleure votre vie puisqu'alors il vous manquait. Vous savez que je n'aime pas l'argent pour lui-même, mais pour ce que j'en peux faire et j'ai conscience d'en avoir ainsi fait bon usage. Qu'il ne soit donc plus question de cela entre nous.
Lettre de Jean Brunel, 10 août 1946
Bien reçu aussi votre lettre m'accusant réception des 4.601 F. Non, je n'ai jamais retrouvé la trace du chèque Denoël. Est-ce que « La Maison » a paru dans Quadrige ? Non, Caillard n'a rien suggéré d'indigne. Il m'a remis un peu d'argent pour vous. J'en ai ajouté.
Ceux de vos amis que Caillard aura prévenus et qui voudront le faire, pourront le faire aussi. Il n'y a là aucune obligation ni aucune dépendance puisque cela vient d'un mouvement de sympathie qui restera anonyme. J'y ai bien réfléchi. Vous pouvez accepter. Je ferai en sorte que tout soit vraiment correct et sans mal.
1947
Lettre de Jean Brunel, 1er avril 1947
Votre lettre du 27 mars adressée à Luc me parvient à Paris, que je n'ai pas quitté depuis longtemps. Depuis des semaines, depuis des mois, je dois vous écrire et chaque jour je ne puis. J'ai attendu longtemps pour des questions matérielles, celles qui concernent le peu d'argent que je vous fais parvenir chaque mois. Elles ont été très compliquées, sans véritable raison d'ailleurs. J'aurais voulu pouvoir vous donner à ce sujet des assurances et calmer les scrupules que vous m'aviez témoignés dans une précédente correspondance.
C'est très peu de chose mais les amis qui l'ont fait ont agi en toute simplicité et sans avoir été le moins du monde sollicités, vous pouvez en être sûre, sans quoi je ne me serais pas entremis, car je sais trop combien vous auriez pu en avoir de peine.
Si je quitte Paris et vais en Auvergne, ce que je ne sais encore à l'instant où je vous écris, je viendrai vous voir à Mézels ; mon séjour ne sera pas long car le temps me talonnera, mais je viendrai vous embrasser.
Me Jean Brunel [1906-1980]
1949
Lettre d'Albert Paraz à Louis-Ferdinand Céline, 30 avril 1949
J’ai reçu en même temps que la tienne une lettre d’une piquée nommée Bénédicte [sic] Champigny [...] en la lisant j’ai trouvé une coïncidence vraiment extraordinaire qui pourrait presque figurer dans un recueil métaphysique car elle me raconte exactement la même histoire Voilier et Denoël et elle me parle exactement de Barjavel. Elle me dit qu’au moment de l’élaboration d’un de tes contrats Denoël l’interrogeait sur ta santé. Il l’avait fait venir avenue Ch. Floquet pour analyser ton écriture. Elle lui a répondu : Céline vous enterrera et il avait paraît-il des cauchemars. Il se voyait assassiné en voiture mais c’est tout de même embêtant que ces histoires-là on vous les raconte plus tard tout en vous disant que cela date de 24/25/26/27 et 28 (1).
1. Denoël a habité avenue Charles Floquet entre 1933 et
1939, mais les cauchemars évoqués remontent bien à 1928, comme en témoigne le journal lorsqu'elle parle de la rue de Grenelle « où l'autre soir, sa vie a pris fin, ainsi qu'en 1928 finissaient les cauchemars qui lui donnaient la fièvre. Il luttait, se débattait, souffrait : c'était la prison. Il parvenait au réveil plutôt qu'il s'éveillait. Il ouvrait des yeux glauques,
d'agonisant, nous regardait sans nous voir, puis se resaisissait en
murmurant que c'était effroyable, que l'on tentait de l'assassiner...
Comme il menait alors une vie follement déréglée, qu'il était couvert de
dettes, ses soucis lui donnaient plus d'une hantise. Mais j'attribuais
surtout son cauchemar, toujours pareil, si épouvantables qu'en fussent
les variantes, à son goût morbide, ridicule, pour les romans policiers ».
Lettre d'André Malraux à Marcelle Doyon, 2 août 1949
Je viens de rentrer à Paris. Pendant mon absence j'avais envoyé à Champigny un camarade, qui est tombé là-bas dans les extravagances sympathiques que vous imaginez [...] Il a reçu Champigny à moitié évanouie dans ses bras, et puis elle s'est mise à lui expliquer le coup et ils sont restés 4 heures ensemble (1).
1. Lettre citée dans : André Malraux. Lettres choisies 1920-1976. Gallimard, 2012, pp. 199-200. Dans une lettre de mai 1949, la femme de René-Louis Doyon avait attiré l'attention de Malraux sur la « situation tragique » de Champigny.
* Communication de M. Claude Schvalbergh, libraire à Paris.
*

