Elsa Triolet
Née Ella Iourevna Kagan le 11 septembre 1896 à Moscou, décédée le 16 juin 1970 à Saint-Arnoult-les-Yvelines.
Cette préface à une « Vie de Michel Vignaud », du nom du héros du Cheval blanc, a été rédigée en septembre 1965 par Elsa Triolet en vue de la réédition, l’année suivante, du roman chez Robert Laffont dans la collection « Œuvres romanesques croisées d’Elsa Triolet et Aragon ». Elle fut reprise à partir de 1972 dans l’édition « Folio » du Cheval blanc. Cet hommage public à son éditeur, mort vingt ans plus tôt, est remarquable à plusieurs titres, et mérite d’être commenté.
*
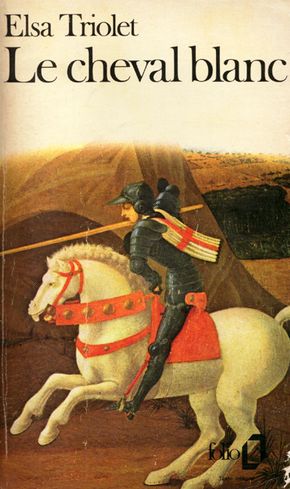
[...] La première moitié du roman était prête quand est arrivé à Nice Robert Denoël, qui avait déjà édité Bonsoir Thérèse et Mille Regrets, Les Cloches de Bâle et Les Beaux Quartiers.
Porteur de lunettes, épaules de débardeur, ce jeune Belge promettait de devenir un grand éditeur tant il avait d'intérêt, de passion pour la littérature, tant il avait le goût du risque et des affaires. Ses auteurs n'étaient ni de jeunes espoirs bien policés et sportifs ni des hommes de lettres à légion d'honneur, il se les choisissait, par goût, parmi les extravagants : Luc Dietrich, Lanza del Vasto, Louise Hervieu... et déjà c'était l'éditeur de Voyage au bout de la nuit, dont le manuscrit avait traîné dans toutes les maisons d'édition sans trouver preneur. Il est vrai qu'il a aussi fait paraître les romans suivants de Céline, sans la moindre répugnance. Ses fins de mois n'étaient jamais drôles et, pourtant, les rencontres avec lui et sa femme, Cécile, belle comme une cariatide, prenaient toujours un air de fête. Ses auteurs, il les aimait, il supportait avec curiosité et compassion les tordus, les malades, les excentriques.
En 1939, quand tu étais déjà mobilisé et que la police tournait autour de nous comme des corbeaux, quand tant d'amis et connaissances préféraient ne pas me reconnaître dans la rue, Robert Denoël venait me voir rue de la Sourdière, dans le blackout de la défense passive, et me disait : « Vous avez vraiment très envie de voir Aragon ? » J'en avais très envie, vraiment, et il m'emmenait dans sa voiture sur les routes avec leurs barrages et les gendarmes qui posaient des questions, pour te chercher à Crouy-sur-Ourcq, à Coulommiers...
En 1942, Robert Denoël apparut à Nice lors d'un voyage, si je ne me trompe, avec une amie qu'il avait emmenée au Portugal : elle était Juive, et, peut-être, Anglaise et il voulait la mettre en lieu sûr. Ce voyage était un risque dévoué, passionné.
A cette rencontre, j'ai montré à Robert Denoël la première moitié du Cheval blanc. Il n'eut qu'une peur : est-ce que la suite allait être à l'avenant ?
En septembre 1942, nous nous étions donné rendez-vous en Avignon. Je me vois à l'Hôtel de l'Europe, assez démuni à l'époque, bien que bourré d'antiquités précieuses. Notre chambre à nous ne contenait aucun beau meuble ; elle était si petite qu'il n'y avait guère que le lit pour s'asseoir. Je me vois, jambes pliées sous moi, lisant à Robert Denoël des pages du Cheval blanc, la fin. Il me dit que je n'avais pas l'air de me rendre compte combien... etc. Et moi qui ne pensais qu'à ces rumeurs sur son compte, entendues pour la première fois rue de France, dans la librairie de Pierre Abraham : l'éditeur Denoël travaille avec les Allemands. Est-ce vrai ? Oui, dit-il, c'est vrai. C'est à peine si je parviens à articuler : « Mais alors, on ne peut plus être amis !... » Et lui qui me console et me prie de ne pas dire de bêtises, ses employés doivent manger tous les jours, n'est-ce pas... Parlons du Cheval blanc !
Dans la nuit, il avait lu le manuscrit en entier. Il allait essayer de le publier sans coupures... Qu'aurait-on pu y couper ? Du point de vue allemand, c'était le tout, la chair même du livre qui aurait dû être exécutée. Mais les Allemands n'y verraient que du feu ! C'était un risque à courir.
Nous avons déjeuné dans une petite salle de l'Hôtel de l'Europe. C'était un festin, l'avenir et même le présent semblaient beaux. Dans les rues d'Avignon, sur les berges du Rhône, Robert rencontrait des personnages curieux qu'aussitôt il nous expliquait, peuplant le pays de figures fantastiques.
En ces jours de septembre 1965, comme j'écrivais cette préface, par un étrange hasard, une carte postale de Robert Denoël, du 22 septembre 1942, adressée au 16, Cité du Parc, à Nice, fit surface sur la mer des vieux papiers épars... Je ne cherchais rien, je ne savais même pas qu'elle existait, mais elle vint comme à propos de ce qui m'occupait aujourd'hui... [...]
J'avais donc fait dans Le Cheval blanc ma première tentative voyante pour me servir dans l'écriture d'un élément complexe existant, préfabriqué. Dans les lignes retrouvées, Denoël met le doigt dessus, pour me demander, il est vrai, de l'enlever, d'enlever les êtres existant réellement parmi des êtres imaginaires. Il m'écrivait : « Je reviens aux citations ou à la présentation de personnalités connues parmi les figures imaginaires. Cela tient trop peu de place dans le récit pour que celui-ci y gagne en véracité. Croyez-moi, vous ne le situez pas mieux ni dans l'espace ni dans le temps. Ou alors il faudrait recourir à cet artifice d'une façon systématique tout au long du livre. Si mes souvenirs sont exacts, il n'y a guère que la partie proprement parisienne où apparaissent des personnages comme Cocteau, Bérard, Desnos, etc. Cela donne l'impression d'un décalage un peu pénible, c'est-à-dire l'impression contraire de celle que vous recherchez. Mais tout cela n'est que vétilles et le livre me plaît merveilleusement. »
J'aurais aimé être sûre que Denoël appelât citations les personnages mêmes de Cocteau et Bérard ; ne sont-ils pas, en vérité, quelque chose que l'auteur souhaitait voir exprimé et qu'il a trouvé déjà tout exprimé, pour ainsi dire « dans le commerce » ? La citation, sous toutes ses formes, est un élément nouveau dont on peut se servir dans la création comme d'une matière première, comme des mots du dictionnaire, des couleurs sorties des tubes, des notes d'une octave. Denoël appelle encore artifice cette introduction dans le roman de personnes naturelles, justement non artificielles, mais déjà on en prend l'habitude, et les films de J.-L. Godard sont un exemple de comment on peut se servir, dans la création d'une œuvre d'art, d'éléments préfabriqués, de citations en tous genres. [...]
J'ai laissé le manuscrit du Cheval blanc à Villeneuve-lès-Avignon. Je crois bien que c'est Pierre Seghers qui l'a fait parvenir à Denoël. Je n'en suis pas sûre. Lui non plus.
Le risque de la publication, Robert Denoël l'assumait tout seul. Moi, j'étais cachée sous un faux nom, avec de faux papiers, et si jamais je me faisais prendre, Cheval blanc ou pas, mon compte était bon.
Denoël avait maintenu son point de vue : il n'y avait pas de coupures à faire, les coupures n'arrangeraient rien. Il se borna à amputer la toute dernière phrase du livre de son deuxième volet. La phrase était : Stanislas Bielenki ne reçut pas cette lettre, il y avait un an qu'il était dans le camp de concentration de Gurs où l'on ne fait pas suivre le courrier. On peut lire dans la première édition du Cheval blanc, celle de 1943 : Stanislas Bielenki ne reçut pas cette lettre. Un point, c'est tout.
Il n'y eut pas de dégâts. Quelques lettres, anonymes ou pas, adressées à Denoël, me dénonçant, moi, et l'esprit du roman. Publié à Paris, sous la censure allemande, Le Cheval blanc put pénétrer dans les bibliothèques des prisons : là on savait lire et, après la Libération, me vinrent des lettres pour m'en remercier. Et, même, un exemplaire avec le tampon de la prison. Comme je l'ai déjà dit ailleurs, en 1943 quelques voix du jury Goncourt allèrent au Cheval blanc.
Nous avons revu Robert et Cécile Denoël à un de nos voyages clandestins à Paris. Pendant quelques jours, ils nous hébergèrent chez eux, dans un bel appartement suintant le neuf, près du Champ de Mars. Nous ne savions toujours pas très bien ce que Denoël trafiquait avec les Allemands, mais, eût-il été le pire des collaborateurs que nous nous serions confiés à lui avec la même tranquillité : quoi qu'il advînt, c'était pour ses amis un homme sûr. Il semblait, malheureusement, fort prospère. Cécile sortait pour nous tout ce qu'ils avaient de plus beau : des draps fins, l'argenterie, ses talents de cuisinière. Il n'y avait pas de bonne, me semble-t-il, à cause de nous.
Nous les retrouvâmes après la Libération, cachés chez des amis, dans un petit appartement à Montmartre. Pour sa défense, Robert n'avait que la hargne : il n'en avait pas fait plus, disait-il, que les autres maisons d'édition, il servait de bouc émissaire... Peut-être, peut-être. Ah, ce petit mot qu'il me fit parvenir le jour du Prix Goncourt, en 1945, griffonné sur un bout de carte... Ne pas être à côté de moi... Tout ce que nous avons pu faire, c'est témoigner en sa faveur, par écrit, lors de son procès.
Quand on voit comment vont les choses aujourd'hui... Qu'est-ce donc qu'un collaborateur ? Tout le monde publie, est publié... Que serait-il advenu de l'éditeur Denoël s'il avait vécu ? Il a péri en plein désordre, d'une mort qui ne devait rien aux idéologies : Robert Denoël a été assassiné près des Invalides, une nuit de l'année 1945. Crime crapuleux. Sa voiture tombée en panne, Mme jean Voilier, qui était avec lui, s'en était allée au commissariat pour chercher de l'aide (c'est ainsi que les choses se passaient à cette époque). Lorsqu'elle revint, Robert gisait sur le pavé près de la voiture, le cric à la main : il était mort. On avait dû l'attaquer, et ce n'était pas un homme à se laisser faire.
Le Cheval blanc est publié et republié en éditions courantes, en Clubs divers, avec et sans illustrations, en Livres de poche. Il est périodiquement question de mettre le roman à l'écran. Je me montre exigeante : pour incarner ce jeune homme pris dans son époque, il aurait fallu un James Dean...
Septembre 1965
*
Examinons tout d’abord cette phrase, qui résume la position d'Elsa Triolet après la guerre : « il a aussi fait paraître les romans suivants de Céline, sans la moindre répugnance. » On peut supposer qu’Elsa veut parler des livres suivants, notamment ses pamphlets anticommunistes et antisémites, mais, durant huit ans, elle a pourtant publié les siens, « sans la moindre répugnance », dans la même maison.
Bonsoir Thérèse, son premier roman, que Denoël a accepté par amitié pour Aragon, est paru le 27 octobre 1938, dix mois après la publication de Bagatelles pour un massacre, et moins d’un mois avant celle de L’Ecole des cadavres.
Son deuxième livre, Mille Regrets, est sorti en mai 1942, et a été réimprimé en septembre 1943. Entre ces deux dates, sont parus le pamphlet antisémite de Lucien Rebatet, Les Décombres (juillet 1942) et une nouvelle édition de L’Ecole des cadavres (octobre 1942).
Le 29 août 1942 Le Figaro annonce, dans sa chronique « Les écrivains en vacances » qu'Elsa Triolet « est en Avignon où elle écrit un grand roman picaresque. »

Le Figaro, 15 août 1942
Le 26 septembre c'est Aragon qui écrit à René Laporte : « Elsa termine son roman, et Denoël l'a acheté ferme, ce qui nous assure le dormir et le boire jusqu'au 1er janvier 1944. Ouf... » Rien, dans le programme éditorial de l'éditeur, ne paraît alors rebuter Louis Aragon, ni Elsa Triolet, dont Le Cheval blanc paraît en juin 1943. Pourtant, le 28 septembre 1942, Elsa avait reçu de Gaston Gallimard l'offre de publier son roman... Le livre recueillit bien une voix au Goncourt 1943, mais Elsa oublie de préciser, dans sa préface, que ce prix fut attribué le 21 mars 1944.
Ce qu’elle ne manque pas de rappeler, c’est qu’elle vivait alors « cachée sous un faux nom, avec de faux papiers, et si jamais je me faisais prendre, Cheval blanc ou pas, mon compte était bon. » Depuis combien de temps se cachait-elle ainsi ?
Depuis le 21 mars 1944, précisément. Ce jour-là la Gestapo avait adressé à la police marseillaise un ordre de recherche : « Arrêtez immédiatement la juive Elsa Kagan dite Triolet, maîtresse d'un nommé Aragon également juif ». Ce n’était pas la publication du Cheval blanc qui avait provoqué cette mesure, mais plusieurs articles dithyrambiques des Lettres Françaises clandestines qui encensaient le livre : les services du Commissariat général aux Questions juives avaient lancé une enquête pour établir l'ascendance raciale de l'auteur, avant de la dénoncer aux autorités allemandes. Elsa Kagan dite Triolet aura donc vécu cachée en zone non occupée durant cinq mois.
Ce n'est pas ce qu'écrivait, en 1945, Elsa à sa sœur, Lili Brik : « Nous sommes passés dans la clandestinité le 11 novembre 1942, quand les Italiens ont occupé Nice. » L'arrivée des Italiens a, en effet, obligé le couple Aragon à quitter Nice et à se réfugier à Digne, puis, à partir du 31 décembre, à Lyon, sous un faux nom : Castex. Mais en 1943 Elsa publie sous son nom « Le Mythe de la baronne Mélanie » dans Poésie 43, la revue de Pierre Seghers, collabore au journal Les Etoiles et à la Bibliothèque Française, la maison d'édition créée par Aragon. Il s'agit d'une « semi-clandestinité ».
Le 8 août 1944, une semaine avant l’insurrection parisienne, Robert Denoël et Rémy Hétreau signent un contrat pour une édition illustrée de Mille Regrets, ce que me confirmait l’artiste : « Peu avant [le 13 novembre 1945] de disparaître, Robert Denoël est venu à mon atelier en compagnie d’Elsa Triolet de qui je devais illustrer Mille Regrets. »
Le 27 septembre 1944, un mois après quitté leur domicile, rue de Buenos-Ayres, Robert et Cécile Denoël reçoivent Aragon et Elsa chez Maurice Bruyneel, rue Pigalle à Montmartre, où ils se retrouvent chaque jour pour le déjeuner. Le 14 octobre, c'est grâce à la voiture mise par le parti communiste à la disposition d'Aragon et d'Elsa, que Cécile Denoël va retrouver son fils à Saint-Quentin-les-Anges, dans la Mayenne.
A part une querelle, le 27 octobre, chez les Bruyneel, entre Maurice Percheron et Elsa Triolet, à propos du traitement réservé aux collaborateurs prisonniers au camp de Drancy, on ne relève aucun incident entre Elsa et Denoël.
C’est à la fin du mois d’octobre 1944 qu’une rupture a lieu entre les écrivains communistes et leur éditeur, qui les a sollicités en vue de son procès en cour de justice : « Je leur ai demandé de m’aider... ils m’ont répondu : c’est impossible, on vous a supporté pendant la guerre... Vous ne pouvez pas savoir le calvaire que ce fut pour nous d’être publiés à côté de Céline et de Rebatet, dans la même maison qu’eux ». C’est ce que déclara Denoël à son amie Jeanne Loviton, qui l’a répété à Pierre Assouline.
Puisque les Aragon refusent d’aider celui qui les a hébergés et aidés financièrement durant l’Occupation, Jeanne Loviton imagine d’envoyer un commissaire de police à leur domicile, muni d’un questionnaire factuel. Les deux écrivains sont priés de répondre par oui ou par non à des questions précises concernant des sommes d’argent que Denoël leur a prêtées ou avancées durant l'Occupation.
Cette déposition écrite forcée sera produite devant la cour de justice, au cours du procès de l’éditeur, le 13 juillet 1945 : « Tout ce que nous avons pu faire, c'est témoigner en sa faveur, par écrit, lors de son procès », écrit-elle piteusement. On y a aussi appris que Denoël avait mis en lieu sûr, dès l’automne 1944, le manuscrit du recueil de nouvelles Le premier accroc coûte deux cents francs, qu'il a publié en mars 1945, et qui a obtenu, le 2 juillet 1945, le prix Goncourt 1944.
En dépit de leurs divergences politiques, Denoël et Elsa sont donc toujours restés en contacts éditoriaux sinon amicaux. En mars 1945 Elsa dédicace son livre « A Cécile, comme toujours ». Le soir de l’assassinat de son mari, Cécile Denoël ne prévient par téléphone que quatre personnes, dont le ménage Aragon-Triolet : « A l’annonce de la nouvelle, Elsa Triolet fondit en larmes. Je lui dis que l’on pensait qu’il s’agissait d’un crime crapuleux, mais que, personnellement, je n’en croyais rien et elle me déclara : " Ne croyez pas, en tous cas, que ce soit un crime politique. " » [Lettre de Cécile Denoël au juge Gollety, 8 janvier 1950].
On a reproché à Robert Denoël sa politique éditoriale qui avait consisté à publier des livres et des écrivains de tous bords afin de se ménager une nouvelle carrière après la guerre. C'est une politique qu'il avait, en réalité, initiée dès 1934, alors que la gauche et la droite se déchiraient en France. Le pour et le contre, telle était sa devise. Peut-être n'avait-il pas mesuré ce qu'elle impliquerait, dix ans plus tard.
Jeanne Loviton, elle, avait parfaitement compris le double jeu de ce couple bassement stalinien qui, à ses yeux, avait cyniquement renié ses relations privilégiées avec son amant assassiné. Lorsqu'elle reçut en lecture L'Inspecteur des ruines en 1948, elle renvoya à l'auteur son manuscrit sans l'avoir lu : « La seule fois qu'on m'a refusé un manuscrit, de toute ma carrière littéraire », écrivit Elsa Triolet.
