Dominique Rolin
Née à Bruxelles le 22 mai 1913 et décédée à Paris le 15 mai 2012. Elle a épousé en 1937 le poète liégeois Hubert Mottart [1910-1984] avec qui elle habite avenue du Cor de Chasse, à Boitsfort.
Son premier roman, Les Marais, est paru tout d'abord en feuilleton [du 15 décembre 1940 au 16 février 1941] dans l'hebdomadaire bruxellois Cassandre. C'est son directeur, Paul Colin, qui, sur la recommandation de Robert Poulet, transmet le manuscrit à Denoël, lequel l'accepte d'enthousiasme.
Dominique Rolin rencontre Denoël rue Amélie au début de juin 1942. Le livre est présenté à la presse le 12, à la Brasserie Lipp. Le succès est éclatant, la presse s'enflamme, le roman est proposé pour des prix littéraires. Entretemps une idylle s'est nouée entre l'auteur et son éditeur.
Dominique Rolin a transposé cette relation amoureuse dans Le Jardin d'agrément, un roman paru en 1994 chez Gallimard, dont on a extrait les passages les plus significatifs.
*
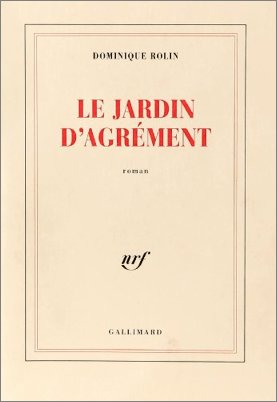
À Paris, le bureau de l'éditeur qui m'a fixé rendez-vous pour la première fois me déçoit. La pièce est exiguë, mal éclairée, meublée sommairement, encombrée de livres. Rien à voir avec la magnificence rêvée qui m'a portée jusque-là. Tant pis, il faut se faire une raison. J'ai mis mon chemisier de shantung bleu vif, un chapeau de paille noire plutôt ridicule sous son coussin de fleurs jaunes et roses. Tant pis, tant pis. H.H. [Hubert Mottart] s'est assis très près de moi, ivre déjà, aux aguets. L'inquiétude qui le brûle est le contrepoint de l'ébranlement joyeux qui me saisit à l'instant, à la minute, à la seconde, l'interseconde devrais-je dire, lorsque l'homme souriant glisse vers moi un volume tout plat, presque un peu mesquin sous sa couverture jaunâtre à mince filet rouge. Quelle surprise! Un livre, ça ? Mon livre, ça ? C'est-à-dire le livre où mon nom s'imprime, comme détaché de mon moi ordinaire pour en extraire un autre, aussi surprenant que suspect, avec lequel il va me falloir composer désormais ?
L'homme décontracté qui me fait face a beau me certifier que je suis l'auteur de ce nouveau moi, j'ai peine à le croire. Pourtant très vite je le crois. Il faut d'ailleurs que je le croie. Je sais qu'il est ma dernière chance de salut. L'homme en question est d'une taille impressionnante. Son regard brouillé de myope m'observe derrière des lunettes à monture d'écaille. Il a l'ampleur à peine voûtée d'un chef. Jusqu'ici je n'ai jamais rencontré de chef. Mais attention ! Il s'agit d'un chef doux, attentif. Ses nombreux pouvoirs lui donnent le droit d'être heureux et communicatif. Il me les offre d'emblée comme s'il avait confiance en moi sans avoir besoin de me connaître. Et je les prends, ces pouvoirs. Je pressens qu'ils vont m'ouvrir une voie de libération jugée jusqu'alors improbable, impossible. Après une semaine d'éternités toutes plus saisissantes les unes que les autres, la femme dont le nom figure en caractères imprimés sur le petit volume jaune rentre à Bruxelles : elle n'a plus rien de commun avec sa doublure exténuée qui attendait son retour là-bas, tassée dans l'enfer d'une réalité repoussante.
L'homme de Paris a déjà cessé d'être un éditeur pour se transformer en homme tout court. Il m'écrit. Il est amoureux, dit-il entre autres choses. Il a l'intention de venir me voir dès que possible. Les journaux parlent de mon roman. Il faut que je me remette tout de suite au travail, assure-t-il aussi. Son écriture bien ronde et concentrée, que barbouillent les pinceaux bleus de la censure, m'apporte la gaieté et, par-dessus tout, d'incroyables réserves de confiance. J'en ai besoin si je veux survivre à la pourrissante obscurité qui m'étouffe. [...] « Tu dois le quitter », m'écrit l'homme de Paris. [...]
« Tu n'auras jamais le courage de le quitter, mon petit », répète l'homme fort et bon sur un ton de tendre dédain alors que nous déjeunons sous les arbres du bois de la Cambre au bord de la pelouse des Anglais. Je le scrute avec une acuité d'insecte agonisant. Son scepticisme a le don d'exciter les richesses de ma curiosité. Richesses qu'on ne peut découvrir qu'une fois franchi le gouffre de la dégradation.
Au printemps de l'année suivante, se met à vibrer le point d'orgue de l'horreur. Je suis obligée de me débarrasser d'un pauvre petit fœtus. Sans l'intervention d'un médecin marron, il aurait dû devenir mon bébé et celui de l'homme de Paris. Je frôle la mort par hémorragie. Seule conséquence avantageuse de cet incident mineur il me permet d'évaluer au plus juste, non sans un certain génie prophétique, mais oui ! - mes impasses et mes chances. La série des maisons de famille où la vie m'a casée jusqu'alors n'a été qu'un recueil d'écrans de passage, y compris l'avenue du Cor-de-Chasse où mes nerfs achèvent de craquer. [...]
Le creusement quotidien de mes humiliations est comme soutenu par un sentiment jubilatoire. Si mes rencontres avec l'homme de Paris sont plutôt rares, elles ont du moins une magique efficacité. Quand il me reproche avec un air de détachement rieur ma lâcheté et mon manque d'ambition, je me borne à hausser les épaules. Impossible d'expliquer à cet homme que je suis obligée de cacher les mots fin et mort. Ces termes ne figurent pas dans le dictionnaire que nous devons tous feuilleter heure après heure, qu'il le faille ou non. Ne sommes-nous pas condamnés à l'étouffement au fond d'une marmite à couvercle de plomb ? [...] « Oh, mon enfance, me dis-je, oh le bois de la Cambre, oh Domi poursuivie par Freddy et Victor Hugo » et je fixe droit dans les yeux l'homme de Paris si grand, solide et beau, sûr de lui, et qui croit m'aimer. L'heure sonnera où je pourrai rejoindre ce moi-moi mourant. Nous serons capables alors de dresser le plan d'un jardin d'agrément extraordinaire.
Mon plan ? Il suffit d'attendre puisque la guerre est sur le point de finir. L'éditeur a quitté Paris. Ses lettres s'espacent avant de s'interrompre. [...] Enfin l'homme de Paris m'adresse un mot lapidaire : il me fixe un rendez-vous en septembre chez un de ses amis. Et c'est là qu'il m'annonce avec douceur et fermeté que sa vie a changé: il a rencontré une femme très belle, très puissante et très riche. Je m'effondre à ses genoux. Il me caresse les cheveux pour me rassurer, il continuera à m'aider dans mon travail. « N'aie pas peur, mon petit, je serai là, je te conseillerai, je publierai tes livres, tu connaîtras la gloire, tu seras entourée d'une cour d'admirateurs... » Je souffre. Soyons honnête : je ne souffrirai pas longtemps.
Un soir de décembre de la même année, l'homme de Paris est abattu par des inconnus dans le quartier désert des Invalides. Pourquoi ? Mille suppositions sont émises à mots couverts. Je me rends là-bas pour assister à l'enterrement. La foule est figée par un froid glacial. Le cercueil descend en grinçant au fond de la fosse. Le spectacle est non seulement passionnant mais crucial. Voici le moment venu de prouver à ce cadavre qu'il a sous-estimé la survivante que j'ai décidé d'être. Elle vibre des pieds à la tête, la survivante ! Un serment solennel lui part de la gorge et lui monte au cerveau, comme incendié soudain par un violent alcool. Je choisis une date précise illuminant la courbure interne de mon os frontal. C'est là que vient de se graver le sigle veiné de mon avenir immédiat. Je te le jure, homme mort, je te le jure.
Est-ce que tu m'entends, homme mort ? Bien sûr que je t'entends. Je quitterai mon doux et terrible pays de naissance. Je saurai m'accoucher sans l'assistance de qui que ce soit. Je serai ma propre sage-femme. C'est elle qui coupera le cordon ombilical. Tu m'écoutes toujours ? Je t'écoute. Je cadenasserai les lieux d'hier. J'ouvrirai ceux de demain. Toi qui m'as sauvée, tu n'es plus qu'un déchet planté dans ton trou, tu le sais, n'est-ce pas ? Oui, je sais. Voilà ce qui te reste à faire : contrôler les défaillances de mon audace ou de ma volonté. Tu vas voir, mon vieux. Tu vois. Oui, je vois, fait-il sous la terre. Je bouge ! Je bouge ! Mes lèvres ont sûrement articulé ces choses tout en les rêvant à moitié. [...]
Je ris de nouveau, je mange, et dors, continue à piquer des fleurs dans mes cheveux tout comme si l'homme assassiné depuis un an m'attendait quelque part. Nous nous assoirons dans notre café habituel du quartier des Invalides. Il prendra mes mains entre les siennes. Il inclinera au-dessus de la table ses larges épaules. Il aura son visage sérieux, un peu amer, pour me dire : « Tu peux compter sur moi », sur un ton de tendre et gaie insolence. Ce que l'homme assassiné ignore cependant, c'est que je déteste à mort les morts. Je les considère tous, sans distinction, comme des bandits de grands chemins, des voleurs à l'arraché, des traîtres, des brigands. Alourdis par le riche butin de leurs souvenirs, ils ont le talent de les caler au fond de leur pourrissant tombeau.
Mon devoir strict de vivant sera donc de tuer les morts jusqu'à ce que mort s'ensuive, ce qui n'est pas aussi simple qu'on croit. Au lieu de commettre des crimes, j'accomplirai là des actes de haute justice. Les morts enfin morts seront obligés de me rendre, rubis sur l'ongle, tout ce qu'ils m'ont arraché. Ils se sentiront humiliés jusqu'aux os, et même jusqu'aux os de leurs os. Ils finiront par se prosterner devant moi. Ils ressembleront à de squelettiques rois mages m'apportant avec respect leurs plateaux d'offrandes coûteuses. Tel est mon fantasme chaque soir avant de m'endormir. « Cher mort, dis-je alors à l'homme enseveli à qui j'ai dû d'être sauvée, je te laisse le reste, tu peux tout garder à présent. J'ai cessé d'avoir besoin de toi. »
*
Dominique Rolin avait déjà eu l'occasion de parler de Robert Denoël au cours d'une émission radiophonique réalisée par Jean Montalbetti sur France Culture, le 4 juillet 1980 : « D'un Céline l'autre : A Paris et à Copenhague ». Ses propos anodins, mal assurés et par moments inaudibles, n'ont d'autre mérite que celui d'un témoignage un peu convenu.
Jean Montalbetti : Dominique Rolin, vous avez publié votre premier roman Les Marais en 1942 chez Robert Denoël, et vous avez été lié avec lui de 1942 à sa mort, dans des conditions assez tragiques, en 1945. Mort tragique d'ailleurs que l'on voit apparaître dans les livres de l'après-guerre de Céline. Quelle place occupait Céline dans cette petite maison d'édition, entre la publication du Voyage en 1932 et la période où vous êtes entrée vous-même aux Editions Denoël, dix ans plus tard ?
Dominique Rolin : Robert Denoël appartenait à une race d'éditeurs qui, je crois, a tendance plutôt à disparaître aujourd'hui. Il avait une sorte de flair extraordinaire. C'est lui qui a publié les premiers textes d'Artaud, de Nathalie Sarraute, et le grand coup ça a été évidemment Céline. Il avait pour Céline une admiration... et je sentais dans ses propos une affection, une tendresse énormes. Il m'avait raconté qu'un beau jour avait échoué sur son bureau un paquet incroyable, avec un papier d'emballage complètement démoli, contenant, sans un mot d'introduction, le manuscrit de Voyage au bout de la nuit...
JM : ...Qui était arrivé probablement dans d'autres maisons d'édition auparavant...
DR : ...Qui avait été refusé dans toutes les maisons d'édition importantes, y compris Gallimard, ce qui montre que le temps a de l'humour.
JM : Quelle était la personnalité de Robert Denoël ?
DR : Denoël était un être extraordinairement sensible... je ne pourrais pas dire poétique, mais il était rêveur... Je crois qu'il avait laissé le souvenir de quelqu'un de rêveur... pariant le tout pour le tout... Il était d'un enthousiasme étonnant... Il est mort jeune, à 43 ans, de sorte qu'il était d'une jeunesse inouïe, et il donnait au contraire l'impression d'une grande maturité, d'un grand équilibre. C'était une sorte d'athlète qui aurait dû vivre jusqu'à 80 ans, s'il n'avait pas été abattu.
JM : Il était très nettement le cadet des grands éditeurs de cette période, c'est-à-dire Gaston Gallimard et Bernard Grasset...
DM : Oui, il avait commencé vers les années Trente, il avait à ce moment-là à peine trente ans...
JM : Denoël vous a fait rencontrer Céline ?
DM : Non, mais il voulait le faire. Chaque fois que je voyais Robert Denoël... c'était rare, puisque c'était la pleine guerre : il était difficile pour moi, vivant à Bruxelles, de venir à Paris, ou lui de venir à Bruxelles. Il fallait un laissez-passer délivré par les Allemands et le voyage en train durait dix à douze heures avec des arrêts en pleine campagne... Chaque fois, il me disait : je voudrais vous faire rencontrer Céline, qui est un être éblouissant. Quand on est en face de Céline, le mieux qu'on ait à faire, quand il y a un groupe de gens autour de lui, c'est de se taire et l'écouter. Il parlait comme il écrit. Il a réussi à faire passer dans sa littérature - c'est quelque chose d'extraordinairement rare - à la fois du parlé qui serait écrit. Il y a une frappe dans l'écriture, une sorte de sceau d'écriture étonnament gravé et en même temps la fluidité du discours. C'est rarissime. Le point faible et terrible de Céline est son antisémitisme... dans Les Beaux Draps par exemple, en 1941... Cet antisémitisme était une chose épouvantable à l'époque et vraiment intolérable...
JM : Est-ce que Robert Denoël était, d'une certaine façon, un peu gêné par un antisémitisme aussi outrancier ?
DM : Oui, je crois... d'après mes souvenirs, Robert Denoël n'était pas du tout antisémite... Il reconnaissait le génie extraordinaire de Céline et il l'admettait en bloc, mais non sans pouvoir raisonner la part de passion antisémite de l'écrivain, qui faisait partie de ses autres passions...
JM : Il n'a jamais envisagé de refuser la publication de ses pamphlets ?
DM : Non, certainement pas.
