Albert Morys
Né Maurice Bruyneel à Paris le 24 mai 1915, décédé à Antibes le 24 janvier 1989. Comédien dès 1932 sous le pseudonyme d'Albert Morys. Rencontre le couple Denoël en 1936 et ne le quitte plus. Epouse Cécile Brusson, la veuve de Robert Denoël, le 10 janvier 1951.
J'ai une dette envers cet homme qui, toujours, a choisi de rester en retrait des événements dont il était le témoin. Albert Morys fut, durant huit ans, mon principal informateur et il mit ses archives à ma disposition : elles m'ont permis de constituer une part essentielle de ce site.
Je lui devais donc une notice biographique mais elle fut longue à établir car, même dans ses mémoires : « Cécile ou Une vie toute simple », qu'il acheva le 19 septembre 1982, il mit en avant les deux amours de sa vie : Cécile Brusson et Robert Denoël, et ne consentit à parler de lui qu'à propos de deux événements marquants.
Le premier remonte à janvier 1940. Il avait été engagé pour tourner dans un film d’Alexandre Ryder : « Après Mein Kampf, mes crimes », où il devait tenir le rôle de Hitler jeune. Ce film où Alain Cuny faisait ses débuts, alternant documents originaux et scènes de fiction, sortit dans les salles parisiennes le 17 mars 1940, avant d’être saisi, trois mois plus tard.
Morys s’en explique : « Un producteur m'avait demandé pour tourner un film de propagande anti-nazi au titre significatif : « Après Mein Kampf... mes crimes ». Pour quel rôle ? Celui d'Hitler, pas moins ! Au moment de l'avancée fulgurante des armées allemandes, fin mai 1940, d'immenses affiches couvraient les murs de la capitale et de sa banlieue où, sous le titre, on pouvait admirer le visage de l'homme à la mèche et à la petite moustache. » Ce rôle compromettant allait lui valoir quelques difficultés pour obtenir sa carte de comédien durant l’Occupation.
Le film subit la critique de Lucien Rebatet qui, dans Les Tribus du cinéma et du théâtre, paru en avril 1941, écrivait : « Les Juifs combattaient valeureusement dans les " tranchées du moral ", en fabriquant pour commencer " Après Mein Kampf, mes crimes ", grossier montage qui prétendait être une biographie de Hitler, avec l'éminente collaboration du Cardinal Verdier, lequel s'y produisait dans un sketche-sermon pieusement antiraciste. » [« Le cinéma juif fait la guerre », p. 48].
En réalité la critique fut mauvaise partout. Dans Marianne Senterre écrivait :

Marianne, 27 mars 1940
Il s'agissait bien, en effet, d'un film de commande. Dans l'article ci-dessous Didier Daix écrivait que Jacques Haïk venait de mettre en chantier, « sous le patronage du haut commissariat à la propagande », un film dont 60 % seraient empruntés aux « actualités ». Le scénario dû à José Lacaze prévoyait qu'à aucun moment le personnage central ne serait confié à l'interprétation d'un comédien. Sans doute le metteur en scène n'avait-il pas trouvé d'images d'archives pour la période 1920-1930, et c'est la raison pour laquelle Morys endossa le rôle compromettant de « Hitler jeune ».

L'Intransigeant, 26 décembre 1939
Le cardinal Verdier avait accepté d'y apparaître à la fin de la projection et de prononcer une sorte d'homélie anti-raciste et anti-nazie. Le plus curieux est que Rebatet écrivit sa diatribe contre le film dans un pamphlet paru aux Nouvelles Editions Françaises, maison d'édition créée en novembre 1940 par Robert Denoël, dont le « secrétaire général » était Maurice Bruyneel, c'est-à-dire... Albert Morys.
Le film fut projeté dans une première salle parisienne, celle de « L'Olympia », à partir du 16 mars 1940. René Manevy en fit un compte rendu élogieux dans Le Petit Parisien du 28 mars et conclut qu'il méritait la plus large diffusion. Deux jours plus tard il quittait l'affiche au profit des « Conquérants », un film d'aventures de Michael Curtiz.
Il reparaît néanmoins le 4 avril au « Moulin Rouge » jusqu'au 24. Le « Péreire » le propose du 24 au 30 avril. A partir du 3 mai c'est le « Parisiana » qui l'affiche jusqu'au 7. Lorsque Morys écrit que, fin mai 1940, des affiches couvraient les murs de Paris, il s'agit d'affiches anciennes car le film, lui, avait cessé d'être proposé au public depuis le 8 mai, et la plupart des salles de cinéma avaient fermé leurs portes.

Le Petit Parisien, 16 mars 1940
En 1945 le producteur Jacques Haïk en fit un montage à partir des éléments sauvés. En 2002 les Films Régent ont réalisé un DVD présentant la version intégrale de 1939, ainsi que la fin de la version de 1945.
La filmographie d'Albert Morys ne se reconstitue pas aisément car la plupart de ses rôles à l'écran furent modestes :
En 1937, il est figurant dans Café Métropole, un film d'Edward Griffith, avec Tyrone Power.
En 1939, il est figurant dans le film de Leonid Moguy : Le Déserteur, rebaptisé par la Censure : Je t'attendrai, avec Corinne Luchaire et Jean-Pierre Aumont.
En 1942, il est figurant dans Haut-le-Vent de Jacques de Baroncelli, dont Paul Vialar a écrit les dialogues.
En 1943, il est « Un malade » dans La Valse blanche de Jean Stelli, et il est figurant (« une espèce de docteur Knock ») dans La Collection Ménard de Bernard Roland, avec Robert Le Vigan.

Ciné-Mondial, 23 juillet 1943
En 1944, il est « François » dans L'Ange de la nuit d'André Berthomieu (tourné en 1942), avec Jean-Louis Barrault, Henri Vidal, et deux débutants : Marcel Mouloudji et Simone Signoret. Il est figurant dans Le Carrefour des enfants perdus, un film de Léo Joannon.
En 1945, il est encore figurant dans Le Jugement dernier de René Chanas, avec Jean Desailly.
C'est donc au théâtre, où il débuta en 1936, qu'il s'est le mieux distingué mais, là encore, ses mémoires sont muets et je n'ai retrouvé sa trace sur les planches qu'épisodiquement.
En décembre 1937 il participait, avec son ami Claude Caillard, à une pièce d'Emmy Guittès : « Les cinq vierges du palais enchanté ».
En 1939 il jouait « Un homme ivre » dans « Un ennemi du peuple », une pièce de Henrik Ibsen adaptée par Georges Pitoëff et créée le 18 mai au Théâtre des Mathurins.
En 1940 il apparaît dans « La Dame aux camélias », une pièce jouée du 2 au 4 mars au Théâtre des Célestins, à Lyon.
Le 23 avril 1943, il eut droit à la 4e de couverture de l'hebdomadaire Ciné-Mondial pour un rôle de fou qu'il venait de créer au Théâtre de l'Œuvre dans « La Folle d'amour » de Jacques Seguin.


Le Matin, 22 juillet 1944
L'article de Ciné-Mondial reproduit plus haut indique qu'il incarnait « un paysan rude et farouche » dans « Le Pain de notre vie » de Jacques Zanuso. C'est une pièce qui fut jouée au Théâtre de l'Œuvre du 1er juin au 11 juillet 1943.
Dans son livre de souvenirs il mentionne furtivement deux pièces auxquelles il participa : « Orphée ou la peur des miracles » de Gabriel Arout dont la première eut lieu en septembre 1943 et qui fut, écrit-il, « un four complet ».
Au cours de l'année 1944 on put voir Morys dans différents rôles qui furent appréciés : Le chroniqueur du Matin rappelait, en avril, plusieurs pièces où il avait brillé :

Le Matin, 29 avril 1944
Morys dit encore avoir repris en juillet 1944 le rôle de Rellys dans « Trois douzaines de roses rouges », une pièce d'Aldo de Benedetti créée en février 1944 au Théâtre des Nouveautés, avec Jacqueline Delubac et Henri Guisol - ce qui est confirmé par l'écho paru le 22 juillet 1944 dans Le Matin.
En avril 1945 il tenait un rôle dans « Les Hauts de Hurlevent » au Théâtre Hébertot.
Comme il l'écrit ci-dessous, Albert Morys a donc bien abandonné en avril 1945 le cinéma et le théâtre (qui était la passion de sa vie) pour se consacrer à l'entreprise éphémère des Editions de la Tour où il servit de paravent à Robert Denoël, puis aux Editions du Feu Follet où il remplit le même office pour son père commanditaire, puis enfin aux Editions de la Plaque Tournante où il ne possédait aucune part mais où il prit sur lui l'essentiel du travail.
Morys s'est aussi essayé à l'écriture. En 1942 il a publié : Le Théâtre pour les jeunes. Analyse de 60 pièces pouvant être jouées par et pour des jeunes, une brochure autographiée de 32 pages éditée par un Service de documentation du Secrétariat général de la jeunesse. En 1957 il a édité à ses frais Le Bréviaire du bonheur, un volume de 128 pages qui fut réimprimé en 1961 par un « Happy Life Institute » domicilié chez lui, à Mandelieu.
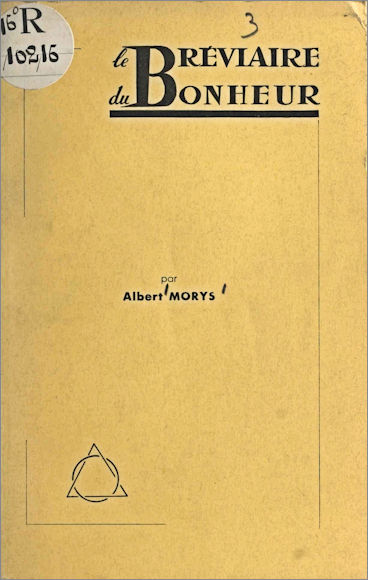
A la fin de sa vie il entreprit de rédiger ses mémoires qu'il intitula « Cécile ou une vie toute simple ». Le titre même montre que c'est bien la vie mouvementée de sa femme qu'il voulait retracer, et celle de son premier mari, Robert Denoël.
Le second événement marquant dont il accepta de parler, avec beaucoup de réticences, concernait sa courte vie d'éditeur, à l'enseigne des Editions du Feu Follet : je l'ai retracée ailleurs sous le titre « L'affaire Anta Grey ».
Son récit, très sincère, est dédié à « ses poussins », c'est-à-dire aux petits-fils de Robert Denoël, qui, pas plus que leur père, ne paraissent s'être passionnés pour l'aventure éditoriale de leur grand-père.
Il m'avait demandé de proposer son manuscrit à des éditeurs, me sachant lié avec certains d'entre eux, mais ce texte, trop familier, ne pouvait les intéresser. Il eût fallu tout réécrire sur le mode commercial ou, à tout le moins, dans un style plus distancié, ce à quoi il se refusait.
Son témoignage est donc resté inédit, et je le publie, selon la formule consacrée, à mes risques et périls, car j'ignore si Albert Morys avait des ayants droit. Son tapuscrit représente quelque 350 pages in-4 dactylographiées, dont j'ai extrait l'essentiel.
*
« Cécile ou Une vie tout simple »
En guise de prologue
Mardi 22 Janvier 1980.
Cécile est repartie près de la Vierge Noire à laquelle sa Maman l'avait vouée lors de sa naissance. Il y a soixante-treize ans de cela ; soixante-treize ans et quatre mois. Mais qu'importent les années ! Son cœur était... son cœur est plus jeune et pur que celui de bien des enfants. Je dis bien « est » car pour moi, elle est et restera toujours vivante. Le corps qu'elle a quitté avant-hier ressemble à un mannequin de cire du Musée Grévin, parfait par la ressemblance mais d'où tous ces petits sillons, creusés par les années, donnent tant de vie à ce visage aimé, ont disparu comme par miracle. Ce corps n'est plus elle et, si ce n'était la peine des siens et ma terrible solitude, son âme sourirait certainement demain lorsque l'on descendra dans la terre cette « chose » qui l'a tant fait souffrir.
Mercredi 23 Janvier 1980.
Le corps sans vie de ma femme bien-aimée devait être mis en terre ce matin. Mais décidément, rien ne sera jamais simple dans sa vie ni le début de l'autre. [...] Tout semblait normal jusqu'à hier après-midi lorsqu'un coup de téléphone de la maison Roblot nous fait savoir que l’on ne peut creuser : la roche s'y oppose. Pas question d'utiliser un marteau-piqueur ou la dynamite ! Robert (son fils) court à la mairie pour avoir immédiatement une autre concession ; le préposé n'était pas là et, sans lui, rien ne peut se faire. [...]
Jeudi 24 Janvier 1980.
C'est donc ce matin que le corps de ma femme bien-aimée est retourné en terre [...] en attendant la tombe aussi simple qu'elle le souhaitait. Usée par la souffrance physique depuis bien des années, par la souffrance morale aussi qu'elle ne méritait pas, Cécile Robert-Denoël, ma femme, a fini de souffrir en ce monde. Son corps est retourné à la terre, son esprit est auprès de nous et son âme a commencé un long cheminement dont nous ignorons le trajet. Tâchons à ne pas la pleurer, cela est difficile. [...]
Jusqu'à la fin elle aura pensé aux autres en s'oubliant elle-même : « Que l'on ne dérange personne surtout, je vous en prie. » Certains, sans doute, pourront mal traduire sa pensée et seront choqués par cette atteinte à la sacro-sainte Tradition dont elle voulait éviter les fatigues et les émotions exacerbées à ceux qu'elle aime. C'est-à-dire à tous.
Dimanche 3 Février 1980.
Deux semaines déjà ! Oui, déjà et pourtant il me semble qu'il y a des mois, des années que je ne la vois plus qu'en photo et dans mon cœur. Je la sens sans cesse auprès de moi ; elle me donne du courage. Beaucoup.
Depuis vingt-quatre ans, lorsqu'en 1956 les médecins disaient qu'il ne lui restait que quelques mois à vivre, six tout au plus, nous nous étions retirés du monde, revenant vers le soleil pour y attendre la mort, donnant une grande partie de notre temps à la méditation. [...] Puis le miracle vint.
Mais il fallut qu'un jour de jeunes littérateurs découvrent notre retraite. Depuis, sans cesse, on lui écrit, on vient la visiter pour des questions sur Artaud, sur Céline, sur tant d'autres... On vient de Paris, d'Allemagne, de Belgique et même d'Amérique pour la voir. « Ils me prennent pour un monument historique ! » disait-elle en riant ; mais elle est heureuse de pouvoir encore être utile a ces jeunes intelligences.
Eh oui ! c'est un monument historique ! Qui mieux qu'elle pourrait témoigner sur les génies de notre siècle ? Elle a connu tout ce qui, de 1927 a 1956, a compté dans les Arts et les Lettres.
« Lorsque je serai morte, me dit-elle un matin, tu seras mon historiographe. » - « Mais nous mourrons ensemble, mon Amour. » - « Qui sait ? Ce serait trop beau ! » Cela aurait été trop merveilleux.
Il me faut donc tenter de faire selon sa volonté, en prenant comme point de départ quelques feuillets écrits vers 1978 que Cécile avait lus et approuvés avec un sourire adorable bien que sa modestie y fut un peu malmenée.
Comme une importante partie de sa vie ne peut être dissociée de celle de Robert et de leur entourage, ils trouveront leur place dans ces pages et, chaque fois que cela me semblera utile, je ferai appel à eux en citant tel de leurs écrits.
N'ayant point d'autres documents que quelques lettres, quelques notes de Cécile, des livres et ma mémoire, il m'arrivera certainement d'écorcher certains noms, d'altérer une date ; que l'on ne m'en veuille pas, cela est secondaire ; l'important est de révéler Cécile, ou plutôt Cès comme l'appelaient ses intimes, telle qu'elle est, telle que nous l'aimons avec ses qualités et ses défauts : un être humain, mais de quelle qualité !...
Depuis longtemps Cécile avait pardonné a ceux dont l'attitude ou les actions, après la mort de son mari, avaient été lâches, cupides ou bêtes. Au cours des neuf derniers jours de son séjour terrestre, son pardon fut total : aussi bien pour ceux qui avaient tenté de la tuer ou d'enlever son fils que pour ceux qui ont assassiné Robert Denoël.
Je parlerai donc aussi peu que possible du meurtre ainsi que des événements concomitants et ne citerai aucun nom à ce sujet, me bornant parfois a rétablir des vérités que certaines campagnes d'intoxication ont voulu travestir.
*
Ma femme est un drôle de bonhomme ! Tout le monde croit la connaître, mais chacun ne voit d'elle que l'une des faces d'un personnage multiple. Oh ! je ne parle pas de comportement ou de caractère, cette multiplicité ne la distinguerait guère, si tel était le cas, de bien des autres êtres et tout particulièrement des femmes, mais de sa vie proprement dite, de son aventure vécue pour user d'une expression qui fait fortune en ce moment mais qui, dans son cas, est réellement exacte.
Elle se déboutonne difficilement. Rentrée dans sa coquille, il faut vraiment qu'elle connaisse bien les gens et les aime pour accepter de parler d'elle-même, « un sujet sans le moindre intérêt », dit-elle. Alors, elle conte avec saveur, souvent avec humour, un passage de sa vie, une anecdote, et cela déconcerte encore plus son interlocuteur. Selon le jour, elle parlera des banquistes du cirque Haigenberk [sic pour : Hagenbeck ] ou du roi Albert 1er et de ses enfants auxquels elle distribuait des caramels, de ses voyages sur les chasse-pierres à l'avant des locomotives ou des petits coucous de l'époque où les avions de la ligne régulière ne transportaient parfois que deux ou trois passagers de Paris à Nice ou plus exactement à Mandelieu, seul aéroport de la Côte d'Azur. Elle parlera avec amour de ses chiens et de ses panthères, ou bien (avec beaucoup moins d'amour !) du Tout Paris tellement plus féroce. Ses amis sont légion et cela va de Picasso à Marcel Cerdan, d'Aragon au Pape Pie XI, d'El Glaoui à Jean Rostand, de Stravinsky à Antonin Artaud, de Jean Cocteau au dernier joueur d'orgue de Barbarie de la capitale.
Mais ne cherchez pas a connaître le secret de sa naissance, vous vous y perdriez, ni même de savoir de quel pays elle est exactement, vous auriez la choix entre une demi-douzaine. Et pourtant elle est chauvine comme il n'est pas possible ! mais on ne sait jamais à l'avance si ce sera au sujet d'une ville ou d'un pays. Ce peut être aussi bien de la Camargue que de Liège ou de Concarneau, du Cap de Bonne-Espérance ou de Saint-Paul-de-Vence ; mais ce sera bien plus souvent de Paris.
Paris. Ah ! Paris ! Quand on prononce ce nom magique devant elle, et plus encore lorsqu'elle le prononce elle-même, ses yeux brillent un peu plus et peut-être sont-ils tout à coup légèrement humides, teintés des regrets d'avoir dû le quitter.
*
Paris ! Lorsque Paris a fait sa connaissance, elle venait tout juste d'atteindre sa majorité pour s'y envoler avec l'homme qu'elle aimait, l'homme de sa vie, celui que le Ciel, en une fraction de seconde, lui avait désigné deux ans auparavant comme l'élu de son cœur et de sa destinée. Et quelle destinée !
Majeure, elle l'était tout juste et semblait encore une enfant aux candides yeux dont le vert semblable à celui de la mer, était aussi changeant qu'elle, et aux cheveux de cuivre flamboyants, mais plaqués et coupés à la Joséphine Baker, l'idole d'alors.
Aujourd'hui, plus d'un demi-siècle a passé et, si la neige de ces derniers hivers a blanchi ses cheveux, adoucissant encore son visage adorable, son regard est toujours le même bien que la mer y soit plus calme et que son sourire flotte sur une tendre philosophie que seules les années peuvent mûrir. Son visage au teint d'abricot, halé par le soleil, resplendissait déjà de joie de vivre; mais l'on pouvait sentir, derrière son sourire qui n'a jamais été un masque, une volonté tenace qui, aidée par la prodigieuse audace des timides, fit d'elle et de son mari, des personnages qui ont marqué leur temps.
Ici, je me dois d'ouvrir une parenthèse. Lorsque l'on parle du mari de ma femme, il ne s'agit jamais de moi ou si rarement... Je l'ai pourtant épousée deux fois en sus du mariage religieux, et durant plus longtemps ; mais ceci est une autre histoire que je conterai peut-être un jour. Non, son mari ce n'est pas moi ; mais quand on fait allusion au mari de l'Impératrice Marie-Louise, qui donc irait penser à Neipperg ?
Fermons donc cette parenthèse pour l'instant et revenons à cette rousse aux yeux verts qui devait, dans l'ombre de son grand homme, révolutionner le monde des Lettres.
*
C'est dans le décor auquel fait immanquablement penser « La Bohème » chantée par Aznavour, que Paris découvrit les deux jeunes gens. Lui, un grand garçon de belle allure, au regard bleu d'acier avec, peut-être, encore un peu trop de « provincialité » derrière son pince-nez et dans son unique costume noir à pantalon rayé. Issu d'une famille d'universitaires belges, puriste jusqu'au bout des orteils, il faisait tout ce qui était en son pouvoir pour ne pas laisser apparaître qu'il était étranger à Paris que, lui aussi, adorait.
Quant à elle, si j'en ai brossé un rapide portrait, j'ai oublié de dire que son accent anglais était absolument irrésistible, ajoutant bien du piquant à son charme. Cela ne laissait aucun doute sur ses origines ; mais elle n'en parlait pas et laissait croire tout ce que l'on voulait. Aujourd'hui encore, si elle a, depuis très longtemps, perdu son accent « étranger » et parle le français comme vous et moi - et certainement beaucoup mieux, Dieu merci, à l'exception de quelques mots de sa fabrication - elle ne peut toujours compter qu'en anglais, ce qui étonne les commerçants qui croient volontiers à une aimable fantaisie.
J'ai déjà dit qu'elle était chauvine. Elle l'est pour la France ( essayez donc de dire qu'elle n'est pas française, vous verrez !), elle l'est plus encore pour Paris, mais terriblement également pour l'Angleterre, ses traditions, son humour, son flegme et sa dignité. A tel point que, lorsque son fils est né, elle est sortie du semi-coma où elle était plongée pour entonner un retentissant « God save the King » à l'ahurissement général.
L'hymne de la fière Albion saluait la concrétisation, l'apothéose d'un amour merveilleux, mais aussi d'une ascension et d'une réussite professionnelle qui avait amené, en quatre ou cinq ans, Cécile et Robert Denoël au firmament du monde de la littérature. Cette réussite, Robert la devait à son grand talent, à son flair qui faisait de lui un éditeur-né, à son acharnement à découvrir les talents nouveaux, à les susciter, presque à les créer, à mille qualités ; mais aussi au dynamisme, à l'esprit d'entreprise, au sens pratique et à l'opiniâtreté de sa femme.
Ce genre de choses n'est pas rare. On parle trop souvent, à mon avis, de la réussite des hommes célèbres en oubliant systématiquement l'aide indispensable que, dans beaucoup de cas, leur ont apporté leurs compagnes. Bien souvent aussi, trop souvent, hélas ! lorsqu'ils croient avoir atteint définitivement le sommet, certains d'entre eux répudient leur passé pour s'amouracher de quelque femelle en mal de vison qui savonne la planche qui les fera dégringoler.
Robert, au départ, était un garçon débordant de qualités, je l'ai déjà dit et ne le répéterai jamais trop ; mais trop dilettante, utopiste comme nombre d'artistes. Le temps ne comptait pas pour lui, ni l'argent qui lui coulait entre les doigts, mais bien plus souvent pour les autres que pour lui-même ou surtout pour les siens.
Le principe « les copains d'abord », cher au bon Brassens, fait les mauvais ménages. Et si Cécile n'avait pas aimé son grand homme plus que tout au monde, si elle n'avait pas eu la sagacité et la volonté nécessaires, le ménage n'aurait pas duré six mois. Nul ne saura jamais combien il lui a fallu de patience et de persévérance pour l'aider à se stabiliser dans une voie et à le mettre en lumière tout en restant dans son ombre.
*
Journaliste intermittent à la Gazette de Liége, Robert, quelques années auparavant, avait quitté la Belgique pour Paris afin de tenter de s'y faire un nom dans le monde des lettres, après un fugace essai dans le Théâtre. Il avait vu beaucoup de monde, s'était fait des amis, avait parlé énormément, écrit un peu, mais les rares articles publiés ne suffisaient pas, loin de la, à le faire vivre. Il fréquentait poètes, jeunes écrivains, artistes-peintres, vendant parfois des tableaux ou des lithographies. Il couchaillait à droite, à gauche, s'était même mis en ménage quelque temps avec une brave fille qui, elle non plus, ne savait pas se fixer.
Quelques temps il avait vendu... ou tenté de vendre des livres rares rue Sainte-Anne, chez Houyoux, un ami libraire, belge lui aussi, puis avait traversé la rue pour tenir la Galerie d'Art de Champigny pour laquelle il éprouva une amitié amoureuse, passionnée et tumultueuse.
La vie de bohème n'était pas rose tous les jours pour Robert. Très remplie, mais inutile ; elle lui semblait vide et sans issue. En Belgique, il pouvait se faire une situation : un notaire l'espérait comme collaborateur en attendant d'en faire son gendre ; mais cela aurait été avouer un échec pour mener richement une vie médiocre, donc indésirable. Dans son désarroi inavoué, Robert songeait souvent à Cécile, cette fille resplendissante au visage ensoleillé, qui lui était apparue un soir de fête sous les habits de la Bohémienne de Franz Hals, dans un bal costumé et dont le regard l'avait envoûté.
L'envoûtement, d'ailleurs, avait été réciproque et, durant un temps, ils ne se quittaient que pour s'attendre. Mais elle était trop sage. Il la respectait et savait qu'avec elle, il ne pourrait jamais s'agir d'une amourette de passage comme il en avait tant connu. Inconsciemment, il craignait sans doute de s'engager dans une voie qui serait définitive, il le pressentait.
*
Un soir, par le plus grand des hasards, elle l'avait aperçu dans les bras d'une fille d'un genre plus que douteux. Elle en avait conçu un chagrin terrible : le fameux « coup au cœur » ou la « peine mortelle » que l'on trouve dans les tragédies classiques. Le monde s'était effondré et elle s'était rendue compte qu'elle aimait ce garçon plus que sa propre vie. Elle tenta de faire la suprême bêtise qui, heureusement, rata. Mais elle ne voulait plus le voir ni même en entendre parler. C'est sans doute pour cela que Robert était reparti pour Paris et menait cette vie insipide.
Mais le sourire de Cécile l'obsédait au point qu'un jour de 1927, n'y tenant plus, il retourna la chercher. Il se fit persuasif : « Viens à Paris. Sans toi, je ne peux vivre. » Elle le fit attendre encore quelques mois, le temps d'atteindre ses vingt-et-un ans, avant de se lancer dans la vie. Dans l'aventure. Il ne lui avait fallu qu'une nuit de réflexion pour prendre sa grande résolution. Mais quelle nuit de dilemme ! C'était une grave, une importante décision que celle de tout lâcher : sa famille, ses études, sa sécurité, et renoncer à retourner jamais dans son pays bien-aimé, l'Afrique du Sud, pour se lancer dans l'inconnu avec l'homme qu'elle aimait, certes, mais qu'elle connaissait si mal et qui pouvait lui réserver tant de surprises.
*
Des surprises, il allait lui en réserver ! sur le plan humain, sur le plan professionnel et surtout sur le plan sentimental. Robert était un passionné qui aimait sincèrement, sans réserve... mais plusieurs personnes à la fois.
L'amour qu'il éprouva pour Cécile était total, absolu et jaloux ; il n'a jamais cessé tout au long de sa vie, mais il a toujours ressenti le besoin de dispenser ailleurs une part de son insatiable sentimentalité et, disons le mot : de sa sexualité, sans que cela enlève rien, sur ces deux plans, notamment à celle qui, pour lui, représentait l'Amour, le foyer, la sécurité et la fidélité dont, curieusement, il éprouvait un besoin farouche et indéfectible.
On peut lire, dans le prologue aux souvenirs de Cécile, ces quelques lignes : «...Il avait, sur ce point, la moralité d'un pacha ou bien d'un roi de France : une épouse honorée, aimée et mère des enfants légitimes, une favorite interchangeable et de nombreuses houris d'occasion...»
*
Le début de leur vie commune fut difficile. Très difficile. Il y eut des heurts entre ces deux êtres de nature, d'éducation et de conceptions si opposées. Mais heureusement leur amour sans limite aplanissait bien des choses. Les maigres ressources avaient vite fondu au soleil de cet amour, mais aussi au profit des camarades et par l'indolence initiale de Robert. Les bijoux, les tableaux de Cécile, tout ce qui pouvait être monnayable ou accepté en gage au Mont-de-Piété avait irrémédiablement disparu.
Plus d'une fois Cécile avait pensé repartir pour sa lointaine Afrique d'où elle tenait son teint d'abricot, son besoin de liberté, son caractère de cavale indomptable et indomptée jusqu'alors et où un « daddy » au cœur tendre l'attendait à chaque minute de son existence. Mais elle aimait son Robert, elle sentait ses talents sous-jacents, elle savait qu'un jour il deviendrait célèbre pour peu qu'il fût guidé, aidé et tellement aimé. Faisant abnégation de sa personne, elle décida qu'elle serait le catalyseur qui permettrait au prodige de se réaliser. Que de patience il lui fallut, que de diplomatie aussi ; mais elle en possédait des trésors inépuisables. Il lui fallait aussi, tout en sauvegardant sa primesautière jeunesse, faire appel à son sens pratique.
Par bonheur elle qui, plus tard, s'intéressait si peu à l'argent, avait appris très tôt à gérer les finances. Sa maman était, comme elle, très entreprenante, mais elle avait une propension à se faire gruger par ses proches et ses amis, dépassant de loin la charité de saint Martin qui, lui, ne donnait que la moitié de son manteau.
Assurément le plus grand des défauts de Cès était son aversion inflexible pour le mensonge et pour l'hypocrisie. Vous auriez pu la brûler en place publique comme Jeanne d'Arc que vous ne seriez jamais arrivés à lui faire dire le contraire de ce qu'elle pensait, même - et surtout - pour s'attirer les bonnes grâces des personnes en place. Vous pensez bien que cela ne lui a jamais simplifié la vie... surtout pendant l'Occupation !
Malgré toute la diplomatie qu'elle essayait de mettre dans ses paroles et, en raison de ses réactions volcaniques, son franc-parler était parfois si explosif que tous ses amis l'avaient surnommée « le V 1 » ! L'ex-libris que je lui avais dessiné représente le nom Cès explosant en une constellation d'étoiles formant la Croix du Sud de son Afrique bien-aimée et éclairant un chemin qui allait vers un ailleurs infini au bord duquel veille une indispensable petite fleur.
*
Cela dit, à côté de ses homériques emportements, ses intimes seuls savaient combien elle pouvait avoir de patience, de volonté et de courage. Elle en eut, hélas ! bien besoin dans les moments dramatiques de son existence. Très sincèrement, je ne pense pas que sans cet ensemble de qualités elle aurait pu amener Robert Denoël à devenir l'homme qu'il fut.
Combien il fallut à « la jeune fille du Cap » de volonté agissante, de persuasion, de gentillesse, de poigne et de diplomatie pour obliger son mari - qui, trop facilement, se laissait entraîner - à se fixer et à créer la librairie de leurs rêves où, enfin, ils pouvaient, le 30 Juin 1928, moins d'un an après leur union, publier leur premier livre : une traduction de L'Ane d'Or d'Apulée, illustrée d'une façon outrageusement moderne pour l'époque et éditée en livre de très grand luxe en un tirage plus que modeste, ce qui donnait davantage de valeur, par sa rareté même, à chaque exemplaire.
Que l'on ne me fasse pas dire ce que je ne dis pas : cette librairie, ce premier livre, ce n'est pas Cécile qui en a décidé : Robert y pensait depuis longtemps, mais il manquait alors du réalisme nécessaire, de l'esprit d'entreprise indispensable pour leur faire prendre corps.
L'Ane d'Or ne portait pas encore le nom qu'ils allaient rendre célèbre, mais seulement celui de leur librairie : Les Trois Magots, qui étaient Robert, Cécile et une associée, en nom mais inopérante : Anne Marie Blanche, que Robert avait connue chez Champigny et dont ils allaient bientôt se séparer.
Ce n'est que dix mois plus tard que parut l'ouvrage suivant, mais il portait, sous l'indication « À l'enseigne des Trois Magots », le nom de Robert Denoël, Editeur. Ce livre était L'Art et la Mort d'Antonin Artaud. C'était aussi le début d'une immense amitié. Une amitié parfois tumultueuse et décousue en raison du caractère instable et fantasque du poète ; mais d'une intensité et d'une profondeur sans pareilles.
J'aurai certainement plus d'une fois l'occasion de reparler de lui, tant ses rapports avec Cécile et Robert Denoël ont été vitaux. Artaud s'était attaché à eux comme le lierre à la pierre car il éprouvait en leur présence un sentiment de sécurité et d'apaisement tel un enfant perdu qui retrouve sa mère.
Sans cesse, il les appelait. Sans se lasser, il priait pour eux et surtout pour le Fifou, le fils de ses amis à la naissance duquel il avait assisté, gardant dans son poignet les traces des ongles que Cécile y enfonçait pour maîtriser la souffrance d'un enfantement douloureux. Que de souvenirs !
*
Bien qu'ils n'en fussent qu'au tout début de leur carrière, « les Denoël », en très peu de temps, étaient déjà connus du Tout-Paris littéraire. Il faut dire que, s'ils avaient manqué d'argent pour se lancer dans le métier, ils n'avaient manqué ni d'imagination, ni d'audace.
La librairie, créée en vidant les fonds de tiroirs et grâce au prêt qu'avait consenti à Cécile un vieil ami de sa famille (Boussaingault, ancien consul à Capetown), se devait de sortir de l'ordinaire. Il fallait attirer les bibliophiles dans un quartier qui ne leur était pas habituel et, pour cela, créer un mouvement littéraire, artistique et mondain autour de la petite boutique de l'Avenue La Bourdonnais.
Cécile et Robert décidèrent d'y organiser des ventes d'autographes, de tableaux, de livres anciens, et cela sans bourse délier ; où auraient-ils pris l'argent pour le faire ? A l'époque, le principal repas du couple était bien souvent constitué par une boîte de maquereaux au vin blanc et quelques centimes de pain.
*
A ce sujet, voici une courte anecdote que Cécile ne raconte pas dans ses souvenirs : La famille de Robert, n'ayant pas souvent de ses nouvelles, dépêcha un beau jour un ami pour voir quel genre de vie menait à Paris, la ville de perdition, le fils du professeur Denoël. La famille de Robert, très bourgeoise, avait, et a toujours, des principes de morale très stricts et c'est parfait ainsi. Trois de ses sœurs étaient entrées en religion, une autre était partie au fin fond de l'Afrique pour y créer des léproseries, un de ses frères était Père Jésuite au Congo Belge, deux autres sœurs vouaient leur vie à l'enfance malheureuse : une famille admirable où tous ou presque étaient des modèles de piété.
[S'ensuit la visite de l'ami liégeois, qui était peut-être Victor Moremans, étonné par le décor fantaisiste d'un ancien atelier de sculpteur où trônait un immense poële, par un mobilier pratiquement inexistant ou peint en trompe-l'œil sur le mur]
*
Pour préparer les expositions envisagées, on fit appel aux amis pour avoir les noms de personnalités qui pouvaient aider les jeunes libraires, non de leurs finances (ils se seraient défilés) mais de leurs conseils, de leur expérience... et des trésors de leurs collections. Puis Robert prit le téléphone et, mettant tout son charme et sa persuasion dans l'appareil, conta aux personnalités les plus diverses ses ambitieux projets et prenait rendez-vous auprès d'elles pour sa femme.
Comme elle était partie à dix ans, les nattes rousses en bataille, à l'assaut des bâtiments officiels, Cécile repartit, presque toujours à pied pour épargner un trajet en métro, sans nattes mais avec autant de décision, chez Anna de Noailles, chez la Princesse Murat, chez Sacha Guitry et bien d'autres. Sa jeunesse, sa spontanéité, sa franchise, son parler direct teinté de son délicieux accent anglais, faisaient la conquête du Tout-Paris ; et les tableaux aimablement prêtés, de même que les autographes et quelques incunables prirent le chemin de la librairie des Trois Magots où chacun put ensuite les admirer à son aise.
C'était un bon moyen de faire connaître la maison. Voyant les allées et venues, les somptueuses automobiles s'y arrêter, nul ne pouvait ignorer bien longtemps la librairie des Trois Magots. Les jours de vernissage y attiraient les plus grands noms qui se devaient d'y être vus. Le porto, ces jours-la, coulait à flots (que de boîtes de maquereaux au vin blanc cela représentait !) Mais tous ces gens qui admiraient, devisaient gaiement, faisaient des ronds de jambes, potinaient, lançant quelque petite vacherie sur les absents, congratulant les autres et notamment les jeunes organisateurs, n'achetaient rien. Pour mettre les tableaux en valeur, on cachait les bouquins par des rideaux de velours et une librairie où l'on ne voit pas de livres !... Heureusement, attiré par la curiosité, un chaland anonyme se hasardait parfois dans la boutique et achetait quelqu'ouvrage. Ce n'était pas le Pérou, mais cela permettait de vivoter.
*
De temps à autre on éditait un ouvrage trop rare, trop beau aussi, donc trop cher et de vente difficile : Les Mimes d'Hérondas, adaptés par Jacques Dyssord et illustrés par Carlo Rim, Le Grand Vent, de Champigny, illustré par Béatrice Appia, étaient des livres admirables comme l'était L'Ane d'Or ; mais quel public pouvait y mettre le prix au milieu de la crise créée par le fameux krach de Wall Street ? Cécile avait eu bien du mal à vendre l'exemplaire numéro 1 de L'Ane d'Or au Président Louis Barthou (exemplaire sur Japon ancien contenant le dessin à l'eau forte, douze croquis originaux à l'encre de Chine, quatre états de l'eau-forte plus un double de l'état définitif colorié a la main et une double suite des autres hors-texte rehaussés à la gouache et signés.) Des courtiers essayaient de placer les ouvrages des jeunes Denoël mais avec quelle difficulté !
C'est alors qu'un artiste, peintre mais surtout dessinateur, le mari de Béatrice Appia, apporta un manuscrit à Denoël qu'il avait connu chez Champigny. Bien que, par diplomatie, il lui faisait bonne figure, Robert n'avait guère de sympathie pour ce touche-à-tout. Il parcourut rapidement son texte et s'en désintéressa. Cécile ramassa le manuscrit qui traînait, en parcourut quelques pages de-ci de-là, puis, le reprenant au début, le lut avec avidité. Le bouquin l'emballait : elle y découvrait une face ignorée de ce Paris qu'elle adorait, elle y sentait vivre certaines petites gens dans des habitudes quotidiennes qu'elle ne soupçonnait pas.
- Tu as lu ça ? demanda-t-elle à son époux.
- Oui. Sans intérêt...
- Mais c'est excellent.
- Tu trouves ?
- Oui. On devrait l'éditer.
- Tu vois cette foutaise en livre de luxe, toi ?
- Peut-être pas en luxe, mais en tirage courant.
Robert avait éclaté :
- Moi, faire du bouquin vulgaire l... D'ailleurs, je te l'ai dit : c'est sans intérêt.
Le jugement était sans appel. Robert se butait. Cécile, elle, voulait absolument l'éditer. Et quand elle voulait quelque chose !...
- Eh bien! tu le feras toute seule si ça t'amuse.
- Chiche !
- C'est qu'elle en serait capable ! Heureusement, nous n'avons plus d'argent.
- Il me reste encore une bague, une améthyste...
Robert se sentit battu. Avec un soupir de dépit, il capitula. Reprenant en mains le manuscrit sans idée préconçue, il le relut et avoua, fair-play : « Tu as raison, le livre est bon ; essayons. »
Il se mit au travail, demanda des devis, calcula le prix de revient d'un tirage rentable ; de son côté Cécile avait présenté son ultime bague (Et quand je dis « ultime », cela est réel ; elle ne voulut plus jamais par la suite posséder de bijoux de valeur, mais de très belles fantaisies afin d'éviter à son époux la tentation de les gager comme ce fut le cas pour tous les précédents. Le « diamant » qu'elle porta par la suite et que le Tout-Paris connaissait était une remarquable imitation) à divers bijoutiers pour en tirer le maximum afin que le papier fût acheté, le tirage et le brochage de l'ouvrage payés au comptant dès la fabrication terminée.
Le livre parut le 29 novembre 1929, en pleine crise. Les frais d'édition avaient presqu'entièrement mangé la bague d'améthyste ; impossible de payer la publicité qui aurait été nécessaire pour la vente. Le stock était là et encombrait la chambre, car Cécile et Robert avaient quitté leur inoubliable atelier romantique et bohème de la rue du Moulin Vert pour s'installer dans l'arrière-boutique de la librairie. Cela évitait un deuxième loyer et les allées et venues : pas mal de kilomètres à pieds à travers Paris matin et soir.
Comment lancer le livre ? Des amitiés, des relations nouvelles nées du remous entourant les vernissages permettaient d'en parler, de faire de la publicité de bouche à oreille ; Frédéric Lefèvre préparait des articles élogieux... Mais il fallait que les lecteurs en puissance trouvent l'ouvrage chez leur libraire dont la plupart ignoraient l'existence d'un certain Denoël dont ils se souciaient peu.
Le sens pratique et l'esprit d'initiative en bataille, Cécile décida qu'à tour de rôle, Robert et elle prendraient un taxi, le rempliraient de bouquins et iraient faire le tour des libraires de la capitale, puis de ses environs, pour les prier d'accepter quelques exemplaires en dépôt, payables après vente. Sitôt dit sitôt fait et, leur tournée terminée au bout de quelques jours, leurs carnets à souche remplis, ils attendirent la suite des événements avec une anxiété facile à comprendre.
Ils avaient joué leur dernier atout à pile ou face. Ce fut un succès. Les coups de téléphone, les livreurs des confrères et ceux de chez Hachette affluaient aux Trois Magots. Il fallut réimprimer...
Peu après fut créé le prix Populiste dont ce livre obtint le prix. On en tira plus tard un film célèbre dans lequel Arletty lançait son fameux « atmosphère » que nul n'oubliera jamais et qui, d'ailleurs, n'est pas de l'auteur du livre.
*
Paris ne se bâtit pas en un jour. Une maison d'édition non plus. Si L'Ane d'Or marquait un point de départ, si le livre d'Artaud avait affiché le nom Denoël, L'Hôtel du Nord de Dabit marquait le vrai démarrage. Il touchait un public plus divers et plus nombreux. Je ne parlerai pas de l'agressivité de Gaston Gallimard qui voyait naître en Denoël un concurrent futur avec lequel il faudrait désormais compter ; je ne dirai pas davantage comment il tenta de racheter le contrat de Dabit, Cécile l’a fait bien mieux que je ne pourrais le faire. Je parlerai de deux des avantages majeurs de l'édition de ce livre.
Son lancement inattendu incita de nombreux jeunes écrivains à apporter à Denoël leurs manuscrits, matière première indispensable. Même des écrivains ayant déjà un petit nom dans la littérature voyaient là un moyen de se mettre à la mode et ils n'avaient pas tort. Paul Vialar, pour ne citer que l'un des plus célèbres par la suite, avait déjà publié plusieurs ouvrages : poèmes, pièces de théâtre et deux romans que peu de gens connaissaient lorsqu'il obtint, chez Denoël, des succès grandissants : La Rose de la Mer, La Maison sous la Mer, et surtout La Grande Meute qui l'entraîna, beaucoup plus tard, à la présidence de la Société des Gens de Lettres.
Cette Grande Meute était, à l'origine, une courte nouvelle que Vialar avait montré aux Denoël. Bonne, très bonne, mais inconsistante. « Pas mal du tout, approuva Cécile, mais je pense qu'il pourrait faire mieux. »
- Tu crois ?
- Oui. Il y aurait de quoi faire un succès si on l'étoffait un peu.
Paul était l'un des commensaux habituels de la maison. On en parla à table.
- Je veux bien, dit-il, mais pour étoffer le sujet, il me faudrait connaître mieux la vie de la chasse à courre, les termes de vénerie, tout un monde que j'ignore totalement.
- Qu'à cela ne tienne, coupa Robert, je vous ferai trouver la documentation nécessaire.
Ainsi fut fait. Vialar bûcha plus qu'un collégien pour le bac, et il sortit le livre souhaité. Encore quelques petites retouches et le chef-d'œuvre était là.
*
Les « auteurs Denoël » d'alors devaient leur succès non seulement au lancement (cela n'aurait été qu'affaire de publicité) mais au travail qu'exigeait d’eux leur éditeur. Il fallait voir Robert et Cécile, chacun enfoui dans un profond fauteuil-club, les jambes bien souvent par-dessus l'accoudoir, manuscrit en mains et armés l'un d'un crayon bleu, l'autre d'un rouge pour rayer ou annoter des passages entiers à couper ou à retravailler en précisant dans quel sens le faire.
Le second des « avantages majeurs » dont je voulais parler, c'est l'arrivée dans la vie de Cécile et de Robert d'un jeune américain qui venait souvent, en voisin car il demeurait quelques rues plus loin, choisir quelque livre et bavarder longuement. Il avait beaucoup apprécié L'Hôtel du Nord et pour les mêmes raisons que Cécile (peut-être le fait d'être étranger à Paris l'un et l'autre y était-il pour quelque chose ?) Ce jeune américain qui s'intéressait tant aux livres et qui disposait de l'argent nécessaire pour en éditer un certain nombre sans avoir à attendre les revenus des premiers s'appelait Bernard Steele. Il entra comme associé et comme ami dans la maison qui prit le nom de Denoël et Steele et put se lancer plus à fond dans la découverte des « jeunes » auteurs. Je mets toujours jeunes entre guillemets car la jeunesse des auteurs n'a pas d'âge, l'an I démarrant pour chacun avec le premier livre publié.
*
Je ne ferai a personne l'injure de rappeler que parmi les jeunes auteurs qui apportèrent leur manuscrit chez Denoël, l'un d'entre eux devait transformer la littérature de notre temps sous le nom de Louis-Ferdinand Céline. On sait que c'est un soir, à la nuit tombée, qu'un inconnu avait déposé un gros paquet contenant le manuscrit d'un ouvrage que Robert et Cécile, rentrant du théâtre, passèrent la nuit à lire avec une avidité que l'on peut qualifier d'exaltante. Un titre : Voyage au Bout de la Nuit, mais pas de nom d'auteur. Celui-ci enfin retrouvé était sceptique lorsque Denoël lui annonça qu'il voulait le publier : le manuscrit avait déjà été refusé par d'autres éditeurs...
Puis, le succès lui montant à la tête, il se prit pour le centre du monde, eut des exigences de plus en plus excessives : «12 pour cent de 1 à 20.000, écrivait-il à Robert, 15 pour cent de 20 à 40.000, 18 pour cent au dessus de 40.000. Toutes traductions, adaptations, à moi seul. Cette lettre au Havre s'il vous plaît. Sinon pas plus de Mort à Crédit que de beurre au cul.» Cela ne s'était jamais vu mais il fallait en passer par où il le voulait : avec le lancement de son premier livre, il était devenu le monstre sacré de la littérature ! Il faisait couler des flots d'encre. Certains le mettaient au pinacle, d'autres le traînaient dans la boue, aucun n'était indifférent.
Pas plus que Cécile je ne suis « célinien ». Ses deux premiers livres sont plus qu'intéressants. Le Voyage, n'en parlons pas ; c'est lui qui est à la base de la célébrité de son auteur ; il est le plus pur : c'est le Docteur Destouches qui l'écrivit ; déjà dans le second, Céline n'était plus le docteur, il était grisé par le succès malgré une rancœur profonde qui le consumait à cause de sa défaite au prix Goncourt. Ensuite, la haine prenait le pas sur le style (que je me garderai bien d'attaquer : il est inégalable).
Ce que je reproche à Céline... - Oh ! mon Dieu, qui suis-je pour reprocher quoi que ce soit à qui que ce soit ; qui donc a le droit de juger ? - Ce que je trouve très grave pour moi qui aime Robert Denoël, c'est que Céline a réveillé chez celui-ci un antisémitisme que tout être élevé à son époque et à la mienne dans les institutions religieuses portait en soi. Pensionnaire chez les Frères des Ecoles Chrétiennes, - je me souviens que l'on nous présentait les protestants comme les suppôts de Satan et les juifs, assassins de Jésus, comme Satan lui-même. Il a fallu attendre Vatican II pour que l'on enlève du rituel de la messe certaine phrase, heureusement en latin, qui condamnait les juifs.
*
C'est une chose que je dis souvent : « Robert n'était pas tout blanc, tout pur » ; mais, s'il a été le bouc émissaire de l'édition au moment de la Libération, ce n'est pas parce qu'il avait, comme les autres, édité des livres allemands et côtoyé l'occupant ; c'est, en filigrane, son antisémitisme qu'on lui reprochait et surtout d'être l'éditeur de Céline le honni.
Cela, Cécile l'a écrit plus d'une fois, a été à la base de la seule mésentente littéraire entre elle et son mari. Je rappelle qu'elle avait interdit à Robert d'éditer Les Beaux Draps et que celui-ci fonda « en catimini » une autre maison d'édition : « Les Nouvelles Editions Françaises » et, ne pouvant utiliser l'argent des Editions Denoël, fit appel à des fonds étrangers, à l'insu de sa femme, par une association avec une certaine Veuve Constant. Cécile ne l'apprit que bien après l'assassinat de son mari. Ceci devait être dit ; c'est fait ; parlons d'autre chose et revenons à Bernard Steele, ami indéfectible qui, ne l'oublions pas, était israélite.
Outre le côté purement professionnel, l'arrivée de Bernard et de son automobile, engin encore peu envahissant à l'époque, dans la vie de Cécile et de Robert, apporta un regain de jeunesse et de gaieté. Non qu'ils en manquassent avant cela, mais l'auto, une certaine aisance et, pour Cécile, un allié anglo-saxon, permirent les pires folies.
Pour le groupe Cécile, Robert, Bernard et Mary Steele, c'étaient surtout les virées en auto loin de la capitale en chantant les vieux airs du folklore français ou les derniers succès de Duke Ellington et de Louis Armstrong ; c'étaient les ballades le long des quais de la Seine, les repas fins mijotés par Cécile (excellent cordon bleu) dans la propriété de Bernard à Montmorency, ou les gueuletons chez Point ou quelqu'autre Grand Cordon de la Gastronomie.
*
L'extension de la maison d'édition avait permis de déménager dans une vieille chapelle désaffectée de la rue Amélie, à L'Hôtel du Nord d'avoir de nombreux petits frères, de voir affluer les manuscrits les plus divers et parfois les plus intéressants et à nos éditeurs d'avoir de plus en plus de travail ; ce qui n'empêchait nullement leur joyeuse vie de continuer.
Lorsque les quatre larrons n'étaient pas seuls en foire, leurs acolytes les plus habituels étaient les Rim : Alice et Carlo Rim. Le sextuor n'avait pas son pareil pour faire des niches aux gens, tirer les cordons de sonnettes et agir comme des galopins en rupture de collège. Carlo Rim apporta à Cécile et à Robert des relations que d'aucuns trouveraient plus que douteuses mais qui se révélèrent fort utiles par la suite.
*
Lorsque les sombres jours de la guerre arrivèrent, quand la nourriture se fit rare et que les truands en place avaient la haute main sur le marché noir, les Editions Denoël avaient alors cinquante employés à nourrir ainsi que leurs familles.
Quelques auteurs provinciaux envoyaient des « colis familiaux » qui remplissaient les placards de confits d'oie, de foie gras et autres spécialités gastronomiquement périgourdines indispensables pour les repas d'affaires, recevoir dignement le Tout-Paris et faire honneur à la réputation de « première table de Paris » que Curnonsky, le roi des gastronomes, avait, depuis longtemps, décerné à Cécile.
Mais cela ne suffisait pas, il fallait aussi de la viande pour cinquante familles plus celle de l'éditeur. Alors, tout aussi régulièrement, Cécile partait pour Questembert, en Bretagne, où elle faisait élever clandestinement moutons et porcs. Pour l'expédition sur Paris, il y avait deux méthodes dont elle avait eu l'ingénieuse idée : 1°) des retours de marchandise s'effectuaient dans des caisses doublées de livres périmés entourant les cadavres porcins ou ovins qui arrivaient ainsi directement à la maison d'édition ; les services de contrôle n'y voyant que du feu ou plus exactement que des bouquins. 2°) les cadavres étaient envoyés, pour autopsie, directement de Bretagne à l'Institut Pasteur où les Denoël avaient des amis qui dirigeaient directement les comestibles dépouillés sur les Editions.
Dans un cas comme dans l'autre, si Cécile n'était pas sur place au bureau, Georges, le fidèle emballeur qui avait vu les difficiles débuts de la maison, téléphonait : « Voulez-vous prévenir Madame que le cousin est arrivé ?» Et Madame venait aux Editions pour faire la distribution entre patrons et employés.
A la maison d'édition, par temps froids, il y avait régulièrement la pause-café, ou thé, ou soupe selon les goûts ; par temps chauds des rafraîchissements. Je sais que cela se fait maintenant dans certaines maisons, mais les Denoël étaient précurseurs. Parmi les bénéficiaires de ces soins dévoués, je citerai, presqu'au hasard, un jeune journaliste de Vichy qui avait quitté sa province et son métier vers 1936 pour entrer dans la grande famille des Editions Denoël. Il allait devenir assez vite chef de fabrication.
Pour lui faire connaître la capitale où il aurait à vivre, Cécile le promena à travers Paris qu'elle aimait et décrivait si bien et elle eut, quelques temps après, à partir en banlieue pour s'occuper des bébés, ce qui explique la dédicace du second livre de René Barjavel, car il s'agit bien de lui : « A Cécile Denoël qui fut mon guide lors de mes premiers pas dans la capitale, et mon soutien dans mes aventures de banlieue, avec la gratitude et l'amitié de celui qui restera toute sa vie un VOYAGEUR IMPRUDENT. R. Barjavel 25.2.44 ».
*
Lorsque j'entends parler de grèves - et Dieu sait si des spécialistes savent les susciter et les organiser, à l'époque actuelle - je me prends à rêver à celle qui faillit toucher les Editions Denoël. Un groupuscule mécontent de ses dirigeants avait décidé d'étendre sa grève à toute la profession du livre et avait, pour ce faire, placé des «piquets» devant chaque maison d'édition. Les employés de chez Denoël étaient au travail et ne voulurent pas se déranger ni se mêler d'un conflit qui ne les regardait en rien. Pour être certains qu'on ne les empêcherait pas de revenir le lendemain s'ils rentraient chez eux, ils décidèrent de rester sur place. Le bivouac s'organisa tant bien que mal ; les épouses avaient été prévenues par téléphone ou par télégrammes. Quant aux repas, c'est, bien entendu, « le petit patron » qui s'en chargea avec l'aide de sa femme de chambre et de sa cuisinière pour le transport des mets préparés à la maison.
Ah ! ils aimaient bien leur « petit patron », les employés des Editions Denoël ! J'allais ajouter : ils se seraient fait couper en rondelles pour Cécile ; mais cela aurait été archi-faux. Il est bien rare que des gens se fassent couper le bout du petit doigt par fidélité ou par reconnaissance... ni même qu'ils risquent de perdre un tout petit peu de leur bien-être.
En l'un des moments les plus tragiques de l'existence de Cécile, un mois après que l'on eût assassiné son mari, la maîtresse en titre de Robert à cette époque [Jeanne Loviton], déclara avoir racheté à celui-ci la totalité de ses parts sociales des Editions Denoël en présentant un document plus que contestable enregistré huit jours après le meurtre. Sans attendre de véritables preuves, les fidèles employés de la maison, à deux exceptions près [Auguste Picq et Madeleine Collet, la secrétaire de Denoël], accueillirent leur nouveau maître en courbant l'échine et en léchant ses bottes. Ah ! c'est qu'ils y tenaient à leur place ! Mais ne demandons pas aux gens d'être des saints, cela ne vaudrait pas la peine de tenter de mériter le Paradis.
*
Dès qu'elle eût appris, par les agents de police dépêchés à son domicile, « l'accident » survenu à son mari, Cécile s'était précipitée en pleine nuit, sous la fine pluie glaciale qui tombait ce soir-là à l'hôpital Necker où il avait été transporté. Je l'accompagnais et étais avec elle lorsqu'elle apprit que Robert Denoël était mort presque sur le coup d'une balle de revolver tirée dans le dos. Malgré l'heure tardive et la résistance de l'interne de garde, elle insista pour aller le voir immédiatement. Mais, dans son désarroi, elle eut une pensée pour celle qui avait voulu lui prendre son mari et me demanda : « Pendant que je vais auprès de lui, téléphone à sa maîtresse. Il est normal qu'elle sache ; elle l'aimait peut-être quand même après tout. » Nous ne savions pas alors qu'elle était, mieux que nous, renseignée sur le meurtre.
*
Tenter d'expliquer ici en quelques lignes comment, pourquoi et par qui fut assassiné Robert Denoël serait une gageure ; cela fit couler tant d'encre et de salive ! Vous dire comment les Editions Denoël ont été escamotées et les procès qui en résultèrent pour que ne soient pas délestés de leur patrimoine Cécile et le Finet, ne peut se faire non plus en quelqu'instant. Ces deux choses que la presse a unies sous le nom d'Affaire Denoël ont duré plus de cinq années. Essayer de vous faire comprendre les curieux rebondissements et l'embrouillamini que l'on peut croire volontaire demandera un nombre de pages que je ne puis placer ici.
Toujours est-il que Robert Denoël fut assassiné le 2 Décembre 1945 ; que sa femme et son fils furent totalement ruinés ; l'enquête sur le meurtre et les procès se terminèrent fin décembre 1950.
J'en parlerai donc plus loin. L'enquête sur le crime avait débouché sur un non-lieu. Reprise quatre ans plus tard grâce à des faits nouveaux difficilement réfutables, un autre non-lieu la stoppa définitivement. Paraphrasant Sacha Guitry, je pourrais dire : il n'y avait sans doute pas lieu de l'assassiner ! La police, semble-t-il, avait bien fait son métier, mais nous étions dans cette période assez équivoque de l'après-guerre. Des pressions politico-judiciaires enterrèrent cette affaire dans une obscurité qui n'est pas près d'être éclaircie. Et pourtant !... Au cours de l'enquête, au cours des procès, Cécile batailla avec l'énergie du désespoir. Mais que faire contre une coalition ? Napoléon lui-même s'y est cassé le nez.
Elle, qui avait une place à tenir dans le monde, se retrouva du jour au lendemain sans un centime. On n'avait retrouvé, sur le corps de son mari, outre des photos d'elle et de son fils bien cachées dans le fond du portefeuille, que la somme de douze mille francs. Ce n'était pas le prix du dernier costume que Robert s'était fait faire et dont la maison Lanvin envoya la facture à sa veuve peu après : 12 182, 40 francs.
Pas un centime pour vivre, pour faire face aux procès qui, en cinq ans, coûtèrent une fortune, pour faire vivre et élever dignement un fils qui n'avait que douze ans et demi à la mort de son père. Que de journées, que de nuits de travail cela a pu représenter, nul n'en aura jamais l'idée. Ah ! comme ils devaient lui revenir en tête ces vers du poème de Kipling : «Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie/ Et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir,/ Ou perdre d'un seul coup le gain de cent parties/ Sans un geste et sans un soupir.../ Si tu peux supporter d'entendre tes paroles/ Travesties par des gueux pour exciter des sots,/ Et d'entendre mentir sur toi leurs bouches folles/ Sans mentir toi-même d'un seul mot...»
Tous les amis qui, à longueur d'année, étaient ses invités, tous les auteurs de la maison qui lui avaient dédicacé leurs livres en des phrases dithyrambiques, tous ceux - combien nombreux ! - qu'elle avait aidés d'une façon ou d’une l'autre, disparurent comme par désenchantement. « C'est dans l'adversité que l'on reconnaît ses amis » ; je crois que, des amis des temps heureux, nous n'étions plus assez nombreux après pour être comptés sur tous les doigts d'une seule main.
*
Un soir qu'il se trouvait triste et inquiet - cela lui arrivait souvent dans les derniers temps - Robert m'avait dit : « - Morys, si un jour quelque chose m'arrivait...»
- Que voulez-vous qu'il vous arrive ?
- Qui sait ? S'il m'arrive un jour quelque chose, épousez Cécile.
- Hein ! Quoi ? Vous savez bien que je ne suis pas fait pour le mariage !
- Epousez Cécile, vous êtes le seul à pouvoir la comprendre.
- Mais...
- Faites-le pour moi, Morys, faites-le pour moi, pour elle, et aussi pour mon fils. »
Il avait insisté sur « mon fils ». J'avais été troublé mais avais répondu par une boutade et n'y avais plus pensé. D'abord parce que je ne voulais pas croire qu'il puisse arriver quelque chose à Robert, qui avait décidé de rentrer au domicile conjugal pour Noël ; aussi parce que je croyais absolument impossible qu'il puisse m'arriver de me marier jamais ; ensuite et enfin parce que si Cécile voulait se remarier un jour, elle trouverait mille partis bien plus intéressants que moi. Qu'étais-je auprès d'eux ? Un baladin qui, un jour de 1936, presque par hasard, était arrivé dans leur vie, avait été adopté et en avait conçu pour eux deux un amour subit et inconditionnel.
Lorsqu'après cinq années de luttes Cécile sut que, définitivement, les forces adverses avaient tous les atouts en mains par le jeu truqué de la politique des petits copains, nous nous trouvions chez son avocat Maître Armand Rozelaar.
- Nous pouvons encore tenter le Conseil d'Etat, avança-t-il sans conviction.
- Non, merci. Ils m'ont eue à l'usure. On ferme !
En sortant de son cabinet, Cécile était songeuse et s'assit sur les marches de l'escalier, sortit machinalement une cigarette : « Tout est fini, dit-elle puis, après un instant : il ne me reste plus qu'a t'épouser. »
Rien n'était plus inattendu. Rien dans son attitude passée ou présente, ni dans la mienne, ne pouvait laisser prévoir une telle décision. Je la regardais avec des yeux ronds. Pourquoi moi ? Tant d'autres hommes se pressaient autour d'elle depuis cinq ans qui auraient pu lui assurer une sécurité, une aisance qu'avec moi elle n'aurait jamais. Pourquoi moi qui avais vendu tout ce que je possédais et n'avais absolument plus rien, moi non plus ? Plus rien qu'un trésor de bonne volonté et un amour muet, inavoué parce que sans espoir depuis quinze ans. Pourquoi moi ? Impossible de lui répondre un mot. C'est ainsi que les choses se sont décidées.
*
Nous avons fait le tour des familles : de celle, nombreuse, de ma future femme, qui m'ouvrit les bras ; de celle aussi des Denoël qui m'accueillirent comme un des leurs. De mon côté, outre un frère que je connais à peine et que je ne vois jamais, je n'avais que mon père que Cécile connaissait bien car il l'avait hébergée à l'époque de la libération et c'est chez nous que Robert venait déjeuner presque tous les jours avec sa femme (bien qu'à l'époque il l'eût quittée momentanément pour sa dernière maîtresse) et recevoir auteurs et amis autour d'une table garnie de mets d'autant plus succulents que c'est Cécile qui tenait les fourneaux ! Il lui apportait même son linge personnel à laver parce que, disait-il, « personne ne repassait et n'arrangeait les affaires comme elle ». Et cela dura jusqu'au jour où mon père lui demanda :
- Est-ce que tu n'es pas un peu idiote, par hasard ?
- Quoi ?
- Ton mari te plaque pour aller vivre avec une .... (disons une dame, le mot est plus correct), tu le vois toujours parce qu'il ne peut pas se passer de toi, tu lui donnes à manger comme à un prince et, en plus, il faudrait que tu laves son linge ? Ça ne va pas, non ?
- Dans le fond, oui, tu as raison : je suis idiote !
Le lendemain, lorsque Robert arriva, le sourire aux lèvres et déposa sa petite valise pour l'embrasser, Cécile lui dit : « Tu pourras la remporter telle quelle ; je pense que cette dame a aussi des domestiques qui peuvent laver ton linge. » Robert la regarda tout bête, serra les mâchoires à s'en rompre les dents, reprit sa valise et partit sans un mot. Mais le lendemain, une azalée arrivait avec un petit mot tendre. Lorsqu'il arriva à l'heure habituelle, sans valise ! il avait affiché son plus beau sourire et nul ne parla plus jamais de linge sale.
Notre mariage civil eut lieu pour la Saint Guillaume, le 10 Janvier 1951. Dans la plus stricte intimité : la maman de Cécile, mon père, nos deux témoins et nous deux bien entendu. Le témoin de Cécile était maître Rozelaar, le mien Jacques Barreau, un ami commun.
Encore deux petits détails au sujet de notre mariage. Bien qu'ayant déjà été mariée et qu'elle fût très largement majeure au moment de nos épousailles, il fallut à Cécile présenter les autorisations de ses parents. En effet, comme Robert, son premier mari, elle était de nationalité belge ; telle est la Loi chez nos voisins. Et si l'on ne peut obtenir cette autorisation, il faut faire, par ministère d'huissier, des sommations respectueuses. N'est-ce pas charmant ?
*
Si notre mariage avait dérangé tant d'amis, malgré sa simplicité, le premier mariage de Cécile - avec Robert, bien entendu - avait été exactement à l'inverse. Grandes orgues, tapis rouge déroulé jusque sur le trottoir, suisse chamarré qui, hallebarde au poing, attendait un imposant cortège et ne vit arriver, en tout et pour tout, que quatre personnes : les mariés et leurs témoins.
Il faut entendre Cécile, il faut surtout la voir raconter son mariage : l'ahurissement du suisse devant si peu de monde ; pas même un parent pour conduire la jeune épousée à l'autel ! puis la dignité de sa démarche frappant le sol de sa hallebarde ; l'éclatement de musique de l'orgue, la voix des anges, les chants, les chœurs; le sourire paternel du curé qui finit par leur dire « Allez, mes enfants, il fait beau, profitez-en ! » La cérémonie avait eu lieu, noble et somptueuse, pour quatre personnes seulement ; mais pour tant de joie profonde ! C'était un mariage d'amour. « Pour le meilleur et pour le pire ».
Le pire faillit arriver dès la sortie de l'église. Un accident d'auto juste au démarrage du taxi provoqua chez Cécile une syncope qui fut d'autant plus longue que le choc inattendu arrivait sur une émotion intense et qu'elle avait juste eu le temps de voir son mari ensanglanté. Elle inquiéta ses invités qui, s'ils étaient absents de la cérémonie, s'étaient réunis chez Gangloff pour fêter joyeusement l'événement.
*
Des émotions de ce genre, elle en donna souvent. Malgré son activité débordante, malgré la joie de vivre qui éclatait sur son visage et dans tout son être, elle était déjà de santé fragile ; la malaria de son adolescence y était pour beaucoup. La naissance de son fils cinq ans plus tard allait la retenir huit mois en clinique où elle se morfondait de ne pouvoir être utile. Ce fils resta unique, mais lui donne tant de satisfactions que ceci compense cela. Elle eut de nombreuses rechutes et, pour un cancer qui s'ensuivit, elle subit quatorze ou quinze opérations. La technique n'était pas encore au point comme aujourd'hui. Chaque fois qu'elle sortait de clinique, elle retrouvait son dur métier de femme du monde et recevait à déjeuner ou à dîner jusqu'à douze fois par semaine !
Durant les premières années de leur union et de leur vie d'éditeurs, Robert et Cécile ne recevaient que des amis et lorsqu'ils en avaient envie. Comme vous et moi. Mais, au fur et a mesure que la maison grandissait, l'utilité d'avoir une vie mondaine devenait impérative ; témoin ce passage d'une longue lettre de Robert à une époque où il lançait une nouvelle revue [Le Document, en octobre 1934] :
« [...] Il faudra trouver une solution, car mes nouvelles fonctions vont m'obliger, nous obliger à voir beaucoup de monde. Tu vas être condamnée à sortir... et à sortir de ta belle sauvagerie. Et je compte beaucoup sur toi, tu sais. De plus en plus je m'aperçois de la nécessité où je me trouve de faire partie d'une certaine société. Et ce n'est pas possible sans un gros effort de ta part. Tout cela n'a rien de gai, c'est en apparence un peu stérile, mais en fait, c'est bien précieux. Nous avons beaucoup trop négligé ce côté de la vie. Et si nous voulons abandonner les difficultés matérielles, sortir de tout ce qui nous écrase, il faut en passer par là. C'est l'utilité de cette partie de la vie qui en salivera l'ennui. Fais donc provision de courage, de bonne humeur et de sourires. Je ne te dis pas de faire provision d'amour, chérie, nous en avons assez à nous deux pour surmonter tout. Et tu me l'as montré souvent. Mais dans le détail des petites choses, il faut aussi que nous soyons toujours unis, que ta main soit dans la mienne, toujours douce et chaleureuse. Je vais mener une vie de plus en plus trépidante, je la mène déjà, il faut que tu m'aides de tout ton coeur, de tous tes actes, sans cela je n'arriverai pas où je veux arriver, c'est-à-dire à l'équilibre, à la sécurité dans l'action mais aussi dans la tendresse. [...] »
Ils allaient arriver au sommet de la célébrité qui leur importait peu, surtout à Cécile, mais était indispensable, comme l'expliquait si bien Robert. Que d'efforts, cachés sous des sourires, cela demandait. Outre les expositions, les « premières », les cocktails où il fallait être vus, il y avait ces réceptions bi-quotidiennes !
Pour qui ne regarde que la façade, pour qui ne voit que le côté extérieur de la vie mondaine, cela semble merveilleux et enviable ; mais pour les femmes qui la vivent, qui n'ont pas toujours la fortune de Rothschild et le font par obligation pour entretenir un standing nécessaire et créer les relations indispensables à la profession de leur mari, comme c'était le cas pour Denoël chez qui les vraies affaires se traitaient entre la poire et le fromage, cela représente un travail harassant surtout si l'on ne dispose pas d'une domesticité importante et que l'on a la réputation d'avoir la meilleure table de Paris. Cécile n'a jamais eu plus qu'une cuisinière et une femme de chambre dont le mari venait pour tenir le vestiaire les jours où il y avait beaucoup d'invités ; c'est peu ! Les convives ne voyaient que le sourire exquis et détendu de la maîtresse de maison et le résultat d'un travail que bien des chefs et des majordomes ne feraient qu'à l'aide d'une flopée de marmitons et de domestiques.
Avant l'arrivée de ses hôtes, toute prête et pimpante dans sa longue robe d'hôtesse, elle s'était rendue à la cuisine, avait retroussé sa robe, enfilé un immense tablier et commencé la préparation des mets que la cuisinière n'aurait plus ensuite qu'à surveiller. Elle avait décoré les plats qui pouvaient l'être à l'avance, s'était assurée que tout était prêt, les vins à la bonne température, les fromages à point ; en un mot : tout. Absolument tout.
Il arrivait parfois que Cécile n'attendait, pour le dîner, qu'un nombre restreint de convives : cinq ou six par exemple, et que Denoël lui téléphone assez tardivement : « Allô, chérie, je viens de rencontrer les Untel et les Chose, j'aimerais discuter avec eux et avec nos invités de ce soir. Veux-tu faire ajouter huit couverts ? A tout à l'heure, chérie. » Et allez donc ! Non seulement cela chamboulait l'ordonnance de la table ; mais il fallait trouver de quoi nourrir ces nouveaux commensaux. Le merveilleux, c'est que Cécile se débrouillait toujours sans qu'il manque un hors-d'œuvre, une entrée, un poisson, une viande, les légumes bien sûr, toujours au moins trois,
la salade, un entremets, les fromages et le dessert. Mieux qu'à la Tour d'Argent ou au Grand Véfour ! Et tout cela ne l'empêchait pas de seconder son mari dans leur métier d'éditeur. Presque toujours, on la voyait arriver chez son coiffeur ou chez la couturière un manuscrit sous le bras, profitant des moments d'attente pour lire ou annoter.
Cette facilité d'improviser des repas lui servit, sur un plan plus modeste, durant la drôle de guerre alors que, réfugiée à Souillac, sans nouvelles de son mari qui, pendant la débâcle de 1940, parcourait la France en tous sens à la recherche de son régiment, elle devait subvenir aux besoins de son fils et aux siens propres. Mais ceci se passe pendant l'Exode ; voyons comment elle avait commencé, cette drôle de guerre. C'est tout un cirque.
*
Elle fit d'abord une très longue halte aux Antiques de Saint-Rémy-de-Provence, invitée par Marie Mauron dont Denoël avait édité Le Quartier Mortisson ainsi que plusieurs ouvrages de Charles Mauron. Marie Mauron, qui est la Provence incarnée, ouvrit le cœur de Cécile et de son Finet aux légendes et au charme de ce pays, plus rude qu'il ne semble, mais tellement exaltant.
Avec Marie, son amour de la Camargue s'étendit à toute la Provence dont elle apprit la langue. Je l'ai entendue dire, en provençal, de longs passages de la Mireille de Mistral dans lesquels passait toute la mélodie de cet admirable pays. Cécile a une propension à tomber amoureuse de tout ce qui est beau, vrai et pur. Quels paysages merveilleux elle doit découvrir là-haut !... Cependant le séjour chez Marie Mauron ne pouvait s'éterniser. Cécile ne voulait pas abuser d'une hospitalité, aussi adorable fut-elle. Robert ne voulait toujours pas que l'enfant rentre à Paris « dans les circonstances actuelles » ; Cécile lui téléphona donc qu'elle retournait à «Retirance».
*
« Retirance » est une petite maison extrêmement modeste, dans le Malvent, entre Saint-Paul-de-Vence et Cagnes-sur-Mer, que Cécile et Robert avaient achetée, mais dans laquelle ils laissaient les occupants, leurs amis Manon et Adrien Caillard. Celui-ci, ancien directeur de scène de Firmin Gémier avant de l'être du Théatre Français, était alors professeur au Conservatoire de Nice où je faisais mes classes avant de connaître Louis Jouvet.
Dès le début de 1940, Robert écrivait à sa femme : « Il va falloir faire des économies, à cause de la guerre les affaires vont beaucoup baisser. » Ainsi il ne lui envoyait guère d'argent pour vivre avec leur fils. A « Retirance », Cécile commença par retourner la terre pour faire pousser des légumes et du grain. Elle acheta des poules, des poulets, des œufs à couver, une couveuse artificielle à pétrole qu'elle avait pu avoir d'occasion et commença à faire de l'élevage, seule avec son fils de six ans car Adrien était trop vieux et Manon trop paresseuse. Cela dura quelques mois, mais la guerre commentait à bouger et l'on se demandait si l'Italie toute proche ne se mettrait pas de la partie. Le poète André Verdet, un ami très cher, et sa famille insistaient pour que Cécile se réfugie à Saint-Pons, minuscule petit hameau près de Gréolières où ils avaient une maison.
*
Pendant ce temps, Robert qui, comme toujours, lui écrivait lettre sur lettre, au moins une par jour quand ce n'était pas deux... et en recevait autant, continuait à faire vivre sa maison d'édition, ayant même ajouté de nouvelles revues patriotiques [Notre Combat] ; mais fulminait contre la censure qui confisquait tout son courrier et le conservait un temps infini. Il avait besoin d'exploser et, ne pouvant le faire, faute de voir les autorités compétentes, prit sa femme à témoin en une longue lettre que voici :
« Comme je te le disais hier, ma chérie, me voilà de nouveau privé de tout ou partie de mon courrier selon les jours et les heures. J'ai fait mener une enquête par plusieurs de mes amis et ces enquêtes n'avaient pas abouti. L'un d'entre eux vient d'arriver à la source de mes ennuis, à l'endroit même où mon courrier subit une purge qui varie entre trois semaines et quatre jours. Là enfin, on était au courant, on savait ! Il parait que je suis soupçonné d'activités anti-nationales. C'est incroyable mais c'est comme ça. Depuis douze ans je passe ma vie à servir les idées, le goût et la culture françaises, j'aide les jeunes écrivains, je crée une firme d'édition justement renommée, mais entièrement vouée aux lettres françaises ; je n'ai même pas comme mes confrères de rayon de littérature étrangère. Je n'aime pas publier de traductions, tu le sais. Je suis entouré de l'estime, parfois même de l'amitié de tout ce qui a un nom dans la littérature. Demain, je trouverais dix cautions de ma moralité, de mon attachement à la France, et sur la foi d'une dénonciation calomnieuse - du moins je suppose qu'il ne peut en être autrement - on me tient pour suspect. Et cela au point que l'on m'a retiré ma carte de circulation. C'est-à-dire que actuellement je ne peux plus sortir de Paris !
Depuis la guerre mon activité n'est pour ainsi dire que nationale. « Notre Combat » qui a l'approbation de toute la presse, de toute l'opinion, du Grand Quartier Général, du ministère de l'Information, a dû, ou susciter des jalousies mal fondées car « Notre Combat » est loin d'être une afffaire brillante !, ou être soupçonné d'abriter on ne sait quelles machinations. C'est invraisemblable, ahurissant, tout ce que tu veux, mais c'est comme ça. L'ami qui s'est occupé de la question n'a eu de rapport qu'avec un officier subalterne. Il a demandé un rendez-vous avec son supérieur pour mettre les choses au point dans le plus bref délai. S'il n'y arrive pas, je vais aller voir l'Ambassadeur de Belgique pour lui demander de faire une démarche officielle.
A côté de« Notre Combat » j'ai publié deux brochures, un Gamelin [par Maurice Percheron] et un Ct Verdun [Face à l'ennemi], une brochure sur Les atrocités allemandes en Pologne [par Antonina Vallentin] et un livre intitulé Une Finlandaise dans la tourmente [par Maïre Inkinen] que tu as dû recevoir ces jours-ci. Les deux volumes publiés avant la guerre [Paul Vialar. La Rose de la Mer et Jean Rogissart. Le Fer et la forêt] et qui ont eu les prix littéraires, ne font pas à proprement parler partie de mon activité de guerre. Je puis donc dire que mon activité de guerre est entièrement consacrée à servir la cause des alliés et de la France, à répandre les idées qui sont à la base de toute l'action gouvernementale. Mieux que cela, dans deux ou trois jours, Roger Giron, chef des services de la presse à la Présidence du Conseil, me remettra le texte d'une étude sur M. Paul Reynaud, étude approuvée par le Président, cela va sans dire - qui paraîtra dans la collection « Les Grandes Figures d'Aujourd'hui » [non parue].
Je me trouve donc dans la situation suivante : le Président du Conseil honore ma firme en y laissant publier par un de ses collaborateurs immédiats une étude sur sa carrière. Le ministre des Colonies encourage ma revue en faisant distribuer des numéros aux troupes coloniales. Le G.Q.G. fait pareil pour les troupes métropolitaines. Le ministre de l'Information souscrit des numéros de ma revue pour ses Centres de Documentation en France et à l'étranger. Et d'autre part, dans le même moment, un service indépendant de ces Ministères, me brime d'une manière extrêmement pénible, dérange toutes mes affaires, me vaut mille avanies de la part de mes correspondants, s'acharne contre ma vie privée en retardant tes lettres et contre la vie commerciale qui est entièrement bouleversée.
Comment ne pas voir là une vengeance, une machination ? Si je suis suspect, que l'on m'interroge, que l'on m'accuse ! Mais pourquoi ces mesures vexatoires ? Pourquoi des lettres commerciales émanant de firmes connues traînent-elles 15 jours dans des dossiers avant de m'être remises ? Je te pose ces questions, non pour que tu y répondes. Je me parle un peu à moi-même aussi. Tu n'imagines pas à quel point cette histoire me tracasse, je pourrais dire me hante. Télégraphies-moi ou essaie encore les lettres recommandées. Au revoir, Amour, je suis désolé de n'avoir que des tracas à te raconter, mais enfin j'espère qu'on me rendra bientôt justice. Je t'embrasse bien tendrement. Robert. »
*
Enfin arrivés à Souillac, Cécile et son fils furent heureux de retrouver Jacqueline, la femme de Billy [Ritchie-Fallon], qui avait été catapultée là avec tout le personnel de la maison qui l'employait. On leur trouva une chambre chez Madame Chassaing, aubergiste du cru. Mais les Allemands arrivaient à grands pas à travers la France. Cécile se trouva absolument sans ressources pour faire vivre son fils, payer sa chambre et se nourrir elle-même. Elle n'avait plus de nouvelles de Paris d'où d'ailleurs Robert était reparti à nouveau à la recherche de son régiment fantôme dont nul ne savait où il était passé.
Certains journaux avaient ouvert à leurs lecteurs une rubrique permettant aux familles dispersées de tenter de se retrouver. Toujours sans nouvelles de son époux, Cécile mit des annonces pour demander à tous les amis, à tous les auteurs de la maison, à tous ceux qui connaissaient Robert de donner de leurs nouvelles et, bien entendu, elle donnait son adresse. De son côté, Robert cherchait sa femme qu'il ne savait pas arrivée à Souillac, écrivait partout au hasard. Tout le monde cherchait tout le monde.
Des réponses, Cécile en reçut. Un stock ! Je lis dans le tas :
De Luc Dietrich : « Donnez-moi de vos nouvelles ma petite Cécile. Êtes-vous bien, en bonne santé ? Et Robert où est-il ?... »
De Wladimir Pozner : « Des amis ont découpé, à mon intention, votre petite annonce [...] où est Denoël ? J'ai eu de ses nouvelles pendant la retraite : un sergent qui le connaissait, lui, et me connaissait, moi, m'a dit qu'il était à Montpellier. Est-ce vrai ? Y est-il toujours ? Est-il démobilisé ? Que compte-t-il faire ?... »
De Serge Moreux : « Je suis dans la désolation de votre séparation volontaire au début par le souci de garer ce petit monstre adorable de Fifou mais qui tourne à la peine obligatoire... »
Des lettres charmantes, adorables, mais quant à savoir où était Robert, bernique ! Ici, j'anticipe pour citer quelques passages d'une lettre, assez drôle dans son ensemble, qu'Aragon écrivit à Robert lorsqu'enfin celui-ci avait retrouvé femme et enfant à Souillac :
« Cher ami, votre lettre du 20 m'est arrivée le 26. Elsa a écrit aussitôt à Cécile et à vous une lettre qui dit au fond ce que je voulais vous écrire. Mais comme vous êtes un distrait vous aviez simplement oublié l'adresse, votre adresse, un timbre postal effacé nous a appris que vous étiez à Souillac, sans plus. Ce qui fait que le mot d'Elsa risque de ne pas vous arriver, pour adresse incomplète. Là-dessus, hier, dans Le Journal, tout à fait par hasard tombé entre nos mains, E[lsa] a découvert une annonce mise par une certaine Mme Robert Denoël, avec adresse complète. Alors je vous récris.
Je n'ai, dans mes voyages, rencontré qu'un neveu d'André Gide avec qui j'ai fait jadis ma philosophie (le neveu, pas Gide). Puis la guerre finie, à Javerlhac (Dordogne) j'ai vu arriver ma femme sans crier gare : avouez qu'il n'y a qu'elle pour savoir faire ça, elle s'était promenée sur les routes cherchant quelqu'un qui portât le soleil d'Austerlitz, insigne de ma division, et elle avait trouvé mon général...[...] Pour ce qui est de la plaque de marbre des Editions Denoël, apprenez que je porte désormais la croix de cette guerre à côté de celle de l'autre (citation à l'ordre de la brigade). Encore deux ou trois guerres, et je ferai un excellent portier de boîte de nuit. Il me plaît que vous pensiez au théâtre, et ne désespériez pas de la scène française. Qui voyez-vous dans « Le Maître de Ballantrae » ? [Pour tromper le temps, Robert avait écrit une pièce de théâtre d'après le roman de Stevenson]. Nous embrassons Cécile, Finet et vous. Et à bientôt, bien affectueusement. A. »
*
Cécile se demandait si elle reverrait jamais Robert. L'Armistice était signé. Le courrier n'avait pas cessé de circuler. Mal, mais il y en avait. Robert, qui avait tant insisté dans ses télégrammes pour qu'elle aille à Souillac avec le fils, aurait bien dû essayer de lui écrire, de la faire contacter. Mais rien. RIEN ! Elle avait su que son frère Billy, qui était Anglais puisque né au Cap de père anglais, avait pu rejoindre les îles britanniques, sans savoir encore qu'il était engagé dans la Royal Air Force dont il allait devenir l'un des héros. Elle ne pouvait rester jusqu'à la fin de sa vie à faire la cuisine en attendant la venue improbable de Robert. Comme tout le monde elle avait entendu parler de ce fameux appel du 18 Juin. Peut-être était-il parti ?
Ayant pesé le pour et le contre, Cécile avait décidé de partir, elle aussi, avec son fils et Jacqueline, en Angleterre où elle avait de la famille qui lui permettrait sans doute de retrouver Billy et, par lui, Robert. Une filière était possible. Elle avait tout organisé dans le moindre détail. Il fallait profiter de partir avant que les allemands envahissent toute la France malgré le traité.
C'était donc bien décidé : le départ était pour le lendemain. Le lendemain, Robert arrivait tout naturellement, frais et rose, le sourire aux lèvres.
*
Robert resta quelque temps à se reposer de ses randonnées en zig-zag. Il en profita pour terminer son «Maître de Ballantrae» et envoyer des lettres dans tous les azimuts. Parmi les réponses, une lettre d'Elsa Triolet dont je ne puis résister au plaisir de citer quelques lignes, tant cela donne l'atmosphère de l'époque. Elle est datée du 27 Juillet (1940) :
« J'ai pu retrouver Louis après à peine quelques miracles et nous sommes ensemble depuis le début du mois. Il va fort bien, mais a les tempes tout à fait blanches et l'allure d'un général en retraite et certainement dans le besoin. Il ne sort jamais sans une canne à manche d'ivoire, cadeau d'un curé, en Belgique. Cela fait qu'avant de voir ses galons tout le monde salue ce noble militaire qui a tout perdu sauf l'honneur... Javerlhac est un petit pays charmant, bien plus petit que Souillac, mais il pleut que c'est un scandale, surtout quand on n'a pas autre chose à faire que de se promener. D'ailleurs je m'entends mal avec la campagne, je deviens laide, grasse et j'ai peur des vaches. [...] qui sait, peut-être irons-nous ou viendrez-vous nous voir et nous écouterons la pièce « Le maître de Ballantrae ». Comment allez-vous Cécile ? La santé ? Finet doit être plus grand que moi ! Toujours aussi merveilleusement blond ? [...] »
Mais, comme Elsa, Robert s'ennuyait à la campagne. Il ne tenait plus en place. Un jour, tout à trac, il décida : «Il faut que je rentre à Paris, que je rouvre la maison ; il y a certainement beaucoup de travail qui m'attend. »
- Tu as raison. Rentrons.
- Non, je préfère que tu restes encore un peu ici avec le Finet. Il faut que je voie comment la vie peut s'organiser avec l'occupant. Dès que tout sera arrangé, vous viendrez tranquillement. »
Et, de nouveau, Cécile se retrouva seule avec son fils.
*
Robert avait pu passer assez facilement. La circulation était relativement aisée pour les démobilisés qui rejoignaient leur domicile. Mais cela n'allait pas durer et la ligne de démarcation qui séparait la France en zone occupée et zone « nono » (non occupée) allait très vite se renforcer.
Cécile recevait des nouvelles assez pessimistes. Lorsqu'il était arrivé à la maison d'édition, Robert avait trouvé les locaux bouclés, les scellés sur la porte et un avertissement en grosses lettres et en deux langues : « Défense d'entrer sous peine de mort ». Cela, certainement parce que, dès le début de la guerre, il avait publié des livres patriotiques et cette fameuse revue Notre Combat qui n'était pas tendre pour les Allemands.
Parmi les principaux articles publiés dans cette revue hebdomadaire, on pouvait lire : « Journal d'un Crime », «La menace aux civils», « La Propagande allemande », « Les chefs nazis. Portraits impitoyables de Hitler, Goering, Goebbels, Ribbentrop et Hesse », « La Gestapo », « Hitler peint par lui-même », « L'ouvrier au pays de Hitler et de Staline », « Les persécutions allemandes contre les catholiques », « Ce que prépare Hitler en Pologne », « Barbares et Musiciens », etc. Il en était paru trente-six numéros, tous plus explicites les uns que les autres. Le dernier que j'ai sous les yeux est intitulé « Les Horreurs de l'Invasion » ; il est daté du 24 mai 1940 ; hélas ! nous n'allions pas tarder à connaître ces horreurs : les bottes teutonnes arrivaient.
Mais l'occupant avait besoin que la vie reprenne « presque normalement » en France et, quelque temps après, la quasi totalité des éditeurs retravailla « presque normalement », chacun sans exception devant payer son tribut à la littérature allemande.
Pour sa propagande, l'occupant avait aussi parfois un geste spectaculaire pour montrer à quel point il était humain, compréhensif et même presque gentil (!) C'est ainsi qu'il avait donné trois jours aux habitants de Paris qui avaient de la famille en zone « nono » pour aller la chercher et la ramener au bercail.
Cécile avait espéré et attendu. En vain. Robert écrivit qu'il lui avait été impossible de venir la chercher parce qu'il se sentait fatigué. En fait, elle sut plus tard qu'il était bien venu en zone libre... mais pour chercher Thérèse, sa maîtresse d'alors, et le petit Jacques qu'elle avait déjà d'un inconnu lorsqu'il avait fait sa connaissance, quelques années plus tôt.
Après quoi, ayant quand même besoin de sa femme pour l'aider dans son travail, il lui écrivit de se débrouiller pour revenir à Paris. Mais cela était devenu beaucoup plus difficile, surtout pour les étrangers. On voulait bien la rapatrier en Belgique avec son fils ; mais pas question pour elle de revenir à Paris.
- Pourquoi votre mari n'est-il pas venu vous chercher lorsque les autorités d'occupation en ont donné la possibilité?
- Il n'a pas pu venir. Voyez sa lettre : il était souffrant.
- Il aurait quand même pu faire un effort. Désolé, je ne peux rien pour vous.
Robert s'énervait, insistait, ne comprenait pas qu'avec sa débrouillardise, elle ne pouvait le rejoindre :
« Mon chéri, Après la visite du brave garçon qui est venu m'apporter ton mot et tes nouvelles, je ne comptais plus guère sur ton retour pour le 19. Hier soir, cependant, j'ai eu une émotion en entendant à plusieurs reprises la sonnerie de la porte de l'immeuble. Faux espoir ! Et je me suis couché tristement dans cette chambre si grande et si vide quand tu n'y es pas. Il faut absolument que tu rentres, vous ne pouvez pas vous éterniser à Souillac. Tout le monde rentre à Paris, et je ne comprends vraiment pas comment tu n'as pas pu te débrouiller. Dis-toi bien que les autorités allemandes sont beaucoup plus complaisantes qu'on ne le dit en région libre. En plus, avec un enfant, tu as une sauvegarde.
Puisque tu ne parviens pas à monter dans un train à Souillac, ce qui n'a pas fini de m'étonner, tu vas aller à Brive. Je pense qu'il n'existe aucune difficulté pour se rendre à Brive par le train ! Là tu iras à la sous-préfecture, tu demanderas à voir le sous-préfet personnellement et tu lui remettras la lettre ci-incluse. Je veux être pendu par les ongles si ce sous-préfet ne te délivre pas sur l'heure un ordre de mission en bonne et due forme qui te permettra de prendre un train-poste - en payant ta place - et qui t'amènera sans difficulté et probablement dans la journée, à Paris.Tu diras à ce sous-préfet que tu es la femme de l'éditeur et que comme telle ta présence est indispensable à Paris. Ton charme naturel fera le reste... [...] j'espère rouvrir ma maison le 1er octobre. En attendant, je travaille aux « Trois Magots » avec Collet, Picq et Georges. Ce n'est pas drôle, rien n'est drôle, mais j'ai les plus solides espoirs. Je pense donc que tu vas faire des pieds et des mains pour arriver au plus tôt. Ta place est ici. [...] Fais mille amitiés autour de toi, embrasse le chéri et pars pour Brive au reçu de cette lettre [...] Je t'embrasse, bien impatient, bien pressé de te revoir, follette, bien désireux de te tenir dans mes bras. Robert. »
Et il ajoute : « Si tu ne vois pas le sous-préfet, demande le Secrétaire Général de la Préfecture. Dis-lui que je suis l'éditeur de Pierre-Jean Launay, très connu dans la région. Si tu n'obtiens rien, vas voir le directeur du journal local, dis-lui la même chose, tu dois réussir. »
Cécile alla à Brive, à Tulle, partout. Elle vit le sous-préfet, le préfet, les directeurs de journaux. Tous la reçurent aimablement mais ils se moquaient bien que l'éditeur ait besoin de sa femme et, toujours très aimablement, lui dirent leur impuissance quant à l'aider, en tant qu'étrangère, à rejoindre Paris. Tous reconnaissaient son charme jusqu'à faire parfois des avances non dissimulées et tenter de prouver que leur impuissance n'était pas sur tous les plans ! Quant à elle, si elle usait de ce charme naturel, elle ne l'aurait pas poussé jusqu'à se vendre au plus offrant pour rejoindre son mari. Il y eut même quelque soufflet bien appliqué qui ne facilita pas les choses.
En fin de compte, c'est par hasard et tout près de Souillac qu'elle trouva la clef qui devait lui ouvrir la voie : la sympathie d'un vénérable membre d'une société fraternelle lui permit, grâce à de faux papiers et à toute une chaîne de sympathisants, de franchir sans encombre et avec son fils la ligne de démarcation si bien cadenassée ; puis d'arriver dans les bras de son époux au moment où celui-ci désespérait de la revoir jamais.
Combien de fois, durant l’Occupation, voyagea-t-elle sans laissez-passer pour aller voir sa maman en Belgique. Et toujours avec son fils. Elle en ramenait des victuailles pour toute la maisonnée. Le Bon Dieu devait être avec elle car jamais elle n’eut la moindre anicroche. Et pourtant, voyager à cette époque et passer les frontières, même avec des papiers en règle, n'était pas toujours facile !
*
Elle avait commencé à voyager dès sa plus tendre enfance. Lorsqu'elle était arrivée au Cap de Bonne Espérance à l’âge de cinq ans, elle avait déjà parcouru l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Bulgarie, la Pologne, toute l’Europe jusqu'aux. confins de la Russie. Et comment, demanderez-vous ? Dans le train comme tout le monde ? Non ! En roulotte avec un cirque ! Ni enfant de la balle, ni gamine volée par des saltimbanques. Non. Mais il y a un peu de l'un et de l'autre : sa maman voulait soustraire Cécile à la famille de son père. Je dis bien de son père et non de son daddy dont j'ai déjà parlé. Le papa de Cécile, c'est toute son enfance et son adolescence heureuses dans le plus beau pays du monde : l’Afrique du Sud.
Son père, elle l’a à peine vu avant son retour d’Afrique. C'est lui qui ressemblait tant à Carbone le gangster ; peut-être parce que, comme lui, il avait une ascendance corse. Celle de Carbone je ne la connais pas, mais celle du père de Cécile est plus célèbre puisque sa grand-mère était une demoiselle Bonaparte. Ce qui fait que la petite Cécile descendait, par son père, de l'un des frères de Napoléon. Est-ce de Joseph ou de Jérôme ? Luc Dietrich, qui avait commencé des recherches généalogiques, aurait pu le dire exactement, mais il fut mortellement blessé à Saint-Lô, lors d'un bombardement alors que, justement, il remontait chez lui pour sauver ses papiers et les emmener dans l'abri anti-aérien.
Cécile est une arrière-arrière-petite-nièce de l'Empereur et, lorsqu'étant petite il lui arrivait de tenir tête à sa mère, celle-ci la réprimandait en l'appelant « petit caporal » comme pour lui reprocher d'être la fille de son père. Mais nous n'en sommes pas encore là : Cécile était encore une toute petite poupée lors de son enlèvement... car elle fut enlevée ! Enlèvement, contre-enlèvement et tout ce qui les précède ; c'est tout un mélodrame digne des romans de Pierre Decourcelle ou d'Adolphe Dennery !
L'histoire se situe à Liège, en Belgique, et plus précisément dans le quartier d'Outre-Meuse. Cela avait commencé bien avant la naissance de Cécile. Les parents de son père y étaient pour beaucoup ; le caractère très entier de sa maman, plus encore.
Walthère Brusson, le géniteur, était ce que l'on peut appeler un beau mâle. Dix-neuf ans, la moustache conquérante comme il seyait à un don juan en ce début de siècle. Nous sommes en 1905. Très fier de sa carrure, de sa prestance et d'un je-ne-sais-quoi qui plaisait aux filles parmi lesquelles il faisait des ravages. Le beau Walthère avait le succès facile et ne se gênait pas pour en profiter.
[ S'ensuit le récit des amours contrariées d'Elvire Herd et de Walthère Brusson, qui aboutit à la conception de Cécile, qui naît le 19 septembre 1906 ]
Walthère reconnut sa fille devant Monsieur l'Echevin Valère Hénault, officier de l'Etat Civil, mais, malgré l'amour qu'elle éprouvait et conserva toute sa vie pour Brusson, la belle Elvire refusa d'épouser celui qui avait été capable de lui faire ça !
De tout ceci, Cécile n'avait jamais parlé à personne sauf, bien entendu, à ses deux époux. Si j'en parle aujourd'hui, c'est parce qu'elle avait décidé d'en parler elle-même sous le titre « La Bâtarde » [Une partie des pages précédentes est écrite d'après une cassette que, déjà très fatiguée, Cécile avait enregistrée avec moi le 18 Juillet 1979]. La maladie puis son départ pour l'autre monde, ne lui ont pas permis de mener à terme son projet.
*
Pour élever sa fille sans être à la charge de qui que ce soit - car sa fierté était plus grande encore que son sens de l'honneur - Elvire travailla ; elle en avait l'habitude. Et que fit-elle ? Un métier qui nous semble absolument incroyable aujourd'hui mais qui existait encore à cette époque et dans ce vieux quartier de Dju-d'-là (Outre-Meuse, quartier populaire de Liège) à peine sorti du moyen âge : elle vendait de l'eau chaude à toute heure, comme l'indiquait la pancarte écrite à la main et affichée à la porte de sa petite échoppe simple et proprette où l'on accédait en descendant deux ou trois marches.
Ainsi Elvire élevait son enfant. Honorablement. Quant à Walthère, il faisait son service militaire ; il revenait rarement, ce qui lui évitait de se faire rabrouer et de risquer de recevoir des casseroles d'eau bouillante !
Cependant, même si Walthère, devenu méfiant depuis l'histoire de la plate-buse, ne pouvait obtenir d'Elvire qu'elle daigne accepter d'échanger les alliances, la petite Cécile portait officiellement le nom de son père puisqu'il l'avait reconnue.
[S'ensuivent d'invraisemblables péripéties où les parents du géniteur Brusson veulent enlever la petite Cécile, qui vit chez les parents d'Elvire Herd, laquelle décide de quitter Liège]
Saisissant la première occasion qui se présentait, elle partit à Neufchâtel, en Suisse, comme dame de compagnie chez une vieille dame adorable qui la prit immédiatement en affection et considéra la petite Cécile comme sa propre petite-fille. La vie s'écoulait douce et agréable, un peu morne peut-être pour la nature d'Elvire qui était de vif-argent et ne pouvait tenir en place. A vingt-et-un ans, elle avait besoin de dépenser ses jeunes forces. Cela dura cependant assez longtemps pour que Cécile garde à tout jamais, de Neufchâtel et de la vieille dame, un souvenir merveilleusement ému qu'elle évoquait encore devant moi soixante-dix années plus tard.
Cécile avait environ trois ans lorsque sa maman décida de quitter la Suisse pour suivre le cirque Hagenbeck de passage dans la région et où elle avait retrouvé des amis de son frère Henri. Que pouvait faire Elvire dans un cirque ? Mais justement dépenser ces jeunes forces qui bouillonnaient en elle et reprendre un entraînement d'athlète, rare chez une femme, surtout à cette époque. Elle était capable de porter douze hommes, et non des moindres, en une pyramide humaine dont elle était la base et le soutien. Petit détail : Elvire Herd mesurait près de deux mètres (Son passeport britannique de 1919 précise 6 pieds 1 pouce [soit 1 m 85]) et était taillée en proportions ! C'est ainsi qu'avec sa maman, la petite Cécile fit, avec un cirque, le tour de l'Europe et alla jusqu'en Russie qui semblait alors être le bout du monde. Trottinant de-çi de-là, elle s'habitua à cette atmosphère enivrante d'un monde très particulier, et à la compagnie des animaux pour lesquels elle éprouvait déjà une grande tendresse.
*
On s'étonnera peut-être de voir Elvire partir avec un cirque et surtout de sa force herculéenne. Il faut dire que son père Guillaume Herd, qui était un curieux homme, possédait une brasserie qu'il avait nommée « Café des Lutteurs » parce que le sous-sol y était aménagé en salle d'athlétisme où s'exerçaient un groupe de jeunes hommes, dont Nicolas et Henri, frères d'Elvire, qui leur servaient de partenaires. Ils étaient particulièrement bien bâtis et d'une force peu commune. Nicolas, l’aîné, surtout semblait avoir un avenir pugilistique de grande classe ; mais peu à peu son petit frère Henri se tailla une place de choix dans la lutte gréco-romaine, un ancêtre de notre catch actuel, autrement difficile, raffiné, mettant en valeur la beauté plastique, mais exigeant plus de véritable force musculaire que de force nerveuse.
Il fonda un groupe de jeunes lutteurs qu'il produisit ici et là à travers l'Europe, puis à travers le monde, passant lui-même en vedette sous le nom qu'il avait adopté à son premier retour d'Amérique : Constant le Marin. C'est sous ce nom que le monde entier l'a connu et a chanté ses louanges, lui décernant tous les prix jusqu'à celui, qu'il garda durant toute sa carrière de Champion Universel (champion du monde toutes catégories) de lutte gréco-romaine.
Sa célébrité lui ouvrit toutes les portes ; il était l'hôte et le commensal des souverains de l'époque. Alphonse XIII, roi d'Espagne et Nicolas II, tsar de toutes les Russies se vantaient d'être ses amis et le recevaient volontiers à leur table, heureux de connaître, de côtoyer cet être colossal digne de la statuaire antique.
Durant la guerre 1914-1918, ses exploits invraisemblables étaient connus de tous et il fut considéré dans son pays comme une gloire nationale ; on voyait des timbres à son effigie. N'avait-il pas, à lui seul, repris aux Allemands une place-forte en empoignant une lourde mitrailleuse (les mitraillettes n'existaient pas encore) et, chargeant sus à l'ennemi en tirant dans le tas. Gravement blessé à la jambe, il continua sa carrière la guerre terminée en portant un collant rembourré pour masquer sa blessure.
*
Etre hors nature, Constant le Marin fut le parrain de sa nièce Cécile, née de l'union éphémère de sa sœur Elvire et de l'un des jeunes gens qui s'entraînaient avec lui dans les caves du « Café des Lutteurs » : Walthère Brusson, descendant des Bonaparte !
Ce Walthère aussi était d'une force herculéenne ; il faisait « le Christ sur deux doigts » : entre deux barres parallèlement placées, assez écartées pour que seules ses mains y puissent prendre appui lorsqu'il avait les bras en croix et fixées bien au-dessus du sol. Dans cette position inconfortable, il repliait l'un après l'autre chacun de ses doigts pour rester ainsi, bras en croix à deux mètres du sol appuyé seulement sur une phalange du médius de chaque main. Connaissez-vous beaucoup d'athlètes capables de le faire ?
Qui s'étonnera, après cela, que durant sa jeunesse, Cécile décrochait au passage tous les trophées sportifs dans les catégories les plus diverses et qu'elle devint, peu après son mariage, une escrimeuse redoutable ?
*
Si Cécile avait une infinie tendresse pour sa maman, elle ressentait une grande vénération pour ses grands-parents. Je me souviens de son immense chagrin lorsqu'elle apprit la mort de sa grand-mère en fin de l'année 1936 ; très peu de temps avant que je perde ma maman à moi. Mais comme ces deux chagrins sont liés, je ne veux pas en parler.
Lorsqu'après l'armistice de 1918 Cécile revint d'Afrique en Europe pour voir sa famille, elle fut horrifiés par les atrocités dont avaient souffert les siens. Il faut dire que les Uhlans de la Mort ont laissé d'affreux souvenirs en Belgique et dans le Nord de la France. Dès ce jour elle décida d'oublier totalement la langue germanique de ses ancêtres et si, parfois, je l'ai surprise à lire Schiller et Goethe dans le texte, jamais je ne lui ai entendu prononcer un mot d'allemand.
*
Et, malgré moi, cela au nous ramène à l'époque de l'Occupation où, quoi que l'on en ait dit plus tard, chacun essayait de vivre et de faire son trou en attendant que passe l'orage. Robert Denoël qui, depuis le départ de Bernard Steele, cherchait un associé-commanditaire, finit par en trouver un. A cette époque, celui-ci ne pouvait être, comme Bernard, israélite et américain ; il n'y avait pas le choix. Mais il eut le bonheur de tomber sur Wilhelm Andermann, éditeur d'art à Munich, ce qui lui permettait de ne pas afficher ses opinions qui, comme celles de beaucoup d'autres bavarois, ne suivaient guère les thèses du Führer.
Andermann était un homme du métier, absolument charmant et prévenant. Cette association fut, mises à part les gamineries de jeunesse, aussi agréable que celle avec Bernard Steele. Avec Robert il parlait un français teinté de l'accent de Bavière qui rappelait à Cécile le parler chantant de sa grand-mère bien-aimée. Avec elle, il parlait un anglais impeccable.
Comme elle le faisait depuis tant d'années, Cécile continuait à recevoir à sa table auteurs, amis et relations d'affaires. Immanquablement, parmi ceux-ci se trouvaient des Allemands ; un ostracisme eût été suicidaire. Mais elle avait prévenu son mari : « Chez moi, on ne parle pas l'allemand et je refuse de recevoir quiconque porterait l'uniforme. »
Robert avait pensé que cela ne simplifierait pas ses affaires ; bien au contraire, cette fermeté plut beaucoup à ces messieurs dont certains étaient heureux de reprendre pour quelque instant une vie civile qu'ils regrettaient d'avoir dû abandonner. Bien qu'aucun ne parlât jamais politique « chez Madame Denoël », on se rendait facilement compte qu'un grand nombre d'entre eux, surtout chez les intellectuels, ne suivaient pas volontiers les idées de leur chef forcené.
Un soir, invité a dîner, le lieutenant Friedrich arriva avec quelques minutes de retard. C'est lui qui faisait passer de temps à autre en Angleterre un message de Cécile à son frère Billy, alors Flying-Commander dans la R.A.F. Marie Mich' (Marie Michel, la femme de chambre qui servait aussi à table ; ce nom pour la distinguer de l'autre Marie, la cuisinière que l'on appelait Marika) lui ouvrit. Il était en uniforme.
- Bonjour monsieur. Si vous voulez bien attendre un moment dans l'entrée, je vais prévenir Madame. Cécile arriva : « Oh ! »
- Excusez-moi, chère madame, j'étais en service. Si j'avais dû rentrer me changer, je serais arrivé beaucoup trop en retard. Je suis navré.
- Attendez. Tournez-vous. Bon, cela va aller. Entrez dans la chambre d'amis, je vais voir si un costume de mon frère pourrait vous aller.
Il était fort élégant lorsqu'il arriva au salon parmi les invités.
*
Dès le début de l'Occupation, la Propaganda-Staffel tint très vite en mains la majorité des journaux de la zone occupée et avait l'œil rivé sur les éditeurs qui n'eurent le droit d'exercer leur métier et d'obtenir le papier nécessaire que s'ils étaient bien gentils et bien disciplinés. J'y ai fait une courte allusion déjà. L'office allemand laissait les éditeurs libres... de choisir, à date fixe, pour les éditer, trois ou quatre ouvrages dans une liste établie par la Propaganda. A l'une de ces convocations, je veux dire : à l'une de ces « invitations », Robert arriva, l'œil malicieux et le sourire, un peu ironique, aux lèvres.
[S'ensuit la rencontre improbable avec les autorités allemandes, durant laquelle Denoël, faisant fi des titres imposés, propose d'éditer les discours du Führer, ce qui provoque leur stupeur]
Le livre parut le 21 Mai 1941 et, Denoël étant devenu l'éditeur du chef suprême, on devint un peu moins exigeant avec lui qu'avec ses confrères : si vous comparez son catalogue avec ceux des autres éditeurs, vous y trouverez moins d'ouvrages allemands. Les maîtres de la Propaganda-Staffel devinrent moins « pinailleurs », laissant parfois passer ce qu'il n'auraient pas accepté d'un autre. Peut-être est-ce à cause de cela que l'on fit de lui, après la Libération, le bouc émissaire de la collaboration dans le monde des Lettres. La jalousie fait dire et faire tant de choses !...
Mais cela lui permit, entre autres, de publier en 1942 Mille Regrets d'Elsa Triolet dont nul n'ignorait qu'elle était russe, d'origine juive, épouse et collaboratrice d'un communiste notoire : Louis Aragon. Toutes choses qui auraient dû normalement mener son éditeur au poteau d'exécution.
*
Malgré toute la tendresse que je n'ai cessé d'éprouver pour lui, je n'irai pas jusqu'à dire que Robert était tout blanc et pur comme un petit ange aux ailes roses ; non ! Il était exactement comme tous les autres, ni plus, ni moins. Seulement voilà : il était sans doute plus naïf et n'a pas pensé à protéger ses arrières comme d'autres l'ont fait, affirmant, preuves à l'appui car ils avaient eu la prudence de faire établir des reçus ou des lettres explicatives, qu'ils avaient aidé la Résistance. Robert, lui, se contentait d'aller en province voir ses auteurs, notamment les Aragon, pour leur porter des subsides dont il savait qu'une bonne part servait aux F.T.P. Mais ne tentons pas de refaire l'Histoire, cela ne ramène pas les morts. Les dessous de l'Histoire et les renseignements que l'on a « de source sûre » se fondent parfois sur des ragots ou sur une intoxication organisée pour des intérêts particuliers. Et ils ont la vie dure.
*
Pour en revenir au sujet qui m'occupe, je prends ici pour exemple le soi-disant divorce de Cécile et de Robert. Tout dernièrement, Marc Laudelout, jeune fondateur de La Revue célinienne, me posait ces deux questions au sujet de Robert Denoël : « Savez-vous quand il se sépara de Cécile Denoël ? Et ce que fit votre épouse durant les années de séparation ? » J'ai d'abord souri en lisant cela : Laudelout n'était pas né au moment du drame ; il ne pouvait pas savoir. Mais très vite j'ai pensé que cela devait refléter une « information » largement répandue.
Beaucoup de personnes ont dit ou pensé que Robert et Cécile avaient divorcé ; qu'importaient les ragots, ils se moquaient bien l'un et l'autre des qu'en dira-t-on ! Cependant, le bobard avait fait beaucoup plus de mal qu'il ne semble. La famille de Robert l'avait cru au point qu'après l'assassinat, son indifférence frisait l'hostilité vis-à-vis de sa veuve. Attitude largement regrettée par la suite, je dois le dire, et même compensée plus tard par une affection très sincère. Mais en attendant...
Voyons les faits : Robert avait à l'époque une maîtresse en titre qui se prénommait Jeanne, comme avant il y avait eu Thérèse, comme avant... etc. etc. et, comme toujours, en sus de cela quantité d'aventures passagères. Cécile n'était pas une épouse complaisante, je l'ai déjà dit, mais elle aimait son mari qui l'aimait malgré toutes ses incartades. Selon l'expression de celui-ci : « Quand on a chez soi les meilleurs crus, il est agréable parfois d'aller boire une piquette sur le zinc d'un bistrot ». En fait, cela ne l'amusait pas toujours : « Ah ! vous avez de la chance, mon petit Morys, me disait-il parfois ; si vous saviez ce qu'elles me fatiguent à me tourner autour ! »
- Personne ne vous oblige à vous laisser aller...
- Il faut bien être poli, n'est-ce pas ? Et puis, j'ai ma réputation à soutenir.
Et il était sérieux en me disant cela. Ce qui ne l'empêchait pas d'adorer sa femme. « C'est un boomerang cet homme-là, me disait Cécile : il peut être lancé dans n'importe quelle direction, il me revient toujours. » Le plus beau de l'histoire, c'est que lorsqu'il avait un chagrin d'amour, il venait le raconter à sa femme ! Lorsqu'il avait conduit Thérèse au Portugal, il était revenu dare-dare auprès de sa femme pour se faire consoler.
Donc, vers la fin de la guerre, la maîtresse en titre était Jeanne. Alors que les autres jouaient « Back Street » et laissaient le pas à la légitime épouse, celle-ci avait tout fait pour en tirer le maximum et le tenir totalement à sa merci ; elle avait une grande expérience et ne jetait son dévolu que sur des personnages célèbres.
Jeanne avait hérité de son père une petite maison d'édition spécialisée à laquelle, au bout de peu de temps, Robert donna une certaine ampleur. Elle aurait même souhaité que Robert divorce afin de se l'approprier davantage, ce qui aurait bien arrangé ses affaires. Lui, selon son habitude, opinait du bonnet mais se gardait bien de faire quoi que ce soit dans ce sens.Très introduite dans les milieux de robe et pour cause : avant l'arrivée de Robert, elle n'éditait que des livres de Droit, elle insista pour qu'il voie un avoué de ses amis. Lorsque Cécile fut mise au courant, elle ne fit qu'en sourire : « Nous, divorcer ? Jamais ! »
Cependant Jeanne insistait tant que la vie de Robert devenait impossible. Pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec l'amour, elle et quelques amis firent pression sur lui jusqu'à ce qu'il amène Cécile à rendre visite à l'avoué. Cécile s'y rendit. La séance fut orageuse. Cécile partit en claquant la porte et rentra chez elle, furieuse.
Le Finet, la voyant dans un état d'exaspération peu commun, posa une question et s'entendit répondre cette phrase horrible qui s'inscrivit pour toujours en lettres de feu dans sa mémoire : «Ton père et moi nous divorçons »
Ce soir-là et le lendemain durèrent une affreuse éternité. Puis, par un pénible effort de volonté, Cécile se calma. Elle tenta d'analyser les faits. Robert n'était libre ni de ses paroles ni de ses actes, elle le sentait. Elle savait qu'il n'avait rien à lui reprocher. C'était un coup de folie passager, imposé sans nul doute. Il reviendrait.
Lorsque Robert avait téléphoné le matin à neuf heures, comme il le faisait chaque jour, Cécile avait raccroché sans l'entendre. Elle se le reprochait. Pourvu qu'il rappelle demain !... Effectivement le lendemain, à l'heure habituelle, le téléphone sonna. Après une courte hésitation, Cécile décrocha le combiné et attendit sans rien dire.
« Mon pauvre chéri, tu m'en veux ?... » - « Il y a de quoi, non ? » Robert lui expliqua qu'il n'avait pu faire autrement, qu'il n'était pas maître de son destin, qu'il ne pouvait pas tout lui dire...
- Et c'est une raison pour divorcer ?
- Non. Mais il faut le laisser croire. Je suis en train d'arranger les choses ; il y a derrière cela tout un fatras d'affaires où l'on a voulu m'engager mais dont je vais me sortir. Il faut laisser croire... rien ne sera changé entre nous ; cela n'engage à rien...
Cela, en effet, n'alla pas plus loin. Pour un divorce réel, il faut bien plus qu'un rendez-vous, si orageux soit-il, chez un avoué ! Mais cela semblait avoir suffi aux yeux de ceux qui désiraient, par intérêt, les désunir. Alors !...
Cependant, grâce à tout un jeu de relations, on fit courir le bruit du prétendu divorce et, après la mort de Robert Denoël, on alla même jusqu'à montrer des lettres que l'un ou l'autre aurait écrit. Les faux en écriture ont joué un grand rôle dans « l'Affaire Denoël ».
Les événements qui avaient précédé pouvaient donner un semblant de confirmation à la séparation. Cela se passait en 1945. L'année précédente, le débarquement allié avait renforcé à juste titre l'espoir des patriotes et la crainte des collaborateurs. Comme la plupart des autres éditeurs, Denoël aurait pu attendre les événements puis, ensuite, les décisions de la Commission d'Epuration qui, peu après sa mort, allait donner un avis favorable aux Editions Denoël. Mais de « bons amis » - vous savez : ces gens qui vous veulent du bien ! - donnèrent des conseils pernicieux à Robert : « Cache-toi, disaient-ils, sinon les résistants auront ta peau. »
Jusque là, il était tranquillement resté avec sa femme dans leur appartement de la rue de Buenos-Ayres, le Champ de Mars comme jardin, la Tour Eiffel comme voisine. Bien sûr il rentrait tard parfois, mais cela n'était pas nouveau et sa vie s'écoulait doucement en famille, à ceci près que, pour éviter au Finet les risques de bombardement, celui-ci vivait à Saint-Quentin-les-Anges, dans la Mayenne, chez Monsieur Laisné, instituteur et secrétaire de mairie.
Ce n'est qu'au mois d'août 1944, peu de jours avant la Libération de Paris, que Robert, devant l'insistance accrue de ses amis, quitta son appartement pour aller se cacher, non chez sa maîtresse, mais dans l'immense magasin où étaient entreposés les décors de l'Opéra-comique, chez les Lemesle, dont la fille Noëlle était la répétitrice de piano du Finet. Cécile quitta l'appartement au même moment et alla loger quelques jours dans un hôtel de la rue de Lille où logeaient déjà des amies.
Le 19 août commençait l'Insurrection de Paris. Le lendemain, à la demande de Robert, Cécile et moi venions nous installer dans mon appartement au 5 de la rue Pigalle, dont l'immense balcon donnait sur la rue Blanche et le clocher de l'Église de la Trinité toute proche. J'avais laissé cet appartement à mon père qui nous y accueillit avec joie : il y avait trois chambres et une salle à manger, cela suffisait largement.
C'est quelques jours plus tard que Robert quitta les décors de l'Opéra-comique pour aller, dit-on, habiter chez sa maîtresse. En fait, il avait loué, au nom de celle-ci par prudence, une garçonnière boulevard des Capucines, juste au-dessus du théâtre qui porte ce nom. Je connais parfaitement l'endroit et le Finet aussi, mais jamais nous n'y avons rencontré ni l'un ni l’autre la dame en question. Petit détail : dans l'encadrement de la glace qui surmontait la cheminée étaient fichées quantité de photos : de sa femme et de son fils ; aucune de l'autre personne.
[S'ensuit un chapitre où Cécile et Morys, l'un et l'autre « diplômés de la Croix-Rouge », soignent les blessés des batailles de rues du mois d'août 1944]
Mais revenons à Robert « qui avait quitté Cécile » durant les échauffourées et continua à habiter sa garçonnière jusqu'à son dernier jour. J'allais régulièrement l'y voir et, dès qu'il fut revenu à Paris, son fils y allait deux ou trois fois par semaine pour voir son père qui lui donnait des leçons de latin et de grec.
Il voyait certainement davantage sa favorite en titre et se montrait avec elle chez des amis communs, ce qui accrédita la rumeur de la séparation. Mais, tout aussi régulièrement, il venait déjeuner chez moi, avec ou sans invités. J'y ai déjà fait allusion : rappelez-vous l'histoire du linge sale ! Cependant, ces déjeuners quasi quotidiens ne suffisaient pas. Tous les après-midi, à cinq heures, Cécile et Robert se rencontraient, seul à seule, dans un café de l'avenue George V où il avait ses habitudes.
*
Il me faut donner quelques précisions sur les déjeuners de la rue Pigalle ; mais plutôt que d'en parler moi-même, je crois plus simple de laisser la parole à mon père en recopiant la majeure partie d'une lettre, datée du 16 décembre 1949, qu'il écrivait à Maître Rozelaar. Je ne change rien à son style parfois savoureux et direct ; je me contenterai d'y ajouter de temps à autre, en italique, des compléments d'information :
« Cher Maître,
En lisant un article de Paroles Françaises que Maurice vient de me montrer [numéro du 18.11.49 : il s'agit de l'un des nombreux articles inspirés par la partie adverse pour créer un climat d'opinion], j'ai sursauté devant certaines phrases et certaines affirmations qui s'y trouvent, et, entre autres :
1°) que Robert avait trouvé une aide pécuniaire auprès de Madame L... [Loviton].
2°) que Robert était en instance de divorce avec sa femme, que « ce divorce était décidé, que Mme Denoël l'acceptait, il le fallait bien, ayant accumulé depuis des années ce que les tribunaux appellent des injures graves »
3°) qu'elle n'a jamais été une compagne pour lui, etc.
Je vous assure qu'il suffit de les avoir vu vivre ensemble et travailler ensemble pour affirmer que ces gens en ont menti ; et je connais assez Cécile et Robert pour pouvoir l'affirmer. J'espère qu'un jour on demandera mon témoignage sur beaucoup de points, et je le donnerai sans mâcher mes mots car je n'ai pas l'habitude de mettre des manchettes pour dire ce que je pense !
Pour « l'aide pécuniaire » : Robert m'a dit bien des fois qu'il avait acheté la majorité des parts des Editions D... [Domat-Montchestien], qu'il a dû prendre comme à son habitude avec un prête-nom ; il disait également, lorsqu'il nous savait seuls que « ça coûte cher une maîtresse, surtout quand elle veut faire des affaires ».
Quant à l'instance en divorce, à ne pas être une compagne pour lui, etc ; j'ai ici sous les yeux la preuve que cela est absolument faux. Vous savez que de la Libération de Paris jusqu'au 8 Mars 1945, j'ai hébergé chez moi Madame Denoël et à ce propos je peux témoigner des sentiments qui unissaient Robert à Cécile et qui n'étaient pas ceux de personnes qui veulent divorcer.
A ce moment-là, Robert habitait chez sa maîtresse mais venait déjeuner ou dîner presque tous les jours avec sa femme et, par la force des choses, j'assistais à ces repas. Il invitait même chez moi, toujours avec sa femme, des amis et auteurs.
Je relève dans le journal que je tenais régulièrement et où ces indications voisinent avec des coupures de journaux, des notes de blanchisseuse et autres, quelques notes au sujet de ces déjeuners avec des amis. Le style de ces notes est peut-être un peu rapide, vous m'en excuserez, je ne veux pas le changer en le recopiant pour n'enlever aucune valeur à ce témoignage. Les voici :
DIMANCHE 20 AOUT 1944 : Robert Denoël téléphone en me demandant si nos invités sont arrivés en parlant de sa femme et de Maurice. - Midi, ils arrivent.
DIMANCHE 17 SEPTEMBRE : Je cherche une boutique à louer dans le 6e arrondissement, Robert m'avait demandé que je m'en occupe (il l'avait demandé au cours d'un repas). [C'était pour y installer les Editions de la Tour qu'il créait, j'y serais prête-nom.]
MARDI 19 SEPTEMBRE 1944 : Anniversaire de Cécile. Déjeuner avec Paul Vialar, Madeleine, Robert, Cécile, Maurice et moi.
VENDREDI 22 SEPTEMBRE : Déjeuner Robert, Cécile, Maurice et moi, visite de Simone Lozini.
MERCREDI 27 SEPTEMBRE : Dîner avec Louis Aragon, Elsa Triolet, Robert, Cécile, Maurice et moi.
JEUDI 5 OCTOBRE : Déjeuner avec Paul Vialar et sa femme Madeleine.
MARDI 10 OCTOBRE : Serge Moreux vient voir Cécile.
SAMEDI 14 OCTOBRE : Cécile part voir son fils en auto avec Monsieur Bart, chauffeur bénévole de Louis Aragon.
DIMANCHE 15 OCTOBRE : Robert a rendez-vous avec Elisabeth Porquerol, ici, à 4 h.
VENDREDI 27 OCTOBRE : Grand déjeuner avec Robert, Cécile, Maurice Percheron et sa femme Suzanne. Pendant le déjeuner, Elsa Triolet est venue rendre visite ; Maurice Percheron a dit qu'il avait été à Drancy et a donné quelques détails sur la façon dont on traite les détenus. Mme Elsa Aragon s'est fâchée et est partie.
MERCREDI 10 NOVEMBRE : Déjeuner Robert, Cécile, Paul Vialar, Madeleine, Maurice et moi.
JEUDI 9 NOVEMBRE : Déjeuner avec Paul Vialar, Madeleine, Maurice Percheron, Suzanne, Robert, Cécile, Maurice et moi.
VENDREDI 10 NOVEMBRE : Anniversaire de Robert. Je me souviens l'avoir vu arriver souvent avec des paquets de gâteries, hors d'œuvre et autres ; et le jour de l'anniversaire de Cécile, il est arrivé les bras chargés de chrysanthèmes.
SAMEDI 11 NOVEMBRE : Déjeuner avec Paul Vialar, Robert, Cécile, Maurice et moi.
LUNDI 20 NOVEMBRE : Robert reçoit Lejay [représentant des Editions Denoël]
LUNDI 4 DECEMBRE, 20 h. : Robert vient chercher Cécile pour aller dîner avec Eliane [Bonabel], 11 rue Pigalle.
MARDI 5 DECEMBRE : Cécile me dit que Robert a été charmant et qu'ils ont dîné au champagne.
MERCREDI 20 : Maurice va à Saint-Quentin-les-Anges chercher Finet, et Cécile va au mariage de Bessi [ Eric-Matthieu Bessi, un ami de notre groupe qui devint médecin peu après et perdit une jambe en combattant en Algérie]
VENDREDI 22 DECEMBRE : Robert vient déjeuner. Je remplace Maurice aux Editions (de la Tour)
DIMANCHE 24 DECEMBRE : Robert vient déjeuner et il emmène son fils (qui logeait avec nous) voir une collection au Musée Cognacq-Jay. - Robert, Cécile, Finet, Maurice et moi.
LUNDI 25 DECEMBRE : Paul et Madeleine Vialar arrivent avec Noëlle [Lemesle]. [Ce jour-là Robert s'était fait précéder d'une magnifique azalée accompagnée d'une carte portant ces mots : « Voilà ton petit arbre de Noël, mon chéri, il n'est pas aussi beau que je l'aurais voulu mais toutes ses branches et toutes ses fleurs sont chargées de ma tendresse. R. »]
MERCREDI 27 DECEMBRE à 18 h. : Il [moi] conduit Finet à l'occuliste Plique, puis chez Percheron où il doit dîner avec son père et sa mère.
LUNDI 10 JANVIER 1945 : Déjeuner Robert, Cécile, Finet, Moineau, Maurice et moi. Gigot haricots [Moineau, c'est Mme Bessi]
LUNDI 8 JANVIER : Maurice part reconduire Finet.
LUNDI 15 JANVIER : Déjeuner ici avec Robert, Cécile, Paul et Madeleine Vialar et Maurice.
LUNDI 26 FÉVRIER : Après déjeuner, Robert arrive et demande à Maurice qu'il mette au point des couvertures pour des romans populaires... etc.
MARDI 27 FÉVRIER : Robert vient à 2 h 30 voir la première couverture. Maurice n'est pas satisfait de lui quoiqu'elle est bien. Il y a eu paraît-il une discussion, Cécile s'en est mêlée et a donné raison à Robert.
JEUDI 8 MARS 1945 : Cécile rentre chez elle où elle trouve un appartement très sale, beaucoup de vaisselle cassée, deux belles carafes, ses fauteuils de salon abîmés, etc. etc. Elle est désolée.
Maître, vous le voyez, pour un homme qui ne pouvait supporter sa femme, il venait bien souvent la voir et ils passaient d'excellents moments ensemble. Il faut que je dise aussi autre chose qui m'avait choqué : au début, Robert venait avec son linge sale... [Ceci je l'ai déjà raconté, je coupe donc ce passage]. J'ai lu aussi dans le même article de Paroles Françaises que Madame Denoël n'a jamais été capable ni de donner un coup de téléphone, ni d'organiser une réception, ni de faire une démarche, ni de seconder en quoi que ce soit son mari.
Vous savez, Maître, et tout le monde le sait à Paris, que c'est avec sa femme et grâce à elle qu'il a pu fonder les Editions Denoël ; que sa table était une des meilleures de Paris et tous ceux qui ont eu la chance d'être reçus chez les Denoël peuvent témoigner que Cécile était (et est encore) une maîtresse de maison remarquable. Quant à « faire des démarches », si l'on entend par là « donner ses faveurs » pour en avoir une récompense, il s'agit là d'un autre métier où la maîtresse rendra certainement des points à une professionnelle... et je pense que c'est en partie à cause de cela que ces ignobles procès durent depuis si longtemps !
Veuillez agréer, cher Maître, mes salutations distinguées,
G. Bruyneel »
Si j'ai cité la majeure partie de cette longue lettre, ce n'est que pour remettre en lumière une vérité que l'on a trop travestie. Mon intention n'est pas de relancer, malgré toutes les preuves que nous avons eues en mains depuis, une polémique vieille de trente-cinq années. A ce sujet, Cécile avait relevé cette excellente réplique du Président Giscard d'Estaing, le 27 Novembre 1979 : « Il faut laisser les choses basses mourir de leur propre poison ».
*
Le 8 mars 1945, juste avant de rentrer chez elle, Cécile écrivit à Robert une lettre dont je viens de trouver le brouillon - par hasard comme si, intentionnellement, une main invisible l'avait placée là tout exprès sous ma main - Je me souviens d'autant mieux de cette lettre que c'est moi qui la remis à Robert. En voici le texte :
« Paris 8 Mars 1945
Mon chéri,
Je voulais te voir pour te demander quelque chose. Je te l'écris, cela te donnera le temps d'y réfléchir avant de me répondre. Comme tu le sais, je rentre aujourd'hui à la maison que nous avons quittée avec tristesse lors des événements. Penses-tu que nous y voyant, le Finet et moi, tu ne regretteras pas notre vie familiale ? Il est encore temps, Bobby, de la reprendre si tu le désires. Dis moi ce que tu en penses. En tous cas fais-moi le plaisir d'accepter ce petit cadeau en souvenir de notre première rencontre, il y a vingt ans aujourd'hui déjà. Comme le temps passe. Quelle que soit ta réponse je te garde toute ma tendresse. Cécile. »
Lorsque Robert lut cette lettre dont j'ignorais le contenu il était ému aux larmes. Il m'a dit simplement : « Mon petit Morys, dites-lui que, pour Noël, c'est sûr. Avant, je ne peux pas. »
J'ai alors à peu près deviné ce que Cécile lui demandait et savais pourquoi il ne pouvait pas retourner auprès de sa femme ; je me demandais même comment il arriverait à se dépêtrer de ce guêpier où il s'était laissé entraîner : il n'y avait aucune raison pour que le chantage que l'on exerçait sur lui se termine avant la Noël car l'organisation qui le tenait était puissante. Mais ceci fait partie de ce fameux secret qui a entouré sa mort et qui, tant d'années après le forfait, persiste toujours.
*
Robert resta boulevard des Capucines, dans la garçonnière louée au nom de sa maîtresse, ce qui permit à celle-ci de la faire vider en s'appropriant tout ce qui s'y trouvait, avant que l'on n'ait pensé à y faire apposer les scellés après le tragique événement.
Il vivait donc « chez sa maîtresse » ; mais tous ses amis savaient qu'aux environs de neuf heures, nul ne devait téléphoner afin de laisser libre la ligne pour l'époux volage qui, chaque matin, appelait sa femme. De même les rencontres de l'Avenue George V continuaient, bien que beaucoup moins quotidiennes, et je crois me souvenir que c'est au cours de l'une de celles-ci que Robert dit à sa femme qu'elle pouvait annoncer au Finet que son père serait définitivement de retour à la maison pour la Noël 1945. On sait, hélas ! que c'est le 2 décembre de cette même année qu'il fut abattu d'une balle dans le dos.
*
[Morys raconte ensuite que, le 14 octobre 1944, Cécile est allée voir son fils à Saint-Quentin-les-Anges, grâce à la voiture mise à la disposition d'Aragon par le parti communiste, pilotée par Jean Bart, chauffeur bénévole : elle y est restée une dizaine de jours]
Pendant ce temps, à Paris, nous nous faisions tous un sang d'encre. Moi, à vrai dire, peut-être un peu moins que les autres ; je me doutais que Cécile aurait trouvé le moyen de rester plus d'une soirée et un matin avec son Finet. Je connaissais aussi l'accueil chaleureux des Laisné. Mais quand même !...
Robert ne tenait plus en place. Dix fois par jour il téléphonait à D'dou (c'est ainsi que l'on appelait mon père) pour savoir si l'enfant prodigue était de retour ; il était prêt à faire un holocauste de tous les veaux gras de la terre. Impossible d'avoir la moindre nouvelle : le téléphone, le télégraphe étaient coupés avec l'ouest d'où les alliés venaient sans cesse mais où il pouvait y avoir encore des poches de résistance allemande. On savait les routes peu sûres ; il courait les bruits les plus épouvantables sur le sort de quelques égarées parmi la soldatesque internationale.
Si Robert ne pouvait plus mettre deux idées en place à la suite l'une de l'autre, ses amis, nos amis, étaient eux aussi très anxieux. Alors qu'Aragon fulminait d'être privé de sa voiture, Elsa priait pour Cécile et chaque jour partait visiter sept églises - c'est, je pense, une tradition orientale - où elle implorait de la Bonté Divine qu'il ne soit rien arrivé de fâcheux à son amie très chère. Car Elsa aimait très sincèrement Cécile qui le lui rendait bien. Et cela dura jusqu'au soir du 26 octobre. Le voyage s'était allongé par suite d'aventures imprévues.
Étant à Saint-Quentin-les-Anges, Cécile était allée rendre visite à Jacques de Fourchambault, ami et auteur de la maison, grâce auquel Robert et elle avaient connu monsieur Laisné dont l'auteur de Mort au Monde et de Charles-Louis Philippe, le bon sujet disait le plus grand bien, bien qu'il fut « contre la calotte ».
[Relation du voyage retour vers Paris, avec une voiture remplie de victuailles]
En débarquant la veille à la tombée de la nuit, Cécile avait monté d'une traite nos cinq étages pour nous rasséréner et me demander de descendre aider monsieur Bart. Ce ne sont pas tellement les bagages qui étaient encombrants, mais le coffre était plein à craquer de victuailles de toutes sortes, jusqu'à un mouton à peine dépecé pour être transportable.
[Chapitre relatif au scoutisme. Cécile fut totémisée du nom de Bagherra, Morys de Mouflon dévoué]
Après le drame du 2 Décembre, nous avons continué à fréquenter ce camp ami où nous retrouvions cette indispensable fraîcheur d'âme si compromise par les tracasseries, procès et une insidieuse campagne de presse auxquels Cécile avait à faire front.
En 1948, ayant à traduire et adapter un ouvrage assez touffu, passionnant mais qu'il fallait complètement remanier, remis par un iranien inconnu : Gourgen Yanikian, Cécile avait besoin d'avoir l'esprit libre, de n'être dérangée par aucun coup de téléphone, par aucune sollicitation. Où aurait-elle été mieux qu'a « La Rose des Vents » ? Fidèle secrétaire, je l'accompagnais, bien entendu. N'ayant pas de machine à écrire portative, je plaçais la grosse machine de bureau dans mon sac à dos avec cahiers, carbone, un stock de papier... plus le matériel habituel. C'est donc au grand air que prit naissance la forme définitive de La Victoire de Judas Iscariote, de Georg Yanik - Cécile avait demandé à l'auteur d'européaniser son nom - qui valut à l'auteur et à son adaptatrice les foudres d'un certain épiscopat qui parlait d'excommunication (Cela se passait aux Etats-Unis après la publication d'une traduction anglo-américaine de l'adaptation par Cécile du livre de Georg Yanik) car il n'était pas permis alors à de simples mortels d'interpréter les Ecritures et de présenter l'apôtre Judas autrement que comme la personnification de la traîtrise et de la félonie. Cette histoire aurait beaucoup amusé Sa Sainteté Pie XI, qui avait honoré Cécile de son amitié. Mais nous reparlerons de lui un autre jour ; revenons à La Rose des Vents.
*
A lire tout ceci, on pourrait croire que je passais ma vie au côté de Cécile. Mais je passais autant de temps sinon davantage avec Robert. Quelqu'un [Henri Thyssens] me demandait dernièrement : « Quel était votre rôle rue Amélie ? » Voici textuellement ce que je répondis :
« Mon rôle rue Amélie ? Aucun. Je n'y allais que très rarement. Je voyais Denoël chez lui et un peu partout mais pratiquement jamais aux Éditions. Sur le plan matériel, je composais des couvertures de livres, préparais des mises en pages, faisais de la technique, des recherches à la Bibliothèque Nationale, etc. Mais ce qui comptait réellement dans l'amitié qui nous liait, Robert Denoël et moi, se passait sur le plan psychique. Ceux de ses auteurs ou de ses amis qui remarquaient ma présence auprès de lui disaient que j'étais son ombre. (Le mot est de Philippe Hériat, mais repris par Cocteau, Louise Hervieu, Vialar et bien d'autres). Il avait, comme beaucoup de gens en vue à se méfier de tout le monde. Je puis dire que je fus certainement le seul ami sur lequel il savait pouvoir s'appuyer sans hésitation, comme le faisaient également sa femme et son fils. Sauf lorsque mon métier exigeant m'en empêchait, j'étais toujours présent lorsqu'il le souhaitait à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit.
Dès le premier instant de notre rencontre, un véritable amour me lia à Robert, à Cécile et à leur fils. Denoël avait besoin de moi comme d'un talisman. En réalité, je lui servais de « chambre de réflexion » : lorsqu'un problème d'une certaine importance le tourmentait, sur quelque plan que ce soit, même le plus intime, il me le confiait et cela lui permettait d'en trouver la solution la meilleure sans que j'aie à lui donner mon sentiment, sans que j'aie à dire le moindre mot ; il m'arrivait seulement parfois d'éteindre mon regard. Il me parlait sans crainte, sachant que mon silence serait total... même après son passage en l'autre monde.
La présence de ma photographie sur son bureau a fait jaser bien des imbéciles en mal de ragots. Sa seule raison d'être là était d'ordre psychique. De tout ceci, je n'ai jamais parlé à quiconque et je ne pense pas qu'il l'ait fait. Seule sa femme avait compris, mais elle ne m'a jamais posé de questions qui eussent été indiscrètes, même après 1945. J'ai connu les Denoël en 1936, l'année de Mort à Crédit, du prix Théophraste Renaudot aux Beaux Quartiers de Louis Aragon, du prix Femina à Sangs de Louise Hervieu et du prix Interallié à René Laporte pour Les Chasses de Novembre. J'étais encore auprès de lui la veille de sa mort, nous travaillions ensemble au Bonheur du Jour. »
*
« A n'importe quelle heure du jour ou de la nuit ». Lorsque Robert et Cécile restaient tardivement chez des amis durant l'Occupation et qu'ils risquaient d'être en retard pour le couvre-feu - et ils attendaient toujours le dernier moment pour rentrer ! - Robert demandait, la permission de téléphoner.
- Vous permettez, j'appelle Sire Galahad.
- Qui ?
- Le chevalier servant de ma femme.
Après quoi il enfourchait son vélo et rentrait juste à temps pour ne pas être interpellé par les patrouilles allemandes. Cécile avait ainsi encore un peu de temps pour bavarder avec leurs amis.
Sitôt reçu le coup de téléphone de Robert, je partais par le dernier métro ou, le plus souvent, à pieds, arrivais chez les amis, buvais le coup de l'étrier, prenais livraison de Cécile et nous rentrions au pas de promenade. En ma qualité de comédien, je possédais un « Ausweis » (laissez-passer allemand). Si nous rencontrions une patrouille, je disais en montrant ma carte : - Ich bin Schauspieler.
- Und Sie ? demandaient-ils à Cécile.
- Mein Schwester, répondais-je avec un sourire.
Et nous poursuivions sans encombre notre chemin jusqu'à la patrouille suivante.
*
Par un coup de poker, j'avais obtenu un Ausweis permanent et valable à n'importe quelle heure de la nuit. Voici comment. En Janvier 1940, un producteur m'avait demandé pour tourner un film de propagande anti-nazi au titre significatif : « Après Mein Kampf... mes crimes ». Pour quel rôle ? Celui d'Hitler, pas moins ! Au moment de l'avancée fulgurante des armées allemandes, fin mai 1940, d'immmenses affiches couvraient les murs de la capitale et de sa banlieue où, sous le titre, on pouvait admirer le visage de l'homme à la mèche et à la petite moustache. Lorsque la vie reprit son cours à Paris, au début de l'Occupation, il fallait bien que je reprenne mon métier.
[S'ensuivent les péripéties relatives à un nouvel ausweiss, difficilement obtenu]
*
Une nuit, on frappe à ma porte. J'habitais sous les toits une chambre lambrissée, délicieusement aménagée, quatre étages au-dessus de l'appartement des Denoël, et de la fenêtre de laquelle on apercevait le Sacré-Coeur entre les pattes de la Tour Eif'fel. Je me réveille en sursaut : « Qui est là ? »
- Cécile est malade... C'était la voix de Robert. J'ouvre.
- Vous n'avez pas des sinapismes ou des autoplasmes ?
- Non, bien sûr.
- Et les pharmacies sont fermées...
- A trois heures du matin !... Mais, attendez, il y en a sûrement chez mon père. J'y vais.
Et me voilà parti. De la Tour Eiffel à la rue Pigalle, il y a bien six kilomètres. Je les fais le plus vite possible ; j'arrive, monte les cinq étages, entre dans l'appartement, trouve les sinapismes et repars. Mon père ne s'était même pas réveillé. Arrivé rue de Buenos-Ayres, essoufflé d'avoir pressé le pas, je sonne doucement. Robert, à moitié endormi, vient m'ouvrir et va se recoucher. « Vous savez les mettre, n'est-ce pas ? Merci, mon petit Morys. ». Et il se rendort.
Cette présence constante, cette intimité, avait de quoi faire parler les commères, mâles et femelles. Les gens adorent trancher de tout, surtout lorsqu'ils ne savent rien. Ils jasaient à qui mieux-mieux. Un jour j'étais l'amant de Cécile. Le lendemain, le petit ami de Robert ! Celui-ci s'en amusait follement et il en rajoutait. Lorsque nous marchions côte à côte dans la rue et qu'il apercevait une de ces mauvaises langues, il me prenait « tendrement » par la taille et se penchait vers moi pour me parler à l'oreille. Ce qui ne laissait aucun doute à personne !
En septembre 1943, pour la création de « La Peur des Miracles », une pièce de Gabriel Arout qui devait se jouer le mois suivant au Théâtre du Vieux-Colombier, il me fallait un costume assez élégant. J'avais reçu une allocation de tissu, matériau rarissime, et une indemnité substantielle. Cécile me trouva un tailleur, supervisa les essayages ; vraiment c'était parfait. Robert, connaisseur en la matière, en était satisfait.
- Vous avez les cravates pour aller avec ?
- Non, pas encore.
- Bon. J'ai le temps ; venez avec moi.
Un taxi nous dépose chez Lanvin, son fournisseur attitré.
- Bonjour, monsieur Denoël. Bonjour, monsieur.
- Norbert (A la vérité, le vendeur s'appelait Robert comme Denoël), je voudrais deux très belles cravates pour mon ami. C'est pour aller avec un costume gris-perle.
- Bien, monsieur, voici la collection. Denoël regarde rapidement
- Non. Vous avez mieux que cela.
- Non, monsieur, je vous assure...
- Enfin, Norbert, ce n'est pas « ça » que vous me vendez habituellement. Allons voir derrière.
- Mais, monsieur...
- Quoi ? demande sèchement Robert.
- C'est que... c'est que les autres sont réservées à nos meilleurs clients.
- Et je ne suis pas un bon client ?
- Oh ! si, monsieur.
- Allons, Norbert, vous ne voulez pas que mon ami porte des cravates de quatre sous, non ? Montrez-nous ce que vous avez de mieux.
Le vendeur regarde Robert, me regarde, bafouille, rougit... et je reçois en cadeau les deux plus belles cravates que j'ai jamais eues de ma vie. J'étais aux anges ; j'aurais bien embrassé Robert pour la peine. Mais le vendeur aurait trouvé cela bizarre. Lorsque, quelques jours plus tard, Cécile alla choisir des chemises pour son époux ; c'est le même vendeur qui l'accueillit. Il avait l'air gêné. Tandis qu'elle hésitait entre deux modèles, elle lui dit à brûle-pourpoint :
- A propos, monsieur Norbert, elles sont très belles les cravates que mon mari vous a achetées l'autre jour.
- ...
- Vous savez : quand il est venu avec son ami.
- Oh ! madame. Vous l'avez su ! Vraiment, Madame, je ne voulais pas !... Mais je n'aurais jamais cru cela de monsieur Denoël.
Cécile éclata de rire et rassura le pauvre garçon qui attendit un moment avant de sourire à son tout, ses doutes envolés. Mais quand même !...
*
Maintenant que les ans m'ont changé, que la maladie m'a contrefait, je puis le dire sans fausse modestie, puisqu'il s'agit d'un passé trépassé : j'étais alors vraiment joli garçon et faisais des ravages tant dans le cœur des dames que dans celui de certains messieurs, en refusant de comprendre leurs désirs. En cela au moins j'aime choisir moi-même.
Je le répète : j'aimais Cécile autant que j'aimais Robert, j'aimais Robert autant que j'aime Cécile : d'un amour profond, sincère, qui devait rester pur. Un soir cependant... Un soir, j'avais du vague à l'âme. Cécile venait d'apprendre une nouvelle incartade de Robert. Elle était triste. Je m'étais approché pour tenter de la consoler et, je ne sais pas ce qui m'a pris : je l'ai prise dans mes bras, elle m'a serré dans les siens, le pire faillit arriver. Grâce au Ciel, un incident minime nous permit de reprendre nos esprits et d'éviter la bêtise qui aurait, à jamais, terni notre belle amitié. Plus jamais nous n'avons recommencé. Mais j'ai su, ce soir-là, que mon amour pouvait aussi être physique et qu'il était partagé. J'en conçus à la fois une immense joie et un chagrin profond. Cet amour était sans espoir puisque nous aimions, puisque nous aimons toujours, Robert, l'un et l'autre.
[S'ensuit une scène durant laquelle Morys avoue à Robert Denoël son amour pour Cécile]
*
Lorsqu'après la Libération Robert fonda les Editions de la Tour et me demanda d'en être le gérant, il ajouta : «Bien entendu, cela ne doit pas vous empêcher de poursuivre votre carrière. » Mais voilà, j'avais à jouer le soir «Les Hauts de Hurlevent » au Théâtre Hébertot, à tourner la nuit « Le Jugement Dernier », et à redevenir dans la journée gérant d'une maison d'éditions dont j'étais à la fois : le technicien de fabrication, le directeur commercial et le vendeur car je ne disposais que d'un coursier. A ce rythme-là, qui aurait pu tenir ?
Il me fallait choisir : d'un côté Robert que j'aimais et qui avait besoin de moi ; de l'autre, le Théâtre qui était la passion de ma vie ; ma seule raison d'être en dehors de l'amour et peut-être grâce à lui. Coupant avec ma passion et ma vie, j'ai choisi l'amitié. Ce ne fut pas sans douleur, Jacques Hébertot me l'a beaucoup reproché ; d'autres aussi. Mes camarades et mes amis - je l'ai su plus tard - m'ont cru mort. Je l'étais pour eux. Mais je n'ai pas déçu un ami ; mon ami le plus cher.
Cela se passait en avril 1945. Le 2 décembre il était mort. Ensuite, c'est à sa femme et à son fils que je vouai ma vie. Et ce fut mon bonheur. Je n'ai pratiquement plus quitté ni Robert ni Cécile, les voyant chaque jour ou presque, assurant la liaison entre eux, comblé du bonheur d'être le lien entre deux êtres qui, malgré les apparences, ne faisaient toujours qu'un et ne pouvaient se passer l'un de l'autre. Ineffable amour que le leur. Étrange amour que le mien.
*
Cependant, j'étais jeune, parfaitement constitué et je n'avais pas l'intention d'entrer dans un monastère. Alors... On peut très bien entretenir dans le fond de son cœur un amour infini et, s'il est sans espoir, prêter son corps à de « folles étreintes ». Ni plus ni moins qu'un autre, j'ai vécu nombre d'aventures qui m'ont parfois laissé des souvenirs exquis et tendres, mais où l'Amour, le vrai, n'avait aucune part.
Avant notre union j'ai tenu à ce que Cécile n'ignore rien de mes « dépravations » ; il était encore temps pour elle de me récuser. Ensuite, à dater du jour de notre mariage, sachant le mal que cela peut causer et dont elle a tant souffert, je n'ai plus jamais succombé, même en pensée, à la moindre tentation. Je n'y ai aucun mérite : je l'aime et, de toutes façons, je n'aurais jamais trouvé mieux. Mais je n'ai pas entrepris d'écrire ce livre pour parler de moi ; j'ai un bien meilleur sujet ; profitons-en.
*
Cécile, c'est l'Amour. Je ne sais rien ni personne qu'elle ne puisse aimer sinon ce qui est haïssable par essence. Elle aime par-dessus tout la vie, comme elle aime tout ce qui est vivant : les animaux, les plantes, la nature, mais aussi les humains. Et cela, c'est plus rare. Bien entendu, elle a ses préférences ; ce n'est pas une sainte, je l'ai dit, et elle n'aime pas également toutes les créatures. Comme il fallait s'y attendre, ses préférences l'attirent vers les plus faibles, ceux qui, difficilement, peuvent se défendre eux-mêmes : l'enfant qui représente la vie de demain et le vieillard que l'on rejette aisément comme chose inutile ; contre lequel souvent on est injuste, par lassitude souvent ou bien par lâcheté.
Parfois l'injustice prend des proportions abominables, irréversibles. C'était le cas de Guillaume Seznec qui, pour l'assassinat d'un homme, dont on n'a jamais su s'il était vraiment mort, fut condamné aux travaux forcés à perpétuité.
Je ne raconterai pas cette histoire dramatique, d'autres mieux informés et plus compétents l'ont fait depuis longtemps. On sait que, pour conduite exemplaire, Seznec fut relâché au bout de vingt ans. Vingt ans de bagne pour un crime qu’il n'avait pas commis ! Un second drame s'était greffé sur le premier : la fille de Seznec avait tué Le Her, un être odieux qui l'obligea au mariage en lui faisant croire qu'il pouvait innocenter son père. Ce mariage fut un enfer pour se terminer dramatiquement le 3 octobre 1948 (Jane Seznec fut acquittée sans difficulté). C'est une histoire atroce dont nous n'avions, par les journaux, comme tout le monde, que des échos lointains.
Un jour de 1949, Claude Sylvane, une journaliste qui avait pris cette affaire à cœur, décida de tenter d'en connaître tous les dessous et de faire publier un livre qui permettrait de réclamer la réhabilitation du bagnard innocent.
« A qui pouvais-je parler de l'éditer, avant même qu'il ne fut écrit, dit Claude Sylvane, - sinon à cette autre femme si hautement humaine, si compréhensive et si bonne, que j'avais, en quelques mois d'amitié vraie, découverte en Cécile Robert-Denoël ? C'était quelques jours avant l'anniversaire de l'assassinat de son mari. Toute autre qu'elle eût sans doute alors pensé davantage à son chagrin qu'à celui d'une autre. Cécile Denoël écouta attentivement ce que je lui dis et me répondit simplement : « J'éditerai votre livre. » Ce fut tout. Rien n'était encore écrit et pourtant, sans manuscrit, sans autre chose que notre commune pitié de femme, notre commune volonté de justice, un contrat venait d'être signé, sans qu'il fût besoin de plume ni de papier, scellé avec notre amitié et notre désir de servir une cause. » (Extrait de Notre Bagne, par Jane Seznec).
Éditer un livre, même avec les pauvres moyens dont elle disposait, n'était en soi que peu de chose et je n'en parlerais pas s'il n'y avait la suite ; cela ne lui suffisait pas. Avec l'appui d'un journaliste de Paris-Presse, Arqué (dont j'ai oublié le prénom parce que nous l'appelions amicalement « le Chef »), elle refit toute l'enquête pour tenter de retrouver, vingt-cinq ans plus tard, un témoin qui aurait pu confirmer une thèse appuyée sur des certitudes que le conseiller Quémeneur, pour l'assassinat duquel Guillaume Seznec avait été condamné, n'était pas mort mais était parti à l'étranger - vraisemblablement en Amérique du Sud - pour ne pas être impliqué dans une affaire de trafic de matériel militaire.
Puis Cécile organisa des conférences dans toute la Bretagne et recueillit ainsi des milliers de signatures pour une demande de révision du procès afin que l'honneur fût rendu à Seznec, le forçat innocent. Pour terminer ce périple où elle n'avait cessé de payer de sa personne, ce fut un meeting monstre à Paris.
Guillaume Seznec, qui était venu loger chez Cécile, lui vouait une véritable vénération. Je dois dire que cela était réellement émouvant de voir ce vieillard au regard d'un bleu transparent, à la peau brûlée dans l'incendie de sa maison et tannée par le soleil de Cayenne, parler à la jeune femme qu'était encore Cécile, en l'appelant «Maman ». Et il mettait dans ce mot toute la tendresse de son pauvre vieux cœur usé par la souffrance mais dans lequel renaissait un espoir. Jamais je ne l'ai entendu l'appeler autrement et, de son écriture mal assurée, rendue tremblante par l'âge et son éprouvante vie de bagnard, il lui dédicaça ainsi le livre qu'elle avait publié : « A ma mère spirituelle, G. Seznec. » C'est l'une des dédicaces les plus sincères, en tous cas la plus bouleversante qu'elle ait jamais reçue.
Un matin, il lui apporta un petit paquet qu'il tenait comme les saintes reliques. Il en contenait une en effet : un morceau de velours noir brodé d'or. « Un morceau de la robe de mariage de ma chère femme, dit-il, c'est tout ce qui m'en reste ; vous seule êtes digne de la garder. » Ce petit paquet fait partie de nos trésors.
[Suit un chapitre, très personnel, où Cécile recueille l'économiste Francis Delaisi, et sa secrétaire, Hélène Aubinière, dont la fille, Arlette, épousera ensuite Robert Denoël, fils unique de l'éditeur]
*
Les préférences de Cécile l'attirent vers l'enfant et le vieillard, écrivais-je plus haut ; passons donc à l'enfance. J'ai raconté déjà comment elle avait recueilli, durant le bombardement de la gare de Toulon, les petits oubliés sur les quais. Qu'elle adore les enfants et fasse pour eux tout ce qui est en son pouvoir n'a rien d'étonnant ni d'original ; grâce à Dieu des milliers d'êtres humains professent cet amour. Mais Cécile a aussi voué des années à la psycho-pathologie de l'enfance.
Tout en exerçant son métier d'éditeur, elle avait sérieusement travaillé la psychanalyse. Dans les années 30, cela n'était guère courant et l'on ne pouvait, comme aujourd'hui, se dire « psychologue » et moins encore psychopathe [sic !] sans exercer en relation et sous le contrôle constant d'un médecin spécialisé. Bien entendu, Cécile avait fait ses classes et sa didactique était une réussite rare.
C'est pour elle et par elle que, dès 1931, Denoël et Steele créèrent la « Bibliothèque Psychanalytique ». C'est en spécialiste, poussée par le Docteur René Allendy, qu'elle s'occupa, au centre de la rue du Rocher, des enfants arriérés que l'on appelle aujourd'hui « inadaptés » mais qu'alors on rejetait de la société. Elle obtenait de très bons résultats mais lorsque certains, dont le mal venait d'une hérédité inguérissable, rentraient dans leur famille, ils perdaient tout le bien que des soins attentifs et méticuleux pouvaient leur éviter.
*
Cet amour de l'être humain et de l'enfance en particulier ne devait pas s'arrêter à quelques cas exceptionnels. Toutes les mères de famille connaissent ce petit carnet bleu qu'on leur remet à la naissance de chaque enfant, sur lequel sont portés, dès le premier jour, tous les soins, toutes les vaccinations, tous les maux de leurs petits et qui devrait, normalement, les suivre tout au long de leur vie pour la préserver et préserver celle de leurs descendants. Bien souvent, par insouciance ou par paresse, les mères l'abandonnent au plus tard lorsque l'enfant a deux ans et bien souvent plus tôt : lorsqu'il ne leur sert plus à toucher les allocations post-natales.
Ce petit carnet bleu s'appelle, je ne vous apprends rien, le Carnet de Santé. Si vous demandez qui en sont l'auteur et le promoteur, nul ne saura vous répondre. Même les médecins l'ignorent, à quelques exceptions près, mais il faut pour cela qu'ils aient plus de soixante ans et s'y soient intéressés. Voici son histoire.
Il était une fois une femme, pas tellement âgée mais vieillie, courbée, presqu'aveugle, vaincue par la maladie depuis sa plus tendre enfance. Une maladie qui lui venait de son grand-père, dont nul jamais n'aurait parlé pour éviter la honte et l'opprobre généraux, mais qui avait fait d'elle une douleur ambulante. Cependant sa face blême, aux yeux creux et plus qu'à moitié morts, cachait une volonté farouche : cette femme voulait éviter à d'autres êtres humains le martyre qu'avait été, qu'était encore, sa lamentable vie.
Elle avait frappé à bien des portes, ses demandes avaient été rejetées, ses cris d'alarme, étouffés. Sous forme de roman elle avait écrit sa misérable histoire, cent fois retravaillée. Son manuscrit avait traîné chez quelques éditeurs et lui était chaque fois revenu avec un mot aimable. C'est l'usage.
Je ne sais par quel biais, je ne sais si Cécile connut d'abord la femme ou son écrit, mais elle fut troublée jusqu'au fond de son âme. Elle en parla à Robert qui, à son tour, en fut ému. Le livre fut bientôt publié. Sous le titre Sangs, il allait connaître le succès et Louise Hervieu, la pauvre femme de mon histoire, allait recevoir le prix Fémina. Cela se passait en 1936 et j'ai eu le bonheur d'aimer et d'aider cette femme admirable.
Le succès du livre était un premier pas mais cela ne suffisait pas à Louise, à Cécile et à Robert. Ils entreprirent une croisade pour que fut créé un « Carnet de Santé » dans lequel auraient été inscrits les antécédents des parents, puis tous les soins, toutes les maladies de l'enfant, ensuite de l'adulte jusqu'à son heure dernière, pour servir à son tour à maintenir en santé ses enfants et ses petits-enfants.
L'entreprise semblait simple ; elle était trop grandiose et cependant tellement humaine. Elle se heurtait à l'indifférence générale, lorsque ce n'était pas à l'hostilité : il est des choses et surtout des maladies qu'il ne fallait pas évoquer sous peine d'être mal vu ; il y a peu de temps encore, elle étaient bannies du petit Larousse. Seules certaines chansons de salles de garde y faisaient allusion, mais « l'honnête homme » se bouchait pudiquement les oreilles afin de les ignorer !
Louise, Robert, Cécile et leurs amis firent des pieds et des mains, créèrent l' «Association Louise Hervieu pour l'établissement du Carnet de Santé » dont le manifeste commençait par ces mots : « Les chevaux et les chiens de luxe ont un pedigree mais les petits de l'homme naissent et meurent comme des bêtes obscures ; car la peine sacrée des mères n'est pas respectée. Leur enfant innocent, trop souvent malingre ou misérable ne vivra pas, ou il vivra en désespéré. C'est qu'il porte le poids de tares ancestrales. Mais ceux-là dont il est la victime, ceux-là étaient déjà des victimes. »
L'association amena à ses idées les plus éminents médecins de l'époque et finit, après bien des démarches, par intéresser un homme d'état à sa cause. Le premier juin 1939, enfin ! un arrêté ministériel instituait, à l'usage des citoyens français, le Carnet de Santé. J'ai sous les yeux la première page de « Paris-Presse » de cette date où s'étale ce titre : « M. Rucart crée le carnet de santé individuel, confidentiel, facultatif. »
C'était une demi-mesure, mais c'était déjà un grand pas... qui aurait dû être suivi de nombreux autres. Hélas ! à moins d'un miracle cela restera un coup d'épée dans l'eau, tout comme l'est le certificat pré-nuptial, frère cadet du carnet de santé, qui était de même source.
Et Louise Hervieu est morte en chagrin. De son émouvante correspondance je relève ces phrases extraites de lettres qu'elle m'écrivait de Longny-en-Perche où l'inflexible maladie l'avait menée. D'une lettre de 1942 : « Le chagrin du carnet m'a pourrie. Je ne peux plus me passer des soins que je reçois dans ces maisons d'hospitalisation. » Du 6 janvier 1943 : « Merci cher Albert Morys de votre fidèle souvenir à une vieille femme malade et profondément retirée, qui ne peut plus être bénéficiaire de vos voeux. Car je réagis de plus en plus faiblement devant mes spasmes et je tombe comme au temps de ma petite enfance [...] Et c'est vous qui verrez la Paix ! et un carnet de santé, véritable témoin et gardien de l'individu et de sa descendance. De celui qu'on annonce et auquel j'ai tout donné de moi-même, je ne sais rien. Quant au certificat prénuptial qui n'est point éliminatoire et ne comporte pas de sanction, c'est une mesure pour rien. Quant à l'assainissement de la procréation, celle qui ne peut plus la défendre vous recommande encore et pour toujours le carnet, cher Morys. C'est la douleur de Louise Hervieu ».
Pauvre Louise ! son Carnet est, en partie, un ratage. Sa vie fut sans doute trop éphémère mais, malgré tout, bien des choses ont changé : les maladies dont elle avait osé parler ne sont plus « honteuses »et, même s'il y a beaucoup de je-m'en-foutisme chez certains de ceux qui portent les germes transmissibles, la prophylaxie a fait des pas de géant. La voix de Louise Hervieu n'y est peut-être pas étrangère, même si l'on a oublié son nom. Sa souffrance n'aura pas été inutile. Sa rencontre avec Cécile non plus.
*
Les perruches. Là, il s'agit d'une histoire dramatique. Cécile en parle dans son livre de souvenirs car elles ont une grande importance dans sa vie ; mais je ne peux pas ne pas en parler ici. Lorsque Cécile, ayant réintégré son appartement en 1945 après avoir quitté la rue Pigalle, le Finet revint définitivement de la Mayenne l'année scolaire terminée ; outre les leçons de latin et de grec qu'il lui donnait dans sa garçonnière et dont j'ai déjà parlé, Robert voyait son fils les dimanches matin et, ensemble, ils allaient visiter des musées, se promener...
C'est ainsi que le dimanche 2 décembre, ils visitèrent la maison de Victor Hugo, place des Vosges ; puis passant quai de la Mégisserie, Robert acheta un couple de perruches, une cage, et remit le tout au Finet pour qu'il les remette de sa part à sa maman. Le soir de ce même dimanche, il était assassiné.
Cécile avait été doublement heureuse de recevoir ce présent : pour l'intention d'abord et pour le symbole qu'elles représentaient et confirmaient bien que Robert serait de retour pour Noël. Après le drame, les perruches devinrent plus précieuses encore.
*
A la mort de Robert, il lui fallait être très forte et nul, hormis trois intimes, ne put voir ses larmes. Elle avait à soutenir un fils et venger un mari. Elle ne savait pas encore que, pour couronner sa détresse cachée, elle et son fils étaient ruinés. L'instant le plus douloureux ce fut lorsque, après une nuit de veille, après avoir vu le corps de l'homme de sa vie étendu sur le marbre et percé de balles, il lui fallut annoncer à son fils que son mère était mort. Et mort assassiné.
Cécile alla dans la chambre du petit attendre l'heure de son réveil. Elle referma la porte. Nul n'entendit le moindre bruit, le moindre cri, les moindres pleurs. Lorsque le Finet sortit de sa chambre, toilette faite, son pas était peut-être un peu raide, son regard trop fixe, les yeux un peu rouges bien sûr, mais aucune larme ne les noyait.
Le jour de l'enterrement, c'était un homme qui conduisait le deuil avec sa mère. Plus ferme que jamais, le regard haut et droit, l'œil sec. Plus tard, on a dit que le fils n'avait pas plus de cœur que sa mère. Ils avaient, l'un et l'autre, un courage indomptable. Mais nul ne saura jamais combien chacun d'eux a pu pleurer lorsqu'il se fut enfermé dans sa chambre.
A cet enterrement, parmi les amis, les auteurs, trop peu nombreux il faut le dire, la couardise dépassant encore l'ingratitude, je reconnus deux ou trois des « houris » de Robert. L'une d'elles, auteur de talent dont il avait édité deux ouvrages [Dominique Rolin], au moment du serrement de mains (détestable coutume !) s'approcha en pleurs de la veuve pour lui dire : « Ah! madame, vous ne savez pas ce que je perds ! » Cécile était au courant de son aventure. La regardant dans les yeux, elle lui-répondit simplement : « Je ne l'ignore pas, madame. »
*
Je viens de parler du courage de Cécile. Cela m'a fait rechercher le texte d'une conversation, enregistrée en mai 1974, au cours de laquelle elle me parlait de cette nuit tragique. En voici deux passages pris sur le vif :
« Il faut avoir des nerfs d'acier pour aller voir sur la table d'une morgue son amour et sa vie écrasés. Dans un mort voir sa propre mort. Tout en sachant qu'il faudra vivre et lutter. Ça c'est abominable. »
« Cela n'a pas été facile de construire mon armure. Cela a été dur, je ne m'y sentais pas toujours très bien. Ça gêne aux entournures, le métal, cela irrite et cela blesse. Il le fallait pourtant : il fallait avoir de l'acier, mais on s'accroche les mains en " modelant " de l'acier. ... Rozelaar disait : " Je me demande de quoi vous êtes faite ; vous avez des nerfs d'acier ! " - " Oui, monsieur, j'ai des nerfs d'acier. " Tu parles ! Toute seule, le soir, je n'avais pas des nerfs d'acier. Plus d'une fois je me suis laissé aller à mon désespoir qui, il faut bien le dire, ne durait pas longtemps, mais qui existait quand même. »
*
Les morts sont vite enterrés. Le souvenir de Denoël éditeur s'est éteint très rapidement. On en a parlé au moment de l'assassinat. Cet événement a permis à quelques médiocres de jeter leur venin ; quant aux autres, en cette période plus que troublée, ils se terraient. Puis Denoël est devenu « l'Affaire Denoël » dont certain personnage politique de première importance, manœuvré par « une amie », tirait les ficelles aux dépens de la veuve et de l'orphelin, jusqu'au moment où l'on a fini par l'enterrer complètement.
Très vite les parts sociales des Editions Denoël furent acquises par un grand éditeur parisien. Depuis, le public s'est habitué à croire que le nom de Denoël n'est qu'une sous-marque. Le meurtre était oublié, les procès épuisés ; il ne semblait pas y avoir eu un jour un homme qui ait porté ce nom. Consummatum est.
*
Antonin Artaud se sentait chez lui chez tous les amis qu'il fréquentait ; mais il s'était plus spécialement attaché à Robert et Cécile, un peu comme un chien perdu qui tente de se faire aimer et adopter ; ce que d'ailleurs il avait réussi. Que l'on ne voie dans cette comparaison nulle mauvaise pensée : nous aimons trop les animaux ! et dire de quelqu'un qu'il fait penser à un chien perdu ne représente que tendresse et affection.
Au sujet d'Artaud, il est une chose qui exaspère toujours Cécile et surtout l'attriste : le fait que, dans un livre ou une revue littéraire, on présente une photo de lui, c'est toujours un être laid, amaigri, le regard vague. D'accord, vers la fin de sa vie, lorsqu'on le promenait au Café de Flore ou ailleurs comme un monstre de foire, après sa sortie de maison de santé et qu'on le surnommait « Artaud le Momo », il n'était guère appétissant à voir et lorsque, par hasard, nous l'apercevions, Cécile fuyait, les larmes aux yeux, malheureuse de ce que l'on avait fait de lui.
Artaud avait été un beau gars. Il avait d'ailleurs beaucoup de succès féminins, même s'il rendait « dingues » les dames qui tentaient de vivre avec lui. Il suffit de voir les nombreux films qu'il tourna ; même s'il tenait souvent des rôles d'exaltés ou d'introvertis ; cela convenait tout à fait pour les grands films de l'époque et tout particulièrement pour ceux d'Abel Gance. Robert a fait de très bonnes photos de lui dont l'une pourrait être sous-titrée « Nanaqui l'Enjôleur ». Lorsqu'il voulait absolument quelque chose et qu'on le lui refusait, il faisait du charme et c'est dans un de ces moments-là que Robert prit ce cliché [non retrouvé].
Nanaqui était un fumeur impénitent qui, plus d’une fois, mit le feu à son oreiller ou aux couvertures - ou plus exactement à ceux de Bill ! - Il faillit un soir mourir asphyxié et mettre le feu à la maison. Mais ceci n'est qu'un détail. Lorsqu'il n'avait pas de quoi fumer : « Cécile, tu me donnes du tabac ? »
- Je n'en ai pas ; Robert non plus.
- Robert, viens avec moi, on va en acheter.
Il aurait pu, bien sûr, aller à la civette la plus proche. Cela aurait été trop simple : il fallait aller à Montparnasse ! Robert et Cécile avaient du travail et ne pouvaient pas toujours l'accompagner. Artaud ne voulait pas y aller seul. Si on ne voulait pas l'écouter et l'accompagner, il faisait des caprices jusqu'à ce qu'il parvienne à ses fins. Très vite, Robert et Cécile prirent l'habitude d'avoir une réserve de tabac à son usage. Bien cachée. Mais fouinant, Nanaqui découvrait les cachettes, il les vidait sans que nul ne s'en doute jusqu'au moment où, de nouveau : «Cécile, tu me donnes du tabac ? » On cherchait les cachettes les plus insoupçonnables ; toujours il les découvrait. Pour lui, cela devenait un jeu!
Antonin Artaud a beaucoup compté dans la vie de Cécile et de Robert. Je n'en parlerai pas trop ici. Il faudrait que je trouve un jour le temps et le courage nécessaires pour débroussailler les notes que Cécile destinait à un livre qu'elle voulait lui consacrer parallèlement à ses autres « Souvenirs » que, malheureusement, la maladie ne lui permit pas de mener à leur terme. Cependant je ne puis passer complètement sous silence « Les Cenci » qui, en 1935, ont révolutionné le monde des Lettres et du Théatre et firent couler tant d'encre. A propos de la «première » de cette tragédie, Hanoteau écrivait : « 6 mai 1935. Deux millénaires plus trois siècles de théâtre biffés par une seule représentation. » (Ces Nuits qui ont fait Paris. Fayard, 1971). Je n'en parlerai ici que très succinctement.
Comme pour « Marie Stuart » qu'il voulait absolument que Cécile joue à la T.S.F. - on ne disait pas encore la radio - Nanaqui a écrit la majeure partie des Cenci sur le secrétaire de Cécile ou le bureau de Robert... en prenant n'importe quel papier qui lui tombait sous la main et parfois une lettre importante. Et tout en écrivant, il clamait ses textes à voix haute au point que ses hôtes les savaient par cœur.
Lorsqu'une période importante lui semblait être au point, il obligeait Cécile à laisser tout son travail en cours - et Dieu sait si elle en avait ! - et l'emmenait le long des quais, descendait près de la Seine et là, il déclamait ses phrases d'une voix forte ou les faisait dire de même par sa malheureuse et amicale victime, afin de mieux entendre, dans la caisse de résonance que formaient les murs des quais et l'eau, la musicalité de son œuvre.
Sachant qu'autrefois Cécile avait obtenu un premier prix de Tragédie, qu'elle avait joué avec Sir Benson, du Old Vic Theater, Artaud voulait absolument qu'elle crée l'un des deux rôles féminins de sa pièce : « Ma chère Cécile, Je vous apporte les " Cenci " et vous demande de les lire jusqu'à demain. Le rôle que je vous destine est celui de Lucretia... »
Mais Cécile ne voulait pas. Elle ne voulait plus faire de théâtre ; elle ne voulait surtout pas que l'on dise : « C'est parce qu'ils sont connus qu'elle s'est fait attribuer un rôle » ou bien « Son mari commandite la pièce pour qu'elle puisse se prendre pour une actrice ! » Vous savez comment sont les bons petits copains ! Comme Nanaqui a eu Cécile à l'usure, cela n'a pas manqué et, comme le commanditaire était Lord Abdy, on peut lire dans le livre de Guillaume Hanoteau déjà cité : « On ne fait pas joujou avec le théâtre sans avoir envie, un jour ou l'autre, d'y jouer pour de vrai. Au terme des pourparlers, Cécile Bressant, c'est-à-dire Mme Robert Denoël, était Lucretia, la femme de Cenci, Lady Abdy, Béatrice. Or, les références de cette dernière étaient minces, quelques leçons avec Dullin, et le rôle écrasant... » Bien sûr, il ne dit rien de méchant au sujet de Madame Denoël, mais on peut s'y tromper.
Pour arriver à ses fins, Nanaqui avait dû revenir à la charge. Une lettre (enfin datée !) du dimanche soir 17 Février 1935 commence ainsi : « Ma chère Cécile, le rôle de Lucretia dans la version historique de l'histoire des Cenci, Shelley étant définitivement écarté, a été écrit pour vous, et pour vous permettre de mettre en valeur les qualités que je vous attribue avec ce texte. Si vous avez quelque chose dans le ventre, c'est une occasion pour vous irremplaçable de le montrer. Physiquement, vous êtes le personnage, vous l'êtes aussi spirituellement. Il n'est pas question, je vous assure, qu'une autre personne que vous le joue. Je ne veux plus d'acteurs mais des êtres vivants. Si vous consentez à vivre, c'est-à-dire à sortir la vie effervescente qui est en vous, vous jouerez ce rôle de manière grandiose. »
Artaud l'avait tellement tarabustée que Cécile avait fini par accepter de répéter le rôle de Lucretia en attendant que l'on trouve une actrice. Il en vint enfin une (très connue) ; mais lorsqu'elle vit comment Artaud metteur en scène traitait ses acteurs et principalement les deux principales actrices, elle s'enfuit à toutes jambes et court peut-être encore ! Cécile se laissa donc faire et joua le rôle écrit pour elle. Je ne donnerai aucun détail technique; elle seule pouvait le faire vraiment. Mises à part les bribes que l'on vient de lire, je ne citerai pas les lettres de Nanaqui à ce sujet ; mais je tiens à recopier in extenso la dernière de celles-ci, écrite juste après la dernière représentation : « Je ne peux pas laisser se terminer cette série de représentations des " Cenci " sans vous remercier de la fermeté extraordinaire, et qui est à mes yeux quelque chose d'héroïque, avec laquelle seule de toutes les actrices et de tous les acteurs des Cenci, vous êtes demeurée, sans dévier de la ligne de votre rôle, ne descendant pas un instant et à aucune des quinze représentations au-dessous du diapason qui vous était demandé et que vous avez su tenir. Il y a plus que de la conscience, il y a une sorte de grandiose acharnement qui vous a valu d'ailleurs dans l'ensemble de l'opinion, d'être tenue pour beaucoup plus émouvante, sincère et vraie que le premier rôle féminin. Soyez-en inoubliablement remerciée. Antonin Artaud ».
Et il ajoutait dans la marge : « Si tout le monde avait fait son devoir comme vous et avait su maintenir l'atmosphère, la vie et la tension obtenues aux dernières répétitions, nous aurions eu un triomphe écrasant au lieu d'un succès discuté et qui ne touche pas à certains morceaux du spectacle. »
*
Tout le monde n'est pas littérateur - je n'ai pas la fatuité de croire que je le suis - et nombre de gens peuvent se demander en quoi cette pièce, qui ne fut jouée que quinze fois (La lettre d'Artaud indiquait quinze, l'édition de ses œuvres complètes par Gallimard indique dix-sept ; je crois ce chiffre plus exact), était une chose tellement importante. Sans aller rechercher tout ce que l'on a pu en dire, en général, d'excessif tant dans la louange que dans le dénigrement, je crois utile de recopier ici quelques passages d'un texte d'André Franck qui présentait au monde littéraire, artistique et, hélas ! surtout mondain « Les Cenci », Tragédie en quatre actes et dix tableaux d'Antonin Artaud :
« Depuis deux mois, le monde de l'esprit, du théâtre, une jeunesse éprise de hardiesse et d'art, savent qu'Antonin Artaud monte Les Cenci, tragédie d'Artaud lui-même, d'après Shelley et Stendhal, aux Folies-Wagram. Partout on en discute. Pourquoi cet intérêt ? Pourquoi ces discussions ? Pourquoi cette passion ? Comme le contrastre est grand avec l'indifférence où sombrent, à l'ordinaire, la plupart des événements du théâtre ! Les représentations des Cenci aux Folies-Wagram sont en effet le début d'un mouvement qui veut redonner aux représentations théâtrales leur vraie place, leur rôle : réveiller le sens du tragique, prendre le public par les entrailles et le cœur, lui redonner les passions de nature. Il n'est point de théâtre sans un envoûtement du spectateur par le spectacle. Avoué ou non avoué, conscient ou inconscient, l'état poétique, un état transcendant de vie, est au fond ce que le public recherche à travers l'amour, le crime, la boxe ou l'insurrection. Le Théâtre de la Cruauté a été créé pour ramener au théâtre la notion d'une vie passionnée et convulsive ; et c'est dans ce sens de rigueur violente, de condensation extrême des éléments scéniques qu'il faut entendre la cruauté sur laquelle il veut s'appuyer. [...] Aux Folies-Wagram, on hurlera, on pleurera, on sifflera peut-être, mais c'est de trop subir les émotions du véritable tragique. Il y a des batailles d'Hernani qui sont bienfaisantes. »
Un peu plus loin André Franck parle de la mise en scène qui, à l'époque, représentait une véritable révolution et serait mieux comprise aujourd'hui près d'un demi-siècle plus tard :
« Cette mise en scène comporte d'abord une symbolique complète du geste, qui hausse le geste à la valeur d'un véritable langage. Une symbolique des mouvements aussi, où la mise en scène est conçue comme une véritable gravitation. Enfin le jeu muet prend une importance primordiale. Pour une fois on a voulu faire du théâtre intégral où les éclairages eux-mêmes doivent mettre le public dans un certain état d'esprit et sont traités à la manière de Goya.
Les sonorités, elles aussi, prennent dans cette mise en scène une importance singulière. S'il faut agir sur le spectateur par tous ses sens, l'ouïe est d'une importance primordiale. On entendra, aux Folies-Wagram, une marche au supplice exécutée avec des instruments en bois, un enregistrement du bourdon de la Cathédrale de Chartres, des bruits de tempête... une musique surhumaine et inhumaine de Désormières. [ ...] Tout historique qu'elle soit, la tragédie des Cenci n'en est pas moins une fourmillante et continuelle allusion à l'actualité. On y retrouvera notre époque avec ses spasmes, ses hurlements, ses effrois... »
Pour parvenir au paroxysme qu'il souhaitait, Artaud ne craignait pas de torturer littéralement ses acteurs. Il était même allé jusqu'à vouloir pendre par les cheveux Béatrice et Lucretia. Sans truquage ! Vous pensez si Iya Abdy et Cécile Bressant avaient refusé ! Certaines scènes étaient d'une brutalité inouïe : à un moment, Artaud-Cenci lançait furieusement sa jeune femme Lucretia d'un bout à l'autre de la scène. Il était heureux que Cécile ait été championne dans les disciplines les plus diverses au cours de sa jeunesse et qu'elle continuât à pratiquer escrime et danse acrobatique deux fois par semaine ! Cependant, la violence d'une répétition de cette scène causa un drame irrémédiable : malgré le début du premier cancer constaté après la naissance du Finet, Cécile était en voie de lui donner un petit frère. A la suite de cette violente répétition, elle fit alors un accident qui déclencha définitivement le « mécanisme » du cancer qui la priva de la possibilité d'avoir les autres enfants qu'elle souhaitait et mit sa vie en danger.
Dans sa dernière lettre au sujet des Cenci, Artaud parle du diapason qui était demandé aux acteurs. Effectivement l'intensité dramatique ne devait pas se relâcher un seul instant et il fallait que, tout en restant parfaitement audible la voix couvre par moments la « musique surhumaine et inhumaine » dont parle André Franck et le bourdon de la cathédrale de Chartres dont le son assourdissait acteurs et spectateurs.
Petit détail supplémentaire : pour obtenir certains effets visuels, Artaud avait imposé à Cécile un maquillage qui s'accentuait au cours du déroulement de la pièce et, pour la scène du supplice, ce maquillage contenait un produit à basé de minium qui lui brûla la peau et dont les traces ne purent jamais être effacées.
*
Lord Abdy avait commandité le spectacle mais, au fil des jours, cette commandite se révéla insuffisante. Robert, qui ne pouvait rien refuser à Nanaqui, ajouta peu à peu ce qui manquait au point que cela mit en difficulté les finances des Editions Denoël et Steele qui, malgré des succès importants, étaient toujours sur la corde raide. La maison était justement en train de lancer une publication nouvelle qui consistait en une série de grands cahiers (30 x 40 cm environ), d'une centaine de pages, axés chacun sur un thème d'actualité important : Le Document, selon la formule que l'on pouvait lire dans les premiers numéros : « Le Document procède d'une formule originale. Un seul écrivain pour un seul sujet. Mais un sujet vraiment passionnant. Mais un écrivain vraiment éclairé. »
Il s'agissait d'une entreprise grandiose pour l'époque et qui mettait en jeu un financement important pour le budget, trop modeste, de la maison. Trois numéros du Document avaient déjà paru, deux autres de même importance étaient en fabrication. Le trou creusé dans la caisse des Editions par le «supplément de commandite » des Cenci, faillit faire sombrer le Document. Peut-être aussi l'entreprise était-elle trop ambitieuse ? Toujours est-il que les numéros suivants tombèrent de 98 à 32 pages et le prix de 10 F. l'exemplaire à 3 F. Le Document conserva pour ses lecteurs un grand attrait, devint une revue mensuelle ; mais l'originalité, la spécificité que présentaient les cinq premiers exemplaires tomba et la publication perdit de son intérêt.
*
Après le premier titre « U R.S.S. puissance d'Asie » paru en octobre 1934, qui avait été une petite bombe dans le monde de l'information, le titre suivant : « Le Pape dans le monde contemporain » allait également avoir un impact très important. Si je m'attarde sur ce sujet, c'est que pour la mise au point de chaque détail, il était nécessaire d'aller sur place demander une confirmation ou une autorisation de publication, tant les choses touchant aux religions étaient alors taboues.
L'auteur, Joseph Ageorges, possédait parfaitement son sujet et était un habitué des coulisses du Vatican, mais il se heurtait à trop d'interdits. Le don de persuasion de Robert et l'opiniâtreté souriante de Cécile allaient faire tomber certaines barrières et glisser un œil indiscret dans les chasses gardées du Saint Office. Ils s'y rendirent ensemble une première fois, furent reçus en audience privée par Sa Sainteté le pape Pie XI et, dès cette première entrevue, une sorte de sympathie s'établit entre le Saint Père et ses deux jeunes éditeurs au point que, pour se dégourdir un peu les jambes (alpiniste avant son élection, Pie XI se morfondait de ne plus pouvoir vraiment faire du sport), il leur fit lui-même les honneurs des jardins privés tout en parlant « travail », car le pape est un homme qui a peu de temps à perdre. Très discrètement Robert profita de ce que Cécile entretenait le Souverain Pontife pour faire quelques photographies ce qui, dans la partie privée, était strictement interdit. mais lorsque, lors d'une autre visite, l'éditeur-photographe avoua son crime en présentant les agrandissements qu'il avait fait faire, le successeur de Saint-Pierre ne put qu'admirer et sourire et il donna l'autorisation d'en publier certaines dans le Document (La plupart des photos illustrant ce numéro, hormis les photos d'archives, sont de Robert Denoël).
Un plan de travail fut établi et, chaque fois que cela était nécessaire, Cécile ou Robert faisaient un saut jusqu'à Rome après avoir demandé à l'avance une audience qui n'était jamais refusée. Bien entendu, Robert se présentait en jaquette, Cécile en stricte robe noire et portait mantille de dentelle, noire également (Une mantille ayant appartenu à Laetitia Bonaparte, légèrement restaurée, que Cécile tenait de sa grandmère paternelle).
*
L'appartement magnifique de la rue de Buenos-Ayres où le Tout-Paris se pressait autrefois - mais où jamais nul ne pénétrait sans y être invité - était quasi-désert. Presqu'autant que lorsque, entre 1941 et 1944, Cécile et Robert faisaient le vide pour accueillir Louis Aragon et Elsa Triolet qui, lorsqu'ils venaient à Paris durant l'Occupation, descendaient régulièrement chez Cécile et Robert. Comme ils le disaient eux-mêmes, c'est là qu'ils se sentaient le plus en sécurité, même s'ils savaient les risques qu'ils faisaient courir à leurs hôtes ainsi qu'à toute autre personne qui se serait trouvée là lors d'une éventuelle « visite » de ces messieurs de la Gestapo.
Luc Dietrich, lui, fait partie des quelques familiers de la maison que Cécile et Robert couvaient littéralement avec une paternité discrète. De bien jeunes parents ! leur amitié pour lui était venue d'une sorte de « coup de foudre » lorsqu'ils eurent lu le manuscrit du Bonheur des Tristes, et s'assura par l'amour commun de la photographie qu'avaient Robert et Luc.
Si, lors de mes difficiles débuts de comédien, Robert me trouvait toujours un travail urgent et indispensable à faire « pour lui rendre service » vers l'heure des repas afin de m'obliger discrètement à partager ceux-ci avec eux aux époques où ils savaient que je ne mangeais pas tous les jours ; pour Luc, grand malade qui, lui non plus, ne roulait pas sur l'or, il usait (toujours avec la complicité de Cécile bien entendu) d'une autre stratégie : il lui demandait de partir à la recherche de tel livre rare, de tel renseignement indispensable, et lui avançait très largement, mais toujours avec une adorable discrétion, les frais de ces recherches dont il était friand.
C'est ainsi qu'un jour il lui demanda de rechercher les origines paternelles de Cécile. Il savait d'ailleurs très bien à quoi s'en tenir puisque Marie Bonaparte, princesse de Grèce, appelait toujours Cécile « ma chère cousine », ce qui agaçait singulièrement celle-ci qui répliquait : « Tu ne peux pas m'appeler Cès ou Cécile comme tout le monde ? » Luc se mit donc en chasse.
Un jour, revenant d'une des nombreuses quêtes que cela représentait, il regarda Cécile d'un air admiratif et lui dit simplement : « Eh bien, mon vieux ! » Il ne put malheureusement donner les résultats précis de sa longue enquête (j'ai déjà dit comment il en était mort), mais souvent, lorsqu'il écrivait à Cès, au lieu de commencer sa lettre par le rituel « Chère amie », il débutait par « Mon Vieux » !
Drôle de garçon. Difficile parfois, exigeant, dur bien souvent, mais tellement attachant. Il lui arrivait de venir rue de Buenos-Ayres et de demander à Cécile ou à Robert : « Vous m'acceptez pour un jour ou deux ? » - « Bien sûr, mon petit Luc. » Il s'installait alors dans la chambre d'amis la plus confortable... et y restait deux ou trois mois ! D'une certaine manière, il rappelait Antonin Artaud par ses fantaisies inattendues. Il se voulait exclusif et me jalousait parfois, pas toujours très gentiment ; mais on pardonne beaucoup à un malade et il y avait tant de misère et tant de tendresse en lui !
Pauvre Luc. Il avait mal démarré dans la vie et s'en vengeait sur ses nombreuses conquêtes féminines. Car il avait auprès des dames un de ces succès... Original, il le fut jusqu'à son enterrement qui eut lieu un jour où les «croques-morts» faisaient grève, et ce sont quatre gaillards en bleu de chauffe, recrutés au dernier moment, qui portèrent son cercueil dans l'église où avait lieu la cérémonie. Curieuse destinée que la sienne.
*
Tout le monde connaît l'amitié merveilleuse qui liait Luc Dietrich et Lanza del Vasto. Curieux personnage, lui aussi, tout à fait à l'opposé de Luc. Il descend d'une noble famille sicilienne : les princes Lanza di Taubia qui obtinrent, en 933, le marquisat du Vasto, dont Lanza fit son nom ; il en gardait le symbole et signait souvent d'une croix dont chaque branche se terminait par un croissant.
Au départ, Robert Denoël ne l'aimait pas tellement ; comme vous et moi il avait ses têtes et ses lubies : il le trouvait trop esthète et s'arrangeait pour éviter de le rencontrer trop souvent, ce qui peinait beaucoup Luc Dietrich.
Or, un jour qu'il discutait avec Lou Albert Lazard - encore un phénomène que je suis allé voir bien des fois dans son atelier - il décide, sans en avoir les moyens financiers, de partir à l'aventure vers l'Orient sans but précis. Bien entendu, au cours de ses pérégrinations, il écrivait à son ami Luc qui, ainsi, était au courant de ses aventures, pouvait imaginer les paysages, vivre un peu de sa vie hors du commun.
Peu avant le retour de son ami, Luc apporta quelques unes de ces lettres à Cécile qui les lut avec une joie, une émotion, une exaltation qui lui firent demander :
- Vous en avez d'autres ?
- De ses lettres ? Tout un tas. Vous voulez les lire ?
- Avec joie.
Cécile lut, relut les lettres et questionna : « Il revient quand ? »
- Dans quinze jours, trois semaines...
- Vous pouvez me confier ces lettres ? Luc hésita :
- Que voulez-vous en faire ?
- Les montrer à Denoël ; il y a là la matière d'un bouquin formidable !
- D'accord, mon vieux, mais ne les abîmez pas. J'y tiens, vous savez !...
- Je sais.
Le soir, Cécile en parla a Robert... qui avait d'autres soucis, qui n'avait pas le temps, et surtout pas le désir de lire quoi que ce soit de Lanza.
- Tu ne vas pas me refaire le cour de L' Hôtel du Nord, non ! éclata-t-elle.
Robert la regarda un instant, silencieux tout à coup.
- C'est à ce point là ?
- Autre chose, mais mille fois mieux.
Dès son retour, Lanza apprit que Denoël l'attendait et ce qu'il souhaitait de lui. Il ne vint pas. Je le rencontrai à plusieurs reprises chez Luc, avenue Alphonse XIII, et il nous parlait volontiers de son voyage et des enseignements qu'il en avait rapportés ; mais il se hérissait à l'idée d'en publier le récit.
Cécile aussi venait souvent voir Luc, alité à cette époque, et revoyait Lanza toujours réticent : « J'ai d'autres choses en tête », coupait-il lorsqu'elle parlait du livre espéré, « je dois terminer mon Gilles de Rais. D'ailleurs ce que j'aurais à dire sur l'Inde n'intéresserait qu'une élite. »
Le temps passa. La guerre survint. Lanza partit en Suisse, il en revint mais, chaque fois que l'on évoquait sa merveilleuse expérience, il se refermait sur lui-même et parlait d'autre chose. Jusqu'au jour où Cécile demanda à Robert d'user de son don de persuasion. Ce qu'il dit, ce qu'il fit, nul ne le saura sans doute jamais. Toujours est-il que celui que Gandhi avait choisi entre tous et nommait « Shantidas », le Serviteur de Paix, se mit à l'ouvrage et, en quelques mois, grâce aux lettres de Luc et à ses notes personnelles, écrivit Le Pèlerinage aux sources, qui allait ouvrir les yeux et le cœur des Occidentaux que nous sommes sur de nouvelles façons de penser et de vivre. Le livre parut en novembre 1943 et son succès, dès les premiers jours, dépassa toutes les espérances. Qui ne connaît aujourd'hui le nom de Lanza del Vasto ?
*
Je reviens à Luc Dietrich ou plus exactement à Marie Bonaparte, que j'ai connue grâce à lui : pour le lancement de son livre Terre, album de photographies illustré de textes très courts mais infiniment poétiques, inspirées par les images et le ressouvenir, Denoël avait organisé une exposition de photos de Luc Dietrich à la Galerie Braun. Marie Bonaparte avait acheté deux de ces photographies encadrées et Luc m'avait demandé de les porter chez elle pour les lui remettre en mains propres. J'étais enchanté de l'aubaine : je n'avais pas encore rencontré « Son Altesse Impériale et Royale la Princesse de Grèce » (tel était le titre officiel par lequel il était séant de la nommer). En fait, lorsque son majordome m'introduisit dans la bibliothèque où, pensivement, elle allait de long en large les mains derrière le dos, j'eus l'impression de me trouver devant « le petit caporal ».
Lorsque je la vis de plus près, la ressemblance était un peu moins nette, mais l'impression première subsistait et l'on imagine facilement que le futur empereur devait avoir, comme elle, le ton un peu sec et précipité. Mais la Bonaparte que j'avais en face de moi possédait une extrême gentillesse qui savait mettre à l'aise et chassa ma paralysante timidité. La visite éclair que je devais faire à cette princesse dont le temps était précieux dura plus d'une heure.
Si je parle d'elle dans un ouvrage dont le sujet principal est sa cousine Cécile, c'est pour conter cette anecdote que je tiens de celle-ci. Les réunions de travail de la « Revue Psychanalytique »se tenaient régulièrement chez Marie Bonaparte. Cela se passait généralement dans la bibliothèque, haute de deux étages et ceinturée à mi-hauteur d'un balcon intérieur où s'installaient souvent le prince Georges et Cécile, qu'amusaient les interminables palabres de ces pontifes de la psychanalyse d'alors ; et d'où les deux compères observaient, peu charitablement, les tics et les manies de chacun de ces messieurs qui, sans s 'en douter, préparaient la libéralisation des mœurs d'aujourd'hui.
Chacun de ces doctes messieurs avait sa thèse propre et la défendait comme une forteresse assiégée par l'ennemi. A tel point que le ton de ces réunions montait peu à peu et que, laissant leur dignité au vestiaire, ces disciples de Freud semblaient être prêts à en venir aux mains ! Vue du balcon, la bataille contenue prête à se déchaîner était, parait-il, irrésistible : Cécile et Georges espéraient pouvoir un jour compter les coups.
Le prince, un soir, demanda à Cécile sur un ton doctoral : « Ne pensez-vous pas, chère amie, que chacun de ces messieurs aurait besoin d'une sérieuse psychanalyse ? » Je ne sais plus ce qu' elle répondit mais ils éclatèrent tous les deux d'un rire qui créa, en contrebas, un silence aussi subit qu'offusqué et que toutes les barbes se levèrent en une muette réprobation.
*
J'en reviens forcément au moment le plus grave de sa vie : lorsque son mari, lorsque son amour fut assassiné. J'ai promis de dire ce qu'il en était de ce meurtre ; l'heure est venue d'en parler. En parlant du crime, je vais être obligé de parler également des procès. L'imbrication semble telle que tous, à l'époque, pour parler du premier ou des seconds usaient du même terme : « L'Affaire Denoël ».
A la vérité, sans le meurtre, les procès n'auraient pas eu lieu ; mais il n'est pas possible d'affirmer, comme certains ont tenté de nous le faire dire, que la bénéficiaire des procès était l'instigatrice du crime. L'eût-elle été d'ailleurs que, grâce à ses « amitiés » puissantes, elle s'en serait tirée blanche comme neige. Telle est la justice des hommes. Mais la neige finit par fondre et, à Paris, elle devient boue.
Avant de parler de « l'Affaire Denoël » proprement dite, il me faut préciser quelle était la situation de Robert Denoël avant le drame. On sait que Robert avait un associé bavarois : Wilhelm Andermann. Celui-ci possédait 1480 parts de la Société des Éditions Denoël. Deux autres petits porteurs fictifs de parts : Pierre Denoël et Max Dorian, en possédaient officiellement cinq à eux deux. Quant à Robert Denoël, il possédait les 1515 autres, ce qui lui assurait la majorité, et par le nombre de parts et par le nombre d'actionnaires puisqu'il avait en mains son frère Pierre et son employé Max.
Pour ne pas compliquer ces explications préliminaires, j'éviterai de parler des Editions de la Tour dont Robert possédait la totalité des parts qui, « officiellement » étaient réparties entre deux hommes de paille : Maurice P... [Percheron] (Je n'indique pas son nom car il eut une « attitude » peu recommandable par la suite. Cécile a pardonné et je viens d'apprendre son décès) en ayant un tiers, et moi les deux autres tiers.
Une tactique identique avait été utilisée dans une autre maison ainsi que l'écrivait le grand quotidien « France-Soir » qui dévoila qu'en 1944 Robert Denoël disposait d'une fortune considérable qu'il dissimula dans diverses maisons d'édition et qu'entre autres il possédait en sous-main la moitié des parts des Editions D...-M... [Domat-Montchrestien] dont il sera question au cours des procès car la gérante en était Jeanne L... [Loviton], la maîtresse en titre de Robert à cette époque.
Au moment de la Libération de Paris, les parts sociales d'Andermann, sujet allemand, furent mises sous séquestre. Rien de plus normal. Un administrateur provisoire de la Société des Editions Denoël fut nommé. Cela s'est passé pour la majorité des sociétés ayant eu des capitaux « ennemis » ; cela aussi était normal.
Robert Denoël était dépossédé de sa maison d'éditions, me direz-vous ? Que non pas ! Cet administrateur provisoire était Maximilien Vox que, par les amis de son amie (et ici on pourra voir le seul coup de chapeau que je donnerai à cette dame), Denoël avait réussi à faire nommer. Ancien collaborateur de la maison, notamment à l'époque du Document dont il composa plusieurs couvertures, Maximilien Vox ne faisait pratiquement rien sans en référer à Robert, qui continuait à choisir les manuscrits et à diriger « sa » maison par administrateur interposé.
C'est sous son règne qu'Elsa Triolet obtint le prix Goncourt pour Le premier accroc veut deux cents francs, que l'auteur dédicaça simplement « A Cécile, comme toujours » ; c'est dans les mêmes conditions que parut le Tropique du Cancer d'Henry Miller dont Cécile avait commencé la traduction à une époque où il n'était guère possible de la publier en Europe. C'est finalement une traduction de Paul Rivert qui fut éditée. Cécile a traduit plusieurs ouvrages sous le pseudonyme de Pierre Dutrait. C'est sous ce même pseudonyme que fut publiée une piécette de théâtre de Robert : « Ziziphora » dont nous possédons le manuscrit [Ziziphora n'a pas été édité]. Pierre Denoël s'est également servi de ce nom, notamment pour des mots croisés dans « Ce Soir »). Pas un seul employé de la maison ne doutait que Denoël fut toujours « le patron ».
Donc, d'une part, société sous administration provisoire, d'autre part quelques livres, parus durant l'occupation, ne concordant pas avec les vues de la nouvelle France, une enquête avait été ouverte ; cela aussi était plus que normal. Denoël était vice-Président du groupement corporatif du Livre, il en fut exclu le 19 Septembre 1944 parce que son incorrigible franchise n'avait pas fait plaisir à la majorité de ses confrères. Dès la Libération, il y eut des Comités d'Epuration qui se voulaient les copies conformes des comités révolutionnaires créés un siècle et demi plus tôt. Si Denoël eut affaire à eux, il ne fut pas le seul, peu s'en faut.
Robert fut donc convoqué par le juge Olmi qui devait trancher de ce genre d'affaires. La convocation arrivée à son domicile rue de Buenos-Ayres, c'est donc Cécile qui la reçut et se mit directement en rapports avec ce magistrat pour demander un report de deux ou trois jours, « son mari étant momentanément absent de son domicile », et également s'assurer que, s'il se rendait à cette convocation, il sortirait du cabinet du juge en toute liberté. Elle en obtint l'assurance. C'est donc moi qui remis la convocation à Robert, accompagnée d'un mot de sa femme insistant pour qu'il ne se laisse influencer par personne et réponde sans la moindre crainte à la dite convocation.
Robert se rendit à l'heure dite chez le juge Olmi et en ressortit le cœur plus léger : il avait pu s'expliquer d'homme à homme sans aucune intervention extérieure. Il s'ensuivit un non-lieu en date du 13 juillet 1945 et une décision de classement cinq jours plus tard : le 18 Juillet. Cependant la Société des Éditions Denoël restait en cause pour trois ouvrages - trois ouvrages seulement [en réalité : douze] - dont le jugement définitif fut prévu pour fin décembre 1945. Le décès de Robert Denoël retarda ce jugement. Disons tout ce suite que la Société des Éditions Denoël fut définitivement blanchie le 30 Avril 1948.
Les trois livres incriminés étaient : Les Discours d'Adolf Hitler (1941) ; Propos sur l'Angleterre de Charles Albert (1941) et Les Décombres de Lucien Rebatet (1942). C'est tout. Libéré des foudres du Comité d'Epuration au mois de juillet 1945, Robert Denoël avait décidé de reprendre officiellement en mains la direction des Éditions Denoël dès le début de l'année 1946 (France-Soir indique que c'est à la mi-novembre 1945 que Robert Denoël aurait manifesté dans son entourage l'intention de reprendre, dès janvier 1946, la direction de ses affaires. Dans son agenda, un rendez-vous était prévu pour le 3 décembre 1945 avec des hommes d'affaires) et de lui donner encore plus d'ampleur que par le passé.
La petite maison d'édition de la Tour n'avait plus de raison d'être ; elle vivoterait pour conserver le nom et faire du « compte d'auteurs » en remplacement des Editions des Trois Magots fondées autrefois dans la librairie des débuts et qui avait été vendue durant l'occupation. Quant à moi, je retrouverais les planches qui me manquaient et où Jacques Hébertot (pour ne citer que lui) me réclamait. L'autre petite maison d'édition reviendrait aux Cours de Droit qu'elle éditait auparavant. Robert reviendrait tranquillement auprès de sa femme et de son fils... en attendant peut-être quelque fugue sans gravité majeure. La guerre se terminait. Tout allait rentrer dans l'ordre. La vie allait reprendre. Mais le Destin était là et, pour qu'il ne manque pas son coup, il y a ceux qui allaient appuyer de tout leur poids dans la balance.
*
Hormis le ou les criminels et, bien entendu, la victime, le meurtre n'eut aucun témoin. Il est impossible de savoir exactement ce qui s'est passé puisque Robert Denoël était mourant lorsqu'il fut trouvé et que le ou les agresseurs ne sont pas connus. On est donc obligé de se fier aux témoignages des personnes présentes avant ou après le crime. Et rien n'est plus sujet à caution qu'un témoignage sans preuve.
L’événement s'étant produit dans la soirée du dimanche 2 décembre 1945 entre 21 h 20 et 21 h 23, tous les journaux du lendemain matin annonçaient en première page le meurtre de l'éditeur d'après le très bref communiqué qu'ils avaient reçu et sur lequel ils avaient dû broder sans donner de détails (sauf imaginaires pour certains d'entre eux) : Denoël avait été tué par une balle de fort calibre ; d'après le commissaire de police du quartier du Gros-Caillou, il se serait agi d'un crime crapuleux.
Dès le mardi la plupart des journaux donnaient les premières indications officielles que voici résumées en quelques phrases :
- Robert Denoël et une amie se rendaient en automobile au Théâtre Agnès Capri après avoir dîné chez cette amie, rue de l'Assomption.
- Alors que la voiture se trouvait au coin de la rue de Grenelle et du boulevard des Invalides un pneu aurait éclaté.
- Pour ne pas arriver en retard au Théâtre, l'amie serait allée au commissariat de police pour demander un taxi pendant que Denoël aurait changé la roue. (Le fait d'aller au Commissariat n'a rien d'étrange : à cette époque on ne pouvait avoir un taxi autrement. Ce qui pourrait sembler étrange, c'est que la dame n'ait pas attendu auprès de son ami durant les quelques minutes nécessaires à un changement de roue.)
-- Un garde mobile en faction à une cinquantaine de mètres devant le ministère du Travail, ayant entendu un coup de feu, s'est précipité et a découvert un homme gisant sur le bord du trottoir, face contre terre. Ses mains crispées tenaient encore un cric et une manivelle.
- L'homme : Robert Denoël, mortellement blessé, est emmené à l'Hôpital Necker ; il meurt durant son transport sans avoir pu parler. Une balle de Colt, calibre 11,8 mm, entrée sous l'omoplate gauche est ressortie sous le sein droit.
Tels semblent être les faits sur lesquels devront se baser toutes les suppositions pour tenter de reconstituer le drame.
*
Le commissaire divisionnaire Pinault et l'Inspecteur principal Casanova sont chargés de l'enquête, aidés par les inspecteurs Ducourthial, Boulanger et Pelletier. Le juge Gollety a désigné le Docteur Piédelièvre, médecin légiste, pour pratiquer l'autopsie. Parallèlement les journalistes sont sur les dents. Ils essaient d'avoir les tuyaux de dernière heure ; d'aucuns font leur enquête personnelle d'une manière très sérieuse ; d'autres pondent des articles plus ou moins fantaisistes. Cela n'est pas particulier à l'affaire Denoël, il en est généralement ainsi pour tout ce qui peut faire vendre du papier.
Selon les journaux, le corps de Robert Denoël fut découvert, soit par deux employés du ministère du Travail, soit par un garde mobile, soit par un chauffeur de taxi. Un promeneur aurait même croisé trois hommes qui auraient attaqué l'éditeur avant de l'abattre d'un coup de revolver. Cette dernière version fut aussitôt démentie par la police ; pas les autres.
Certains ont parlé d'un coup de feu, d'autres de deux. La balle ayant traversé le corps changeait parfois de calibre en passant d'une rédaction à l'autre mais ce n'est certainement qu'une faute d'inattention de la part d'un copiste. Le corps aussi changeait de place : selon l'édition que vous lisiez, il pouvait être : près de la voiture, sur le trottoir en face ou près de ce trottoir. Un témoin, un seul, avait entendu crier « Au voleur » et un grand cri de douleur. Où était la vérité?
Peu à peu la version officielle se précise ainsi : « Occupé à changer un pneu, Denoël est assailli par derrière, il se dégage, porte un coup à l'un des assaillants au moyen du cric. Celui-ci prend la fuite, l'éditeur le poursuit. Le second agresseur, pour dégager son camarade, abat l'éditeur d'une balle tirée dans le dos. »
Dès cet instant on peut logiquement penser qu'il y avait deux agresseurs. Pourquoi Denoël poursuit-il le premier ? Qui sont les malandrins et quel est le motif du crime ? Nul ne semble le savoir encore. On ne le saura officiellement jamais. La question de savoir s'il y eut un ou deux coups de feu est secondaire puisque, d'après l'autopsie, une seule balle serait entrée et ressortie. J'avoue qu'ayant vu la plaie, je n'aurais jamais pensé qu'un seul projectile puisse faire autant de dégâts. C'est horrible !
Le 11 décembre 1945 à midi les obsèques ont lieu en l'église Saint Léon, place Dupleix ; c'est la paroisse dont dépend l'appartement de Cécile et Robert, rue de Buenos-Ayres.
*
Deux jours plus tard, le 13 décembre 1945, d'après Midi-Soir, une lettre signée V.N. avait été adressée à la préfecture de police, déclarant que le signataire de cette missive était prêt à faire des révélations importantes par l'intermédiaire d'un quotidien. Ceci est peut-être fantaisiste (cela arrive et « officiellement » on l'a considéré comme tel) ; ces révélations sont peut-être réelles et, dans ce cas, on aurait réussi soit à neutraliser ce V.N., soit à acheter son silence. Il semble que nul n'en ait plus jamais reparlé par la suite.
Le 12 Avril 1946, tout en faisant remarquer que, depuis décembre, la police garde le plus profond silence sur l'assassinat de Denoël, le journal Le Populaire dévoile que maître Rozelaar, avocat de Madame Denoël, a saisi le juge des référés deux mois plus tôt au sujet d'une curieuse affaire : Le 21 janvier 1946 Jeanne L... [Loviton] (la dernière maîtresse de Robert) aurait fait savoir que Robert Denoël lui aurait cédé la totalité de ses parts sociales des Editions Denoël. Cette cession de parts, datée du 25 Octobre 1945, soit trente-huit jours avant le meurtre de l'éditeur, avait été enregitrée le 8 Décembre !
Etait-il pensable que, « même par amour », Denoël se serait dessaisi de la totalité de sa maison d'édition ? Etait-il possible que, sous quelque menace que ce soit, il eût déshérité son fils ? N'est-il pas bizarre que cet acte de cession, dont nul n'avait jamais entendu parler, ait été enregistré six jours après l'assassinat ?
Maître Rozelaar, au nom de la veuve et de l'orphelin de l'éditeur, a vu là une « manœuvre frauduleuse ». Le langage des gens de robe use ainsi d'euphémismes qui, s'ils sont transparents, ne manquent pas d'être hypocrites ; mais c'est là l'une des exigences de la loi.
Une série de procès commence. D'un coté, maître Rosenmarck, avocat de la maîtresse de Denoël, soutient que l'achat des parts est réel ; de l'autre côté, maître Rozelaar qui essaie de défendre la vérité. Certains ont appelé cela la guerre des deux Roses ; mais c'est surtout la lutte du pot de terre contre le pot de fer : sans amis puissants il est plus difficile de prouver la fraude que d'exhiber des actes sur lesquels les nom et date ont été visiblement ajoutés après coup et ceci sans explication valable ; quant à l'authenticité de la signature, les experts ont semblé s'y perdre.
Au sujet de « l'achat » des parts sociales et de leur paiement, avant retrouvé le texte d'une plaidoirie de Me Armand Rozelaar, je lui laisse la parole (devant la Cour d'Appel de Paris le 2 novembre 1949) :
«... Quoi qu'il en soit, retenons ces dates dont le rapprochement est significatif : 25 octobre 1945, cession prétendue des parts ; 2 décembre, assassinat de Denoël ; 3 décembre, enregistrement des parts ; début janvier 1946, notification à la Société Denoël. La mort a été mise à profit... Et quand les scellés sont mis sur l'appartement que Madame Loviton louait pour Denoël (Il s'agit de la garçonnière de Robert Denoël, 39, boulevard des Capucines, louée au nom de Jeanne. C'est moi qui, chaque fois, remplace le nom de celle-ci par L... et le nom de sa maison d'éditions de cours de droit par D...-M.), on ne trouve rien. Ses vêtements, ses livres, sa montre en or ont disparu. Quant à son compte en banque, il est à sec. Où est donc passé le reste de ce qu'il possédait ?
Le paiement des 757.000 francs ? Une plaisanterie. 757 000 francs, c'était peut-être la valeur nominale des parts. Leur valeur réelle était bien plus élevée. Le fonds de commerce valait sept à huit millions (Des millions de 1945, rien que pour le fonds). Jamais Denoël, qui adorait son fils, n'aurait. consenti à le dépouiller ainsi. L'adversaire a dû avouer que le versement n'a pas eu lieu le 25 octobre, le jour où l'acte aurait été régularisé et la quittance donnée, mais seulement le 30 novembre. Nous affirmons qu'il n'a pas plus été effectué le 30 novembre que le 25 Octobre. Le livre de caisse de la société D...-M... [Domat-Montchrestien] porte trace d'une opération invraisemblable que voici : Le 30 novembre Madame L... verse à son titre personnel dans la caisse de cette société dont elle est gérante, 757 000 francs et s'en fait donner reçu. Puis cette opération faite de la main droite, elle retire, de la main gauche, la même somme et en donne reçu à la caissière ! Cette mise en scène n'a été orchestrée que parce que, en décembre 1945, Madame Loviton sait bien que jamais Madame Denoël ne consentira à lui céder les parts, qu'il y aura procès et qu'il lui faudra prouver comment elle a payé... »
Pourquoi cet étrange échange de reçus de sommes égales aurait-il eu lieu à la fin du mois de novembre ? Cela semble très simple : tous les comptables et même les simples commerçants savent qu'au début de chaque mois on commence, dans les livres de caisse, une page nouvelle et que le bas de la page précédente reste momentanément vierge, les additions étant provisoirement faites au crayon pour le cas où un redressement serait à ajouter. Les écrits sont généralement régularisés à l'encre au moment où l'on a terminé le bilan annuel. Il est également souhaitable, pour ne rien changer dans les autres livres de comptabilité, que les sommes entrées et sorties soient égales. Ce qui fut le cas.
*
Tous ces procès traînent et coûtent une fortune à Cécile, qui n'a que son travail pour y faire face. Quant au crime, dont on n'avait plus parlé depuis fin décembre 1945, on en reparle deux ans plus tard : n'ayant trouvé aucune preuve de quoi que ce soit, les enquêteurs ont accepté la thèse d'un crime de rôdeurs et leurs recherches se terminent par un non-lieu qui clôt cette affaire le 28 Décembre 1947.
La guerre des deux Roses continue jusqu'au jour où, beau cadeau de Noël, le 24 décembre 1948, le tribunal [de commerce] donne gain de cause à la veuve et à l'orphelin, Cécile et le Finet, en condamnant Jeanne à la restitution des parts sociales des Éditions Denoël et à six cents mille francs de dommages-intérêts.
Du coup certains anciens amis ou collaborateurs des Denoël réapparaissent, téléphonent leur indéfectible amitié ; j'ai même retrouvé une lettre venue des Etats-Unis dans laquelle Max Dorian se réjouit de la victoire du bon droit et offre son aide... pour prendre la direction des Editions Denoël.
Comme il fallait s'y attendre, Jeanne et son groupe ne restent pas inactifs, ils interjettent appel et, mettant en branle le ban et l'arrière-ban des supporters, bénévoles ou non, volontaires ou contraints, ils repartent en guerre en sortant leurs cartes maîtresses. En octobre 1949 un arrêt de la cour d'appel remet tout en question : les procès reprennent. Commence alors une lutte à mort.
Comme j'ai parlé deux lignes plus haut de cartes maîtresses, certains pourraient croire que je me fais l'écho de rumeurs selon lesquelles une amie de Jeanne [Suzanne Bidault] qui tint un poste important au ministère des Affaires Etrangères, dont Roger Peyrefitte a beaucoup parlé et avec quel talent ! en lui donnant un surnom qui rappelle celui d'un batracien, mais que je me garderai bien de nommer. Une amie de Jeanne, disais-je, devenue la secrétaire de l'un des trois hommes d'état les plus importants de l'époque, fit définitivement pression sur celle-ci pour qu’il appuie de tout son poids politique dans la balance de la justice et, en remerciement, accepta de l'épouser. J'étais, bien entendu, au courant de ces rumeurs, « mais je n'ai point pris foi sur ces méchantes langues et j'ai voulu gager que c'était faussement »... (Arnolphe dans L'École des Femmes de Molière, Acte II, Scène V. Je laisse à l'auteur la responsabilité de la réponse d'Agnès.)
*
Le 3 décembre 1949, le journal Combat dévoila que la police détenait un document important en rapport direct avec l'assassinat de l'éditeur Robert Denoël mais aussitôt l'avocat de Jeanne demanda à ce journal de rectifier cet article ; on peut lire dans Combat du 7 Janvier 1950: « Maître Rosenmarck a saisi le Procureur Général. Celui-ci a répondu que le Préfet de Police avait fait connaître au Parquet de la Seine que ses services ne possédaient aucun document inédit et n'ont appris aucun élement nouveau à propos du meurtre de Robert Denoël ».
Il est bien entendu que nul n'oserait mettre en doute les dires d'un procureur ou d'un préfet. Mais il arrive au plus naïf de se demander quel intérêt l'avocat de Jeanne Loviton pouvait avoir à ce qu'il ne soit pas fait état d'un document qui aurait trait, non pas aux procès mais au meurtre. La question est troublante mais je tiens à affirmer que je ne veux en tirer aucune conclusion.
La timide révélation de Combat ayant tourné court, France-Soir déclencha, le vendredi 13 janvier 1950, une fracassante campagne de presse sur l'affaire Denoël, reprise par la plupart de ses confrères parisiens et à laquelle s'intéressèrent divers journaux de province et de l'étranger. Et la bombe fut d'autant plus importante qu'elle révélait, sans pouvoir être démentie, que beaucoup de choses avaient été cachées au sujet du meurtre de l'éditeur.
Tout ce que l'on avait su jusque là, d'après le non-lieu du 28 décembre 1947, c'est que des rôdeurs introuvables auraient fait le coup. Des rôdeurs qui semblent n'avoir rien volé malgré le cri : « Au voleur » entendu par un voisin. Dans l'article de Georges Gherra, dans France-Soir du 13 Janvier 1950, mentionnons les rumeurs selon lesquelles les conclusions d'une enquête parallèle menée par la direction des Renseignements Généraux de la préfecture de Police étaient opposées à celles de la Brigade Criminelle.
Retenons particulièrement cette phrase qui, dans son extrême prudence, laisse entrevoir ce que d'aucuns avaient certainement intérêt à tenir caché : « Le dossier aurait été gardé secrètement par l'ex-préfet Charles Luizet qui l'aurait légué à son successeur Monsieur Roger Léonard ». Ce dernier démentait ces bruits. Je me garderais bien de penser qu’'il avait reçu des ordres à ce sujet. Cependant, sur les instances de Madame Denoël, le Parquet avait confié, le 28 décembre l949, au juge Gollety le soin de rouvrir le dossier de l'affaire criminelle.
Après quoi maître Armand Roozelaar aurait remis le 12 janvier 1950 à ce juge un volumineux mémoire qui exposait en détails les machinations qui auraient eu pour but d'accaparer l'exploitation de l'entreprise Denoël. «Toutefois ce texte ne contenait aucune précision qui puisse établir un rapport entre ces manœuvres et le crime lui-même ». Cette dernière phrase n'étant dans cet article que pour éviter toute tentative de procès en diffamation, comme dans certains romans ou films on lit, avec indifférence ou un certain sourire : « Toute ressemblance avec des personnes existant ou ayant existé... »
Du coup l'affaire du crime impuni reprend une place très importante dans tous les journaux. On rappelle rapidement l'affaire et l'on ajoute mille et un détails passés alors sous silence mais qui eussent été indispensables quelques années plus tôt. Pourquoi les avait-on cachés si longtemps ? Pourquoi tant de discrétion ?
Bien entendu, certains journaux prennent parti. L'Aurore insiste beaucoup sur le crime d'un rôdeur ; c'est une solution tellement pratique ! Ce journal aurait pu rappeler l'arrestation, à l'époque du crime, de quatre spécialistes d'agressions nocturnes, âgés de dix-neuf à vingt-cinq ans, qui opéraient dans le secteur des Invalides ; non, ce journal assure que le meurtre a été commis par un nègre américain. On n'a jamais retrouvé ce noir de l'armée alliée et d'ailleurs il ne semble pas que l' on ait fait quelqu' effort pour le rechercher.
Signalons que la guerre est terminée : on parle sur un ton différent. Pour en terminer sur ce détail, rappelons que la balle qui a tué Robert Denoël était d'un calibre 11,8 mm et que les revolvers dont étaient dotés depuis 1941 les militaires de l'armée américaine étaient de calibre 11, 43 mm. Cela ne prouve rien mais pourquoi ajouter une touche de racisme gratuite ?
Dans son volumineux mémoire, Rozelaar demandait l'audition de plusieurs témoins oubliés, notamment deux personnes avec lesquelles Denoël avait déjeuné le jour du crime. Il demandait aussi des expertises comptables des entreprises qui avaient reçu des fonds de l'assassiné.
Car si l'on avait fait grand bruit autour du crime en 1945, pour le public il ne restait vaguement que l'image d'un cadavre allongé sous une pluie fine à proximité d'une voiture arrêtée. Mais il était intéressant d'en savoir davantage sur tout ce qui avait précédé cette image et dont on avait vraiment très peu parlé. Qu'avait donc fait Robert Denoël ce jour-là ?
*
Le matin, nous le savons, il avait passé une adorable matinée avec son fils, de la place des Vosges, la maison de Victor Hugo, au quai de la Mégisserie où il avait acheté, pour sa femme, ce symbole de fidélité : une paire de perruches.
Puis, après avoir quitté le Finet, il était allé avec Jeanne, sa maîtresse, déjeuner à « La Tour de Nézant », propriété d'Henri Jeanson à Saint-Brice-sous-Forêt, où ils avaient passé une partie de la journée en compagnie de Marion Delbo, qui recevait également monsieur Baron, administrateur de colonies, sa femme et un jeune journaliste du nom de Claude Rostand. Il semble ne s'être rien passé de bien particulier chez Marion Delbo, à part un coup de téléphone que reçut Robert d'une personne inconnue. Coup de téléphone qui fut certainement très important, assez long, et inquiéta sans doute Denoël. Toujours est-il qu'il refusa de rester à dîner comme il y était convié : il fallait qu'il rentre à Paris.
Quittant Saint-Brice vers 13 heures, Jeanne et lui rentrèrent donc dans la capitale, faisant un détour par Neuilly pour y déposer monsieur et madame Baron. On les retrouve ensuite rue de l'Assomption, chez Jeanne, où ils dînent. Robert reçoit alors un autre coup de téléphone sur lequel on n'a pas davantage de précisions que sur le premier. Par la suite, longtemps après, on tentera de dire que c'est tel ou tel ami sans importance qui avait donné chacun de ces coups de téléphone « vraiment sans importance ». Je me garderai bien de faire le moindre commentaire et comme il n'existe aucun témoignage autre que celui de ces amis sans importance, faisons comme ceux dont c'est le métier : croyons-les.
La bonne, mademoiselle Zatopek, qui cependant est très discrète, précise que monsieur Denoël dîne très rapidement au point qu'il néglige le dessert. Le dernier coup de téléphone aurait été reçu vers vingt heures. Robert et Jeanne seraient partis entre 20 h 15 e t 20 h 30. D'après la version officielle, Robert et Jeanne allaient simplement voir le spectacle du Théâtre Agnès Capri situé rue de la Gaîté.
D'après les déclarations de Jeanne, elle et Robert étaient seuls dans la voiture et il n'est pas question de rendez-vous qu'ils auraient pu avoir. C'est aussi d'après ses déclarations que l'on a su qu'un pneu aurait éclaté alors qu'ils étaient près du square des Invalides. C'est d'ailleurs bien là que fut trouvée la voiture. Aucune autre déclaration n'a confirmé ni infirmé ses dires, on doit donc croire qu'elle a dit la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Quant à moi, je n'ai pas à donner mon opinion, mais je suis toujours étonné que, pour aller de la rue de l'Assomption à la rue de la Gaîté, ils aient cru bon de passer devant les Invalides.
Une autre chose m’a étonné beaucoup plus : c'est que le pneu ayant éclaté sur un sol mouillé, puisqu'il tombait ce soir-là une petite pluie fine, la voiture ait été aussi bien rangée au bord du trottoir, sans aucune trace de dérapage. Là, les photographes de presse auraient pu faire une belle photo : une déchirure de pneu est chose photogénique mais, peut-être en raison de l'époque guerrière, je ne me souviens d'aucune photo de presse au sujet de l'assassinat.
Ajoutons que la voiture ne fut pas mise sous scellés, que le chauffeur de Jeanne vint le lendemain la rechercher et, pour ce faire, changea la roue sans la moindre difficulté. Il ne me souvient pas non plus que l'on ait jamais reparlé de cette roue. Bizarre.
Revenons au soir du 2 décembre 1945. Toujours d'après l'unique témoignage de Jeanne : le pneu droit avant de la voiture « ayant éclaté », elle quitta Robert pour aller au commissariat de Police. En passant devant le ministère du Travail, tout à côté, elle en demanda le chemin à l’agent en faction comme si elle ne savait pas où était ce commissariat.
A ce sujet, le journal La Presse du 22 janvier 1950 s'étonnait qu'elle ait eu à demander son chemin puisqu' elle avait résidé précédemment rue Casimir Perrier, une petite rue qui aboutit justement à ce commissariat.... « pour aller chercher un alibi », dira un jour maître Rozelaar. Des gens mal intentionnés pourraient dire aussi que la question posée à l'agent près du ministère était déjà un premier alibi. Jeanne arrive donc au commissariat ; elle a à peine le temps de s'ébrouer et de demander que l'on appelle un taxi qu'elle entend dire qu' un meurtre a été commis.
Ici, il me faut être particulièrement circonspect et bien faire attention à mettre mes phrases au conditionnel car j'avoue ne pas avoir encore pu mettre la main sur un journal ou une pièce quelconque qui confirmerait ce que je vais écrire ; je l'écris donc sous toutes réserves et ne puis en assurer l'authenticité : je n’étais pas là pour l’entendre. Il paraîtrait que Jeanne, n'entendant aucun autre détail, ne sachant où cela s'était passé, s'il s'agissait d'une femme, d'un homme ou d'un enfant, se serait écriée : « Mon pauvre Robert, ils l'ont assassiné ! »
Je le répète : je n'ai aucune preuve que cette phrase ait été réellement proférée, mais il y eut tant d'autres «témoignages» qui ne purent être prouvés mais furent cependant retenus officiellement, que je puis la tenir pour réelle puisque je suis certain que le bruit en a couru et que ceux qui en ont parlé ont fait un sort à ces deux conclusions de l' exclamation : 1°) Ayant laissé Robert seul, ce qui n'est peut-être pas certain, elle savait qu'il allait arriver malheur et que ce malheur était prévu. 2°) Puisqu' elle aurait dit au pluriel : « Ils l'ont assassiné », c'est en sachant qu'au moins deux personnes devaient se charger du forfait.
*
Maître Rozelaar ayant remis au juge Gollety un second mémoire complétant le premier, portant sur les circonstances du meurtre et demandant l'audition d'une vingtaine de témoins dont certains n'avaient pas été entendus, d'autres trop évasifs ou contredisant certains témoignages, les principaux journaux s'emparèrent de l'affaire et se renseignèrent de leur mieux comme le veut leur profession.
France-Soir indiquait six questions principales qu'avaient à résoudre les policiers et qui peuvent se formuler ainsi :
- Quelle était la véritable situation financière de l'éditeur. Question importante car si d'aucuns avaient dit, à juste titre, qu'il possédait une fortune considérable, Jeanne avait dit qu'il était arrivé presque sans un sou avec sa petite valise et qu'elle avait dû lui trouver l'argent indispensable, sinon l' entretenir.
- Quel avait été l'emploi du temps de Denoël à partir du moment où il quitta la propriété d'Henri Jeanson à Saint-Brice-sous-Forêt, l'après-midi du 2 décembre 1945.
- Il était nécessaire d'entendre comme témoins les personnes qu'il avait ramenées dans sa voiture, c'est-à-dire vraisemblablement monsieur et madame Baron. C'est monsieur Baron qui avait parlé du coup de téléphone reçu, à Saint-Brice, par Denoël.
- Tâcher de retrouver la personne qui donna ce coup de téléphone important au point de faire refuser l'invitation à dîner pour rentrer plus vite à Paris.
- Savoir ou tenter de comprendre pourquoi Robert Denoël et Jeanne Loviton, partis de la rue de l'Assomption vers 21 heures (ou entre 20 h 15 et 20 h 30 selon la bonne) pour se rendre à Montparnasse au Théâtre Agnès Capri, se retrouvèrent vers 21 h 20 à l'angle de l'esplanade des Invalides et de la rue de Grenelle.
- La sixième question concernait certains témoins dont des contradictions avaient été relevées au cours de la première enquête « et dont l'attitude, par la suite, a été pour le moins suspecte ».
L'Aurore posait très différemment des questions presque analogues, mais plus précises, plus incisives :
- De la rue de l'Assomption au boulevard des Invalides, une demie heure c'est beaucoup, à une époque où les rues n'étaient guère encombrées (J'ajoute personnellement que Robert n'avait pas pour habitude de conduire lentement).
- Il se peut également que les Invalides ne soient pas le plus court chemin pour se rendre de Passy à Montparnasse. Cela ne signifierait rien - les automobilistes empruntent souvent des itinéraires imprévus - si justement le boulevard des Invalides ne passait à proximité du siège des Éditions Denoël, rue Amélie, et du domicile d'un des familiers du couple Denoël-Loviton (15 rue Las Cases). Le juge devra sans doute entendre cet homme (Il s’agit du docteur Maurice P. .. [Percheron] dont j'ai déjà parlé au sujet des Editions de la Tour. C’était un auteur habituel des Editions Denoël, talentueux, spécialiste des pays orientaux où, à l’époque, la vie d’un homme comptait peu. C' est, dit-on, par son entremise que Robert et Jeanne firent connaissance au cours d’un dîner chez le professeur Delbet. Mais celui-ci n’y est pour rien.)
- Pourquoi, à une époque où voitures et taxis sont rares, un homme qui se trouve en panne seul dans une auto avec une femme, l'enverrait-il chercher un taxi ? Pour changer une roue, il faut dix minutes dans les cas les plus ordinaires. « Nous craignions, a déclaré madame Loviton, d'être en retard au théâtre ». Le fait de changer la roue n'avait a priori aucune raison de constituer une cause de retard. Et le rédacteur de cet article ajoutait un peu plus loin : « Mme Loviton avait peut-être d'autres raisons de s' éloigner de la voiture en panne. »
- D'autres passagers avaient-ils pris place dans la 202 ? N'y eut-il pas discussion entre l'un d'eux et l'éditeur connu pour sa violence et sa force redoutable ?
Pour compléter cette question, j'ajoute ici la thèse d'un membre des Renseignements Généraux dont je suis obligé de taire le nom, et qui fut reprise par maître Rozelaar : on peut supposer qu'une violente discussion se serait engagée entre l'un des passagers inconnus et que Robert aurait arrêté la voiture pour continuer la «conversation » dehors, face à face, puis, ayant voulu repartir en laissant son interlocuteur au bord du trottoir, celui-ci aurait crevé à l'aide d'un couteau le pneu avant droit de la voiture. Têtu, Robert aurait sorti le nécessaire pour changer la roue tandis que Jeanne, ne voulant pas être mêlée à une affaire qui allait tourner mal, serait partie au commissariat : soit, si elle est « hors du coup », pour éviter un massacre (dans ce cas, elle aurait pu alerter le premier agent auquel elle demanda le chemin du commissariat), soit, si elle savait ce qui risquait de se passer, pour ne pas être sur place et avoir le meilleur des alibis.
Revenons au questions de L'Aurore : - Le jour du drame, Denoël et Madame Loviton avaient déjeuné à Neuilly chez une amie. Cette personne n'avait pas été entendue. L'éditeur avait ramené de Neuilly à Paris, deux personnes qu'on n'a pas cherché à retrouver. Ne serait-ce pas, non plus, intéressant de les interroger ?
Ces deux personnes sont et resteront, je pense, une énigme de plus. Il ne peut s'agir de monsieur et madame Baron, ramenés en fin d'après-midi de Saint-Brice à Neuilly, ces deux personnes ayant déjà été interrogées.
*
Les journalistes se remuent beaucoup, il coule beaucoup d'encre et l'on se pose beaucoup de questions. Sous la signature de Paul Bodin, Carrefour publie, le 17 janvier 1950, un article susceptible de plaire aux nombreux lecteurs de ce journal. Mal et incomplètement documenté, mais il a du talent et cela peut faire illusion. Il tente de passer en revue différents mobiles possibles du meurtre de l'éditeur, dont voici les principaux ; je me permettrai d'y ajouter mon grain de sel :
- Le crime crapuleux est tout à fait plausible ; mais alors comment expliquer que l'on n'ait pas fait les poches de la victime ? Il y avait le portefeuille, les papiers personnels, l'agenda, le carnet de tickets de métro. On ne tue pas pour rien ! Le rédacteur précise que l'arme du crime était celle d'un tueur.
- Il peut s'agir d'un crime passionnel : Denoël, qui avait de très grands projets, avait dressé d'accord avec Madame Loviton un plan d'association, etc. (Je crois inutile de continuer, on connaît cette version de cette dame, mais la suite se retourne contre elle : ) En demandant la réouverture de l'enquête, Madame Denoël aurait affirmé que son mari avait renoncé à divorcer, ce qui laisserait supposer que le crime a pu avoir un mobile passionnel en même temps qu' un mobile d'intérêt.
Je me garderai bien de commenter cette version. Par contre, je commenterai longuement la version suivante car je suis mis en cause et, pour ne pas couper un bon nombre de fois le texte du journaliste, je le laisse intégral et en parlerai ensuite :
- Il pourrait s'agir d'un crime d'intérêt. Denoël avait fondé à la Libération les Éditions de la Tour (A). Il avait pour cela emprunté de l'argent, grâce à l'aide de Madame Loviton (B). Denoël avait choisi, comme gérant de ces Editions l'ami même de sa femme (C), auquel il avait fait signer, une semaine avant l'attentat, une cession de parts en blanc (D). Cette cession devait devenir effective le 4 ou le 5 décembre 1945 (E). Elle devait, en effet, être enregistrée au nom des nouveaux propriétaires (F). Le hasard voulut que Denoël fût assassiné (G). Les choses en restèrent donc là ; Madame Denoël hérita, régulièrement, les Editions de la Tour (H). Fin de citation.
Vous avez remarqué que j'ai placé des lettres-repères entre parenthèses. Cela va simplifier les choses et je vais pouvoir vous parler sans circonlocutions inutiles, comme je l'ai fait devant les policiers :
(A) Il s'agissait d'une affaire plus que modeste où j'étais seul ; j'eus, par la suite, un coursier. Mes appointements de 6 500 F par mois n'étaient vraiment pas excessifs ! Je ne m'en plaignais pas : j'avais le bonheur de travailler pour un être admirable.
(B) Emprunter de l'argent pour la Tour ? Il en possédait largement et en dépensait bien plus, rien que pour lui-même. Je ne parle pas de ses autres frais.
(C) Est-il besoin de préciser qu’il s’agissait de moi et que, par-là, on tentait d’avilir sa femme ; c’est plus que mesquin... et le rédacteur était aussi mal renseigné sur mon compte que sur la féroce jalousie de Denoël qui n'aurait pas poussé I'inconscience jusqu'à accorder son amitié et sa confiance à un possible « petit ami de sa femme » au sens où cela est sous-entendu. Bien entendu, les policiers m'ont interrogé longuement sur ce sujet et sur bien d'autres. Mon interrogatoire fut d’autant plus poussé qu’une information (anonyme sans doute) leur était parvenue : je pouvais avoir voulu me débarrasser d'un rival ; j'étais un coupable possible. J'ai répondu avec sincérité et avec une infinie tristesse mais je comprenais que, ne nous connaissant pas, on ait pu me soupçonner. Trois semaines plus tard, c'est avec un plaisir évident que l'inspecteur Casanova me rassura quant aux «inquiétudes» que la police avait dû avoir à mon égard.
(D) Non. Comme cela se fait toujours, nous avions signé, mon « associé », le Docteur Percheron et moi, ces cessions en blanc le jour même où nous avions signé l'achat fictif des parts (Je parle d’ailleurs de ces blancs-seings dans une lettre datée du 23 janvier 1946 citée page 253).
(E) Est-il besoin de dire que cela était un peu trop grossièrement cousu de fil blanc ?
(F) Au nom de qui, grands dieux ? Sans doute le même acquéreur que pour les Éditions Denoël ; il n’y a pas de petits profits.
(G) Le mot « hasard » placé ici me choque beaucoup, mais sans doute n'ai-je pas le goût de la plaisanterie morbide.
( H) Non. Madame Denoël n'hérita pas les Editions de la Tour. Ni de rien d'ailleurs. Puisque l'on voulait tout lui prendre ainsi qu'à son fils, on voulut, là encore, la déposséder : le Docteur Percheron eut une réaction digne de lui mais j'en parlerai plus tard, après en avoir fini avec les mobiles imaginés par Paul Bodin dans Carrefour.
- Il aurait pu s’agir d’un crime de concurrents. Vers le milieu du mois de décembre, Denoël devait comparaître devant le Comité d’Epuration de l’Edition.
Ici le rédacteur fait encore erreur : Robert ayant bénéficié d'un non-lieu à ce sujet en juillet, c’est la Société des Editions Denoël qui restait en cause pour trois ouvrages dont l’un, Propos sur l’Angleterre, était hors jeu puisque son auteur, Charles Albert, qui avait comparu devant la Cour de Justice à ce sujet, avait été acquitté . Revenons-en au « crime de concurrents » :
Bien qu'il ne risquât plus grand-chose, il en avait assez, disait-il, d'être le « bouc émissaire » de l’édition. Il avait constitué un dossier dont on parlait dans tout Paris et qui mettait en cause d'autres éditeurs. Il aurait été question d'une autre voiture noire qui aurait suivi la 202 de Denoël ; un éditeur aurait eu recours à une police politique renommée pour abattre un témoin gênant.
Jusqu'ici cette version n'a rien d'absurde et expliquerait les cris « Au voleur ! » si quelqu'un lui avait ravi le fameux dossier noir. Mais laissons continuer le rédacteur :
Mais nul ne pouvait prévoir que le pneu de la 202 éclaterait, et il était facile d'éxécuter l'éditeur en d'autres circonstances : Denoël, qui circulait fréquemment à motocyclette, était extrêmement vulnérable, surtout lorsqu'il rentrait au domicile de son amie, rue de l'Assomption (pourquoi ne pas citer les nombreux autres cas ?) Pourquoi aurait-on attendu qu'il tombe en panne boulevard des Invalides ? En ce qui concerne les pièces contenues dans le dossier de Denoël, on affirme aujourd'hui qu'elles ne constituaient un mystère pour personne.
Un mot rapide sur ce fameux « dossier noir » : dès qu'il sut, en 1944, qu'on pouvait lui reprocher d'avoir édité des livres collaborationnistes, sa réaction immédiate fut : « Mais les autres aussi ! » Il lui fallut deux minutes pour savoir que la preuve était à portée de la main : pratiquement tous les livres publiés en France et dans les pays francophones sont indiqués et font de la publicité dans la Bibliographie de la France. Il suffisait de découper et rassembler dans un dossier, qui devint « le dossier noir », les publicités parfois dithyrambiques des ouvrages allemands ou pro-allemands publié par TOUS les éditeurs durant l’Occupation. Ne pouvant faire rapidement ce travail lui-même, il demanda à des amis sûrs de l'y aider ; son collaborateur, auteur, et ami, René Barjavel, y prit une grande part, parmi quelques autres dont je me flatte d'avoir été pour une modeste participation.
Mais, une fois de plus, revenons-en à cet important article de Carrefour :
- Cela aurait pu être un crime politique. Toujours d'après le même rédacteur, au moment de la Libération, des hommes d'une police politique se seraient présentés chez Denoël qui n'aurait obtenu son salut qu'en dénoncant un repaire de miliciens. Lorsque les hommes de la police politique se seraient présentés chez les miliciens, ils auraient été accueillis par des mitraillettes, laissant de nombreux morts sur le carreau. D'où la vengeance contre l'éditeur.
Alors là, je crains que le narrateur ait lu trop de romans d'espionnage ! Si je comprends bien, cette « police politique » ne savait pas qu'Aragon, Elsa, Thorez et compagnie étaient des amis. Il aurait fallu aussi que Robent soit de mêche avec des miliciens, qu’il les dénonce et puis qu’il les prévienne. Cela se serait passé à la Libération, en août 1944, et les méchants policiers politiques auraient attendu seize mois pour l’abattre d’une balle dans le dos par une nuit pluvieuse de décembre 1945 ? Un peu tiré par les cheveux !
Je vais peut-être vous faire sursauter, mais Robert Denoël avait horreur de la politique ; il n’y connaissait rien. Lorsqu’il éditait un auteur, ce n’était pas pour les idées qu’il pouvait défendre, c’était parce qu’il lui avait trouvé du talent. C’est tout. C’est tout, mais c’est énorme et merveilleux. « Une maison d’édition doit être le miroir de son époque (écrivait-il déjà en janvier 1939), non pas un miroir abandonné au bord d’une route, mais un miroir orienté vers le talent quelle qu’en soit l’origine ou la direction. »
Hormis les thèses relevées dans Carrefour, il y en eut quantité d’autres dans tous les journaux. Je vous en fais grâce. Il y en a une cependant qui vaut d’être citée : c’est le crime de jalousie. Le journaliste qui développait cette version apprenait à ses lecteurs que Denoël avait plusieurs maîtresses dont une femme mariée. Or l'époux bafoué était justement à Paris cette nuit-là ; il aurait fomenté une machination pour abattre un rival. Pourquoi pas ?
Il y en aurait des mobiles pour cet assassinat ! Peut-être un jour un Alain Decaux arrivera-t-il à en démêler l'écheveau ? Sans doute l'énigme restera-telle jusqu'à la fin des temps et, comme il ne s'agit ni de Louis XVII ni du Masque de Fer, cela sera très vite oublié. Je ne vous donnerai pas ma solution de l'énigme, je ne la connais pas. Mais on peut rêver, imaginer un conte qui commencerait comme tous les contes :
Il était une fois un homme, intelligent mais puérilement naïf lorsqu’on savait l' enjôler, qui s'était laissé embringuer dans une aventure qui peut sembler invraisemblable.
Les truands honorablemment connus, les politiciens louches, les malandrins qui jouent sur tous les tableaux à la fois, ceux qui, au vu et au su de tout le monde, se servent de dés pipés et s'en sortent toujours la tête haute et le sourire aux lèvres, chacun sait que cela n’existe que dans les romans. Mais justement cet homme-là ne vivait que pour la littérature et, comme il était parfois rêveur, il se laissa porter par un petit nuage qu’il voyait rose mais qui était d’un gris boueux.
Les rêves, cela dure un temps plus ou moins long mais, à moins de les continuer jusque dans la mort, on s'en réveille forcement un jour. Or justement un matin, en s'éveillant, il s'aperçut que l'on s'était servi de lui et que, peu à peu, il s’était laissé entraîner sur une pente dangereuse et qu'il commençait à s'enliser dans la fange de ce que l'on ne peut appeler ni politique (ceux qui l'entouraient étaient de tous les bords à la fois), ni mafia (car les mafiosi ont un sens, particulier sans doute mais réel, de la parole donnée).
Par son flair et son talent qui faisaient de lui un éditeur-né auquel ne manquait parfois que le sens des réalités, il représentait une puissance et une valeur marchande qu'il ne soupçonnait pas. Par sa prestance on pouvait le mettre en avant en tirant discrètement les ficelles. On l'avait attiré par son point faible dont il avait réussi à s'évader si souvent ; mais cette fois il était tombé sur une véritable organisation qui avait fait ses preuves, principalement dans l'art de ferrer le poisson.
Sur le plan professionnel, on avait ajouté un appât qui lui laissait entrevoir, grâce à quelques compromissions auxquelles il n'avait pas pris garde, tout ce qui pouvait lui manquer pour faire de lui le maître d'un monde, celui de sa spécialité. On lui assurait même qu'il pourrait réaliser un rêve qu'il avait, au cours des années, préparé dans la solitude de son cabinet directorial, avec quelques amis, avec sa femme : celui de créer, en plein cœur de la capitale, une maison où pourraient se rencontrer, se réunir, se connaître les gens de Lettres du monde entier. On avait entretenu ses rêves, on les avait même magnifiés. Il pouvait être le maître de ce qui était sa vie : le Livre, à la condition inavouée que d'autres mangent la plus grosse part du gâteau.
Pour y parvenir, il avait écouté ceux qu'on lui présentait comme les plus puissants de demain. Déjà, grâce à des amis, et aux amis de ses amies, il avait pu avoir tout le papier, le fil, l'encre, le plomb, la main-d'œuvre qui lui avaient permis de ne plus avoir de vrais soucis d'approvisionnement en un temps où tout était plus que rare. Oh ! il n'était pas le seul à en profiter mais on lui laissait croire qu'il était, de loin, le plus favorisé. Les capitaux circulaient dont certains lui passaient entre les mains pour aller emplir d'autres poches ou des comptes en banque numérotés.
Des amis, souvent, faisaient le travail pour lui : il n'avait qu'à signer ; mais, plusieurs fois, il était allé lui-même en Suisse accompagné d'une dame qui, si l'on en croit les papiers qu'il présentait à la frontière, était son épouse légitime. Mais celle-ci, de son côté, vivait au grand jour et l'on aurait pu, presque heure par heure, démontrer qu'elle n'avait pas quitté la France. Mais qui s'en serait soucié ? On avait réussi à la mettre hors du coup.
Lorsqu'il se réveilla réellement, l'homme sentit l'étau se resserrer autour de sa personne. Lorsqu'il redescendit de son septième ciel, qui était en réalité un enfer, il tenta de se dégager mais il était trop tard. Le filet qui l'enserrait était trop solide. Ses gardiens trop politiquement et judiciairement puissants. Lorsqu'il osa parler, les menaces se firent plus directes.
Il s'était toujours sorti de tous les guêpiers - et Dieu sait si ses aventures amoureuses l'avaient parfois mené loin ! - pourquoi ne se sortirait-il pas de celui-là ? Parce qu'il avait dépassé les limites, parce qu’il savait trop de choses sur trop de gens, on ne pouvait pas le laisser vivre. S'il n'acceptait plus d'être celui que tant de gens trop connus manipulaient, il devait disparaître.
Il avait beau se jouer la comédie : « Le cauchemar va s'évanouir comme un mauvais rêve qu'il est ; à Noël je serai de nouveau chez moi, heureux entre ma femme et mon fils. Noël, c'est la fête de la Lumière qui chasse les ombres malfaisantes. Le Sauveur reviendra pour absoudre quelques petites erreurs. »
Mais il était déjà trop tard. Et cependant trop tôt : l'Enfant-Dieu n'était pas encore né et n'allait pas accomplir ces miracles, surtout pour celui qui, bien qu'élevé chez les Jésuites, l'avait trop renié. Belzébuth ne voulait pas prendre le risque d'attendre et de se faire posséder, comme cela avait été le cas avec les rois mages et Hérode.
L'homme le sent alors : pour lui plus de grâce possible, plus d'espoir. Oh ! Combien il regrette de n'avoir pas pensé plus tôt aux conséquences de ses folies. Oh ! comme il regrette d'avoir, pour la gloriole, délaissé sa femme et son fils bien-aimés. Déjà, dès qu'il a compris que le Destin sera inexorable, il a confié l'un et l'autre à un ami fidèle : « Si un jour il m'arrive quelque chose.. faites-le pour elle, pour moi et pour mon fils. » Sur quelles frêles épaules il a déposé son Amour !
Et le matin du jour fatal, sentant l'Heure arriver, il envoie un dernier message sous la forme de deux perruches, risible symbole d'une fidélité trop élastique. Et qui portera ce message ? Celui qui aurait dû être la continuité de son œuvre, de sa vie : son fils. Non. Je l'ai dit tout à l'heure : tout cela n'est qu'un conte, un rêve ; un cauchemar, sans doute. Les contes de fées ne finissent pas toujours bien. Il arrive parfois que le loup mange la mère-grand et le Petit Chaperon Rouge.
*
Revenons sur terre et continuons la lecture des journaux. Le 3 avril 1950 on apprenait, grâce à un important article de Georges Gherra dans France-Soir qu'un document, inconnu jusque-là, avait été placé sous scellés. Cela n'avait peut-être l'air de rien, mais c'était d'une importance capitale et l'on pouvait se demander pourquoi ce document n'avait pu être connu plus tôt, comme on pourra se demander ensuite pourquoi il allait disparaître à tout jamais. Voici ce dont il s'agit :
Le 2 Décembre 1945 au soir, peu après 21 h, le gardien de nuit du Ministère du Travail avait consigné dans son « Livre de nuit » les allées et venues et les paroles échangées entre lui-même et deux personnes dont la présence au ministère, un dimanche soir, lui avait parue insolite.
Remarquez au passage que l'on ne saura jamais les noms de ces personnages mystérieux, ni sur les paroles échangées et que nul n'aura plus jamais aucun renseignement sur les intrus en question. Ce n'est qu'un détail mais la suite est pour le moins curieuse :
« Ce fait banal en apparence lui était apparu si important le lendemain qu'il avait arraché la feuille du livre de nuit. Il en rendit compte à son chef qui lui conseilla de la garder. Il suivit ce conseil et, il y a quelques jours, il remettait la feuille à l'inspecteur Vauge. Le contenu de celle-ci est tenu secret. » Vous ne trouvez pas cela bizarre, vous ? Moi, si.
Des gens qui se promènent à la nuit tombée, un dimanche, dans un ministère où ils n'ont rien à faire puisque cela a étonné le gardien de nuit, qui doit être sourd puisqu'il n'a pas entendu les coups de feu tirés sous les fenêtres de ce même ministère. Au lien d'en parler à la police, il en parle à son chef. Celui-ci lui conseille de n'en souffler mot à personne. Obéissant, il garde soigneusement ce papier pendant plus de quatre ans alors que le monde entier sait que ce soir-là, vers la même heure, un crime a été commis à quelques mètres. Le ministère en question est un bâtiment allongé côté boulevard des Invalides et, si l'entrée principale se trouve rue de Grenelle, il y a une porte dérobée sur le boulevard, non loin de l'endroit où fut trouvé le corps de Robert Denoël agonisant. Faut-il vous faire un dessin ?
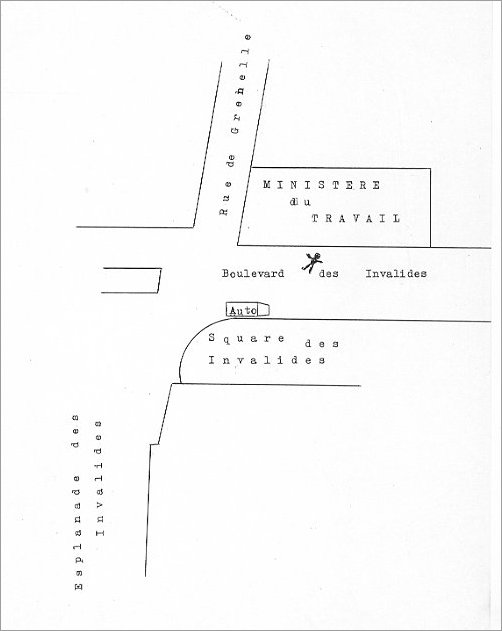
Si l'on ajoute que la voiture se trouvait près du trottoir en face, devant le petit square des Invalides, que la douille de la balle qui tua Denoël fut retrouvée dans le gravier, une dizaine de mètres à l'avant de l'automobile immobilisée, et qu'enfin le coup de feu a été tiré à moins d'un mètre cinquante (on a retrouvé des traces de poudre sur le vêtement) ; si on se souvient que Robert tenait encore fermement le cric dans une main et la manivelle dans l'autre ; il semble facile de reconstituer l'assassinat :
On a volé, fait, ou dit à Robert Denoël quelque chose d'assez grave pour qu'il en menace l'auteur et commence à le poursuivre en direction du ministère vers lequel il se dirige. Immédiatement, puisque Denoël est encore à moins d'un mètre cinquante du trottoir, dix mètres devant la voiture, un autre interlocuteur tire dans le dos de Denoël pour protéger la fuite de son complice, qu'il va rejoindre, tandis que, mortellement blessé, l'éditeur poursuit son premier agresseur avant de s'abattre vingt mètres plus loin, de l'autre côté du boulevard devant le ministère. Dès que les coups de feu ont été entendus (bien que l’on n’ait retrouvé qu’une douille, il semble qu’il y ait eu deux coups de feu), on accourt : les assassins ont disparu. Le boulevard est désert et pourtant bien éclairé (les mots « désert » et « bien éclairé » sont dans les documents).
Officiellement on n'en saura jamais davantage sur ce meurtre. Certains pourront penser que les personnes rencontrées par hasard dans le ministère avaient des amis puissants... Mais à quoi sert de se poser des questions ?
*
Le 6 juillet 1950 on annonçait que le juge Goletty venait de rendre une nouvelle ordonnance de non-lieu au sujet du crime. Ordonnance confirmée le 28 juillet par la Chambre des mises en Accusation de la Cour d'Appel de Paris. Toute cette partie est donc officiellement et définitivement terminée ; nous ne reparlerons donc plus de cet assassinat. Un parmi tant d'autres. Les intouchables s'en sortent toujours, quels que soient l'époque et le régime.
*
Alors que les procès avaient tellement duré pour enfin rendre à Cécile et à son fils la légitime propriété des Éditions Denoël, les choses se passèrent très vite, tout à coup, et, en dernier lieu, le 13 décembre 1950, la 3e Chambre de la Cour d'Appel rejetait définitivement la demande de Madame Denoël. Jeanne Loviton en devenait propriétaire et, pour bien prouver que c'était par amour pour Robert qu'elle avait machiné tout cela, elle s'empressa, dès qu'elle en eut légalement la possibilité, de monnayer les Éditions Denoël en les vendant à une autre maison d'édition. Le Veau d'Or est toujours debout.
*
Je pourrais tourner la page après cette transaction mais ce n’est pas encore tout à fait terminé au sujet des à-côtés de « l'affaire Denoël ». Si j’ai fini de parler du point de vue « technique », il reste encore quelques anecdotes qui valent leur pesant de détritus.
On sait qu'à la mort de Robert, Cécile s'était trouvée complètement démunie. Les douze mille francs trouvés sur le corps étaient passés dans le tiroir-caisse de Lanvin-Tailleur. Il restait les meubles, patrimoine accumulé au cours des ans et auquel Cécile espérait bien ne jamais toucher... lorsqu'un jour se joua une pièce digne de Plaute. De « bons amis » dont j'ai eu l'occasion de parler à plusieurs reprises, le Docteur Maurice P... [Percheron] et sa femme Suzanne vinrent trouver Cécile au début de l'année 1946 :
- Ma pauvre chère amie, qu'allez-vous devenir ? Tout ce qui est dans cet appartement devra être vendu. Tout ce qui était à Robert ...
- Ce qui restera est le patrimoine de notre fils, avait coupé Cécile.
- Mais, ma bonne amie, il a tout cédé à Jeanne.
C'est à ce moment-là que je me permis d'entrer dans la conversation :
- Cela m'étonnerait !
- Mon petit ami, me dit alors dédaigneusement cet « ami », ne vous mêlez pas de ce qui ne vous regarde pas !
- Oh ! mais cela me regarde au contraire, répliquai-je, vous ne pourrez pas tenter de refaire ce que vous vouliez faire aux Editions de la Tour : Robert et Cécile m'ont vendu tout ce qui est ici ; même le bail est à mon nom et je puis en donner la preuve. Je crois que vous pouvez sortir : je n'ai pas l'impression que Cécile ait envie de continuer cette inutile conversation.
- Viens, Suzanne, je crois que nous n'avons plus rien à faire ici.
- En effet, dis-je en me levant.
Effectivement, le 30 septembre 1944, par acte enregistré, j'avais acheté - en payant par chèque, bien que la somme fût beaucoup moins importante que 1 515 parts des Éditions Denoël - la totalité des meubles et objets appartenant à Cécile et à Robert, bien résolu à leur restituer le tout lorsque la flambée de violence qui accompagnait la Libération, puis la fin de la guerre, se serait calmée, de même que le « droit au bail » de cet appartement qui m'avait été cédé le 7 octobre 1944.
Ce qui s'était passé aux Editions de la Tour ? Il me semble plus simple, malgré le style hâtif et un peu décousu, de recopier ici la majeure partie d'une longue lettre que j'écrivais le mercredi 23 janvier 1946 à Cécile sur papier à en-tête des Editions de la Tour :
« Ma chère Cécile,
Je tiens à t'écrire pour te confirmer certaines choses que je t'ai déjà dites. A l'heure actuelle où chacun peut être à la merci d'un mauvais coup (on verra plus loin les « accidents » dont Cécile et le Finet ont failli être les victimes), un excès de prudence ne nuit pas. Voici le fait dont je veux te parler :
1°) Les parts des Editions de la Tour qui sont officiellement à mon nom, ainsi que celles qui sont officiellement au nom de Maurice Percheron, c'est-à-dire la totalité des parts, appartiennent en réalité à Robert. Tu sais que Percheron et moi avons repris fictivement ces parts dans cette affaire. [...]
D’ailleurs, tu le sais, nous avons, Percheron et moi, signé en même temps que l’achat officiel des parts des cessions où le nom de l’acquéreur et la date sont en blanc afin que Robert puisse à tout moment par lui choisi de reprendre possession intégrale de cette maison. Ces papiers en blanc sont actuellement entre les mains d’Hagopian (un homme d’affaires qui travaillait, avec beaucoup de discrétion, pour Robert, Jeanne et compagnie).
2°) Un jour, après la mort de Robert, Percheron est venu me voir au bureau « pour mettre quelques petites choses au point ». Il a d’abord tâté le terrain, m’a assuré que j’aurais une très belle situation par la suite, en quelque sorte a essayé de m’acheter avec des promesses. Puis il a essayé de me faire croire que si, moi, j’étais fictivement porteur de parts, lui l’était réellement ! Comme je lui affirmais que je savais pertinemment qu’il était aussi fictif que moi, il prit par la bande en déclarant qu’il avait prêté 200 000 F à Robert, et qu’en contrepartie, Robert lui avait dit : « Eh bien ! vous serez désormais véritable propriétaire des parts dont vous êtes porteur, cela vous rapportera dans les 250 000 F par an au moins (!) et ainsi nous serons quittes ». Cette même version a été reprise par sa femme Suzanne lorsqu’elle t’a vue ici en ma présence, le 26 décembre 1945.
Robert n’empruntait pas et ne prêtait pas d’argent sans reçu et Percheron savait aussi bien que Robert et que moi qu’il avait fait un blanc-seing. Si ce qu’il dit était vrai (supposition invraisemblable) il aurait réclamé la destruction de ce blanc-seing. Je témoignerai s’il le faut, je m’y engage, que Percheron a voulu t’escroquer ainsi que ton fils. Je prends l’entière responsabilité de ce que j’avance.
3°) Robert avait des intérêts très importants dans les Editions Domat-Montchrestien ; plus d’une fois il m’a dit : « Il me faut de l’argent pour l’échéance chez Domat-Montchrestien » - Il avait l’habitude de dire « mes trois maisons d’édition » en parlant des Editions Denoël, de Domat-Montchrestien et de la Tour.
4°) Je me souviens aussi, et tu dois te le rappeler, que Robert cherchait (fin 1944 ou début 1945) un prête-nom pour camoufler un million ; il me l’aurait proposé si je n’avais pas été chargé des Editions de la Tour.
J’avoue que cela peut ne pas paraître honnête de ma part d’avoir aidé Robert à « camoufler » des biens (je parle de la Tour) mais tu sais quelle influence il avait sur moi et tu sais que je l’ai fait pour sauvegarder quelque chose pour le Finet et pour toi. Je tiens plus que jamais après sa mort à faire tout mon possible pour que rien ne tombe entre les mains des rapaces qui se sont rués sur ses avoirs, à tel point que l’on pourrait se demander si l’intérêt ne les aurait pas poussés à se débarrasser de sa personne.
Mais ceci n’est pas mon affaire, c’est celle de la police, de la justice ; je pense qu’elle existe et que le meurtrier et ses complices, s’il y en a, seront punis. Je reste plus que jamais, ton ami, A. Morys ».
Près de quarante ans plus tard, cette lettre me bouleverse autant que lorsque je l’ai écrite. Cependant il ne s’agissait que d’une lettre et, légalement, elle n’avait pas « date précise ». Plus tard, le 10 novembre 1946, j’ai écrit une autre lettre rappelant les mêmes faits, avec cette différence que les blancs-seings, celui du docteur Maurice Percheron et le mien, étaient alors entre les mains de Maître Brunel, notaire de la succession Denoël. Cette lettre-là est écrite sur papier timbré et, comme je n'avais ni le temps ni la possibilité de la faire enregistrer, en raison des « incidents » dont nous ne cessions, Cécile, le Finet et moi, d’être les cibles, je l’ai envoyée en pneumatique en demandant (par téléphone) que l'enveloppe n'en soit ouverte, si besoin était, qu'en présence d'un huissier de justice qui pourrait en constater le contenu et la date de timbrage.
Ce que je n'ai pas écrit dans ces lettres, c'est que le docteur Percheron dut ressentir de violentes douleurs au coccyx après notre entrevue. J'ai toujours eu l'audace des timides.
*
Au cours des cinq années que durèrent les « procès Denoël », les moyens les plus divers furent mis en œuvre pour faire pression sur « la veuve Denoël » qui ne voulait pas démordre de ses droits et de ceux de son fils, en dépit de toutes les manœuvres de la partie adverse, qui ne parvenait pas à trouver un moyen de chantage malgré toutes les inventions lancées par les avocats et complaisamment reprises par une certaine presse.
Il faut penser que c'est par erreur ou par coïncidence qu'une automobile monta un soir sur le trottoir jusqu’au mur alors que Cécile y marchait ; celle-ci ne dut qu’à sa sveltesse et à sa rapidité d’échapper à un grave accident.
C'est aussi par erreur ou coïncidence qu'alors qu’elle écrivait, fenêtre ouverte, dans sa bibliothèque, deux balles tirées du Champ de Mars, sur lequel donnait cette pièce, n’atteignirent heureusement que des livres placés dans l’axe de sa tête. Dès le lendemain un agent des Renseignements Généraux, Richard de G..., ayant récupéré les balles, confia à Cécile un revolver pour qu'elle puisse se défendre au cas où des inconnus viendraient l'attaquer à domicile.
Pour les mêmes raisons, sans doute, alors qu’il jouait avec quelques camarades dans un terrain vague - où se dresse maintenant l'hôtel Hilton - le Finet faillit être enlevé par d'autres inconnus. Sans sa présence d'esprit et celle de ses camarades, ces inconnus auraient eu le meilleur des otages. Prévenue aussitôt aux Editions de la Tour où nous étions en train de travailler, Cécile alerta immédiatement son avocat Armand Rozelaar qui, à son tour, se mit en rapport avec l'agent des Renseignements Généraux que nous connaissions et, puisqu'il y a largement prescription, je peux dévoiler ce qui se passa alors. Il fut décidé que, dès le lendemain matin, j'emmènerais le Finet en Belgique. Dès lors, ce fut une course folle car d'abord il fallait que le jeune Denoël soit inscrit sur mon passeport... et je n'en avais pas !
Avec Richard, nous allâmes à la Préfecture de Police pour obtenir, dans la nuit même, l'indispensable passeport légèrement antidaté ; j'avais une photographie, cheveux au vent, prise un jour où je campais, elle servit de photo d'identité. Bien entendu, il était indiqué que j'étais accompagné d'un enfant : Denoël, Robert, Lucien, Guillaume, né le 14 mars 1933 à Boulogne-Billancourt. Pendant ce temps, un ami médecin préparait, pour le Finet et pour moi, les indispensables certificats de vaccinations qui, avouons-le, n'eurent pas le temps d'être pratiquées.
Toujours dans le même temps, le Finet avait été confié à notre ami Robert Holer chez lequel il allait passer la nuit, après avoir dîné une dernière fois avant ce départ plus que romanesque avec sa maman, qui avait pris deux taxis et le métro pour être certaine de n' être pas suivie.
Tout cela ne semble pouvoir se passer que dans les romans ou les films d' espionnage.Pour un roman, c'en était un ! et cette course effrénée valait la peine d'être vécue : elle surpasse tous les « jeux scouts » du monde. Dans le train que nous prîmes le lendemain matin, quatre places étaient réservées : pour le Finet, pour moi, et pour deux messieurs très discrets et fortement musclés que nous ne connaissions pas et qui ne semblaient pas nous connaître mais dont l'œil inquisiteur jaugeait toutes les personnes qui auraient pu nous approcher. J'ai l'impression que si le Finet avait eu besoin d'aller au petit coin, il n'y serait pas allé seul.
A Erquelines, gare-frontière, ils descendirent pour être immédiatement remplacés par deux autres messieurs, belges ceux-là, mais tout aussi discrets et musclés. Arrivés à Liège, après avoir embrassé la grand-mère du Finet et déposé nos bagages, nous partîmes nous dégourdir un peu les jambes, manger quelques glaces, puis allâmes jusqu'à un petit patelin adorable dont j'ai oublié le nom mais où l'on pouvait louer des barques et faire un peu de canotage. Nous avions totalement oublié nos « anges gardiens » tant ceux-ci étaient discrets mais, alors que nous ramions, je vis l'un d'eux demander au loueur de lui montrer le passeport que j'avais laissé en garantie. Il s'éloigna satisfait mais je remarquai qu'il restait tout à proximité. Durant tout le temps que le Finet passa en Belgique, deux « gorilles » le protégèrent avec une infinie discrétion.
*
Après la mort de Robert, Cécile n'avait d'autre source de revenus que les petites Editions de la Tour. Malgré tous nos efforts, malgré l'ardeur que nous y mettions et le travail que cela représentait pour Cécile et pour moi, la Tour nous aurait peut-être permis de survivre, mais ne permettrait jamais de faire face aux procès Denoël. Nous n’avions pas le moindre capital pour imprimer et lancer les ouvrages qui nous auraient permis d’assurer le roulement nécessaire à la marche normale d'une affaire, si modeste soit-elle.
Nous avions édité un livre de Blaise Cendrars composé de deux ouvrages anciens, introuvables depuis longtemps : Le Plan de l’Aiguille et Les Confessions de Dan Yack ; mais cela, en plus de quatre livres de demi-luxe et trois ouvrages pour enfants qui constituaient notre minuscule fonds, était loin de suffire. Nous aurions dû sortir aussi un livre nouveau de Paul Vialar dont Robert m'avait apporté le manuscrit quelques jours avant le drame, mais un jour, peu avant la fin de l'année 1945, Vialar m'avait téléphoné :
- Mon Petit Morys, j'ai deux ou trois petites choses à revoir dans mon roman, cela vous ennuierait-il que je le fasse reprendre ?
- Non, bien sûr, Paul ; même si vous le voulez, je peux vous le porter.
- Ne vous dérangez pas : un ami doit justement passer demain après-midi du côté de votre bureau...
Je ne revis jamais Vialar. Nous ne revîmes jamais le manuscrit. Le livre [La Mort est un commencement] parut quelque temps plus tard aux Editions Domat-Monchrestien. Chez Jeanne. Comme par hasard.
La Tour n’avait vraiment pas eu le temps de prendre son essor, nous n'avions que trop peu d'ouvrages, même après en avoir ajouté de nouveaux d’Urbain Brousté et d’Henri Clérisse. Nous n'avions aucun moyen de faire la publicité indispensable. En outre, notre plus gros client, grossiste-distributeur très connu [Hachette] se faisait tirer l'oreille pour régler ses factures ; nous étions vraiment sur la corde raide.
*
Vers la même époque, je connus une expérience assez curieuse. Non que l'Occupation ait contraint les Français à être sages et pudiques, mais la Libération fit fleurir une grande liberté de mœurs : l'excitation qui suit toutes les grandes tensions de l’histoire, qu'il s'agisse de révolutions ou de guerres. Lorsque l'on a senti que la vie semble avoir peu de prix, le peuple tâche d'en profiter au maximum et c'est assez compréhensible.
Ce n'était pas nouveau : les livres licencieux ont toujours eu cours sous le manteau. Je me souviendrai longtemps du premier roman de Jean Genet : Notre-Dame des Fleurs dont Jean Cocteau avait apporté le manuscrit à Robert, qui le publia sans autre nom d’éditeur que « Aux dépens d’un amateur, Monte-Carlo » et dont j’ai aidé, en rougissant, à corriger les épreuves.
Si les livres du « second rayon » existaient depuis toujours, dans les années qui suivirent 1944, ils fourmillèrent. Une loi empêchait les libraires de les exposer à la vue du public, mais il suffisait bien souvent de déplacer un ouvrage plus sérieux pour trouver au-dessous l'un des fruits de ce libertinage inprimé dont je parle. Les plus timides des libraires plaçaient ces ouvrages sous le comptoir ou dans l'arrière-boutique, mais toujours à portée de la main. Il y avait, bien sûr, quelques irréductibles, mais ils ne représentaient pas cinq pour cent de la profession.
C’était la grande époque de Saint-Germain-des-Prés, du «Tabou » et de « La Rose Rouge ». La vitalité battait son plein malgré la morbidité de l’existentialisme. Un trompettiste de talent qui faisait accourir les foules dans les caves enfumées, écrivit, sous le pseudonyme de Vernon Sullivan, un livre que notre confrère Jean D’Halluin publia, aux Editions du Scorpion, sous le titre : J’irai cracher sur vos tombes. L' auteur, qui s' en disait le traducteur, le trompettiste du «Tabou », était Boris Vian dont les textes se trouvent aujourd' hui dans les livres de classe des écoles primaires. Les mœurs ont bien changé en trois ou quatre décennies.
Ce fut un succès, et lequel ! les lecteurs y trouvaient à la fois l'érotisme qu’ils espéraient et un anti-racisme qui plaisait d'autant plus, après les contraintes hitlériennes. La formule était bonne, beaucoup d'éditeurs l'exploitèrent, les clients en redemandaient.
Quant à nous, nous étions une fois de plus au creux de la vague. Nous avions sabordé les Editions de la Tour qui n’étaient plus viables, j’étais donc libre. Une personne qui me touchait de près [Gustave Bruyneel] mais que ne nommerai que par son initiale G... se proposa pour commanditer une autre maison dont je serais le gérant et que je dirigerais à ma guise à la condition que je sorte un livre dans le genre de ceux dont le public raffolait.
Accessoirement, sous le couvert de cette petite maison, G... vendrait quelques livres pour son compte par correspondance ; il ne se mêlerait en aucune façon de « ma » petite maison d’édition ; je n’aurais pas à m’occuper de « sa » librairie. Pourquoi pas ? C'était pour moi une façon de me renflouer rapidement, peut-être, et d'aider Cécile et le Finet qui étaient totalement hors du coup.
Sur commande, un ami nous écrivit en un temps record un roman qui, s'il ne brillait pas toujours par le bon goût, était d'une bonne écriture, suivait d'assez près des faits divers collectés dans des ouvrages que j' avais trouvés à la Bibliothèque Nationale, qui m'en avait fourni un micro-film, et donnerait exactement au lecteur ce qu'il recherchait. Un seul défaut : le titre était trop long et ne me semblait pas assez frappant. N’ayant aucun budget pour ce livre, hormis les frais de fabrication., je pensais qu’il fallait que, du premier coup d'œil, le public sache de quoi il s'agissait. Le titre choisi par l’auteur était : « Les Sultans sont en Amérique » ; cela correspondait bien au thème de l'ouvrage, mais n’aurait attiré personne. Je proposai : «Salauds ! » Est-ce que ce ne serait pas un bon titre pour le bouquin d’Anta Grey ? »
Anta Grey était le nom présumé de l'auteur soi-disant américaine, une femme ; le nom du traducteur n’ayant jamais été précisé, ce qui, par la suite, me valut quelques complications avec un juge d'instruction qui me fit l'honneur de m’en croire l'auteur, ce dont j'aurais été bien incapable ; mais nous n'en sommes pas encore là.
Le titre de « Salauds ! » fut donc adopté avec cette indication fallacieuse : « Le titre américain de cet ouvrage est Hounds ». Le manuscrit partit d'urgence chez l'imprimeur ; en décembre 1947 les premiers exemplaires étaient imprimés. L'aube de 1948 le vit chez la majorité des libraires de Paris, puis de province... et à la Bibliothèque Nationale où tout un chacun peut encore le consulter. Je ne puis me souvenir si la Bibliographie de la France en a accepté la modeste publicité ; qu'importe, elle avait, bien des années plus tôt, refusé celle de Prélude charnel [par Robert Sermaise].
*
La profusion de livres plus ou moins érotiques réveilla les ligues puritaines qui alertèrent la justice afin que celle-ci extermine de son glaive ces impudicités. La brigade des mœurs fit des perquisitions chez les libraires, les éditeurs, les imprimeurs...
Il y avait trois ans que Salauds ! avait paru lorsque deux inspecteurs (très sympathiques, je dois le dire) se présentèrent à mon bureau avec un mandat de perquisition. Je n'avais rien d'autre que ce livre qui pût les intéresser, sinon la réserve de livres de G... à laquelle je ne pensais pas et une enveloppe que ce même G... m'avait remise pour un de ses clients étrangers qui devait passer la prendre. C'est cette enveloppe qui intéressa le plus mes visiteurs : deux collections de photos que vous pourriez voir aujourd'hui dans n'importe quel magazine ou à la télévision, qui étaient alors condamnables si l'on pouvait entrevoir un sexe masculin ou si le sexe féminin laissait apparaître des poils, le même retouché par un habile photographe étant autorisé.
J'appris aussi que les livres érotiques étaient autorisés s'ils étaient d'un prix élevé, alors qu'à un prix commercial courant ils étaient repréhensibles. C'était le cas de Salauds ! Vous dirais-je la suite de cette aventure? Elle est peu glorieuse. Il y avait tant d'inculpés tous jugés ensemble qu'auprès des autres je n'étais que menu fretin dans un panier de crabes et, n'ayant jamais été condamné, je m'en tirai avec une amende. De nombreuses amnisties ordonnées par la suite jetèrent un voile pudique et définitif sur tout cela.
*
Cécile n'était pour rien dans cette affaire. Si j’en parle dans ce livre qui la concerne au premier chef c'est parce que l'on a tenté de la mêler au scandale et au procès où j’étais seul en cause. C’est aussi à cette époque qu’elle adapta La Victoire de Judas Iscariote qu’il était normal que j'édite ; cet ouvrage parut donc aux Editions du Feu Follet puisque telle était la marque sous laquelle je publiais aussi d'autres ouvrages plus courants. Oh ! je ne suis pas un ange : il m'est arrivé une autre fois encore (pour des raisons bien différentes) d'avoir à payer une amende puis de bénéficier ensuite d'une amnistie ; nul n'en parlera donc plus jamais : la Loi l'interdit ! Mea culpa.
*
Durant plus de cinq ans, les procès étaient là qui accaparaient une grande partie de notre temps, de notre esprit. Mais que l'on n'aille pas croire que nous ne pensions qu'à cela et que notre vie était morose, ressassant une vengeance au coin d'un âtre moribond.
La vie était là et nous la vivions de notre mieux. Nous avions à travailler beaucoup pour faire face aux besoins des procès outrageusement coûteux, aux études du Finet, de sa vie, de la nôtre et souvent de ceux que nous faisions vivre. Mais cela c'est parce que nous le voulions bien ou que nous étions trop faibles pour refuser une aide qui nous a toujours semblé normale.
Cécile a toujours été au courant de ma vie privée ; je n'ai jamais eu de liaison durable puisque je n'avais qu'un amour qui me semblait toujours inaccessible ; ce qui me conservait disponible pour être sans cesse présent lorsqu’elle - ou Robert lorsqu'il vivait encore - avait besoin de moi.
*
Sur les instances d’Henri Poulaille, Cécile, ayant rompu avec le cinéma, consentit à bâtir une nouvelle maison d'édition. Elle choisit pour nom de firme : « La Plaque Tournante » et, sur le conseil de quelques amis, accepta d’y adjoindre la mention : « Direction : Cécile Robert Denoël ».
La Plaque Tournante devait être un tremplin pour l’échange des idées entre les pays dont Cécile pressentait que le rapprochement serait de plus en plus indispensable. Cécile avait beaucoup hésité : n'ayant toujours que très peu de capitaux, elle savait que l'aventure serait, une fois de plus, très risquée. Epuisée par tant d'années de luttes, sa santé déjà chancelante s'étiolait de plus en plus et ne tenait qu’à force de volonté ; elle savait qu’il lui serait difficile de tenir longtemps. Poulaille la pressait ; quelques autres aussi. Un appui qui, hélas ! n'était que moral. Cependant quelque chose lui disait que, quoiqu’il pût arriver, cela ne serait pas inutile.
Les Editions La Plaque Tournante naquirent donc très modestement en éditant, en février 1950, un livre étonnant de Raymond Asso, plus connu à l'époque comme parolier des chansons d'Edith Piaf que comme écrivain : Le Sixième Evangile. Suivirent d'autres ouvrages dont L’Egypte au cœur du monde de Marcelle Capy, puis Notre bagne qui retracait la navrante histoire de Guillaume Seznec, forçat innocent et de sa fille Jane dont j'ai déjà parlé, et Les Brebis du Seigneur de Ferreira de Castro, dont Henri Poulaille avait écrit la préface.
Puis vint le temps où, la santé de Cécile s'amenuisant de plus en plus, les procès étant lamentablement terminés, les médecins lui conseillèrent de quitter Paris et sa faune.
Mais, avant de baisser les bras, Cécile allait publier encore deux livres, début d'une collection éphémère mais qui lui tenait à cœur. Cette collection portait le titre générique « Europe Unie » ce qui, si peu de temps après la Seconde Guerre Mondiale semblait être un défi à l'avenir.
Le premier ouvrage était une étude : Puissance économique et culturelle de l’Europe unie, par Jean Fourastié et André Varagnac, avec un avant-propos de Henri Frenay ; le second, écrit par le générali Béthouart s'intitulait La Peur du risque et la Communauté Européenne de Défense. De nos jours, cela semble tout à fait normal mais, lorsque parut ce livre, combien de gens croyaient à une possibilité d'union européenne ? La main tendue à nos ennemis d'hier c'était, pour beaucoup, une sorte de trahison. Cela demandait un courage immense et, rien que pour avoir édité ce livre, La Plaque Tournante justifiait son existence et son nom.
Amie de la paix, premier éditeur de l’Europe Unie, Cécile se réjouit lorsqu’elle vit peu à peu cette Europe prendre naissance ; mais, lorsqu'il fallut voter pour élire les membres du Parlement européen, un quart de siècle plus tard, la maladie empêcha Cécile, pour la première fois de sa vie, d'aller voter elle-même. Bien entendu, elle me donna procuration et c'est avec une émotion compréhensible qu’en son nom et au mien, je déposai nos bulletins dans l'urne en juin 1979. Le livre du général Béthouart fut le dernier : Cécile quittait Paris. Les médecins croyaient avoir eu gain de cause.
*
Ceux qui la connaissaient, ou croyaient la connaître, auraient pu la chercher ; elle avait repris une pension de famille à Montmorency : « Le Pavillon Blanc », presqu'à la limite d’Enghien-les-Bains dont la gare était proche, ce qui me permettait de servir quelques petits déjeuners avant de partir travailler aux Editions Dunod où j’étais technicien de fabrication. Le train me déposait à la Gare du Nord où je prenais le métro qui me déposait, sans changement, à Saint-Sulpice, près de mon lieu de travail. Cela nous permettait aussi, lorsque nous en trouvions le temps, de nous promener au bord du lac d’Enghien qui est bien agréable et, de temps à autre, d'aller au Casino, non pour y jouer mais pour y voir quelqu’opérette.
Nous étions à Montmorency depuis un peu plus de deux ans lorsque notre médecin, ayant consulté des confrères, ayant fait faire toutes les analyses nécessaires, nous avait conseillé de retourner vers le soleil, dans le Midi. [...] Cela se passait au début de janvier 1956 : juste après les traditionnels vœux de bonheur et de santé.
Depuis trois ans je travaillais aux Editions Dunod ; j'y avais la charge et la responsabilité de fabrication des dix revues techniques que publiait cette maison, dans une ambiance de confiance et de sympathie partagée avec l'ensemble du personnel. Je dois dire que j'y étais heureux.
Chaque matin je prenais le train puis le métro pour revenir le soir par les mêmes moyens, ayant déjeuné rapidement à midi pour pouvoir téléphoner longuement à ma femme afin de couper une trop longue absence et tenter de rassurer mon inquiétude pour sa santé plus que précaire. Depuis quelques mois j'avais obtenu de François Dunod l'autorisation de quitter mon travail à quatre heures - en ramenant chez moi quelque dossier on des épreuves à revoir - afin d'être plus tôt auprès de Cécile et de la seconder dans son travail.
Nous avons donc vendu le fonds du « Pavillon Blanc », où nous n'étions que locataires, pour revenir plus vite vers le soleil. Mais qu'importe la somme, qu'importe l'argent, lorsque la santé est en jeu et que la vie s'en va. Nous partîmes donc pour Nice un jour de mars de cette année 1956 qui devait être la dernière.
[A la Colle-sur-Loup, Cécile et Morys retrouvent leur ami Jacques Barreau, qui y tient une boutique de brocante. Rééditant l'arrangement pris en 1928 avec Anne Marie Blanche, avenue de La Bourdonnais, Cécile propose à Jacques Barreau de diviser son local : brocante d'un côté, restaurant de l'autre.]
Ne manquait plus que l'enseigne. « L'Ane d'Or » proposa Cécile, en pensant au premier livre qu'elle et Robert avaient publié. Dans un vieux cadre doré de grande taille, j'installai une tête d'âne super-stylisé découpée dans du papier doré, sur fond noir ; grâce à un petit spot, cela prenait un relief étonnant. Sur la façade que nous avions repeinte, ornée de canisse et de plantes grimpantes, je dessinai une immense tête d'âne avec l'indication «Restaurant». Des pancartes d'un humour léger indiqueraient les spécialités du jour, les menus.
Et ainsi, s'activant, faisant des projets, préparant un avenir improbable, nous tâchions de ne pas trop penser à la raison qui nous avait fait revenir vers le soleil. Le sourire éclatant et communicatif de Cécile masquait parfaitement le drame intérieur que nul ne connaissait... et n'aurait pu croire en la voyant.
Mais, malgré tous les soins dont je tentais de l'entourer, Cécile se fatiguait beaucoup trop. Et le terme approchait. L'originalité du restaurant était maintenant connue, sa cuisine renommée... Puis vint le jour où la fatigue l'emporta sur la volonté. Deux ou trois mois après l'ouverture de « L'Âne d'Or » la maladie prenait le dessus. Durant quelques jours, je remplaçais Cécile à la cuisine, dans la salle, partout ; mais j'étais inquiet, mon esprit était dans la chambre où elle était enfermée, auprès du lit qu'elle ne quitterait plus.
Nous avions dû fermer le restaurant. Jacques avait empilé les tables dans un coin, avait réinstallé sa brocante. C'est normal. « L'Ane d'Or », lui, était mort. Une fois de plus nous étions sans argent ; mais la Vie était là ; et nous avions notre Amour. Que peut-on souhaiter de mieux ?
*
Il fut une époque où, chez Robert et Cécile Denoël, c'était, au mois de décembre, un véritable branle-bas de combat pour préparer la fête qui était donnée pour les amis du Finet, mais où le Tout-Paris se pressait. En 1943, une pièce de théâtre avait été écrite spécialement par Paul Vialar sur un thème que je lui avais fourni : « La Naissance du Père Noël ». L'année précédente, c'était : « La grande Pitié du Prince Antheaume », écrite, spécialement elle aussi, par Maurice Percheron, dont j'ai le programme et quelques photos sous les yeux.
Pour chaque pièce, Pierre Capdevielle écrivait une musique originale que jouait au piano un autre compositeur célèbre : Tony Aubin, car Pierre tenait à jouer dans les pièces auxquelles il ajoutait des facéties de son cru... même lorsqu'il incarnait Saint Joseph ! Grâce au Ciel, Cécile, qui jouait la Vierge, tenait son rôle beaucoup plus au sérieux.
En fin de programme un illusionniste présentait son numéro après que le Père Noël « en personne » ait distribué aux enfants les jouets et cadeaux dont sa hotte débordait. J'écrivais dernièrement à René Barjavel que j'avais encore dans le cœur l'émerveillement de son fils devant le Père Noël que j'étais et il me répondait que ses enfants, qui ont des enfants en âge d'en avoir eux-mêmes, s'en souvenaient toujours.
Durant les jours qui précédaient ces représentations, les répétitions se poursuivaient dans un appartement en pleine transformation : la scène occupait la bibliothèque tandis que le salon et la salle à manger constituaient la salle. Tout au fond se trouvait un « buffet » amplement garni et joyeusement dévalisé. Afin de réserver le jour de Noël aux enfants, nous avions été obligés, pour ne mécontenter personne, de faire une « répétition générale » et une soirée-bis, ce qui permettait à plus de deux cents amis d'assister au spectacle. Heureusement, l'appartement était grand !
Je dis « nous » parce que, tout naturellement, à la demande de Robert, c'est moi qui montais la scène, faisais les décors, réglais les éclairages ; mais nous nous partagions la mise en scène. Métier oblige : on me distribuait toujours l'un des principaux rôles et j'avais les partenaires les plus divers : on y rencontrait, outre Cécile et Capdevielle déjà nommés, un chef d'orchestre suisse, un directeur commercial, un professeur de culture physique, une répétitrice de piano, un interne en médecine, un de mes routiers-scouts, et même la bonne de la maison, auxquels s'était jointe Svetlana Pitoëff, sœur de mon ami Sacha, qui eut une grande surprise la première fois qu'elle était venue répéter chez les Denoël : ses parents Georges et Ludmilia Pitoëff, ainsi que ses nombreux frères et soeurs, avaient habité ce même appartement ; je crois même me souvenir que c'est là qu'elle était née.
A son grand regret, Robert ne jouait pas car il fallait bien que l'un des hôtes soit là pour recevoir les invités - et dès son rôle terminé, Cécile se changeait rapidement pour l'assister dans sa tâche - mais il prenait volontiers la place de l'un des acteurs lors des répétitions, et j'ai eu la joie de prendre une magnifique photographie du célèbre éditeur, couronne en tête, sérieux comme un pape dans son costume de roi. Cette photo n'a jamais été montrée de son vivant qu'à quelques rares amis intimes : elle aurait trop amusé les journalistes !
*
Revenons sur la Côte où, contre toute espérance, Cécile revit. Je ne dirais pas qu'elle reprend goût à la vie : jusqu'à sa dernière heure de lucidité comme dans les pires moments de son existence, Cécile n'a jamais cessé d'aimer la vie ; même si une fois, une seule et pour très peu de temps, elle perdit l'espérance. J'en parlerai plus tard.
Ma situation s'est sensiblement améliorée : je travaille pour deux entreprises, l'une s'occupant de fleurs, l'autre de construction. Nous avons dû déménager, quitter la Colle-sur-Loup pour Cannes, ce qui me permet d'être à pied d'œuvre et de travailler davantage. On me demande même, durant le Festival, de faire la critique des films pour un journal éphémère ; je la fais.
Pendant ce temps, Cécile dessine et peint sur parchemin pour G... [Gustave Bruyneel] que nous avons retrouvé par hasard et que je ne voulais pas voir tout d'abord, au souvenir de l'enveloppe de photos pour lesquelles il m'avait laissé condamner à sa place.
Les dessins qu'elle faisait donnèrent un regain de vigueur au négoce de G... qui, vieillissant, ne pouvait suffire pour le gérer. Il m'appela à la rescousse pour en assurer la co-direction. Après une hésitation, j'acceptai. Nouveau déménagement. A Nice cette fois, où nous continuions à travailler sans compter, Cécile et moi, mais pour la même entreprise que j'allais, assez rapidement, reprendre à mon compte.
Peu à peu, à force de travail, nous arrivions, une fois encore, à remonter la pente et à faire des projets. En 1959, nous achetions un terrain perdu dans la campagne que desservait un chemin de terre bordé de fossés et d'herbes folles. C'était à Mandelieu, commune de deux mille habitants, où jadis les petits avions qui faisaient le trajet Paris-Nice déposaient leurs quelques rares passagers éblouis à leur arrivée par l'abondance de mimosas qui, en février et mars, couvre tout le paysage. C'est ainsi que, vingt-cinq ans plus tôt, Cécile avait été conquise par cette vision.
Sur ce terrain, nous avions projeté de construire la maison de famille : un mas qui devait abriter quatre générations : la maman de Cécile, mon père, nous deux, le Finet et Arlette sa femme, Patrice et Olivier (qui était encore en gestation et dont on ne savait pas encore qu'il serait un garçon), leurs enfants.
Cécile et moi n'avions jamais eu de maison familiale, nos parents, les siens et les miens, ayant la bougeotte et déménageant trop souvent. Nous espérions donc implanter là la maison que nous avions prévu d'agrandir lorsque les petits, à leur tour, prendraient femme et auraient des enfants. Le nom de la maison : « Saint-Amour ». Tout un programme. Mais le destin voulait que jamais Cécile n'ait longtemps quelque chose qui lui appartienne vraiment et ses espoirs allaient sombrer après cependant quelques années de bonheur et de rêve.
*
Les fondations de Saint-Amour étaient à peine achevées qu'un télégramme nous arrivait de Liège : « Mère décédée. Docteur Bertrand ». Ce docteur Bertrand est Emile, cousin germain de Cécile, fils unique de sa tante Flore. Cécile téléphona aussitôt pour faire ses condoléances et savoir comment était morte sa tante. Elle apprit alors que ce télégramme laconique l'informait du décès de sa propre maman. Ce fut pour elle un coup terrible autant qu'inattendu [Elvire Herd est morte le 31 juillet 1959].
Je ne conterai pas le voyage qui, en un temps record, devait nous amener à Housse, petit village des environs de Liège, en passant par Mourmelon, camp militaire où le Finet était sergent. Je ne vous dirai pas les difficultés administratives pour avoir le droit d'entrer dans la maison de la maman, les outrances des sociétés de pompes funèbres et mille détails absurdes qu'il vaut mieux oublier ; le tout contrebalancé par l'accueil adorable de l'un des frères de Robert : Carl Denoél, sa femme Hélène et leurs nombreux enfants. [Charles Denoël, dit Carl, frère aîné de Robert, né le 19 février 1899].
La vie reprit, un peu plus triste : la santé de Cécile ayant été ébranlée par cette séparation d'avec sa maman qu'elle adore. Nous allions aussi souvent que possible à Mandelieu voit grandir la maison où une chambre désormais serait inutilisée. Enfin vint le jour de 1960 où, presque terminé, Saint-Amour était habitable et où nous avons emménagé.
Comme prévu, mon père vint s'installer chez nous mais, très vite, s'ennuyant de la ville, nous quitta pour retourner vivre à Nice. En août, quittant définitivement Paris, le Finet et Arlette prenaient possession de leur partie de Saint-Amour avec Patrice, bambin de deux ans et Olivier qui courait encore à quatre pattes. Au lieu de quatre générations, il n'y en aurait que trois, le sort l'avait voulu ainsi, mais l'avenir était merveilleux et nous pouvions enfin vivre heureux dans la joie de la famille réunie. La vie s'écoulait simplement, avec son travail quotidien, mais aussi son lot de joies nombreuses et aussi de surprises.
Durant notre séjour à Nice, l'inondation de notre cave avait dévasté des souvenirs qui y étaient entassés, des lettres, des photos et toute une collection de disques aimés : « L'Anthologie Sonore » et tout le jazz des années 1920 et 1930. A Saint-Amour, ce fut l'incendie de notre bureau qui consuma des livres, des archives, tant de choses... Mais qu'importe, la vie continuait, et cette vie était belle et souriante entre les enfants, les petits, les fleurs, les arbres, les oiseaux.
Tout cela était trop beau. Il ne fallut qu'un grain de sable pour enrayer les rouages de notre bonheur. En 1963, un incident mineur au fin fond d'un village perdu dans la brousse, en Afrique avec laquelle nous travaillions, suffit pour bloquer nos rentrées, déséquilibrer notre budget et nous empêcher de payer les intérêts des prêts grâce auxquels nous avions pu construire.
Cela allait ébranler tout l'édifice et anéantir à jamais toutes nos espérances. Grâce au Ciel, après avoir tâtonné quelque peu, les enfants retrouvèrent une autre situation ; mais ils désertèrent la maison. Saint-Amour n'avait plus de raison d'être.
*
Pour la première fois de sa vie, Cécile flanche. Épuisée. Depuis des jours et des jours, nous voyons la terre s'entrouvrir sous nos pieds. La propriété hypothéquée par les prêts, le travail arrêté, comment pourrons-nous payer demain ? A retourner jour et nuit le problème qui nous semble insoluble, cela finit par devenir obsession. Nous avons pourtant plus d'une fois été tout au bas de l'échelle, nous avons eu des moments plus dramatiques, mais nos crânes semblent vides, ou plutôt farcis de la même pensée qui tourne sans cesse et ne nous laisse pas un moment de répit. La fatigue, cette fois, est trop forte ; nous nous sentons vieux, tout à coup. Plus de santé, les enfants partis, nos rêves déçus. Nous avions trop espéré ; nous avions trop joué, y compris notre cur, sur une seule carte. Nous n'avons jamais été joueurs et nous sommes perdus.
Après l'échéance que nous venons de payer, il nous restera un peu moins de trois mille francs. Nous ne pourrons pas faire face à l'échéance suivante, même en vivant au ralenti. C'est la fin.
[Cécile et Morys, utilisant leurs derniers trois mille francs, partent, le 29 janvier 1964, pour Rome et Florence, où ils séjournent onze jours]
Il nous était possible de vendre la moitié du terrain de Saint-Amour ; cela fut fait très vite et nous déchargea d'une partie de nos dettes. Nous savions que cela ne nous permettrait pas de survivre longtemps, mais nos esprits avaient été oxygénés par notre évasion et nous avions repris confiance en la vie, prêts à faire face au Destin.
Nous pûmes ainsi affronter dans une quasi-sérénité la ruine totale, que nous savions inévitable, peu d'années plus tard. Et nous avons considéré cette déconfiture non comme un désespoir, mais comme une épreuve de plus qui nous était infligée pour nous permettre, comme si nous avions fait vœu de pauvreté, de vivre heureux, totalement détachés des biens terrestres, sachant que jamais nous ne serions abandonnés si nous gardions le cœur ouvert.
Le 12 mars 1970, le mas Saint-Amour était mis aux enchères et vendu pour une somme dérisoire qui, après le paiement des frais, ne nous laissait rien. Entretemps, le 4 juin 1969, nous avions été cambriolés, cela manquait à notre panoplie ; mais nos voleurs étaient repartis les mains vides : nous n'avions déjà plus rien qui pût les intéresser.
*
Curieusement, la fin de Saint-Amour vit les lueurs d'une aurore nouvelle. Cécile avait encore une mission à accomplir. Depuis 1956, nous avions pratiquement coupé tous les ponts avec nos relations ; quant au monde des Lettres, il semblait mort à tout jamais, pour nous.
Or, un jour, alors que depuis plusieurs années nous n'avions plus aucune nouvelle de la famille Denoël, Cécile reçut une lettre de l'un de ses neveux qu'elle avait vu bébé dans les bras de sa mère. C'était François, fils de Francis, frère de Robert, celui sans doute avec lequel il s'était le plus battu en ses jeunes années ; cela crée des liens. [François, dit Francis, frère cadet de Robert Denoël, né le 30 juillet 1905].
François junior était à Menton pour deux semaines et demandait à sa tante s'il pouvait venir chez nous pour faire sa connaissance ; il resterait une heure au plus, pour ne pas déranger.
C'était un garçon timoré, ambitieux comme on l'est à son âge, passionné de littérature et qui voulait tenter de tout savoir sur son oncle Robert qu'il n'avait pu connaître. On en parlait peu dans la famille, peut-être parce qu'il n'avait pas suivi la même carrière que ses frères, pour la plupart ingénieurs ou professeurs, comme le père qui avait été une célébrité dans sa spécialité. La plupart, à l'exception de Paul, homme admirable que nous aimions beaucoup, Cécile et moi. Père supérieur des Jésuites a Mavidi, dans la province d'Inkisi au Congo Belge, il mourut tragiquement lorsque ce Congo fut devenu le Kinshasa avant de s'appeler le Zaïre.
François voulait entendre parler de son oncle Robert dont l'auréole le fascinait. Cécile fut intarissable sur son sujet favori.
- Tante Cécile, tu devrais écrire tes mémoires.
- Je sais ; cela ferait bien plaisir à Morys qui me « tanne » depuis des années à ce sujet. Mais je suis trop fatiguée. Et puis cela n'intéresserait personne.
- Oh ! tante Cécile, comment peux-tu dire cela ? On parle tant de toi et d'oncle Robert chez les jeunes écrivains...
- On verra, on verra. Mais parlons de toi. Que fais-tu ?
François s'enlisait dans des études de Droit qui ne lui plaisaient guère mais auxquelles tenaient ses parents. Par la suite, car cette visite fut le début de nouvelles relations cordiales avec la famille, Cécile obtint des parents de François qu'ils acceptent un changement d'orientation et, dès qu'il eut troqué le Droit pour les Lettres, le jeune François devint brillant et en termina glorieusement avec les Facultés. Puis, suivant l'exemple de son oncle dont il voulait suivre les traces, il quitta Liège pour Paris où il fréquenta les milieux de la jeune littérature.
Un jour de janvier 1969, Cécile reçut une lettre à en-tête de René Julliard, qu'elle avait bien connu trente années auparavant. Le nom du signataire lui était inconnu ; la lettre commençait ainsi :
« Madame,
« C'est M. François Denoël qui me recommande de vous écrire, car vous auriez des correspondances de L.-F. Céline et d'Antonin Artaud, et vous connaissez peut-être les deux grands Cahiers de l'Herne consacrés à Céline où sont réunis justement une importante correspondance de cet écrivain. Nous y avons d'ailleurs publié un texte de Robert Denoël »... La lettre était signée Dominique de Roux.
La réaction de Cécile fut d'abord explosive. J'ai sous les yeux le brouillon de la réponse que j'allais avoir à taper, et l'écriture est plus que catégorique. Cécile n'a jamais eu une écriture apathique ; mais là !...
« Monsieur,
« Votre lettre du 22 Janvier dans laquelle vous me parlez incidemment d'un texte de mon mari Robert Denoël, publié par vos soins dans les Cahiers de l'Herne, m'a plutôt surprise.. c'est le moins que l'on puisse dire ! - Je ne me souviens absolument pas en avoir donné l'autorisation, ni à vous, ni à quiconque, n'ayant jamais été sollicitée à ce sujet. »
Cette prise de contact tonnante allait, à la suite de nombreux coups de téléphone et correspondances, devenir une grande amitié. Depuis l'insistance de François, Cécile s'était décidée à commencer la rédaction de ses souvenirs ; Dominique l'aiguillonna pour qu'elle s'y adonne de toutes ses forces qui, hélas ! étaient souvent amoindries par la maladie.
Le 5 mars, moins de quarante jours après leur premier contact, Dominique de Roux ayant reçu copie des lettres de Céline que nous possédions, prévit l'édition dans sa collection « Glose » d'un petit ensemble qui comprendrait : 1°) un texte de Cécile sur Robert et la création des Editions Denoël jusqu'à Céline ; 2°) le texte de l'Apologie de Mort à crédit, par Robert Denoël ; 3°) la correspondance de Céline.
Cécile donna son accord et écrivit immédiatement le texte demandé : vingt-deux pages qui correspondaient exactement à ce que souhaitait l'éditeur. Au mois de mai, Dominique venait sur la Côte et j'allais le chercher chez Witold et Rita Gombrowicz. L'après-midi que nous passâmes à Saint-Amour fut constructive et exaltante. Quelques jours plus tard, Dominique écrivait à Cécile :
« De retour de Belgrade, ma première lettre est pour vous. Depuis cette après-midi auprès de vous et de votre mari, je ne cesse de penser à votre exemple, maintenant posé en face de moi pour mieux voir les spectacles qui nous déchirent et nous blessent. Si vous avez su vous éloigner, et même vous avez su ne plus être douloureuse à force d'être profonde, c'est qu'un jour vous avez réalisé une œuvre à vous, comme ensuite vous avez su comprendre ce que vous vouliez. Je vous suis infiniment reconnaissant d'être là, votre exemple prêt à être transposé par l'imagination du ressouvenir quand tristesse et misère morale nous accablent ... »
Lettre qui, cela se conçoit, émut Cécile qui répondit :
« Cette sérénité d'aujourd'hui, croyez-moi, n'est pas venue sans crises de désespoir, de rage, de fureur, jusqu'à entamer les limites de la Foi. Une maladie qui aurait dû m'être fatale, la méditation et la Foi retrouvée m'ont placée sur le Chemin. »
Tout cela tandis que tout s'écroulait autour de nous. Dans une lettre à Dominique, datée du 9 janvier 1970, Cécile résumait notre situation :
« Le bilan de l'année 1969 serait désastreux pour nous dans l'ensemble s'il n'y avait eu un rayon de soleil qui éclaira notre vie d'un espoir nouveau. En effet, il y a un an nous ignorions jusqu'à votre existence. Notre excuse : la réclusion volontaire où nous nous étions enfermés depuis trop longtemps. Sans l'émulation provoquée par votre première lettre qui a, tout d'abord, allumé une salutaire réaction de colère, mes mémoires seraient sans doute restées à l'état de projet malgré les objurgations de Morys. Je n'aurais pu, non plus, sans vous, renouer avec Bernard [Steele] d'amicales relations. Je mets donc à l'actif de mon bilan notre rencontre, et au passif, notre ruine. »
Cécile revivait parce qu'elle sentait qu'elle pouvait être utile à une jeune génération littéraire qui recherchait les enseignements d'un passé lointain pour eux mais, pour elle, si proche encore. Depuis, jusqu'aux derniers de ses jours, même dans les moments où la maladie prenait le dessus sur la vie, Cécile correspondit et reçut avec joie ces chercheurs qui avaient besoin de son témoignage, de ses souvenirs. Et, dans la plupart des cas, ils devinrent des amis, dont certains très chers à son cœur.
Le mas Saint-Amour adjugé, nous nous trouvions sans argent et sans toit. Gaby, une amie à laquelle Cécile avait redonné le goût de vivre après la mort de son mari, René Pagliano, que nous aimions beaucoup, possédait un appartement à Nice, dans un immeuble neuf dont le nom : « La Croix du Sud » rappelait bien d'heureux souvenirs à Cécile. Gaby nous offrit le toit qui nous manquait jusqu'à ce qu'elle trouve un locataire, qu'elle ne se pressa pas de chercher.
Nous partîmes donc pour Nice et je trouvai du travail à Antibes. Deux ans plus tard nous décidions d'habiter Antibes et peu après je perdais mon emploi. Pour la première fois de ma vie je me fis inscrire au chômage, ce qui me permit de toucher une « aide publique » de huit francs soixante dix par jour, en pointant régulièrement.
*
Malgré sa fatigue et grâce aux soins qui commençaient à faire effet, Cécile avait accepté de recevoir un jeune écrivain belge [Henri Thyssens] avec lequel elle correspondait au sujet de Céline, mais qui désirait lui poser directement quantité de questions et les approfondir. Mais le jour où il arriva, tout au début d'avril 1975, Cécile eut une rechute et se sentait très faible.
- Je peux lui demander de revenir un autre jour, suggérais-je.
- Non, ce petit a fait le voyage spécialement pour me voir, ce ne serait pas gentil de ma part.
Elle le reçut donc et répondit au feu roulant de ses questions durant près de trois heures, contant des anecdotes, jusqu'au moment où l'infirmière arriva pour une intra-veineuse. Le médecin avait prévenu : « Si vous sentez que c'est trop fort pour votre état actuel, faites arrêter la piqûre. »
Cécile, très affaiblie par la visite, supporta mal le début de la piqûre et demanda à l'infirmière d'arrêter. Celle-ci n'en tint aucun compte (C’est une exception ; toutes les autres infirmières que nous avons connues étaient parfaites). Cécile eut une syncope dont elle se remit mal. Peu après, un infarctus et elle tomba dans le coma. Billy, son frère, arriva d'Angleterre où il est médecin ; il l'ausculta et fut persuadé que c'était la dernière fois qu'il la voyait vivante.
Malgré les apparences, je ne pensais pas qu'elle puisse partir sans m'avoir prévenu. Je restai auprès d'elle, lui prodiguant les soins que conseillait le médecin, qui venait deux et trois fois par jour. Cela dura cinq longues journées. Le dernier de ces cinq jours, je lui tenais la main comme je n'avais guère cessé de le faire, lorsque je sentis cette main revivre, s'agripper à la mienne : Cécile revenait à la vie. Son heure n'avait pas encore sonné.
Combien de fois a-t-elle été aux portes de la mort tout au long de sa vie ? Déjà, au temps des Trois Magots, elle avait échappé de peu à cette fin terrestre, par la faute d'une bronchite mal soignée. Robert m'a conté son désespoir à cette époque. De son lit, dans l'arrière-boutique, elle avait tout à coup cru voir une grande lumière et en avait été réconfortée ; la guérison avait suivi de peu.
Cécile s'était ouverte, de cette espèce de vision, à son vieil ami Max Jacob, le seul qui pût la comprendre sur ce point. Max répondit aussitôt à cette lettre que Cécile garda longtemps sur elle et qui en est tout abîmée :
« Bonne amie Cécile,
« Si Dieu s'est dérangé vous lui devez une politesse, allez le voir au Sacré-Cœur de ma part. Confession générale et communion tout de suite. Si c'est le diable qui vous tourmente, allez demander la protection de Dieu contre le diable. Confession générale et communion. Je vous embrasse. Ayez confiance, c'est une simple crise mystique sans maladie physique. Max. »
Crise mystique, c'est bien possible ; mais hélas! la maladie physique était bien réelle chaque fois. Cécile se remit doucement, lentement, lentement. Lorsque je m'inquiétais de la voir souffrir, elle me répondais faiblement avec-son adorable sourire : « Mais, mon Amour, si je souffre, c'est que je vis. Alors !... »
Lorsque cela allait plus mal, il lui arrivait de me répondre : « Tu le sais bien, je suis en sursis depuis des années. Quelle chance, nous avons ! » Enfin, lorsqu'une catastrophe ou des douleurs plus graves encore l'accablaient, elle me rassurait de son mieux, d'un sourire souvent très las mais rayonnant : « Dieu ne nous envoie jamais plus d'épreuves que nous n'en pouvons supporter. » Je ne dirais pas qu'elle parvenait toujours à me convaincre, mais je l'admirais.
Un après-midi de novembre 1976, bien emmitouflée, elle avait enfin pris place dans la voiture pour prendre l'air. Nous roulions doucement sur la petite route de Valbonne lorsqu'une voiture, venant en sens inverse, nous heurta de plein fouet. Choc brutal. Nous nous retrouvâmes a l'hôpital : Cécile avait toutes les dents brisées. Il fallut, quelques mois plus tard, les lui enlever. Nouvel infarctus... dont elle se releva plus affaiblie encore mais avec, toujours, au fond du cœur une tendresse et un courage infinis. Durant ces années nous avons vécu de miracles. Dans un rêve qui ne devait pas avoir de fin. Qui aurait dû, sans doute, ne pas en avoir...
Mais, à la fin de l'été 1979, il me fallut encore partir pour l'hôpital, trois interventions urgentes m'y attendaient et, pour la première fois de notre vie commune, Cécile ne pouvait pas me suivre. Habituellement, si elle ne pouvait partager ma chambre à la clinique, elle allait loger dans l'hôtel le plus proche pour être auprès de moi le plus longtemps possible. Comme je le faisais lorsque c'était elle qui était entre les mains d'un chirurgien.
Je fis deux séjours à l'hôpital de Cimiez, à Nice. Deux séparations durant lesquelles nos esprits ne se quittaient pas. Chaque jour j'avais de ses nouvelles et, lorsque je pouvais me lever, je lui téléphonais de l'hôpital. Avant de partir, j'avais enregistré sur un petit magnétophone autant de petits messages, illustrés de chansons qu'elle aimait, que de jours où nous serions séparés. Elle en écoutait un chaque matin et y apprenait, en fin d'audition, dans quel livre de la bibliothèque j'avais placé le petit mot d'amour quotidien. De mon côté, dans ma valise, dans ma trousse de toilette, dans mon pyjama, j'avais trouvé les mots tendres qu'elle y avait glissés. Lorsque je revins, un festin m'attendait, la plus belle nappe, les plus beaux couverts, des dessins, des poèmes, des fleurs (artificielles car elle ne pouvait sortir, mais qu'importe !), la maison resplendissait de bonheur, malgré la fatigue que ma femme cachait derrière son éblouissant sourire ; fatigue en grande partie née de son inquiétude.
Pour Noël, mous avons ensemble préparé l'arbre et la crèche qu'elle voulut différente cette année-là ; mais encombrante sans doute et moins charmante que la crèche provençale à laquelle nous ajoutions presque chaque année un ou deux santons nouveaux, les plus anciens étant plus vieux que nous, mais très belle et très digne. Réveillon sage et délicat que nous avons fait durer pour attendre le coup de téléphone des enfants. Leurs voix joyeuses nous réchauffèrent le coeur. Puis, quelqu'instant plus tard, Cécile me prit les mains, mit ses yeux dans les miens et me dit :
- Mon Amour, il faut que je te dise...
- Oui ?
- Mon Amour, pardonne-moi... je n'ai plus la force de vivre.
Elle me serra les mains. Fort, très fort. Et son regard m'implora de ne pas lui répondre, de ne pas pleurer. Son sourire léger se fit d'une douceur irréelle. Dans les bras l'un de l'autre, je ne sais combien de temps nous restâmes sans rien dire.
Dès lors, je la vis s'affaiblir davantage. Elle m'avait demandé de la laisser dormir aussi longtemps que possible le matin, ses nuits étant, depuis tant d'années, tellement difficiles. Mais lorsque je me levais, je trouvais toujours près de ma tasse un petit mot adorable. De même, elle en trouvait un aussi lorsqu'elle apparaissait aux environs de midi. C'est une habitude que nous avions prise depuis toujours et, bien que nous en ayons détruit des centaines, je ne puis ouvrir un tiroir sans en retrouver quelques uns. Le nouvel an passa. Puis vint le 10 janvier, anniversaire de notre mariage civil.
*
Ce jour où commença la fin, le jeudi 10 janvier 1980, j'avais, comme chaque matin, trouvé sous la tasse de mon premier café le tendre message quotidien auquel elle ajoutait ce rappel d'avoir à faire vérifier la direction de la voiture : « N'oublie pas le shimmy de la Binouchette ». Sur la table, une enveloppe contenant une carte de vœux comme j'en trouvais lors de chaque fête. Comme presque toujours, elle se terminait par ces quelques mots : « For ever, ever and after ».
De mon côté, avant de partir faire les courses, j'avais dessiné une carte qui, elle aussi, était pleine de vœux pour cet anniversaire, le vingt-neuvième. Cette carte allait, hélas ! rester sur la table de son petit déjeuner durant des jours et des jours, auprès des médicaments du matin désormais inutiles. J'avais entrevu Cécile à demi-endormie vers sept ou huit heures du matin. Tout semblait encore normal. Après l'heure de midi j'avais, à plusieurs reprises, entrouvert sans bruit la porte de sa chambre ; elle dormait calmement.
Vers cinq heures, je tentai quand même de la réveiller : « Non, laisse-moi, je veux dormir ». Je m'étais assis auprès d'elle. Vers cinq heures et demi, un grognement : « Je veux faire pipi ».
- Alors lève-toi !
Ce n'est que plus tard que je me rappelai que son bras gauche était curieusement placé. Elle tenta de bouger, de se lever, la jambe ne suivait pas, le pied se mettait de travers. Je tentais de l'aider ; en vain. J'ai alors poussé ses jambes hors du lit, essayé de poser son pied à terre, tenté de la soulever. Elle ne pesait plus que cinquante et un kilos, mais pour moi c'est trop lourd. Comme elle retombait sur le côté, je m'assis sur le lit tout contre elle pour la soutenir de mon corps. Cela dura une heure et demie : jusqu'à sept heures ! Enfin, le corps à moitié sur le lit, à moitié dans le vide, sa tête retomba sur mes genoux. Fatiguée par l'effort, elle ne remuait plus mais je ne pouvais bouger car chaque fois que je tentais de me dégager pour appeler à l'aide, elle me suppliait : « Ne t'en vas pas ! » et s'accrochait à ma ceinture.
Impossible, absolument impossible de faire un mouvement sans risquer de la voir tomber à terre d'où je n'aurais pu la soulever. Cela dura jusqu'à dix heures du matin, le vendredi. Une nuit atroce. Enfin, elle sembla s'endormir. Doucement, je pris sa tête pour la poser sur le lit et, me glissant millimètre par millimètre, je parvins à me dégager pour appeler le médecin. Il était dix heures dix. Par chance, il était à son cabinet ; lâchant ses consultations, le docteur Evrard arriva aussitôt. Il la prit comme une plume pour la replacer sur le lit. Tension, à peu près normale, piqûre intra-veineuse d'Iskedyl. Puis il téléphona pour avoir une ambulance de réanimation. A onze heures nous étions à l'hôpital d'Antibes.
J'avais eu le temps de téléphoner à Arlette pour qu'elle prévienne Robert. Lorsque Cécile rouvrit les yeux dans la salle de réanimation de l'hôpital, elle nous vit, le Finet et moi, nous reconnut immédiatement et nous sourit autant que le lui permettait sa bouche déjà déformée par l'hémiplégie.
Peu de temps après, par les couloirs souterrains et avec un infirmier, nous l'a conduisions jusqu'à une chambre du groupe médical, toujours sous perfusion, auprès d'autres malades. Je pus heureusement, dès le lendemain, la faire placer dans une chambre particulière où je pouvais rester et m'allonger pour la nuit dans un fauteuil. Dormir, c'était une autre question.
Elle avait de très longs moments de lucidité durant lesquels elle parlait normalement, ne se plaignant pas ; ce n'est que dans son sommeil semi-comateux qu'elle se plaignait de douleurs aux bras, au ventre, à la tête, au bassin, au foie...
J'avais fait un saut à la maison pour lui ramener le strict indispensable dont son « vieux Bon Dieu de Tancrémont », qu'elle m'avait demandé. C'est un petit crucifix de bronze de huit à dix centimètres : le Christ en croix curieusement habillé de sa robe descendant jusqu'aux pieds, réplique d'un très ancien crucifix de bois un peu plus grand que nature, que l'on vénère dans les environs de Liège. Lorsqu'on le prie, au lieu de baisser humblement la tête, on le regarde bien en face et parfois on le voit pleurer. Nous étions allés le voir une trentaine d'années auparavant, Cécile et moi. C'est avec joie qu'elle le retrouva lorsque je le lui remis et elle le pria immédiatement en wallon. Lorsqu'elle disait le « Notre Père », c'était en anglais, comme elle l'avait appris dans son enfance. Ce n'est que lorsqu'elle me demandait de prier avec elle, qu'elle s'adressait à Dieu en français.
Le dimanche, d'une voix un peu lasse, elle me demanda faiblement : « Quelle date sommes-nous ? »
- Dimanche 13 janvier.
- Bon anniversaire, notre amour, articula-t-elle doucement, puis elle ajouta, le sourire un peu triste : « Je t'offre un drôle d'anniversaire, mon amour ! » C'était, en effet, l'anniversaire de notre mariage religieux, celui qui compta vraiment pour nous.
Ses intestins, qui l'avaient tant fait souffrir et pour lesquels nous étions revenus vers le soleil, ses intestins se relâchaient,elle n'avait pas le temps de demander le bassin ou, si on le lui laissait trop longtemps, celui-ci glissait sur le côté. Il fallait la changer de nombreuses fois par jour. Cécile ne cessait de s'en excuser auprès des infirmiers et infirmières. Elle, si maniaquement propre et pudique, en souffrait terriblement, s'excusant et remerciant sans cesse.
Le mardi 15, elle me demanda mon bloc et, sans pouvoir lire ce qu'elle écrivait, étant allongée, le bloc sur la poitrine, elle écrivit son dernier message. Je suivais du regard le tracé du stylo à bille. Avec quelle difficulté elle écrivit ceci : « Bonjour Amour. Merci pour tout et ton amour. Merci à tous et à toutes. Merci à nos poussins. Mamie. » Les poussins, ce sont Patrice et Mylène, Olivier et Christine qui étaient venus la voir.
Le samedi 19, Cécile s'endormit calmement. Je pus même dormir un peu, cette nuit-là. Chaque fois que je m'éveillais, j'entendais sa respiration régulière et calme. A six heures moins le quart, quelque chose d'insolite me réveilla : c'était sa respiration qui avait changé de rythme, elle était trop forte et saccadée, faisant penser aux chemins de fer à vapeur d'autrefois. J'allais me lever lorsque l'infirmière entra pour changer le flacon de la perfusion. Je sens qu'elle a une hésitation et s'apprête à repartir. Malgré moi je lui demande : « Peut-on appeler un prêtre ? »
- Oui, mais j'appelle d'abord le médecin.
Moi qui l'ai vue si souvent aux portes de la mort sans avoir jamais vraiment craint son départ, je savais que cette fois, elle était déjà sur le chemin qui conduit ailleurs...
Le dimanche, pas de médecin ni d'interne dans le bâtiment ; il faut attendre. Un interne arrive enfin, fait mettre l'oxygène, change le liquide de la perfusion. Le chapelain arrive un peu plus tard, ânonne l'onction des malades comme une vague formule bâclée. Il en voit sans doute trop pour y faire attention.
Je téléphone à Robert qui, aussi rapidement que possible, arrive avec Arlette, Olivier, Mylène et Christine ; Patrice est parti en manœuvres de côté de Besançon. Une partie de la matinée se passe sans que Cécile reprenne connaissance, continuant sa respiration saccadée et dramatique. En réalité, tout était fini, seul l'oxygène entretenait les battements d'un cœur fatigué à outrance et prolongeait inutilement une apparence de vie qui, déjà, était partie. Sans nous être concertés, nous étions d'accord, le Finet et moi, pour arrêter la pression. L'infirmière n'en avait pas le droit. Nous non plus. Le médecin de service arrive enfin. Timidement je lui demande :
- Croyez-vous qu'il soit utile de la laisser souffrir inutilement ?
- Elle ne souffre plus, me répond-il.
- Il n'y a vraiment plus d'espoir ?
- Non.
- Alors, soyez bon : faites enlever l'oxygène.
Il réfléchit une seconde : « Vous avez raison. » L'oxygène enlevée, après quelques instants le rythme respiratoire redevient normal. Cécile semble se détendre. Quelques instants avant midi, sa poitrine se soulève pour une énorme respiration. A midi juste, c'était le dernier soupir.
Nous avons rapproché ses pauvres mains tuméfiées par les perfusions. Mylène avait cueilli, avant de partir, une rose de son jardin ; nous avons ajouté son vieux Bon Dieu de Tancrémont, qu'elle priait encore la veille en wallon. C'était fini. Cette croix dans cette main qui ne pouvait s'étendre et semblait la tenir dans le poing rappelait le blason des lointains ancêtres de son « papa » d'Afrique, blason que j'avais remarqué sur le cachet de cire qui fermait toutes ses lettres et dont la devise était « Facta non verba ». Des faits, non des paroles ; devise qui avait aussi été celle de Cécile.
Cela choquera sûrement bien des gens : je suis heureux que Cécile n'ait pas survécu. Je savais, par le médecin, qu'elle aurait été à jamais paralysée, que son cerveau aurait été abominablement amoindri, mais pas assez pour qu'elle ne s'en rende pas compte ; en fait une souffrance physique et morale de chaque instant, une mort permanente.
Le soir du décès, le Finet est venu coucher chez nous pour ne pas me laisser seul. Mais je ne suis pas seul : je sens sans cesse la présence de Cécile auprès de moi. Cela peut sembler dément mais je lui parle et j'ai parfois l'impression qu'elle me répond. Durant les premières semaines, lorsque je sortais pour faire les courses ou pour aller chez les enfants, j'avais hâte de rentrer pour la retrouver. Depuis, je la porte avec moi, en moi. Notre amour ne peut s'arrêter avec la vie. « For ever, ever and after », m'écrivait-elle toujours. Nous avons commencé cet après qui ne finira pas.
Dimanche 19 septembre 1982.
