Robert Poulet
Né le 4 septembre 1893 à Liège, mort à Marly-le-Roi le 6 octobre 1989. Frère aîné de Georges, il fit des études d'ingénieur des Mines à l'université de Liège, sous la direction de Lucien Denoël, le père de Robert.
Entre 1924 et 1926 Poulet publie plusieurs contes dans Sélection, la revue bruxelloise à laquelle Denoël collabore, lui aussi, mais les deux hommes ne se rencontreront qu'à la fin de l'année 1930, lorsque l'écrivain propose aux Editions Denoël et Steele son premier roman, Handji, qui paraît en février 1931. Denoël publiera, entre 1932 et 1944, cinq autres ouvrages de Poulet, dont l'essentiel de sa production romanesque.
Son premier témoignage a paru dans Entretiens familiers avec L.-F. Céline, publié chez Plon en janvier 1958.
Le suivant a été publié en juin 1979 dans Ecrits de Paris avant d'être repris en brochure de luxe par Pierre Aelberts, en juin 1981.
*
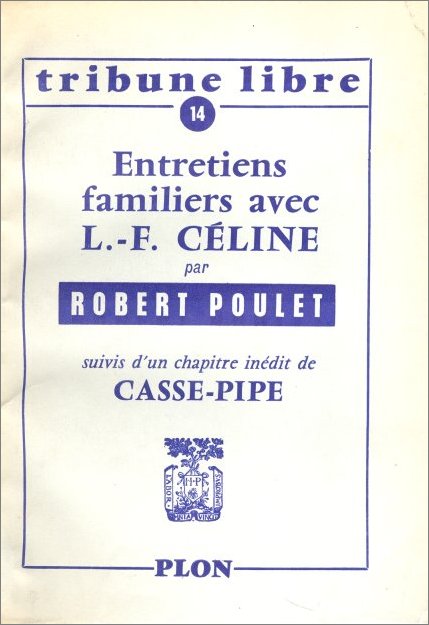
Au printemps 1932, Robert Denoël n'était encore qu'un petit éditeur de rien du tout; ce qui signifie qu'il n'avait hasardé que quelques pas sur la corde raide où il devait s'avancer dangereusement toute sa vie. Il n'en avait pas moins déjà à son actif quelques découvertes notables, comme celles d'Antonin Artaud et d'Eugène Dabit. L'année précédente il avait publié mon Handji, suivi du Trottoir ; et il s'apprêtait à prendre sous son bonnet, par amitié pour moi, un assez mauvais roman intitulé Le Meilleur et le pire. Sans grande conviction, j'étais venu signer le « service de presse » de cet ouvrage raté. Je trouvai la rue Amélie en effervescence.
- Nous nous préparons, me dit Denoël, à lancer avec fracas un bouquin extraordinaire, première œuvre d'un inconnu total qui, pour ce coup d'essai, a trouvé un esprit nouveau, un ton nouveau, un style nouveau. L'événement littéraire du siècle !
Je retins un sourire sceptique. Depuis longtemps je connaissais mon interlocuteur et je n'ignorais pas que très souvent il fallait, de ses propos, en rabattre, dans l'abstrait comme dans le concret. Ce sont des choses qu'on n'écrirait pas tout au long si l'étonnant personnage vivait encore ; car il y a des vérités nécrophiles, qui ne se posent que sur les tombes. Elles n'en sont que plus vives et plus sûres.
Sans l'étrange assassinat dont il fut victime, et qui donne à rêver, si l'on considère les conséquences qui s'ensuivirent, il est probable que Robert Denoël occuperait aujourd'hui la première place dans l'édition française ; qu'en tout cas il y jouerait le rôle le plus actif, celui que Bernard Grasset a tenu dans l'entre-deux-guerres, le rôle du trouveur, de l'initiateur audacieux. Mais cela ne va pas sans enflure ni sans écorniflure. Beaucoup d'idées, un peu moins de scrupules, une intelligence rapide, un côté de jouisseur et d'imposteur courtois, qui contrastait avec son faciès de bon jeune homme fraîchement dégourdi ; les paupières qui battaient, la bouche ingénieuse ; dans l'allure, une fermeté, une dignité de notaire qui pourrait bien, d'un jour à l'autre, mettre la clé sous le paillasson ; l'art périlleux d'arrondir les périodes. Et l'oreille de chat, qui bouge au moindre bruit, préparant le bond immédiat, pour fuir, pour saisir... Un chimérisme bien chiffré de dilettante excité par les affaires. Gentil, hennissant ; moitié valet de comédie, moitié capitaine de bateau dans une tempête, cramponné à sa dunette...
Ce Parisien merveilleusement adapté était né Liégeois. Il avait grandi dans une famille supernombreuse, confite en dévotion, genre boy scouts bien-pensants. Le père, professeur d'Exploitation des Mines à l'université... Et nous les étudiants, chantions à tue-tête, blaguant la fécondité de ce vieillard irritable :
« Je mène balader mes enfants
Au printemps
C'est moi qui les fais téter
En été,
J'leur sers de nurse et de bonne
En automne,
J'les préserve des courants d'air
En hiver,
J'augmente ma p'tite collection
En toutes les saisons. »
Seize ou dix-sept, tous plus sages et plus dégourdis les uns que les autres. A l'exception du seul Robert, lequel avait des goûts artistes. Il écrivait des contes « humains » et admirait fort Charles-Henry Hirsch. En outre, le sens du commerce, une sensibilité capricieuse et la bougeotte. Tant et si bien qu'il secoua le joug de la tradition paternelle. Echappant de justesse aux malédictions qui s'ensuivirent, il se hasarda dans la Babylone moderne, avec quatre sous, qui se multiplièrent, eux aussi ; un peu trop magiquement.
Cousu de dettes, toujours le nez sur une échéance désastreuse, il rencontrait infailliblement à moins une un commanditaire-bouée, ébloui par sa faconde franco-belge et frappé par son flair. Ainsi, de presque-krach en quasi-faillite, il avait rebondi jusqu'à cette boutique de la rue Amélie, où je l'avais retrouvé, l'année d'avant, déjà désinvolte, expéditif, muni d'un accent d'appellation contrôlée. On poussait la porte ; on tombait sur un réduit où bâillaient des emballeurs à la moue désenchantée (ce sont toujours les mêmes depuis vingt ans). Derrière, un petit bureau-grotte, que Denoël remplissait de ses chuchotements catégoriques. Des secrets qu'on entendait à trente pas ; mais il avait calculé cela aussi ; cela faisait partie de sa fausse naïveté et de son vrai instinct.
De naissance, il savait quels aimables mensonges il faut dire aux gens pour qu'ils soient non pas convaincus, c'est trop demander, mais favorablement impressionnés ; il savait le ton sur lequel il faut proférer ces mensonges pour qu'ensuite les interlocuteurs, réflexion faite, se persuadent qu'ils ont pris au pied de la lettre une plaisanterie boulevardière particulièrement fine, sur laquelle il serait ridicule de fonder une revendication ou une protestation.
Que d'auteurs furent reçus dans ce bureau minuscule, et comblés de compliments hyperboliques, où s'insinuait toujours une réserve imperceptible, qui réduisait à néant tout le reste, pour peu qu'on y pensât ! De sorte que les malheureux n'osaient plus ensuite invoquer des contrats en règle où soudain ils ne voyaient plus eux-mêmes qu'une formalité sans valeur, dont ils pouvaient tout au plus faire étendard à titre honorifique dans un cercle d'amis. Que si, prenant un jour leur courage à deux mains, ils réclamaient de l'argent que l'éditeur, aux termes de l'accord signé, leur devait cent fois, Denoël s'inclinait, se confondait en politesses, et tirait de son comptable un mémoire inouï où les droits, considérables dans l'absolu, tombaient à rien en pratique. Discuter ce compte d'apothicaire ? Vous en aviez pour vingt ans.
Seulement, attention, notre tricheur éhonté se serait mis à sec pour publier l'ouvrage d'un génie invendable. Volant tout un chacun et se volant lui-même, pour l'amour de la littérature, il donnait l'exemple d'une indélicatesse désintéressée. Rien ne prouvait, à ce moment où il me récitait son petit morceau sur la fameuse « découverte » de 1932, que le bizarre débutant dont il s'agissait dût conquérir un public. Tous les scandales ne font pas recette ; et surtout les scandales de la vérité. Pourtant, cette fois, Denoël marchait à fond.
Tout avait commencé comme dans un apologue persan. Un beau matin une main inconnue avait déposé chez l'éditeur un paquets de feuillets dont les seules dimensions eussent fait reculer avec effroi la plupart de ses confrères. Mais notre homme, qui s'était si vivement adapté à l'air parisien, demeurait de sa province sur un point : il lisait !
Pendant qu'il tournait donc les pages du monstre, un autre exemplaire du dit aboutissait rue de Grenelle, sous les yeux de Benjamin Crémieux, lecteur de Gaston Gallimard. La maison où André Gide avait refusé Proust (pour le retrouver un peu plus tard) se devait de dédaigner l'autre « romancier du siècle ». Du moins la note de lecture spécifiait-elle qu'après remaniements et allégements radicaux, mon Dieu, le cas pourrait être revu. Il n'y avait pas moins de pour que de contre... A cet instant, Denoël ahuri, effrayé, effaré, furieux, blessé dans ses sentiments les plus chers, s'écriait toutefois - averti par un génie intime qu'on a eu bien tort de supprimer avec lui en octobre 1944, sur l'Esplanade des Invalides (il eût fait merveille à l'heure qu'il est) - : « Il me faut cet homme-là ! » Mais cet homme-là n'avait pas signé son œuvre et ne donnait pas son adresse.
Alors on se rappela que l'énorme manuscrit était arrivé accolé avec un autre, dont l'auteur, moins étourdi, déclinait son identité. L'émissaire de Denoël se rua chez le personnage : c'était une dame, un peu peintre, un peu bas bleu. Elle habitait Montmartre. Une minute la malheureuse, d'après les cris qu'on lui fit entendre, se vit favorisée des dieux, promise au succès littéraire le plus flatteur et à l'admiration des siècles. Jusqu'à ce qu'on lui dît, entre deux compliments :
- Evidemment il y a dans votre bouquin de ces audaces !... Espérons que nous échapperons à la correctionnelle.
La dame sursauta : elle n'avait rien écrit de téméraire, au contraire. L'émissaire reprenait :
- Il faudra aussi que notre volume ait une épaisseur inaccoutumée.
- Comment ?... Cent cinquante pages, à double interligne, avec de grandes marges ?
Tout s'éclaira lorsqu'il se révéla que l'objet de l'enthousiasme denoélien n'était pas le petit roman où la dame avait conté une histoire sentimentale (la sienne, je suppose), mais le très gros roman que son voisin, le « médecin fou », lui avait confié à tout hasard en lui disant : « Puisque vous envoyez votre ours à un marchand de papier, joignez-y donc mon cachalot. »
L'émissaire, averti du quiproquo, ne fit qu'un bond. A l'étage inférieur, il trouva le médecin fou, qui venait de se lever, comme il convient à un spécialiste du service de nuit. Clichy : coups de couteau, crises de delirium tremens, autopsies... La lettre de Gallimard, avec le refus mitigé, tombait justement dans la boîte.
Et c'est ainsi que l'affaire avait été conclue. Elle menait à ce jeu d'épreuves - une montagne - que Robert Denoël me tendait :
- Lisez cela. Vous serez l'un des tout premiers.
Sacrifier à l'élucubration d'un débutant une soirée de Paris ? Perplexe, dans ma chambre d'hôtel, je soulevai du bout des doigts les premières feuilles. A la trentième ligne j'eus un petit sursaut et je m'assis commodément. Vers la sixième page, je commençai à enlever ma cravate...
- C'est prodigieux, dis-je à Denoël le lendemain. Prodigieux de verve, de drôlerie, de puissance satirique !
Mon bonhomme hochait la tête, une lumière dans ses lunettes. Pourtant je sentais que ma réaction ne le satisfaisait qu'à demi.
- ... Et de douleur, de désespoir, d'amour ! corrigea-t-il.
Là, je n'étais pas d'accord. Le Voyage au bout de la nuit m'avait frappé par ses vertus hilariantes [sic]; quant au pathétique, je n'en voyais point, dans cette gigantesque bouffonnerie en langage vert. Toute la nuit, je n'avais cessé de rire, en suivant Bardamu dans ses équipées ; je croyais lire les facéties d'un Courleline terrassier, qui faisait successivement aux quatre coins du globe l'épreuve de l'inconsistance et de l'extravagance humaines.
A cette époque, les intellectuels occidentaux ne juraient que par le cirque. La geste de Bardamu, c'était, à mes yeux, du cirque pur ; quelques entrées de clowns, dans des décors à demi futuristes, où tout au plus s'inscrivaient les signes d'une philosophie narquoise et burlesque, qu'il ne fallait pas trop prendre au sérieux ; en tout cas, pas au tragique, c'eût été de la jobardise. Ma surprise et mon admiration, qui étaient grandes, portaient sur la naissance d'une nouvelle espèce de comique, assez pareil à celui de Charlot, et où je subodorais quelque artifice, d'ailleurs légitime et efficace. Cet avis ne déçut pas seulement Denoël : je le vis en colère.
A la fin, il me dit d'une voix sèche que je n'apercevais pas l'essentiel. Nous avions, avec l'auteur du Voyage, l'équivalent de Dante et Shakespeare mis ensemble, plus un bon morceau de Cervantès. Et le fond du phénomène touchait à la plus poignante déploration non pas comique mais cosmique. Surmontée par un effort de courage. De sorte que tout s'expliquait par une épithète : nous nous trouvions en pleine littérature héroïque.
Ainsi parla Robert Denoël. L'accent étant un peu péremptoire à mon gré, je restai sur mes positions, et même je les durcis. J'avais tort.
Lorsque le paquet de bonnes feuilles se fut transformé en gros volume, sur lequel je me jetai, comme bien on pense, poussé par un malaise de conscience qui ne m'avait pas quitté depuis mon séjour à Paris, je vis s'ouvrir le double fond sous lequel se dissimule la déchirante humanité du Voyage au bout de la nuit. Et je compris que le pitre génial dont la parade m'avait désopilé la rate recelait, en effet, un « héros » ; l'un des plus intrépides briseurs de conventions qui aient surgi en France depuis Baudelaire. Et le plus habile ; et le plus libre, à la fois. [...]
Robert Denoël avait raison de reconnaître dans le premier livre de Céline l'un des signes qui ont toujours précédé les grands désastres. [...]
Dans un coin de la grotte Denoël - il y a vingt ans de ça, - j'aperçus donc un grand diable au visage fermé, à la lippe méprisante, accoutré comme un bistrot en vacances. C'était le docteur Louis Destouches, lauréat de la Faculté de Paris, ancien conseiller médical de la Société des Nations, chef de service au dispensaire municipal de Clichy, et romancier célèbre, sous le nom de sa mère ; pseudonyme qu'il avait pris pour que « ça ne se sût pas ». Un homme de l'art ne peut être en même temps littérateur ; cette conjonction fait mauvais effet dans la clientèle. Ça s'était su quand même ; et de là l'humeur massacrante du grand diable. On ne lui fichait plus la paix ; on lui cherchait des misères. Et les chers confrères de l'endroit, qui déjà le tenaient en suspicion, en tant que communiste présumé, ne le prenaient plus au sérieux en tant que praticien. Je n'échangeai pas avec lui plus de quatre phrases. Notre bon éditeur commun m'entraînait d'un autre côté. Par principe, il montait la garde autour de sa trouvaille, sans s'émouvoir des sarcasmes pittoresques dont elle l'abreuvait.
Dans les couloirs de l'immeuble furetait le souriant Bernard Steele, associé de Robert Denoël et Juif américain, de goûts difficiles, entre Lautréamont et Lucien Létinois. Plus tard, les deux hommes devaient se séparer à cause de L'Ecole des cadavres. Steele avait des goûts larges, mais quand même l'antisémitisme inconditionnel et fulminant de Louis-Ferdinand deuxième manière l'indisposerait. En attendant, il se frottait les mains en pensant à l'effet que le Voyage, convenablement traduit, ne manquerait pas de produire à Greenwich-Village. Dans l'entrée, les emballeurs avaient une mine étonnée et des mains usées par la ficelle. Pour la première fois - sauf lors de la publication d'Hôtel du Nord, mais ça ne se comparait pas - les affaires marchaient.
[Poulet restitue ensuite les paroles de Céline concernant la publication de Voyage :] Mon éditeur - vous l'avez connu : « Mais oui, mon cher, comptez sur moi, mon cher ! » - petite imitation de Denoël à ses moments majestueux - m'avait promis le secret, au sujet de mon identité véritable. Tout mon plan reposait là-dessus. Que se passa-t-il alors ? Est-ce que le sacré bavard ne sut pas, ou ne voulut pas, tenir sa langue ?... Quoi qu'il en soit, un hebdomadaire d'échos, Cyrano, vendit la mèche. Je vis se ruer chez moi une cohue de journalistes aux questions agressives. Catastrophe !...[...] Depuis que le succès commercial s'était déclaré, Denoël me versait environ 250 000 francs par an, rente qui cessa brusquement en 1935. Il n'a pas coulé longtemps pour moi, le Pactole !
[A propos de Mort à crédit :] Denoël, les trois petits points ne lui plurent guère. Effrayé, qu'il était. Réprobateur. Nous quittions la bonne tradition, nous répudiions toute forme : ça ne se rattachait plus à rien... Ah, cette fois, mon éditeur ne répondait plus du succès ! Il se devait de dégager sa responsabilité. De tirer son épingle du jeu...
« Cher Céline, commençait-il, je crains que vous ne vous soyez fourvoyé... Voyons, même pour un homme comme vous, il y a des limites, une mesure à garder ! »
Les traits sévères, le regard perplexe, une angoisse (mais très digne) dans la voix. Brave Denoël, va !... « Mon bon ami, je vous mets en garde. » Et puis il y avait autre chose. Ces passages trop osés, vraiment trop osés ! Evidemment, l'art a bien des droits, mais quand même !... « Il ne faudrait pas qu'on nous taxât de pornographie... Nous avons acquis des sympathies précieuses. Ne nous les aliénons pas. » Avec le texte intégral du roman, c'était bien simple : nous allions tout droit aux poursuites pour outrage aux bonnes mœurs. Nous avions manqué le prix Goncourt. Nous ne raterions pas la correctionnelle... Bon, bref, il y eut des coupures... Des blancs, plutôt ; on laissa dans le livre quelques places vides, à la place des mots affreux que j'avais écrits, et qu'on supprimait par élémentaire bienséance. Malin, Denoël prétendait - comme je me rebiffais : toujours la même façon d'altérer la vérité, en en cachant tel ou tel aspect - que déjà mon premier volume avait failli lui attirer les foudres de la Justice. Il s'en était fallu d'un rien ; même, les Sceaux avaient demandé un rapport sur ma personne, ma biographie avait été examinée au microscope, avant qu'on ne décidât de ne pas me traîner au banc d'infamie. Je ne savais pas s'il fallait me mettre en colère, à l'occasion d'un tel épisode, ou me marrer un bon coup. Monsieur l'éditeur n'en démordait pas ; c'était à prendre ou à laisser. De guerre lasse, je capitulai. Je me soumis à la censure.
[...] Le succès de vente fut moindre que pour le Voyage. Néanmoins, on atteignit des chiffres assez impressionnants. Denoël avait beau faire ses calculs de la façon la plus ingénieuse - il y a toujours avec les éditeurs des éléments de déduction, dont l'auteur dans son étourderie n'a pas tenu compte : 10 pour 100 par-ci, 30 pour 1 000 par-là, et les exemplaires « de passe » ; qu'est-ce que ça veut dire, passe ?... passe et manque, comme dans les casinos - il me revenait malgré tout pas mal de pécune. [...] Me fiant très peu aux gouvernants et à leur monnaie, je convertis en or les chèques denoéliens, droits d'auteur pour l'édition française de mes deux livres et ma part des droits de traduction. Là aussi il y aurait beaucoup à dire, sur le profit qu'un écrivain tire de ses œuvres traduites. Mais passons.
[A propos de L'Eglise :] A présent, la S.D.N. n'intéresse plus personne. La pièce non plus... A peine finie, elle fut d'ailleurs enfouie au fond d'un tiroir. Plus tard Denoël, qui tournait autour de moi, cherchant à presser le citron tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, eut vent de l'objet. Il me le tira des mains, en disant des phrases, en faisant des gestes ; plus dégagé et persuasif que jamais. Dans ces cas-là, les regards qui jaillissaient de ses lunettes se concentraient effroyablement sur les gens, les fondaient à vue d'œil : le soleil sur une motte de beurre... A un moment donné, c'était fait ; j'avais dit oui ; mais je n'étais pas tout à fait fondu... Le bouquin parut. Effet nul !...
*
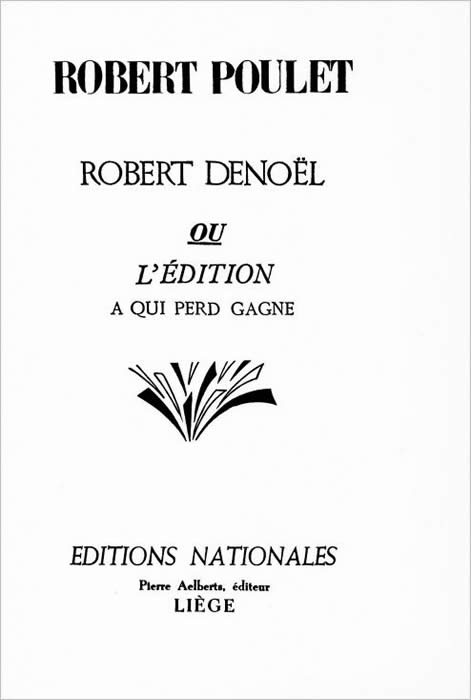
La fourberie luisait dans un de ses yeux et l'enthousiasme dans l'autre. De fait, un fervent et un tricheur à la fois. La conjonction des deux signes était peut-être nécessaire pour que l'entreprise Denoël réussît. En changeant de nature, et même en passant d'un extrême à l'autre, puisqu'une maison qui se voulait indépendante tombait dans les mains de ceux-là mêmes dont elle prétendait s'affranchir.
Tout est parti des rêves d'un étudiant liégeois dont la première qualité se nommait la force persuasive. Il aimait la littérature et les littérateurs ; il n'aurait pas été fâché de figurer parmi ces derniers. A cette époque il écrivait des contes tour à tour cyniques et larmoyants, entre Georges Duhamel et Charles-Henry Hirsch ; des contes pas très originaux, pas très intéressants. Avant même de sortir du marécage des petites revues il avait compris qu'il n'arriverait pas à grand-chose dans cette direction, que mieux valait prendre un chemin latéral, qui ne pourrait être choisi qu'à partir du carrefour des lettres, c'est-à-dire de Paris.
Muni d'un vague diplôme, le jouvenceau quitta père et mère - entourés d'une nombreuse famille - et se lança dans le maquis parisien, où il se distingua tout de suite par ce qu'on pourrait appeler un excès d'entregent.
Son adaptation au milieu - le Sixième Arrondissement, les parlotes de café, les combinaisons qui s'échafaudent lundi et s'effondrent mercredi - eut l'aspect d'un roman picaresque. Tout allait bien, tout allait mal ; on se faisait des amis, dont la moitié étaient des tapeurs et des créanciers, tandis que les ébauches d'édition auxquelles se livrait le Wallon vite débarrassé de son accent ne s'élevaient guère au-dessus du travail d'amateur ; l'alibi social d'un fils-à-papa (que Robert Denoël n'était pas). Et ses futurs confrères, quand ils parlaient de lui, disaient en souriant : « Oui, c'est un garçon charmant. Il paie assez régulièrement ses notes d'imprimeur. »
Il s'en fallut de peu, à deux ou trois reprises, que l'éditeur au petit pied eût des ennuis judiciaires. Il échappait à tout par une suite de chances et de ruses, enveloppées d'une frénésie verbale très habilement dosée. L'aventurier, sans cesse sur le point de gagner la partie ou de sauter, gardait ses dons majeurs, inspirant la sympathie et la méfiance, désarmant les gens par sa franchise et les inquiétant par je ne sais quoi qu'exprimait bizarrement cette extrême ouverture, le cœur sur la main, l'exposé complet et loyal de la situation, une sincérité non discutable, qui se fondait sur le sentiment général, le but à atteindre, en relation avec la noblesse des œuvres de l'esprit, mais qui ne se fondait pas sur des faits et sur des chiffres. Car tout, dans les plans du Rastignac liégeois, était truqué.
Pas escroc du tout. N'aurait pas volé un centime à qui que ce fût. Simplement il se regardait comme un serviteur précieux de la chose littéraire et en déduisait que de sordides considérations moralistes ou législatives ne devaient pas embarrasser son zèle ni en offusquer l'inspiration.
La grande chance de sa vie fut un manuscrit impubliable, qu'il publia - sans peut-être s'apercevoir que c' était l'un des deux ou trois événements artistiques et littéraires du vingtième siècle.
Tout de suite Louis-Ferdinand Céline le détesta. Mais l'affaire était engagée. Elle eut pour conséquence que Robert Denoël perdit son associé, riche juif américain, quand l'auteur du Voyage au bout de la nuit se lança dans une suite de pamphlets qui ne pouvaient être qu'antisémites. Là-dessus coula l'espèce de raz-de-marée que fut la gloire célinienne, avec son reflux inévitable, qui laissa sur la langue française et sur l'histoire littéraire de la France un amas de débris informes.
La guerre en avait accru l'épaisseur, en obligeant aussi la plupart des intellectuels, et donc des serviteurs de l'intelligence, à prendre ce qu'on appelle des positions. Celle de Robert Denoël fut habile comme lui, ambiguë comme son esprit, malheureuse au fond comme sa destinée. Ayant donné des gages aux deux camps, équilibré Céline par Aragon, et tout le reste à l'avenant, en distribuant à la ronde les « Vous avez raison » et les « qui peut voir clair dans ce chaos ? » il pensait sortir indemne des pièges à naïfs de l'épuration. Les événements inclinaient dans ce sens, et l'éditeur s'apprêtait à tourner la page, affublé d'un blâme anodin, que tout le monde aurait oublié l'année suivante, quand un assassin sortit de la foule et le foudroya.
D'où venait le coup ? Toutes les suppositions étaient vraisemblables. Plutôt du côté sentimental que du côté politique. Comme par hasard, le démon de midi - de deux heures de relevée, ce n'est plus tout à fait le même - venait de bouleverser la vie familiale du rénovateur de l'édition parisienne On ne sait pourquoi ni comment, soudain son œuvre ne lui appartenait plus.
Lui mort, elle passa, non sans profit, dans les griffes du seul rival qu'il eût furieusement et continuellement haï. Sur la tombe du « petit Belge » malicieux en le sachant et candide sans le savoir s'accordèrent la femme qu'il aimait et l'homme qu'il ne pouvait pas voir en peinture. Le dénouement mystérieux et tragique de l'expédition partie du boulevard de la Sauvenière, pour s'épanouir brillamment rue Amélie, se prolongea par un commerce tranquille, banal et solide, où il ne restait rien de l'esprit audacieux qui l'avait conçu. Rien, sauf le nom.
Et le fantôme d'un garçon charmant, inventif, pas très sûr, patron sans merci, quoique innocemment aimable, toujours hanté par une échéance, qu'il éviterait d'une pirouette de torero ; silhouette bien parisienne derrière laquelle on retrouvait l'étudiant chimérique qui venait lire à ses amis liégeois des histoires de midinettes abandonnées.
Quoi qu'on puisse dire de ce spectre, abattu en coulisse par un sicaire, au temps des sicaires, il restera qu'il a laissé une œuvre. La maison, naguère minuscule et poussiéreuse, élève largement et hautement sa façade. Il en sort beaucoup de livres, qui ne sont pas ceux que son fondateur eût choisis. Et les auteurs auxquels il tenait le plus sont partis, happés par l'Ennemi triomphant.
La quantité a remplacé la qualité, sous le regard impersonnel d'Amélie. Mais le tiroir-caisse tinte plus souvent qu'en 1930, et c'est un bruit qui aurait enchanté l'agile Robert. Un éditeur qui aimait l'argent. Mais pas plus que la littérature.
