Textes et interviews
1925
Février
✪ Compte rendu de Les cinq sens, un roman de Joseph Delteil [1894-1978] publié en 1924 chez Bernard Grasset. Paru dans Sélection, 4e année, n° 5, 15 février 1925, aux pages 422-423, et signé Jacques Cormier.
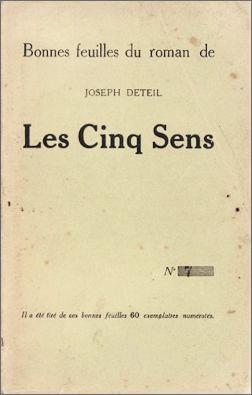
Un magister m'enseigna jadis les rudiments de la science physique. C'est une science plus austère qu'il n'y paraît. Un jour, on me parla des couleurs de la lumière solaire, du prisme. J'appris avec une sorte de stupeur que les sept beautés de l'arc-en-ciel composent le blanc. Le magister voulut me le prouver, car sa science était expérimentale. Il me montra un disque monté sur pivot où étaient disposées les couleurs qu'il appelait « principales ». Il imprima au disque un mouvement rapide. Le disque tournait, les couleurs fondaient. « Regardez, me dit-il, ce disque est devenu blanc ». Or, il s'abusait car le disque mal éclairé était devenu gris...
Ces paraboles sont stupides.
J'en connais d'autres. En classe de chimie on m'apprit ce qu'est une solution : un liquide contenant un corps dissous. Il arrive un moment où le liquide ne dissout plus rien. On dit alors la solution saturée...
Je m'arrête. Pourquoi voulez-vous, Joseph Delteil, être à toute force un auteur comique ? Et pourquoi vos livres où l'on respire tant d'odeurs parfaites, faut-il qu'ils sentent aussi la sueur mâle ? - Pour « plaire aux femmes », vous faites le plaisantin, le journaliste. Oubliez-vous ce but, vous voilà vous-même. De votre plume sautent des associations d'idées, des images « ravissantes », j'entends de celles qui nous arrachent à nous-mêmes et à vos livres. Vos phrases palpitent comme la gorge du pigeon. Elles sont chaudes, grasses, on peut les palper, elles répandent de forts parfums. Votre syntaxe a des seins... Soit.
Mais vous n'êtes pas un auteur essentiellement joyeux. Il me paraît que vous allez au grandiose, au solennel. La plaisanterie n'est pas votre fait. Vous vous y montrez malhabile. Soyez sensuel, - vivent les cinq sens ! - mais avec gravité. Ne riez pas de ces choses, vous riez à faux. Je vous sens destiné à de grands livres, à des sujets épiques. Je me réjouis que vous écriviez une « Jeanne d'Arc ». Ce qu'il y a de moins bon en vous, le comique, pourra s'y donner carrière. Auparavant laissez que retentissent vos autres voix... Vous plairez aux femmes plus longtemps. Je pense à Homère, à la Chanson de Roland, à Bossuet.
Jacques Cormier
Mars
✪ Article signé Jacques Cormier paru dans Liège-Universitaire du 27 mars, où il occupe la page 1, colonne c.
Edgar Scauflaire [1893-1960] avait, comme Auguste Mambour [1896-1968], fait partie de la « Caque », et rejoint en 1923 le groupe « Sélection ». En 1925, Denoël est lié avec cet artiste qui a été chargé de réaliser le portrait de son ami Mélot du Dy pour son recueil de poèmes Amours, et qui a fait le sien en 1923.


Remarquable article dans lequel Denoël place son ami Mambour, si décrié à cette époque, parmi les plus grands peintres belges. Il a reconnu à Scauflaire la meilleure des qualités à ses yeux : l’originalité.
« Edgard Scauflaire »
Parmi toutes les expositions de dessins ou de tableaux que l’on fait à Liège, il est rare qu’il y en ait une qui sorte de la banalité. La plupart des peintres de chez nous s’obstinent dans des conceptions vieillottes, qui n’ont plus aucune raison d’être encore utilisées, puisque leurs inventeurs en ont tiré parti. Aussi est-ce une surprise tout à fait agréable quand dans la foule anonyme de tous ces travailleurs consciencieux on peut distinguer un artiste. C’est ce qui nous est arrivé la semaine dernière au «Journal de Liège» où Edgar Scauflaire exposait de très beaux dessins à côté d’Auguste Mambour. De celui-ci nous ne dirons rien : tous ceux qui ont le goût des beaux-arts savent qu’Auguste Mambour est à l’heure actuelle un des plus grands peintres belges.
Edgar Scauflaire est moins connu mais tenez pour certain que sa réputation aura tôt fait de s’établir. Il n’y a pas longtemps qu’il expose. Il fit à ma connaissance deux expositions à Liège, une au Cercle des Beaux-Arts, voici plus d’un an, et une autre il y a quelques semaines à «La Meuse». Malgré des recherches de couleur très curieuses et une simplification intéressante il eût été dangereux d’affirmer alors que Scauflaire était parvenu à s’exprimer complètement. Je garde cependant le souvenir très net d’une rose sur fond bleu, une merveille de robustesse et de solidité. Je n’ai pas oublié non plus des reines-marguerites, des fuschias [sic] et deux compositions décoratives qui manifestaient une volonté et une sensibilité d’excellente augure...
Aujourd’hui Scauflaire n’expose que des dessins et je ne peux pas m’empêcher de le répéter : ces dessins sont beaux. Ce qu’il y a de remarquable dans l’œuvre de Scauflaire c’est qu’il parvienne avec une sobriété de moyens étonnante à une richesse de résultats qui nous confond. Rien n’est inutile dans ces compositions et l’artiste réussit ce miracle d’allier la force la moins contestable à l’élégance. Tels dessins comme «Adam et Eve» ou le «Nu couché» par exemple, sont construits avec une assurance et une pureté que rien n’émeut. Le décor est absent : seul, le personnage est là sur le fond blanc, mais doué d’une vie qui éclate, qui s’impose.
Tout cela ne serait rien encore, rien, si cette perfection, Scauflaire l’avait empruntée à d’autres. Il est bien évident que son art possède aujourd’hui la qualité essentielle : l’originalité. Scauflaire a dépassé le stade des tâtonnements. Il est lui-même et avec quel bonheur ! Il ne lui reste plus qu’à s’affirmer davantage, avec plus de force encore, de cette manière qui lui appartient en propre qui fait de lui un artiste, qui fait de lui Edgar Scauflaire.
Jacques Cormier
Avril
✪ Compte rendu du Théâtre de Jean-Jacques Bernard [1888-1972] publié en février 1925 chez Albin Michel. Paru dans Sélection, 4e année, n° 7, 15 avril 1925, aux pages 141-142, et signé Jacques Cormier.
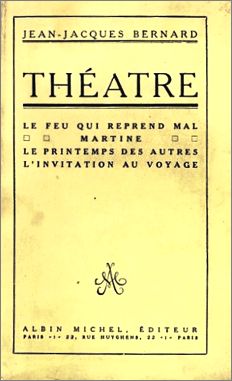
L'habileté comme la maladresse des acteurs, les hasards de la mise en scène, la température, le confort relatif d'un fauteuil d'orchestre, le souvenir même des autres spectateurs accablent notre cerveau quand, avec fatigue et banalité, nous tâchons à apprécier la pièce de théâtre qui vient de se jouer. Mieux vaut d'attendre... Elles sont rares les œuvres dramatiques d'hier et d'aujourd'hui dont la lecture nous évite la nausée ou l'ennui, à tel point que nous sommes portés au respect de celles qui nous ont laissés indifférents.
La qualité essentielle du théâtre de M. Jean-Jacques Bernard , qualité qui frappe au premier contact et qui ne se dément pas, semble être la mesure, je dirais plutôt la décence. Elle se manifeste autant dans la construction et l'agencement des scènes, que dans le décor, la langue, l'accent. Dans ces quatre drames on crie peu, on ne vole jamais, le désespoir, pour s'exprimer, n'utilise pas le revolver. L'auteur a relégué au magasin d'accessoires les plaintes déchirantes, les lettres fatales, la cocaïne, les agonies, les longues et coupables étreintes. Même discrétion dans le choix du sujet. L'action se déroule en quelques mois ou en quelques années à l'intérieur d'un personnage, d'un seul. Celui-ci lutte bien plus contre lui-même que contre son entouage : il ignore la cause de son malaise moral, il ne la soupçonne pas jusqu'au moment où une révélation extérieure lui apprend l'étendue de sa défaite. Il vit d'ailleurs dans un monde d'aveugles, car personne autour de lui n'a perçu ce que le spectateur d'intelligence moyenne a compris dès les premières scènes. Le malheur est que, cet aveuglement, M. Jean-Jacques Bernard ne nous le fasse pas admettre. Il a mis tous ses soins à la construction de son personnage principal ; les autres sont négligés, la convention reprend ses droits. L'intérêt dramatique, dès lors, ne consiste plus que dans l'évolution d'une crise dont nous pouvons trop aisément concevoir le terme. Nous n'avons aucune inquiétude. La solution nous sera donnée au dernier acte ; avec un peu d'application, nous la devinerons, mais la médiocrité d'un tel plaisir nous irrite. Le spectateur devrait partager l'ignorance des personnages secondaires et voir en même temps qu'eux l'action l'action se dénouer, comme dans le théâtre de Pirandello, par exemple ; ou bien, malgré les données supplémentaires qu'on lui accorde, se sentir incapable de résoudre seul un problème trop complexe. M. Jean-Jacques Bernard répugne à la complexité. Il éclaire de la façon la plus franche un aspect de son sujet : cette étude nous touche par sa minutie et surtout par son souci de vérité. Pourquoi n'agrandit-elle pas son domaine ? Pourquoi manque d'audace ?
Il n'en reste pas moins que par leur sobriété de moyens, leur pureté, leur ardeur trop contenue, ces pièces nous offrent l'expression la plus réussie des possibilités d'un théâtre soumis aux anciens canons.
Jacques Cormier
✪ Compte rendu signé Robert Marin paru dans le numéro 3 du Disque Vert où il occupe les pages 88-89. Le livre de Mac Orlan est paru en 1925 chez Simon Kra, aux Editions du Sagittaire.
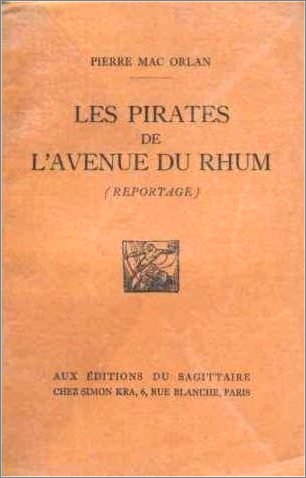
« Pierre Mac Orlan : Les Pirates de l’Avenue du Rhum (chez Kra) »
Plus qu'à d'autres, on pardonne aux auteurs de « reportages » les négligences ou les pauvretés d'écriture. L'intérêt de leur œuvre tient tout entier dans le mouvement qu'ils ont su lui conférer. On n'est pas loin d'exiger une certaine trépidation, comme une sorte de halètement dans la composition ; nous voulons vivre le livre aussi vite que nous le lisons, aussi ne faut-il pas qu'il soit trop riche. La réalité serre l'auteur de près : si son imagination tente de s'échapper, qu'il la contienne. Une autre muse se présente qu'il servira fidèlement...
On comprend dès lors que le choix du sujet - peut-être indifférent en poésie - ait ici son importance, qu'il vaille mieux, par exemple, relater le trafic clandestin de l'alcool dans les eaux new-yorkaises que la fabrication des rails de chemin de fer.
M. Mac Orlan a trouvé un beau titre, une sujet fertile, des anecdotes agréables. Son reportage est construit d'une manière robuste. Pourquoi de si maigres chairs recouvrent-elles son armature? « Les Pirates de l'Avenue du Rhum » nous sont annoncés comme les fils de ces poétiques gentilshommes de fortune qu'illustrèrent les chroniques du Capitaine Johnson. Nous les voyons, nous les reconnaissons à peine. C'est l'histoire de l'affiche et du spectacle.
La poésie de la mer, M. Mac Orlan n'en parlait presque pas dans « Le Chant de l’Equipage » ou dans « A bord de l’Etoile Matutine ». Nous en étions tout imprégnés.
Robert Marin
Juin
✪ Nouvelle signée Robert Marin parue dans le n° 3 du Disque Vert où elle occupe les pages 25-36.
« Une forte tête »
... Un jour, cependant, elle voulut bien obéir au plan que j'avais tracé en esprit. Il pleuvait, une pluie insinuante, qui se glissait dans le poil des fourrures, dans les interstices des pavés, dans les poches des pardessus, promenant ses doigts tièdes sur les visages, dégoulinant avec lenteur le long des vitres et des parapluies, comme fatiguée et honteuse du rôle ingrat qui lui avait été imposé. Nous ne savions que faire. Après quelques pas désagréables et quelques paroles de fausse allégresse, nous décidâmes de nous rendre au cinéma. Diane aimait ce genre d'endroits parce qu'elle y goûtait, dans l'ombre, une dangereuse impression de solitude bien qu'elle ne pût douter un instant de sa sécurité grâce à l'anonyme présence de ses voisins, des ouvreuses et du garde municipal. Nous entrâmes dans une loge déserte. De l'écran, un banquier nous jeta un regard terne et, comme s'il n'avait attendu que notre arrivée pour s'y décider, se tira un coup de revolver dans la bouche. L'issue d'un geste aussi excessif était à prévoir : au moment que j'appuyais le bras au dossier de la chaise de Diane, tout en allongeant les jambes dans l'espoir d'un bien-être utopique, une jeune femme fermait les yeux au faussaire. Sans être ému, je me penchai vers la salle : je vis de haut les musiciens de l'orchestre s'appliquer, sous des abat-jour verts. Du chef, dont l'obscurité coupait la tête et le cou, on ne distinguait que le torse noir et le bras droit prolongé d'une baguette. Ce torse, ce bras et cette baguette s'agitaient d'une manière insolente mais insuffisamment vigoureuse pour dompter le grignotement qui s'échappait de la cabine de l'opérateur en même temps que les images financières et mondaines d'un film conçu sans doute par quelque trappeur dans les solitudes du Texas ou de l'Ohio.
Diane s'intéressait à ces péripéties.
Quant à moi, j'éprouvais un malaise vague et répandu par tout le corps, qui, pour me rendre momentanément hostile aux bureaux à cylindres, aux coffres-forts gothiques, aux messieurs en manches de chemise, aux gratte-ciel, au sourire vierge des dactylographes et aux autres manifestations du génie américain, ne parvenait pas à me faire négliger la pression douloureuse de mes fixe-chaussettes, le poids moite de mes vêtements, ni les prodromes de la congestion que me promettait une cravate trop bien nouée. Dès que je me surpris enclin à la tristesse, je tâchai, afin de me pénétrer de ce sentiment tonique, à me libérer de la musique de Saint-Saëns, de ma gaieté naturelle et des baisers ponctués d'extases qui remplissaient la loge voisine de la nôtre. Mes pensées erraient dans des directions variées sans souci de ma volonté. Le plus convenable me parut, pour éviter cette dispersion, d'imposer à mon esprit un sujet de méditation amer et qui réclamerait l'emploi de toutes mes forces. La mort s'offrit. Je l'écartai comme futile. Naturellement, je m'arrêtai à la vertu inattaquable de Diane : un à un et comme à regret, les efforts que j'avais tentés pour la vaincre défilèrent dans ma mémoire et chacun me précisait un désolant spectacle de défaite. D'une patience vieille de trois mois, de nos promenades au soleil, de mes lettres exaltées, d'une volonté continue et violente, de toutes mes peines, il ne demeurait rien, si ce n'est comme une cendre poussiéreuse et froide, le sentiment de leur vanité. Ah! si l'amie que je voyais chaque mercredi à trois heures et dont les yeux s'illuminaient et m'imposaient leur éclat quand je parlais de choses belles, si la Diane complexe et que je cherchais en vain à connaître, avait ressemblé à celle que, de prime abord, je m'étais imaginée, elle eût été depuis longtemps ma maîtresse, depuis longtemps la lassitude me l'eût fait abandonner. Non, quoi qu'en imaginât Perrin-Varot, mon amie ne pratiquait pas la course au mariage. Elle ne cherchait pas non plus un amant vulgaire. Ses bras, ses genoux ne s'ouvriraient que pour un bonheur salubre. Les rires d'énervement, les prunelles trempées d'une envie soudaine, les chambres d'hôtel et leur hygiène glaciale, les jupons efflanqués qui pendent à un pied de lit, les seins fatigués, les lèvres molles qu'il faut repeindre, tout l'appareil des étreintes commerciales ou passagères habitait des contrées si lointaines, si perdues qu'elle en ignorait jusqu'à l'existence. Dénuée d'instincts bourgeois, certes, elle l'était, mais non au point exagéré de vouloir la mort d'une mère fastidieuse et chérie, non plus que d'écouter des déclarations d'amour. La couleur de son teint, son aversion de la musique russe me conseillaient aussi la réserve et sa passion pour les bêtes de tout calibre et cette chaînette d'or surannée qu'elle portait au poignet. Plus que cela, son regard me gênait, un regard bleu, sûr et grave, comme d'une enfant, regard qui ignorait tout, qui découvrait l'univers à chaque seconde de sa vie, regard délicieusement affecté de la beauté des arbres, des pierres, des reflets du soleil. Ce regard s'avançait vers moi « nu et sans armes ». Comment ne me serais-je pas senti ridicule avec mon arsenal de glaives perfectionnés et de revolvers à répétition ? Il me fallait remiser ce bagage saugrenu, entretenir mon amie des derniers événements de la semaine, railler doucement les conférenciers de l'Université des Annales ou confire mon admiration dans un silence sucré et irritant. Ma vanité blessée se plaignait... Diane se promenait ou était assise à côte de moi ; je touchais parfois l'étoffe de son manteau ; sa chaleur rencontrait la mienne, son parfum m'effleurait - et ce voisinage demeurait stérile. Mais à quoi bon connaître les règles d'un jeu si la partenaire en adopte d'autres au cours de la partie ?
Ces réflexions me remplirent de mélancolie. Je tournai la tête vers mon amie. Elle avait enlevé ses gants : une de ses mains reposait au creux doux de sa jupe, l'autre pendait vacante le long de la chaise. Son visage mouillé d'ombre me sembla lointain, son cou légèrement incliné vers la salle, dans une attitude immobile, la faisait tellement étrangère à mes préoccupations, qu'un désespoir lourd pesa soudain à mes épaules. Sentit-elle cette détresse ? Sans me regarder, elle éleva la main et lentement, avec une tendresse puérile, me caressa la joue. Ma peau crissa. Ce bruit vulgaire, en me rappelant l'ennui d'une barbe vivace, m'interdit de m'abandonner à la minuscule volupté que m'apportait mon amie. La main se retira. Je n'avais pas dit un mot ni fait un mouvement de reconnaissance. Ce n'est pas que je ne sache parler aux femmes, leur conter des niaiseries d'un ton grave, me montrer langoureux, sommaire ou canaille, selon que leur sensualité le commande : j'ai du savoir-vivre. Mais ici un acte était nécessaire et non des mots.
Sur la tablette de la loge, près de sa sacoche, Diane avait déposé une rose-thé dont je voyais, à travers la nuit, discrètement luire la masse charnue. Cette rose est perdue, encore un peu et ses pétales, battant faiblement de l'aile, tomberont sur le sol, dans la boue. Elle allait mourir et si belle que son sort était digne des vers de plusieurs poètes. Cette pensée ne m'eut pas plutôt traversé que le désir me saisit de pousser des cris, de bondir, de taper de grands coups de poing dans la cloison et de hurler des « Eurêka » triomphants. Subitement, comme l'inventeur découvre le détail qui, d'un plan longuement mûri mais informe, va produire une vivante merveille, j'avais aperçu l'importance que prendrait aux yeux de Diane le témoignage concret de mon affliction. « Il faudrait pleurer ici », me suis-je dit. Que le Ciel ne m'a-t-il fait don, comme aux femmes, des pleurs automatiques ! Je repousse cette idée. Elle me rebondit au visage comme une balle de caoutchouc. Je ne peux m'en départir. L'urgence du geste s'affirme. Je me représente versant des larmes brûlantes auprès d'une Diane bouleversée. Je la vois me couvrir de baisers et de consolations. Elle répond affirmativement à mon désir : je peux enfin respirer, je retrouve mon équilibre.
Cette vision anticipée s'éclaira violemment : je n'y distinguais que des bénéfices et d'un relief si plein que je crus un moment à leur réalité. L'hallucination se dissipa ; à sa lumière, le but à atteindre m'était apparu plus attrayant, plus beau. La fièvre me harcelait les tempes, mais cette fièvre qui aiguise l'esprit si elle précipite le mouvement.
Les titres de deux chapitres d'un livre de physiologie que j'avais commencé à étudier ce mois-là, et qui m'intéressait fort, se heurtèrent soudain dans mon cerveau. Je revoyais les pages où ils étaient imprimés, les caractères gras qui les composaient, la place qu'ils occupaient dans l'économie de l'ouvrage et je ne démêlais pas le motif pour lequel je pensais à eux dans un tel instant. Je m'interrogeais. Je répétais ces mots sans relâche, convaincu que leur présence n'était pas inutile. « Oui, me disais-je, l'excitation mécanique, l'excitation naturelle, c'est parfait, et ensuite ? » Le mystère ne s'éclaircissait pas. De guerre lasse, j'abandonnai cette bizarre suggestion et je me remis à réfléchir aux larmes qu'il eût été si opportun de verser, quand surgit dans ma mémoire un troisième terme scientifique : glande lacrymale.
Le contact s'établit. La lumière parut sous la forme de cette phrase : « L'excitation de la glande lacrymale produit la sécrétion d'un liquide aqueux appelé larme. » J'étais au comble de l'énervement. Je ressentais l'émotion haletante du coureur qui va franchir la ligne d'arrivée. Les mains tremblantes, presque délirant, je saisis ma paupière droite entre le pouce et l'index : d'un coup brutal, je la retournai. La réaction prévue s'accomplit. Une grosse larme coulait le long de ma joue tandis que par sympathie mon autre œil s'humectait. Je me penchai légèrement et le fruit mûr de mon labeur vint s'écraser sur le cou de Diane.
De surprise, elle frémit. Puis elle me regarda, crut comprendre ma douleur et d'un geste miséricordieux, d'un geste instinctif, souverain, maternel, m'attira contre sa poitrine. Son cœur bourdonnait, son sein palpitait, son corps était tout agité. Elle me pressa nerveusement et je sentis ses lèvres toucher mes cheveux. Je serais demeuré ainsi longtemps, une moitié de l'oreille incrustée dans sa chair, l'autre blessée par la broche de sa robe, respirant avec elle d'un souffle convulsif. Je m'arrachai pourtant à cette douceur et, comme honteux de ma faiblesse, je rejetai la tête en arrière avec la volonté indiquée de me maîtriser. Un tel spectacle remua Diane profondément. Elle ne pensa pas à en être fière ; elle souffrait. Ses paupières se fermèrent. Elle se voila le visage de ses mains. Elle aurait voulu s'embourber dans un sommeil épais, elle aurait voulu mourir. Pourquoi cette lourde seconde a-t-elle existé ? Ah ! fuir, disparaître, se voir anéantie ! Et ses yeux pleurent ; elle sanglote ; recrue d'amertume, elle se désespère.
Je pris ses mains dans les miennes. Elle luttait contre ses larmes, la fière fille. Toute son énergie travaillait à dominer le mesquin tumulte.
Mais elle le repousse, elle le dompte. Cette chair secouée s'apaise. Sa respiration retrouve un rythme plus lent, se régularise dans une amplitude coutumière. Le calme s'étend. Un petit sanglot crève encore - et plus rien. Pas un mot.
La lumière se fit brusquement. On entendit quelques soupirs, le bruit mou des fauteuils qui se rabattaient contre leur dossier. Une femme toussa. Traînant les pieds, des gens sortirent de la salle. Machinalement, nous avions reculé nos chaises vers le fond de la loge. L'espace qui nous séparait s'était élargi.
Je cherchais un mot à dire mais, plutôt que de prononcer une phrase banale, je gardais le silence. Je n'osais regarder Diane. Je me décidai à la fin, quand les lampes s'éteignirent : j'avais vu des joues blessées, des yeux gonflés, un visage nouveau, sinistre comme une ruine récente.
Les suites de mon geste ne laissaient pas de m'inquiéter. Loin d'en avoir obtenu de la joie, je me sentais au contraire plus malheureux. Nulle impression de triomphe. L'effet avait-il été assez violent ou n'avais-je pas plutôt dépassé la mesure ? Mon malaise ne faisait qu'augmenter. Très indécis, je me rapprochai de mon amie et l'entourant de mon bras je lui fis à l'oreille cet aveu :
- Diane, je n'avais plus pleuré depuis la mort de ma grand-mère.
Elle tressaillit ; stupides de douleur, ses yeux fixèrent la toile sans y rien voir qu'un monde indistinct, qu'un monde de rêve. Je l'examinais. Je l'imaginais découvrant peu à peu son amour. Je lisais sur son visage les progrès de cette découverte et je n'en éprouvais aucune sorte de bonheur.
La curiosité l'avait menée à nos premiers rendez-vous, puis la sympathie. Elle n'y était venue que pour échapper quelques heures à la fade atmosphère de sa vie familiale. Les après-midi que nous passions ensemble, elle les considérait d'un œil amusé comme un plaisir plus piquant que celui qu'elle aurait pu trouver dans la compagnie de ses amies. Elle pensait à moi souvent, mais sans trouble. Elle m'estimait gentil, divertissant, nullement dangereux. Mais, si elle avait souri du ton enthousiaste de mes lettres, elle s'était reproché vivement de m'avoir donné sa bouche dans la forêt. Elle n'avait pu se dissimuler l'émotion extraordinaire de ce premier baiser. Elle l'avait crue uniquement sensuelle et s'était jugée coupable, car elle avait décrété en esprit que jamais nos entrevues ne revêtiraient le caractère d'un flirt.
Moi-même, d'ailleurs, ne la fréquentais-je pas pour un motif anodin, pour la douceur de me promener avec une jolie jeune fille dont les goûts ressemblaient aux miens?
Diane, ou je m'abusais, ne pouvait faire de réflexions autres que celles-là. Je m'y livrais avec elle. N'étaient-elles pas logiques, inéluctables?...
Comme le film évoquait une scène patriotique, l'orchestre, afin de donner plus de portée à l'action, se mit à jouer le Chant du Départ. Je fus un instant distrait. Mon amie, demeurée insensible aux événements extérieurs, poursuivait le cours douloureux de sa méditation. Elle apercevait quelle comédie elle s'était donnée à elle-même. Mon amour était aussi évident que le sien. Elle ne pouvait plus feindre d'ignorer l'un et l'autre. Le remords d'avoir causé ma souffrance, cette souffrance dont je pleurais, ne l'avertissait-il pas de ce que je représentais à ses yeux? C'était une grille placée sur le texte secret de son âme qui la forçait tout à coup d'en comprendre le sens.
Au lieu que cette révélation d'un amour partagé l'inclinât à la joie, elle lui apportait, comme à moi, une menace obscure. Nous nous sentions oppressés sous le poids d'un malheur proche et inconnu. Rien pourtant ne devait nous séparer. Diane écarta l'image de de sa mère, l'image conventionnelle du déshonneur, elle renversa tout ce qui l'éloignait de moi. Ce sacrifice ne la conduisit pas au repos.
De temps en temps, nous jetions un coup d'œil à l'écran pour nous raccrocher à quelque chose de moins affreux. A peine échappés, nous retombions dans une tristesse pesante. Nous nous vîmes perdus dans un désert et incapables de nous suffire à nous-mêmes. Nous ne parlions pas. Qu'eussions-nous dit ? Les minutes s'écoulaient lentement. Enfin l'heure passa. Je fus comme soulagé lorsque la fin du spectacle nous fournit un motif plausible de départ.
Les cris de marchands de journaux, l'éclat des lampes à arc, le bruit des autobus, le coudoiement de la foule ne purent nous tirer de notre torpeur. Comme il n'était pas prudent pour Diane de se promener avec moi en public, nous gagnâmes des rues moins peuplées. La pluie se remit à tomber, plus froide. Les réverbères bavaient une lueur visqueuse. Par endroits, la devanture d'un marchand de vin ou la vitrine d'une boutique découpait sur le sol un trapèze de clarté, immobile et blanc. Deux ouvriers se hâtaient devant nous, discutant à haute voix. Nous avancions muets, tête basse. Diane toucha ma main par mégarde. Je me retournai ; la rue était déserte ; personne ne pouvait nous voir. J'embrassai mon amie sauvagement, je la serrai dans mes bras avec une brutalité désespérée comme si cette étreinte devait la distraire de son tourment. Je comprenais si bien la violence et l'étendue du mal qui la torturait que je me repentis de l'avoir causé. Un immense besoin de rémission m'envahit. J'allais m'élancer, crier mon abjection à Diane, j'allais lui dire : « Diane, ne pleure pas... ne pleure plus... Ce n'est pas vrai... c'est une ruse... mais je t'aime... je t'aime... » Heureusement, un taxis corna à nos oreilles. Nous dûmes nous garer : j'eus le temps de me ressaisir. Je tremblai à l'idée qu'un scrupule niais eût put me faire perdre le prix de mon effort. Diane, indignée, ne m'aurait pas pardonné. Elle serait partie ; je ne l'aurais plus revue.
Nous passâmes les ponts. Un remorqueur hurla sur la Seine. Quelques minutes encore, et il allait falloir nous séparer. Je voulais cependant obtenir un réconfort, un espoir, une certitude...
- Alors, Diane...
Elle ne répondit pas mais de nouveau sa main pressa la mienne.
- Alors, Diane, nous ne nous reverrons plus?
- Oh non, pas cela, Jean... pas cela...
- Mais quoi...
Nous arrivâmes au coin de la rue d'Assas et de la rue de Rennes, endroit où d'habitude, crainte de rencontres fâcheuses, je quittais mon amie. Après avoir trouvé l'heure si longue, nous ne pouvions nous décider à partir, chacun de notre côté. Nous revînmes sur nos pas et ces dernières minutes nous furent moins amères. Nous reprenions confiance. Je dis à Diane des choses qui la touchèrent. Il fut bientôt temps qu'elle rentrât. Je la priai :
- Tu viendras mercredi?
- Oui...
Elle m'avait répondu d'une voix résignée. Ses yeux me sourirent. Je la vis s'éloigner sous la pluie. Un tramway bruyant me la cacha.
Elle disparut.
Robert Marin
✪ Compte rendu signé Robert Marin paru dans le numéro 3 du Disque Vert où il occupe les pages 57-58. Le livre de Thomas Raucat est paru en 1924 aux Editions de la Nouvelle Revue Française.

« Thomas Raucat : L’Honorable partie de campagne (N.R.F.) »
Il est difficile de distinguer ce qui fait le charme profond d'un livre comme celui-ci, de ses ornements, de ses gentilesses, de ses traits d'esprit, de tout ce qui emporte notre premier consentement. Aussi bien le but de M. Raucat n'apparaît pas clairement. A-t-il voulu railler des coutumes japonaises que nous connaissions et nous amuser en les opposant aux nôtres? Ou bien, n'est-ce pas plutôt qu'il ait cherché, tout en usant d'une ironie un peu sucrée, à nous révéler des mœurs auxquelles malgré les efforts conjugués de Pierre Loti et de M. Claude Farrère nous sommes demeurés étrangers ? Les dernières pages, où M. Raucat change tout à coup le ton de son récit, nous inclinent vers la seconde hypothèse. Mais nous nous demandons si ce procédé de grossissement nous donne une idée exacte de l'objet à représenter. Nous sommes plus à l'aise en prenant « L'honorable partie de campagne » comme une fantaisie dont les données réelles importent peu. Nous louerons alors, comme il convient, sa nouveauté, la sûreté de ses mouvements, son équilibre. L'auteur est si heureux que les petites obscénités dont il a semé son livre, revêtent la grâce anodine des danseuses anglaises. Peu à peu la désinvolture de M. Raucat - elle a dû être longuement étudiée - nous mène dans le voisinage d'un monde fort divertissant. Telle est l'abondance de ses documents et telle l'adresse qu'il emploie à les faire valoir que la vie de ses personnages perd son caractère mécanique et qu'elle s'impose à nous avec son rythme et sa durée. Ces personnages ont des appétits aussi nombreux que les nôtres : seul, diffère l'objet auquel ils s'appliquent. Et ce n'est pas tant cette différence qui nous amuse que de la savoir si mince. M. Raucat débute discrètement mais d'une manière décisive. Son livre est gai, rapide et - ceci dans un récit de voyage est un agrément à considérer - on n'y rencontre pas l'auteur.
Robert Marin
Octobre
✪ Compte rendu signé Robert Marin paru dans la rubrique «Chronique des livres» de Liège-Universitaire du 30 octobre, où il occupe la page 3, col. a-c. Le livre de Joseph Delteil [1894-1978] est paru en 1925 chez Bernard Grasset dans la collection « Les Cahiers verts ».
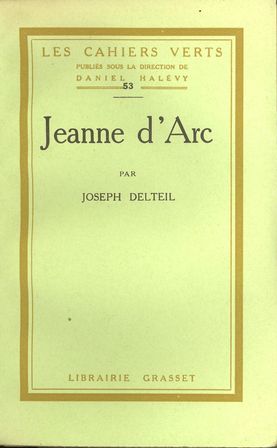
« Jeanne d’Arc par Joseph Delteil »
Joseph Delteil (déjà son nom suffit à le désigner, on ne peut plus l'appeler Monsieur). Joseph Delteil me paraissait, il y a deux ans, une sorte d'ivrogne magnifique. Il avait des idées fixes (il en possède encore) Il braillait et n'épargnait pas les confidences. Il parlait une langue étonnante, avec des mots de toutes les couleurs, une langue bien en chair, nourrie aux images et à la poésie. Comme il disait, sa syntaxe avait des seins. Pourvu d'une sensualité qu'il se gardait de laisser moisir, Delteil faisait des découvertes dans le monde entier (Il faudrait cependant vanter surtout la vertu de son odorat). Avec cela un amour du grandiose et un penchant à la gaudriole. Cela nous a valu des recueils excellents comme «Sur le fleuve Amour» ou «Choléra» : des morceaux ajustés, les bons aux médiocres et la soudure crevait les yeux.
Son dernier livre, «Les cinq sens» m'avait prodigieusement agacé : il contenait un chapitre de premier ordre et une trouvaille par page. Derrière chacune de ces merveilles, j'apercevais le procédé, le plus terrible destructeur de vie, dès qu'il montre le bout de son nez sale.
Or, Delteil veut de la vie : je ne lui reprocherai que de nous le dire si souvent. Encore serait-il bon de préciser. Il n’y manque pas. La vie, c’est tout ce qui est élémentaire, simple, sain ; la spontanéité, le rire, la pensée fortement exprimée, Rabelais, Pascal, et les fleuves, les bestiaux, les routes sous le soleil, les arbres verts. C’est aussi - admirons l’ouverture de son esprit - les rues sordides, les amours des fillettes impubères, les immondices qui grouillent, les aisselles qu’on lave peu, les débauches dégoûtantes.
Tout cela était exprimé, et avec quelle allégresse ! dans des livres sans équilibre où flottait comme une odeur de sexe. Pour discipliner ses élans, leur faire rendre le maximum, il fallait à Delteil un sujet, un grand sujet. «Jeanne d’Arc» s’est présentée et lui a donné l’emploi de ses qualités et de ses défauts : il a créé un personnage si vivant qu’il ne quittera plus nos mémoires (1)
On a beaucoup parlé de l’orthodoxie de ce livre, de l’opportunité des anachronismes dont il est fleuri ; peu de chose a été dit de sa composition. C’est son plus beau mérite. Tous les morceaux, sauf quelques parenthèses du début, déclenchent l’enthousiasme ; ils vivent par eux-mêmes, mais en séparer un, c’est amputer un membre à un beau corps et le déposer tout palpitant sur une table. Ils trouvent dans leur suite une vie plus profonde et plus belle. Le mouvement, provoqué dès les premières pages, grandit, se développe et dénoue sa courbe avec la sérénité d’un fleuve. Je vois là un miracle de l’amour. Delteil a vécu avec Jeanne d’Arc ; ses jeux, ses visions, ses combats, ils les a partagés ; il a souffert sa prison et son martyre.
Quand il a fallu nous les raconter, le ton s’est imposé à lui. J’en donnerai comme exemple un fragment de l’entrée de Jeanne à Orléans : [suit un long extrait du livre].
On voit que le lyrisme de Delteil s’accommode fort bien de la plus belle humeur. D’un bout à l’autre du livre je goûte une émotion et une gaieté pareilles, des images aussi drues et cette allure d’épopée. Les théories et les raisonnements un peu trop nombreux n’entravent point mon admiration. Comment la taire ? Delteil nous a donné une œuvre solide, d’un seul tenant, où passe un frais souffle, l’odeur des champs, le bruit d’un siècle tout bardé de fer et de croix et que domine avec ces yeux de douceur, sa bouche joyeuse où les mots sonnent si rude, sa foi, son corps tendre et sain, la plus belle fille de France et maintenant la plus vivante.
Robert Marin
(1) Que Delteil soit un arriviste, tant mieux, puisqu’il est arrivé ! Je ne regrette que la moustache tartare dont il était orné en 1923 et l’ail dont - assure la légende - il se parfumait lors de ses premières visites à la Nouvelle Revue Française.
Novembre
✪ Nouvelle signée Robert Marin parue dans Liège-Universitaire du 6 novembre, où elle occupe la page 3, colonne a.
« Portrait »
Pas grande, mais tant de droites composent son harmonie, qu’elle paraît longue. Elle lève vers les plafonds, une tête d'où s'échappent des paquets de chanvre : leur fuite est coupée net à la cime du cou. De ses yeux situés l’un contre l’autre, l’orbite s'étire, s'effile et bientôt n'est plus qu`une ride jetée sur la tempe. Le nez métallique, peu de chair dans les joues et sa bouche, elle sera toujours pâle, décidément lui entre dans les narines. Son corps s'insinue dans des robes écarlates ou d'argent, sans qu'il emprunte rien à cet éclat.
Un jour, ses bras sont ronds, le lendemain carrés, dont la fragilité demeure.
Hier, on vit deux seins posés sur ses clavicules ; ils palpitaient, un courant d'air les emporta : Malade, que dit-elle à son image ? Des hommes mûrs la jugent peu honorifique.
Elle danse et tout ce rigide s'attendrit. Portée par la médiocrité des violons, elle va ; ses hanches, doucement s'incurvent ; ses jambes, les plis de sa robe, son allure entière obéit à un même ordre et - dans les cheveux qui ruissellent - voici son visage.
Un sourire l'ouvre comme un éventail peint d’images roses et dorées : ses dents brillent et la flamme mince de ses yeux ; le sang se montre aux joues, fleurit l'oreille, gonfle la lèvre.
La fierté y règne. L'admiration est permise.
Robert Marin
✪ Compte rendu signé Robert Marin paru dans la rubrique « Chronique des livres » de Liège-Universitaire du 6 novembre, où il occupe la page 3, colonne a-e. C’est un éreintement en règle. Hermann Closson est né à Bruxelles le 11 janvier 1901. Le Cavalier seul, publié en 1925 aux Editions du Disque Vert à Bruxelles et chez René Vandenberg à Paris, est son premier roman.
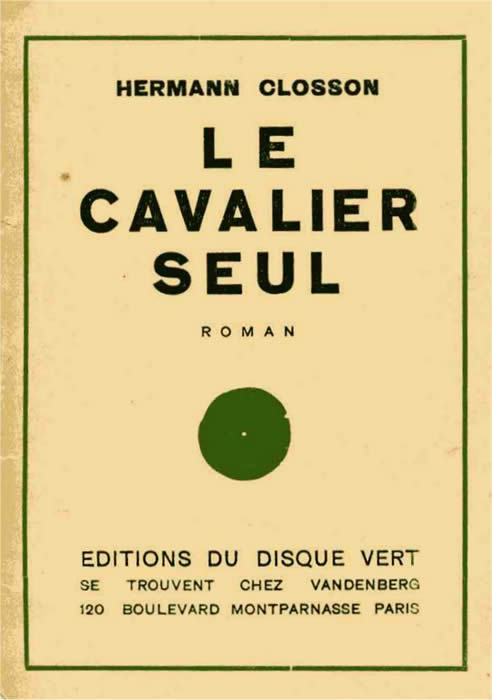
« Le Cavalier seul, par Hermann Closson »
Le cas de M. Closson me parait comparable, mais de loin, à celui de M. Julien Benda qui nous donna de curieux essais comme « Belphégor » et de mauvais romans comme « La Croix des Roses ». M. Benda se montrait maladroit dans la création romanesque : ses personnages vivaient peu, semblaient des abstractions. Et sa langue était tout empêtrée de termes philosophiques.
Si nous retirons à M. Closson le bénéfice d'une large culture et d'une expérience qu'il n'a pu encore acquérir, nous lui reconnaîtrons, non pas des qualités, mais des défauts analogues à ceux qui nous irritent chez l'auteur des «Amorandes». Seulement ces défauts sont élevés ici à une puissance beaucoup trop forte pour être longtemps supportable. En plus du jargon philosophique, M. Closson abuse des néologismes les plus laids et les libertés qu'il prend avec la grammaire choqueraient un collégien. Voici un exemple de son style :
« La nécessité de répondre à son étreinte perturbe ma quiétude. La frigidité de ma caresse décuplera sa valeur. Tant parce que la froideur est un infaillible aphrodisiaque, que par la précision et la perfection des caresses conscientes, etc... »
Situons ce « Cavalier seul ». L'anecdote n'y tient pas de place.
Un jeune homme, très jeune, et une jeune femme reviennent ensemble d'une réunion. C'est la nuit. Ils vont jusqu'à une station de tramway où ils se quittent. Pendant la marche, le jeune homme a pris, puis lâché le bras de sa compagne, ils ont échangé quelques phrases, ils se sont embrassés. Chacun des gestes de la femme fait jaillir dans le cerveau du jeune homme une source de réflexions et d'analyses. C'est en quelque sorte automatique. Un battement de paupières, une pression de main et le «Cavalier seul» commence ses exercices. Ces exercices débutent par une critique acerbe de la femme que le héros accompagne. (Cette femme n'existe d'ailleurs pas. C'est une entité, un symbole de tous les défauts féminins : on comprend les fureurs du «Cavalier seul»). Bientôt, ce que le héros voit de concret dans l'être qui est à ses côtés, l'agace ; il s'éloigne et offre le combat à des abstractions. Ainsi nous sont communiquées ses découvertes sur l'amour, sur le désir sexuel, la courtisane, l'art.
Elles sont de l'ordre le plus banal : on les fit cent fois, entre deux soucoupes, dans les cafés de la Porte de Namur. Que dites-vous de ceci :
« Depuis quand s'agit-il de «comprendre» en art ? Il n'est pas nécessaire d'avoir recours à un processus cérébral pour produire l'émotion esthétique. Ou le processus cérébral n'est qu'un épiphénomène. Un seul art où l'intelligence soit nécessaire à l'émotion esthétique, et peut-être la conditionne : l'art du verbe. Le mot en soi ? Composé, fabriqué, double, quintuple, chargé d'une hérédité formidable. Astéroïde qui ne peut s'évader d'une orbite immuable, soumis aux lois de gravitation du soleil Logique. »
Dégagez, si vous le pouvez. l'idée du galimatias qui la contient. A-t-elle assez traîné, depuis l'armistice, dans les revues d'avant-garde ! M. Closson accumule les pensées de cette force ; mais le tour qu’il leur donne, n'est pas toujours aussi déplaisant. Quand il évoque un acte, il use de la phrase sans verbe que M. Morand mit à la mode et dont il tira d'ailleurs des effets curieux. L'auteur du «Cavalier seul» qui a lu Apollinaire fait, en outre, profiter le lecteur des ressources de la typographie. Il en arrive à écrire dramatiquement des pages comme celle-ci :
«Elle, lit, gouffre, fleurs, ventre, moi ;
Fusées, plaque, flux, ressac, reflux ;
Elle, vitesse, flux, moi, ressort ;
Rythme, elle ressac, moi, marais ;
Elle, glouglou, moi, flux.
Reflux, elle, vitesse, moi,
Flux, sexe, elle, moi,
Sexe, elle, moi,
Elle moi
Elle moi
Elle moi
NOUS.»
Et cependant, il ne faut pas rejeter ce livre. Si mal composé soit-il, si peu vraisemblable que soit l’abondance de ce « monologue intérieur », on ne peut méconnaître qu’il est doué d’une vie, à certains instants, âpre et forte. Le personnage principal parvient à saisir notre attention : malgré son jargon et sa «philosophie», il revêt un caractère humain qui ne laisse pas d’atteindre, parfois, à la grandeur.
Une passion l'anime, comme à beaucoup de jeunes gens qui cherchent des consolations métaphysiques. Mais inspirent-elles souvent des accents de cette violence :
« ...Et ce n'est ni la honte, ni l'enfant, ni la virginité qui l'arrêtent et la font reculer devant la possession immédiate, c'est le lendemain. Elle sait que dès lors ce serait fini, que le signe de sa soumission serait pour moi le signal du départ, que je m'en irai sans tourner la tête et qu'elle hurlera seule. Elle sait que je ne l'aime pas, ou que je ne l'aimerai plus. Et elle veut faire que je l'aime, elle veut susciter l'amour, la plus essentielle des trouvailles féminines, pour n'être pas jetée dehors, après. »
Il faut de la patience pour ne pas laisser échapper les passages d'une valeur égale que l'on rencontre, après quelles aridités ! dans ce volume épais. Réunis, ils composeraient une vingtaine de pages. Un dixième du volume, c'est assez pour avoir confiance en M. Closson : peut-être son prochain livre ne sera-t-il plus un mauvais brouillon, mais une œuvre.
Robert Marin
✪ Compte rendu signé Robert Marin paru dans la rubrique « Chronique des livres » de Liège-Universitaire du 13 novembre, où il occupe la page 3, colonne a-e.
L’édition française du livre de Ramon Gomez de la Serna [1888-1963], due à Marcelle Auclair, est parue en 1925 chez Simon Kra, aux Editions du Sagittaire, dans la « Collection de la Revue européenne ».
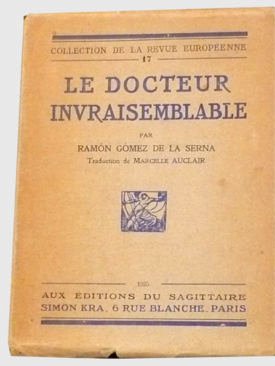
« Le Docteur invraisemblable de Ramon Gomez de la Serna »
Nous connaissons Ramon Gomez de la Serna par un recueil de poèmes en prose d’un genre si particulier qu’il a fallu créer un mot pour le désigner. M. Valery Larbaud en présenta la traduction française intitulée : «Echantillons». Depuis, grâce à M. Jean Cassou, nous avons découvert «La Veuve Blanche et Noire», tentative de roman extrêmement brillante et «Seins», nouvel ensemble de greguerias. Aujourd’hui, Madame Marcelle Auclair nous introduit auprès d’un médecin qu’il est bien agréable de consulter : «Le Docteur Invraisemblable».
Bien que ces quatre volumes ne soient qu’une infime partie de l’œuvre du poète espagnol (1), il semble que l’on puisse déjà porter un jugement.
Je ne donnerai pas une explication des procédés de Ramon. M. Valery Larbaud s’y est appliqué et son analyse, pourtant subtile et tenace, n’a pu décomposer en ses éléments premiers ce corps complexe à l’excès.
Je me contenterai d’indiquer la qualité poétique de cette œuvre et sa fantaisie.
Le propre de l’artiste est de montrer aux hommes ce qu’ils n’ont jamais vu, ce qui revient au même d’éclairer les spectacles anciens d’un jour qui les rajeunit. Ramon Gomez arrête sa curiosité et, par suite, la nôtre sur les objets les plus familiers. Il nous force à les considérer avec une minutie que nous refusons à l’ordinaire. Cet examen fait jaillir en gerbe les images les plus brillantes et des observations que l’on ne pouvait espérer : [suit un long extrait du livre].
J’ai pris en exemple ce passage du Docteur Invraisemblable, non qu’il soit des plus réussis, mais parce qu’il nous fournit une idée nette d’un des procédés de Ramon. Il consiste principalement à donner la vie aux choses inanimées ; à les regarder comme des êtres doués de mouvement et de personnalité. Reculant les bornes de l’analyse, Ramon en arrive ainsi à doter de qualités morales des objets assez peu excitants pour un poète comme des lorgnons, les gabardines, les gants. Il enlève à ces choses leur destination habituelle, les isole et les scrute «en elles-mêmes», de la façon dont un biologiste étudie au microscope une coupe d’épithélium. Ramon va plus loin : il soumet sa «préparation» à divers réactifs et ne se défend pas de nous communiquer les résultats, parfois stupéfiants, que cette méthode lui fait obtenir.
Quand il applique sa verve poétique à des êtres vivants, il en use d’une autre manière. Après avoir déterminé les parties qui les composent, il décrit autour de chacune d’elles une série de spirales qui, bientôt, vont se chevauchant et, finalement, se confondent. Un ordre évident soutient la course de cette fantaisie. Les images les plus neuves, mais d’un contour souple, extensible, accompagnent ses démarches. Leur abondance ne nuit jamais à leur pouvoir d’évocation : l’auteur de «Seins» invente sans arrêt ; sa richesse n’a d’égal que son bonheur. Cette abondance ne l’empêche pas de tirer parti de ses trouvailles. Aussitôt, il les pousse à l’extrême, leur fait «rendre» le maximum. Un divertissement poétique ou comique d’une qualité supérieure nous est offert.
C’est au café que Ramon rencontre le plus souvent le jeune docteur dont les expériences font croire à une science nouvelle et bienfaisante : «Ce n’est que là qu’on échappe un instant à la Destinée injuste et précaire qui nous poursuit chez nous et dans la rue. Si un café discret et dissimulé, comme ceux que nous choisissons, avait existé du temps de Caïn, il aurait pu échapper au regard implacable de l’Œil.»
Au cours d’une causerie, Ramon exige du docteur invraisemblable un récit succinct de sa carrière médicale. Alors qu’il essayait en vain «de résoudre le problème qui consiste à guérir la vie de la mort», un hasard révéla au docteur ce que sont l’originalité et le pouvoir de l’esprit, même dans la profession qui semble s’appuyer le plus sur la discipline... Désormais, il se laissera guider par une spontanéité entière : «l’on doit agir sur les moribonds par des essais violents, désespérés, macabres, si l’on veut».
Ce sont ces essais très nombreux qui forment la matière de ce livre, recueil d’expériences cliniques dont les aspects multiples suscitent en nous tous les mouvements mais, sans trêve, nous charment.
J’ai cité au début de cet article le cas du malade guéri par l’abandon de sa vieille paire de gants ; il y a celui d’une jeune fille sauvée quand elle renonce à porter des étoffes écossaises : «Cette robe (la robe écossaise) est la robe de celle qui dit adieu à la vie, qui aspire à être la compagne des morts d’autrefois, et qui veut s’en aller au limbe des personnages de romans déjà connus...» ; celui d’un bossu fou auquel la raison est rendue par une augmentation du cerveau ; celui d’un baron mourant rappelé à la vie par la coupe de sa barbe, etc... Cette énumération toute sèche indique le caractère très particulier de l’humour de Ramon. Il s’y mêle un tragique au sujet duquel je ne puis m’étendre. Lisez «Le Docteur Invraisemblable».
M. Jean Cassou dans sa préface dit : «Ce serait, je crois, diminuer la portée de l’art de Ramon que de n’y voir qu’un divertissement intellectuel et de n’en point dégager la mystique qui l’anime».
Je terminerai en louant, comme il convient, Madame Marcelle Auclair qui a traduit l’ouvrage : la clarté et l’élégance de la phrase assurent la vivacité de notre plaisir. Quant à la fidélité, M. Cassou est notre garant : il nous enlève toute inquiétude.
Robert Marin
(1) M. Ramon Gomez de la Serna montre une fécondité pareille à celle de Lope de Vega. Il publie un volume à peu près chaque mois.
✪ Compte rendu signé Robert Marin paru dans la rubrique «Chronique des livres» de Liège-Universitaire du 20 novembre, où il occupe la page 3, colonne a-e. L’édition française de Jeunesse suivi du Cœur des ténèbres de Joseph Conrad [1857-1924] est parue en 1925 aux Edition de la Nouvelle Revue Française, dans une traduction due à André Ruyters [1876-1952] et Georges Jean-Aubry [1882-1949].
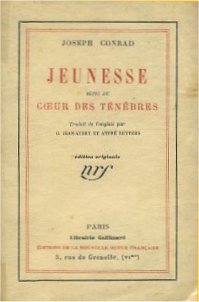
« Jeunesse et Le Cœur des ténèbres par Joseph Conrad »
C’est un propre du génie de créer des figures sans limites préconçues, tellement vastes et profondes, si bouleversantes de vie et de passion qu’elles existent en dehors de leur auteur, avec leurs possibilités monstrueuses et leurs lacunes. La destinée d’un Prince Muichkine, d’un Karamazof, d’un Charlus ou d’un Baron Hulot, suffira toujours à alimenter par elle-même notre intérêt. Bien éloignés d’apaiser notre curiosité, les commentaires de l’auteur ne feront que la rendre plus vorace.
Certains personnages de Conrad : Lord Jim, Heyst et, aujourd’hui que la N.R.F. nous offre la traduction du «Cœur des Ténèbres», Kurtz, nous obsèdent ainsi de leur présence. Nous nous acharnons sur leur secret comme nous ferions d’êtres vivants. Et ceci montre la supériorité des écrivains que nous avons rappelés sur d’autres d’un talent très noble mais combien étriqué, qui renouent avec la tradition de Madame de La Fayette. Un Fromentin, un Radiguet, un Rivière, pour ne parler que des morts, guidés par un souci de clarté et de logique, amputent leur modèle de tout ce qui contrarie la représentation abstraite qu’il en ont établie. Ils l’arrachent à la terre et nous l’exhibent , en quelque sorte, comme un échantillon que l’on pourra désormais étiqueter et placer sous vitrine (1).
Au contraire, quand nous quittons un personnage de Conrad, notre incertitude demeure presque intacte. Notre science est limitée à ses actes dans une circonstance rapportée par l’auteur. Si même dans le conflit qu’il raconte, Conrad jette quelque lumière sur les êtres suscités par son génie, leur complexité, leur richesse de réaction atteint une telle hauteur, qu'aucune clarté ne les touche entièrement. La part de l'ombre existe toujours où nous avons soif de pénétrer. Le problème particulier serait-il d'ailleurs résolu, que nous en imaginerions un autre et notre interrogation subsisterait. Ainsi agissons-nous à l'égard des êtres qui nous entourent et rarement nos précisions sont confirmées.
L’action de l'intelligence dans la composition d'œuvres pareilles semble subordonnée à celle de la faculté créatrice. Il ne s’agit pas de réduire la masse que donne l'imagination à des proportions inventées pas une logique traditionnelle. Il faut, plus difficilement, traduire à une approximation minime ce que l'on a conçu. Le travail de la raison sera d'ordonner, mais non une explication ou une réduction. L'émotion en résultera peut-être moins précise ; rien n'égalera sa richesse.
Conrad ne se contente pas de peindre des hommes et l'atmosphère immédiate où ils vivent. Bien avant que la théorie de l’«unanimisme» n’eût été réduite en petits comprimés aisément absorbables, il nous avait fait assister à la vie d’une collectivité. «Le Nègre du Narcisse» en est, par un côté, le prodigieux exemple. Dans «Le Cœur des Ténèbres» parallèlement, ou mieux, l’un en même temps que l’autre, un homme et un pays sont évoqués devant nous. Ce livre est comme une marche circulaire autour d’un objet qui tantôt se rapproche et tantôt recule, mais n’est jamais effleuré.
«Le Cœur des Ténèbres, dit Conrad dans sa préface, est... le résultat d’une expérience (2), mais c’est l’expérience légèrement poussée (très légèrement seulement) au-delà des faits eux-mêmes, dans l’intention parfaitement légitime, me semble-t-il, de la rendre plus sensible à l’esprit et au cœur des lecteurs... Il fallait donner à ce sombre thème une résonnance sinistre, une tonalité particulière, une vibration continue qui, je l’espérais du moins, persisterait dans l’air et demeurerait encore dans l’oreille, après que seraient frappés les derniers accords.»
On ne peut mieux exprimer le but poursuivi par ce livre et les mouvements qu’il déchaîne. L’habileté de l’auteur est extraordinaire : mieux qu’un Stevenson ou qu’un Dumas il tient le lecteur en haleine. Ce ne sont pas les réticences dans l’exposé ou les coups de théâtre qui poussent l’intensité dramatique à son point culminant. L’accroissement continuel et dont nous ne pouvons imaginer le terme, des êtres en lutte me paraît une raison plus fondée.
D’étroites consignes typographiques m’interdisent tout développement. Je signalerai au moins l’humour particulier à l’auteur de Lord Jim. Il est présent dans les récits les plus tragiques et loin de détruire l’effet, le renforce. Sans doute, est-ce cela que les romantiques cherchaient sans le savoir. D’autres livres de Conrad nous seront donnés bientôt : j’y reviendrai.
La traduction de «Jeunesse» est l’œuvre de M. G. Jean-Aubry qui déjà, traduisit «Des souvenirs». «Le Cœur des Ténèbres» est traduit par M. André Ruyters.
Robert Marin
(1) Heureusement, plusieurs romanciers français luttent contre cette tendance : il faut louer de son audace un Marcel Arland qui écrit «Etienne», même si ce livre n’est pas une réussite.
(2) Un séjour que Joseph Conrad fit au Congo belge de juin à décembre 1890.
Décembre
✪ Compte rendu signé Robert Marin paru dans la rubrique «Chronique des livres» de Liège-Universitaire du 4 décembre, où il occupe la page 3, colonne a-e. Le livre d’Emmanuel Berl [1892-1976] est paru en octobre 1925 chez Bernard Grasset dans la collection «Les Cahiers Verts».
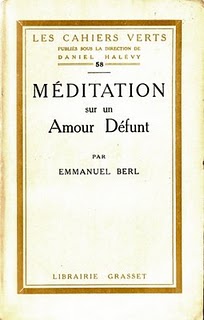
« Méditation sur un amour défunt par Emmanuel Berl »
Quelques pages lues, il devient évident que ce livre ne provoquera ni excès d’honneur, ni indignité. Mais il esquive le médiocre, sinon comment tant d’objections exploseraient-elles à son contact ? Isolées, elles n’entament pas mon adhésion ; leur masse finira bien par la détruire. Il ne me reste qu’une confiance fermement fondée.
J’attaquerai le titre et ce sera un moyen de situer le livre dans l’espace «Méditation», dit l’auteur. Il nous trompe et se trompe soi-même. Exactement : récit mêlé d’analyse et de tableautins et enfin, vingt pages de réflexion. Berl se justifie en rapportant non pas son amour mais son «amour défunt». Cette méchante défense, la seule, lui vaudra le reproche de paresse ou de pusillanimité. La mort est la cause principale de l’examen : elle informe la narration, l’ordre de la pensée, l’économie de l’œuvre tout entière. «Depuis que je connaissais sa mort, écrit-il, toute l’histoire de mon amour s’orientait par rapport à elle.» Ce phénomène est d’autant plus irritant que Berl doute de la mort de cet amour, tandis qu’il croit sans hésitation à sa naissance ou à son épanouissement. Malgré sa foi, il ne parvient pas à nous arracher à notre monde pour nous planter dans le sien. Si je fais un pas dans son univers, je tourne la tête vers celui que je quitte ; il me rappelle, je reviens pour repartir encore. Ce petit jeu fort lassant encourage ma mauvaise humeur.
L’hésitation du lecteur n’est que le corollaire de celle que manifeste l’écrivain. Imposer à d’autres les convictions que l’on voudrait avoir est le fait des habiles. Berl ne craint pas, tout en essayant de nous entraîner, de déclarer ses doutes, voire son scepticisme. Il en résulte que nous croyons en lui, mais que nous refusons toute véracité aux spectacles qu’il nous propose. Beaucoup trop intelligent pour trancher les nœuds gordiens, il tourne autour avec des : si... si... peut-être... sans doute... et le monde ne lui appartiendra pas. J'en arrive à lui souhaiter un peu de bêtises : Il ne serait plus contraint à des remarques comme celle-ci : « Je n'étais pas capable d'un délire suffisant, d'une suffisante inconscience pour m'emparer de Christiane sans nous rendre inexcusables, moi de l'avoir fait, elle de l'avoir subi ».
Je m'étonne d'ailleurs que son analyse franchisse à peine les bornes de l'évidence. Il ne devait pas craindre le sort d'un Jacques Sindral qui, raffinant avec sécheresse sur l'impondérable, rencontre le vide : comme Proust, Berl est trop attaché, je ne dis pas au réel, mais au concret, ou, ce qui est le même, il est trop soucieux de s'exprimer d'une manière concrète pour échouer ainsi. Faute de persistance dans son dessein, il nous restitue une Christiane inconsistante ; déjà nous sentons qu'elle fut amoindrie, qu'elle est une victime. Au contraire, le caractère social de cet amour est beaucoup plus solidement établi, encore que l'auteur feigne de ne pas vouloir y toucher. Sans soutiens comme sans contradicteurs, son amour ne vivrait pas. Dès qu'ils s'écartent, le voilà qui faiblit. La métaphysique des héros suit une marche identique : quand leur amour atteint son point culminant, les affaires de Dieu sont merveilleuses ; elles retombent en même temps que lui. Cela rappelle les joies et les tristesses que les variations de la bourse apportent aux familles.
La timidité d’Emmanuel Berl se cache sous un style agressif. Quand il parle d’un ton définitif de «bordel, d’onanisme, de coucher avec des filles, etc...», je pense à ces personnages de Drieu la Rochelle qui «s’adonnaient avec entrain à la passion du jeu qu’on a introduite dans le monde du sentiment, à la surenchère des confidences brutales». Je ne vais pas jusqu’à dire avec Drieu (à qui d’ailleurs Berl fait parfois songer) : la sincérité est à l’ordre du jour. Mais que pratique-t-on sous ce nom ? un cynisme fainéant et trompeur. «Je ne mets pas en doute la sincérité d’Emmanuel Berl, mais je m’en défie dès qu’il veut me la prouver. Je n’aime pas une modestie qui dit : «Et si faux amant, faux déiste, faux poète, en rien je ne puis dépasser le stade où j’entrevois ce que je ne sais pas atteindre, manque de force, manque de chance ou manque de grâce, mieux vaut du moins ne pas étaler de menteuses richesses».
D’une manière injustifiable, je me mets à la place d’Emmanuel Berl et j’entrevois ce stade auquel il atteindra : il est beaucoup plus large que celui qu’il parcourt avec tant d’attitudes dédaigneuses. Il me suffit de penser à la pesanteur de certains passages de ce livre trop léger. Les exaltations du héros nous sont communiquées avec une véhémence invincible. Et les dernières pages où, débarrassé de ses soucis de narrateur, il se livre à la méditation, rendent un son humain, grave et qui émeut.
Robert Marin
✪ Comptes rendus signés Robert Marin parus dans la rubrique «Chronique des livres» de Liège-Universitaire du 11 décembre, où il occupe la page 3, colonne a-e. Le premier volume d’André Beucler [1898-1985] est paru aux Editions de la Nouvelle Revue Française, le second chez Emile-Paul dans la collection «Les Cahiers du mois».
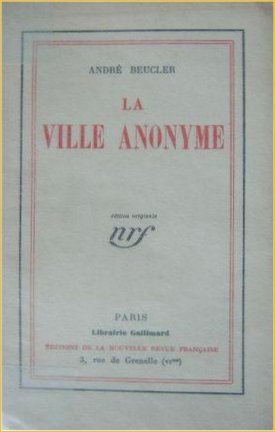
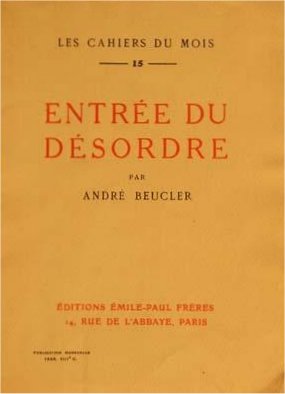
« La Ville anonyme et Entrée du désordre par André Beucler »
Le talent, pour assuré qu’il soit, n’exclut pas chez les artistes d’une même époque une communauté de préoccupations, des visées que seules leurs fortunes diverses permettent de distinguer. Il est rare de rencontrer un romancier qui, sans effort apparent, se détourne du pâturage de sa génération, pour trouver ailleurs des espaces plus verts où la marche soit libre et l’appétit largement apaisé.
«La Ville anonyme» et «Entrée du désordre» nous apportent un monde entièrement neuf, je dirais même, incomparable, car les repères nous manquent pour ajuster ces livres aux œuvres les plus remarquables de ces dernières années. Seul, un petit conte de Pierre Mac Orlan, «Hôpital Marie-Madeleine», peut servir de point de départ à la découverte. Mais les frêles indications qu’il renferme ne soutiennent pas l’éclat des richesses d’André Beucler.
Elles sont d’ordre poétique. La poésie, Beucler de la chercher dans l’interprétation des objets que nous avons sous les yeux, ou dans la lumière dont il inonderait soudain pour nous des rapports obscurs. Il veut nous donner un jouet vivant dont l’aspect comme les gestes nous soient inconnus : quant à sa substance elle est dans le domaine public. Cette tentative ne va pas sans un certain labeur de destruction. A coup de canne et avec une belle application, Beucler a brisé l’univers fragile et menteur dont notre habitude est trop longue pour qu’il puisse encore nous émouvoir. Les morceaux en sont tombés, mille éclats et des blocs aux cassures imprévues, miraculeuses en quelque sorte, dont il use pour rebâtir un monde dont lui-même, pas plus que nous, semble-t-il, ne pouvait prévoir la structure. Le travail bizarre et puissant du constructeur s’accomplit devant nous : les débris de toute forme, de toute couleur, et ils sont innombrables, s’entassent ; guidés par une dure volonté s’assemblent, rencontrent leurs compléments, en une stabilité définitive s’affermissent. La nature des matériaux et, surtout, l’ordre qui préside à leur disposition écartent Beucler loin des surréalistes, font naître une harmonie contre laquelle nous sommes sans défense.
Quant aux personnages qui peuplent «La Ville anonyme», il est évident que la plupart d’entre eux font partie du décor, n’existent que pour lui communiquer une partie de leur vigueur.
Mais il en est qui s’en détachent et participent de deux vies, celle de leur monde et celle du monde antérieur. Non qu’ils paraissent des anachronismes ou qu’ils choquent, comme par exemple des néologismes mal formés sous la plume d’un puriste, mais en dehors des conditions d’existence que l’auteur leur a assignées, leurs actes seraient plausibles en notre imagination, si elle est incapable de les créer, n’hésite pas à les admettre. Toujours par quelque partie de lui-même, Beucler touche la terre ferme. C’est cela qui rend hospitalier un monde d’apparence hostile, c’est cela qui fait notre docilité à la suggestion qu’il nous impose.
L’autorité qu’André Beucler gagne sur nous s’appuie à deux forts étais : son abondance et sa ténacité. Avec autant d’intelligence que d’imagination, il choisit des milliers de petits faits et nous les adresse dans leur face la plus tranchante. Un don d’images extraordinaires le sert dans son entreprise, chaque trait atteint le but : nulle trace d’éparpillement, une aisance et ensemble une rigidité que nous admirions déjà mais appliquées d’une tout autre manière et à un tout autre objet, dans les récits des frères Tharaud. Le seul reproche que je puisse tenter, mais comment reprocher quelque chose à une œuvre aussi généreuse ? ce serait la lenteur de son allure. Nous avançons d’un train uniforme quand nous voudrions bien bondir un peu. Et d’autre part lorsque Beucler se résigne à des sacrifices, l’atmosphère perd en densité. Ainsi dans l’«Entrée du Désordre» qui (bien que d’une forme épurée) paraît une bonne préparation à «La Ville anonyme».
Il reste à André Beucler de trouver le moyen d’allier richesse et rapidité : ce n’est qu’une question de mécanique appliquée.
Robert Marin