Acquittement de la Société des Editions Denoël
30 avril 1948
Les procès d'éditeurs parisiens ont débuté en mars 1945 et se sont terminés en octobre 1955. Durant ces dix années de procédures disciplinaires ou pénales, les sanctions les plus diverses ont frappé des dizaines de maisons d'édition françaises, qui allaient du simple blâme à la confiscation.
Généralement les maisons d'édition fonctionnent en société, ce qui leur permet d'obtenir le crédit nécessaire, le plus souvent sous forme de découvert, auprès des organismes financiers. Ces sociétés constituent des personnes morales, responsables au même titre que les écrivains, de leurs publications.
C'est pourquoi les éditeurs, relaxés ou condamnés, n'en avaient pas terminé avec la justice ou les commissions d'épuration : il restait à juger leurs sociétés.
On a vu que Robert Denoël s’était présenté, le 6 février 1945, devant le juge d’instruction Olmi à la suite des attaques dont il avait été l’objet dans la presse.
Le 19 février 1945 il est officiellement inculpé pour infraction aux articles 75 et suivants du Code pénal et atteinte à la sûreté de l’Etat.
Il comparaît le 13 juillet 1945 devant une cour de Justice. Après examen de son dossier, le commissaire du Gouvernement conclut « qu’il ne résulte pas de charges suffisantes contre Denoël d’avoir commis le crime d’intelligence avec l’ennemi » et demande « le classement de la procédure le concernant sous réserve de poursuites possibles devant toute autre juridiction ».
Cette dernière réserve concerne les poursuites qui seront éventuellement exercées contre les écrivains et leurs œuvres, dont l’éditeur est solidairement responsable, mais aussi sa société d’édition qui, comme pour tous les éditeurs compromis, reste poursuivie.
Le 15 juillet Denoël, qui attend avec impatience la notification officielle de son non-lieu, écrit à Jeanne Loviton : « Rien encore de Simone [Penaud] qui ne semble pas alarmée du tout. Elle explique le retard par l’encombrement des dactylos, qui dépasse, paraît-il, toute imagination. Mais comme toi, je tiens à voir et toucher le papier en question pour me sentir tout à fait libre. »
Deux jours plus tard le « papier » ne lui est pas encore parvenu et il s'en inquiète auprès de son amie, qui lui a donné l'assurance que ce n'était plus qu'une question d'heures : « Ce n’est pas que je doutais de ceux qui t’avaient promis de me tirer d’affaire mais je redoutais tous les impondérables, les sursauts de l’opinion. » Il a bien lui-même quelques amis « mais mal placés ou inactifs ou que je ne pouvais pas solliciter ».
La décision de classement, qui est datée du 15, lui parvient finalement le 18 juillet 1945 et Denoël envoie fleurs et remerciements aux amis de Jeanne Loviton. Par la suite il évoquera ce non-lieu avec quelques correspondants mais sans jamais parler du procès à venir, le plus important peut-être, celui de sa société d'édition.
A Paul Vialar : « J’ai gagné la difficile partie ou plutôt Jeanne l’a gagnée pour moi. Il ne s’agit plus que d’attendre le vent favorable pour faire voguer le bateau. Et j’ai l’impression qu’avec l’escorte du Voilier, il va faire une course fastueuse. » [18 juillet 1945].
A Robert Brassy : « Heureusement le principal de mes soucis est écarté aujourd’hui ; je vous le dis encore confidentiellement car je ne pense pas reprendre la direction de ma maison avant la fin du mois de janvier prochain. » [3 août 1945].
A Jean Proal : « Je vais me reposer, bien fatigué, éreinté même, mais l’âme sereine, j’ai gagné la partie, il ne reste plus qu’à régler le montant des enjeux, ce sera l’affaire de quelques mois et je reprendrai mon travail avec la certitude qu’il sera fécond. » [3 août 1945].
A Jean Rogissart : « En ce qui concerne ma grande affaire, je puis dire maintenant que j’ai gagné la partie, je ne le dis pas encore sur la place publique, mais je me fais une joie de l’annoncer à mes amis. Cela ne signifie pas qu’il soit raisonnable de prendre la direction de ma maison avant plusieurs mois, je ne veux provoquer personne. » [3 août 1945].
A Blaise Cendrars, qui lui a proposé de réimprimer Dan Yack : « Je ne mets toujours pas les pieds dans cette maison qui sera peut-être tout de même bientôt et définitivement la mienne. » [2 octobre 1945].
Tout se passe jusque-là comme si Robert Denoël attendait simplement le moment opportun pour reprendre la direction de sa maison. Or l’instruction du dossier de la Société des Editions Denoël a suivi son cours.
Le 30 octobre 1945, en prévision de la fermeture prochaine des cours de Justice, et pour éviter la forclusion, la Commission nationale interprofessionnelle d’épuration transmet au ministre de l’Information, Jacques Soustelle, les dossiers de maisons d’édition à examiner. Le 5 novembre, le ministre signe un « avis favorable pour l’ordonnance de poursuites » contre dix-sept maisons d’édition dont celle de Robert Denoël.
Le 8 novembre, le Commissaire du Gouvernement informe l’éditeur qu’une plainte a été déposée contre sa société, en l’invitant à produire un mémoire de défense dans un délai de dix jours, à transmettre à la Commission, 117 boulevard Saint-Germain.
Je ne possède aucune lettre de Robert Denoël postérieure au 8 novembre 1945. C'est sur les déclarations des témoins interrogés par la police après sa mort, et la correspondance d'Armand Rozelaar, que je m'appuyerai pour montrer combien cette nouvelle inculpation a pu jeter le trouble dans l'esprit de l'éditeur et celui de ses proches.
Dans le premier courrier qu'il adresse au juge Gollety, Me Rozelaar, qui paraît alors informé sommairement de cette nouvelle instruction, écrit, le 21 mai 1946 : « Robert Denoël bénéficia dès le 15 juillet 1945 d’une ordonnance de classement. Il voulut alors reprendre la direction de ses affaires. Mais les bons amis qui le conseillaient et qui l’entouraient d’une affection vigilante et tenace, lui firent remarquer qu’il avait encore à traverser trois épreuves, dont l’une au moins ne se réalisa d’ailleurs pas. Il s’agissait du Comité de Confiscation, de la Commission d’Epuration du Livre, et de nouvelles poursuites engagées contre la Société des Editions Denoël en vertu de l’ordonnance du 5 mai 1945. La mort dans l’âme, Denoël se soumit et demeura dans la clandestinité relative où il vivait. »
La Commission consultative d'épuration de l'Edition, créée le 2 février 1945, et dont les bureaux se trouvaient au 117 boulevard Saint-Germain (VIe), était chargée de réunir et de transmettre au ministre de l'Information les renseignements de nature à motiver la citation d'un éditeur devant la Commission nationale interprofessionnelle d’épuration. Elle avait obtenu de suggérer, voire d'imposer, des peines à cette Commission nationale, et celle proposée pour Denoël par son président aurait été la plus sévère : « nous avons demandé la sanction la plus grave contre lui, c’est-à-dire l’exclusion définitive de la profession », dira Durand-Auzias au commissaire de police Lucien Pinault, le 8 octobre 1946.
Elle était composée de dix membres dont :
Raymond Durand-Auzias, éditeur, président ;
Francisque Gay, Pierre Seghers, Vercors, tous trois éditeurs ;
Henri Malherbe, écrivain ;
Jean Martin, chef de service chez Larousse représentant les cadres de l'édition ;
M. Damarez, employé chez Plon représentant les employés de l'édition ;
René Riff, Frédéric Weil et M. Dufour, tous trois libraires.
La Commission nationale interprofessionnelle d’épuration était chargée d'examiner les dossiers des sociétés d'édition et de prononcer des sanctions : c'est elle qui aurait dû se charger de celui de la Société des Editions Denoël. Le Président Richard, ancien Conseiller à la Cour de Cassation était à cette époque commissaire du Gouvernement près de cette commission qui avait pignon sur rue au 47 de la rue Dumont d’Urville (XVIe), et c'est lui qui était chargé d'y convoquer Robert Denoël. Cette date n'avait pas encore été fixée au moment de sa mort mais celles du 7 ou du 17 décembre 1945 ont été avancées, la première par Auguste Picq, la seconde par Jeanne Loviton. Le 2 décembre 1945, Denoël ne lui avait pas encore transmis son mémoire en défense - lequel disparut, comme on sait. C'est sans doute pour cette raison que la commission aurait, après la mort de l'éditeur, classé provisoirement le dossier des Editions Denoël.
Le Comité de Confiscation de la région parisienne centralisait au 26 de l'avenue de l’Opéra (IIe) les fiches des personnes et entreprises ayant eu affaire avec l’un des comités ci-dessus. Il n'eut donc pas à se prononcer quant à la Société des Editions Denoël.
La lettre d'Armand Rozelaar concernant le procès civil intenté par sa cliente, Cécile Denoël, à sa rivale, Jeanne Loviton, on n'est pas trop surpris de lire qu'il impute à Mme Loviton et ses amis la responsabilité de la semi-clandestinité dans laquelle a dû se cantonner l'éditeur depuis août 1944, ce qui a permis différentes manœuvres destinées à accaparer sa maison d'édition.
Or, deux jours après son avocat, Cécile Denoël écrivait au même juge d'instruction que « MM. Barjavel, Percheron, Vialar et Robert Beckers m’ont dit qu’il fallait dans le plus bref délai faire partir M. Vox, car M. Vox était à la base de la nouvelle inculpation des Editions Denoël, que mon mari représentait devant la Commission d’Epuration Interprofessionnelle. »
L'accusation était grave mais le juge Gollety aurait aisément pu s'assurer de son bien-fondé en s'adressant directement à la Commission, au lieu de quoi il transmit le courrier de Mme Denoël à la Brigade Criminelle, qui dut ensuite interroger les personnes citées par la veuve de l'éditeur.
René Barjavel déclara au commissaire Pinault, le 9 octobre 1946 : « Je n’ai jamais dit à Mme Denoël que Monsieur Vox était à la base de cette nouvelle inculpation de son mari devant cette Commission d’épuration, pour moi sa comparution devant cette Commission était une conséquence normale de l’inculpation dont il avait fait l’objet devant la Cour de Justice. »
Maurice Percheron dit qu'il avait simplement mis Cécile « en garde contre la gestion que son mari m’avait signalée défectueuse de M. Maximilien Vox et son adjoint M. Pouvrot [Pouvreau] », et Paul Vialar qu'il n'avait pas abordé cette question avec la veuve de l'éditeur.
Robert Beckers déclara qu'il était « fort possible, et même certain qu’au cours de nos conversations, on ait envisagé le maintien ou l’éloignement de M. Vox en tant qu’administrateur provisoire des Editions Denoël, mais j’affirme qu’il n’a jamais été dit que celui-ci était à la base de la nouvelle inculpation des Editions Denoël devant le Comité d’Epuration Interprofessionnel. Peut-être l’un de nous a-t-il dit que si Maximilien Vox était à l’origine de cette nouvelle procédure, c’était un salaud, mais aucun de nous n’était suffisamment informé pour le prétendre et je pense qu’aucun de nous n’imaginait Maximilien Vox capable de tels agissements. Personnellement je savais que Robert Denoël devait passer devant la Commission du Livre Interprofessionnelle car il me l’avait dit 8 ou 10 jours avant. Je pense que sa comparution devant cet organisme devait avoir lieu prochainement, d’après ce qu’il m’avait dit. Il n’était pas très rassuré car aucune décision de ce comité n’était encore connue, par moi tout au moins. »
Les témoins mis en cause réfutaient la déclaration de Cécile Denoël mais l'inspecteur de police Ducourthial, qui avait poursuivi ses investigations rue Dumont d'Urville, écrivit dans son rapport du 15 novembre 1946 : « Parmi les documents constituant le dossier se trouvent seulement un exposé qui paraît être un relevé du livre des délibérations de la Société des Editions Denoël faisant état des diverses modifications apportées à la société depuis sa création, et un état du chiffre d’affaires, de la production et des attributions de papier, portant sur les années 1938, 1941, 1942 et 1943. Il est évident que ces documents paraissent avoir été versés au dossier par une personne susceptible d’avoir pu se documenter dans la comptabilité des Editions Denoël. M. Durand-Auzias n’a pu nous dire par qui, M. Monod prétend que ce n’est pas lui. »
Ducourthial, qui paraissait plus à l'aise dans les dossiers que sur le terrain, en tire ces conclusions : « Il est assez difficile de déterminer qui avait intérêt à un classement des poursuites et qui avait intérêt à le voir disparaître, professionnellement parlant ; les uns sont ceux qui le soutenaient sincèrement, les autres sont ceux qui le jalousaient sur le plan professionnel.
Les profiteurs ou les bénéficiaires de la situation présente, à l’époque, parmi lesquels on pourrait citer M. Monod et M. Pouvreau, n’avaient pas plus d’intérêt, semble-t-il, à souhaiter un classement des différentes poursuites intentées contre M. Denoël, qu’à le voir définitivement exclu de la profession. Dans les deux cas, ils se voyaient privés des bénéfices de la situation.
Absout, M. Denoël reprenait la tête de ses affaires. Exclu du milieu des éditeurs, ses affaires étaient fatalement liquidées et il n’apparaît pas que Monsieur Monod ou M. Pouvreau aient fondé des espoirs pour prendre sa succession. Leur intérêt était de voir la position d’attente se prolonger. »
L'inspecteur avait poussé ses recherches plus loin encore : « Pour ce qui est des poursuites engagées contre les Editions Denoël, en vertu de l’ordonnance du 5 mai 1945, le dossier portant le n° 15.061 à la Cour de Justice se trouve être en la possession de Monsieur Fouquin, Commissaire du Gouvernement, lequel possède d’ailleurs également celui de M. Denoël, portant le n° 8518. »
Le policier, qui ne croyait pas à l'explication rationnelle de René Barjavel, tenait à prendre personnellement connaissance du dossier, et il avait relancé à plusieurs reprises M. Fouquin, lequel avait promis de le lui faire parvenir par la voie officielle... mais ne le fit pas : « S’il nous parvient avant la fin de notre enquête, nous indiquerons plus loin les éléments qui peuvent se rapporter à l’origine des poursuites. »
L'enquête fut ensuite retirée à l'équipe du commissaire Pinault et les nouveaux enquêteurs n'abordèrent plus cette question.
Le 15 mai 1947 Jeanne Loviton a obtenu la levée de l’administration provisoire de Maximilien Vox. Le 23 novembre 1947, au cours d’une assemblée générale, les actionnaires de la Société des Editions Denoël demandent la nomination d’un administrateur judiciaire pour la représenter à son procès, fixé au 30 avril 1948.
Le 20 décembre 1947 la société est citée devant la cour de Justice. Son procès est renvoyé sine die car le bâtonnier Ribet, désigné récemment comme défenseur, n’a pu prendre connaissance du dossier.
Le 23 février 1948 un administrateur judiciaire, M. Weil, habitant 1 rue Jacob à Paris VIe, est désigné pour représenter la Société des Editions Denoël devant la cour de Justice. Le procès, prévu pour le 14 avril, est remis sine die.
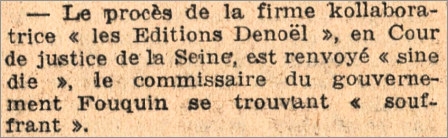
La Défense, 19 mars 1948
Le 30 avril 1948 c’est lui qui comparaît, assisté de Me Joisson, l'avocat de la Société des Editions Denoël, habitant 3 rue de Chaillot, dans le XVIe arrondissement, et du directeur de l’Administration des Domaines de la Seine, en qualité d’administrateur séquestre des parts de l’éditeur allemand Wilhelm Andermann.
Les termes de l’arrêt de la onzième sous-section départementale de la cour de Justice de la Seine sont les suivants :
L'an 1948, le 30 avril à 14 heures 30,
Monsieur J.R. CASTEL, Conseiller à la cour d'Appel de Paris, Officier de la Légion d'Honneur, Président de la Cour de Justice, onzième sous-section départementale de la Seine, Messieurs PONELLE Georges, BOULET Henri, GIQUELN Francis, Madame GLANE Berthe, Jurés titulaires de jugement, membres de la Cour de Justice, Monsieur FOUQUIN, Commissaire du Gouvernement et Maître CORNATON, greffier,se sont rendus dans la Salle d'Audience de la dite Cour de Justice où était présent et libre Monsieur Weil, administrateur judiciaire, demeurant à Paris, (6e) 1 rue Jacob, pris en sa qualité de représentant spécial de la Société d'Editions DENOEL, S.A.R.L. dont le siège Social est établi à Paris 7e, 19 rue Amélie, assisté de son conseil Maître JOISSON, Avocat à la Cour.
Les Jurés ayant pris place aux côtés de Monsieur le Président et ayant prêté serment prescrit par l’article 312 du Code d'Instruction Criminelle, ainsi que cela est constaté au Procès verbal de Prestation de Serment en date de ce jour.
Les portes de l'auditoire étant ouvertes et l’audience étant publique, Monsieur le Président, après avoir constaté la mise en cause et la présence de Monsieur le Directeur des Domaines, désigné en qualité d’Administrateur Séquestre de ladite Société, a constaté l’identité de Monsieur WEIL, mandataire ad litem de la Société d'Editions DENOEL.
Monsieur le Greffier a donné lecture de l'exposé des faits rédigé par Monsieur leCommissaire du Gouvernement, ainsi que de la citation introductive d’instance.
Il a rappelé la liste des témoins désignés à la requête du Ministère Public. Les témoins ont été conduits dans une chambre séparée de l'auditoire.
Monsieur le Président a procédé à l'interrogatoire de Monsieur WEIL, mandataire ad litem de la Société d'Editions DENOEL, et a notamment fait préciser la date de constitution, l'objet et le siège social de ladite Société, ainsi que ses fonctions.
Après quoi les deux témoins cités ont été successivement appelés à leur chambre et introduits dans l'auditoire, où ils ont été entendus oralement et séparément, chacun après avoir prêté le serment de parler sans haine et sans crainte et de dire toute la vérité, rien que la vérité et encore après avoir accompli toutes les autres formalités de l'article 32 de l'ordonnance du 28 Novembre 1944.
Après chaque disposition, les dispositions de l'article 34 de ladite ordonnance, ont aussi été accomplies.
Monsieur le Président a donné la parole à Monsieur le Directeur de l'Enregistrement et des Domaines, qui a fait un exposé de la situation de la Société.
Monsieur le Commissaire du Gouvernement a développé les charges qui appuyaient l'accusation et a requis l'application de la loi pénale.
Maître JOISSON, conseil de la Société d'Editions DENOEL, a présenté les moyens de défense de cette Société, et sur interpellation de Monsieur le Président, Monsieur WEIL a été entendu en ses explications le dernier.
Monsieur le Président a déclaré que les débats étaient terminés. Il a posé les questions résultant de la citation introductive d'instance et en a donné lecture. Puis Monsieur le Président et les quatre jurés titulaires de jugement se sont retirés dans leur chambre de délibérations.
Le juré suppléant a été conduit dans une autre chambre séparée de la Chambre des délibérations de la Cour de Justice.
Monsieur le Président et les Jurés étant entrés dans l'auditoire, y ayant repris leurs places, l'audience étant toujours publique, Monsieur le Président a donné lecture en présence de Monsieur WEIL, es qualité et en se conformant aux dispositions de l'article 63 de l'Ordonnance du 28 Novembre 1944, des réponses faites par la Cour de Justice aux questions posées.
Monsieur le Président a ensuite prononcé l’arrêté suivant :
LA COUR :
VU l'exposé des faits en date du 31 Juillet 1947, rédigé par Monsieur le Commissaire du gouvernement, concluant au renvoi devant la Cour de Justice de la Société d'Editions DENOEL, au capital de 365.000 francs, fondée le 10 avril 1930, dont le siège social est à Paris (7e) 19 rue Amélie, personne morale représentée par son mandataire ad litem Monsieur WEIL, administrateur judiciaire demeurant à Paris (6e), 1 rue Jacob, sous l'accusation de s'être rendue coupable dans les conditions énoncées aux articles 1° et 4° de l'ordonnance du 5 Mai 1945, de collaboration avec l'ennemi,
VU l'exploit en date du 21 avril 1948, du Ministère de Maître DESME, Huissier-audiencier, portant citation à la Société d'Editions DENOEL, prise en la personne de Monsieur WEIL, Administrateur Judiciaire de ladite Société à comparaître devant la Cour de Justice, onzième sous-section départementale de la Seine, à l'audience de ce jour,
VU les questions posées par Monsieur le Président et les réponses faites, lesquelles sont ainsi libellées :
1ère QUESTION :
La Société d’Editions DENOEL, personne morale, prise en la personne de Monsieur WEIL, administrateur judiciaire (représentant spécial de ladite Société, désigné par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de la Seine, en date du 23 février 1948), es qualité, est-elle coupable d'avoir à Paris, entre le 16 juin 1940 et la date de la libération, en temps de guerre, imprimé et publié des brochures et des livres en faveur de l'ennemi, de la collaboration avec l'ennemi, du racisme ou des doctrines totalitaires.
Réponse : NON, à la majorité.
Après en avoir délibéré en Chambre du Conseil et sans désemparer, conformément à la loi,
Considérant qu’il résulte de sa déclaration que la Société d’Editions DENOEL n'est pas coupable de collaboration avec l’ennemi
ACQUITTE purement et simplement DENOEL, des poursuites exercées contre elle, sans dépens.
Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procuteur Général près la Cour d’Appel.
FAIT ET PRONONCÉ au Palais de la Justice, à Paris..........
Et ont signé..........
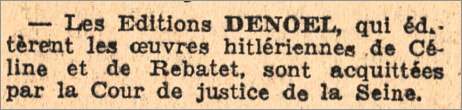
La Défense, 7 mai 1948
*
L'affaire Grasset
Au cours de cette même année 1948 eut lieu le procès de la Société des Editions Bernard Grasset. Il est impossible de ne pas comparer les deux affaires quand on sait qu'un acquittement et une confiscation furent prononcés à moins de deux mois d'intervalle.
Voyons tout d'abord quel fut le parcours après 1944 de Bernard Grasset qui, contrairement à Robert Denoël, a figuré personnellement sur les listes noires du CNÉ car il a publié plusieurs textes littéraires et politiques jugés compromettants.
Le 5 septembre 1944, victime d'une dénonciation anonyme, l'éditeur a été arrêté chez lui, et détenu au commissariat du Ve arrondissement puis au dépôt du palais de justice avant d'être incarcéré, le 11, au camp de Drancy.
Le 19 septembre 1944, plusieurs écrivains dont Duhamel, Valéry, Lacretelle, Arnoux, et Mauriac, adressent une supplique au CNÉ en sa faveur, en faisant valoir son mauvais état de santé. Le 31 octobre Grasset est transféré à l'infirmerie de la prison des Tourettes, puis assigné à résidence.
Le 31 octobre 1945, la Commission consultative de l'épuration de l'Edition, présidée par Raymond Durand-Auzias, rédige son rapport sur la maison d'édition Grasset. Ses conclusions sont sévères : l'éditeur a « largement collaboré avec l'ennemi. Cette collaboration n'est nullement intervenue sous la contrainte de l'ennemi. Elle était à l'initiative personnelle de Bernard Grasset qui, de ce fait, a encouru les plus graves sanctions qui puissent être appliquées à un éditeur français. »
Cette commission propose pour Bernard Grasset l'interdiction à vie d'exercer sa profession, la suppression et la liquidation de sa maison d'édition. Durand-Auzias « dont l'influence est grande, n'a pu adoucir l'appréciation de ses collègues. Il a essayé. Il défend et défendra toujours l'éditeur. »
L'éditeur aurait dû comparaître le 3 décembre 1945 devant cette commission mais, considérant son état de santé, son audition est reportée au 2 janvier 1946, puis au 28 mai 1946. On lui reproche notamment sa collection « A la recherche de la France » et trois lettres compromettantes publiées le 15 septembre 1944 par un organe communiste, La France intérieure, La Commission lui inflige une peine de suspension de trois mois de sa profession.
Combat rappelle que le personnel de la maison Grasset a, le 13 mars 1945, défendu son patron, comme celui des Editions Denoël, dans une lettre-pétition, notamment à propos d'un ouvrage de Goebbels que l'éditeur a réussi à « mettre au placard » depuis décembre 1942 jusqu'à la Libération, risquant ainsi la fermeture de sa maison d'édition.
Bernard Grasset donne à cette occasion une curieuse interview : « Je n'ai jamais cru le moindre mot de ce que j'écrivais. Je n'avais d'autre objectif que de réintégrer ma maison qui était alors occupée par la Gestapo. Il est stupide par exemple de vouloir me faire passer pour raciste. J'ai écrit des blagues parce que j'avais intérêt à écrire des blagues. » [Combat, 26 septembre 1947].
On suppose qu'il a écrit ces « blagues » en vue de réintégrer sa maison, le 22 octobre 1940. Le problème est que Grasset s'est beaucoup manifesté durant l'occupation, dans la presse comme dans l'édition, et ses adversaires ont beau jeu de le lui reprocher.
Ses principaux « faits de résistance » sont le refus, en avril 1942, de publier Les Décombres de Lucien Rebatet, et une postface résolument anti-allemande à la réédition, la même année, du best-seller de Friedrich Sieburg, Dieu est-il français ?
En juin 1946 un « colonel » Manhes a été nommé administrateur provisoire de la maison d'édition : c'est un ancien directeur de cabinet du ministre communiste Marcel Paul. Or en septembre 1947 Bernard Grasset annonce son retour dans sa maison, ce qui déplaît au parti qui a décidé de mettre la main sur cette maison d'édition prestigieuse.
Un tâcheron nommé Francis Crémieux [1920-2004] s'indigne alors dans Les Lettres Françaises : « M. Bernard Grasset, avec ou sans non-lieu, restera l'une des figures les plus répugnantes de la trahison. Il s'est mis au service de l'Allemagne d'une façon totale, ses lettres, ses articles, son activité d'éditeur en fournissent d'abondantes preuves. »
L'inévitable Claude Morgan, lui, ne réclame pas la mort du pécheur, il demande seulement que Bernard Grasset « s'en aille tenter sa chance ailleurs et que la maison Grasset soit dotée, enfin, d'une direction française » (Les Lettres françaises, 2 octobre 1947).
L'éditeur est appelé à comparaître devant une Chambre civique le 20 mai 1948. Son avocat a produit un certificat médical attestant de son incapacité à se déplacer, magré quoi il sera jugé par contumace. La vente des livres qui lui sont reprochés ne représente que 6 % de son activité.
Le commissaire du gouvernement Lacazette, un obscur avocat communiste promu magistrat à la faveur de la Libération, obtient sa condamnation : dégradation nationale à vie, cinq ans d'interdiction de séjour, et confiscation de tous ses biens. Grasset fait opposition à ce jugement.
Un nouveau procès en chambre civique doit se tenir le 28 avril 1949, mais l'éditeur est alors hospitalisé à Sceaux. L'affaire est reportée au 17 novembre mais l'accusé, gravement malade, ne se présente pas à l'audience : l'arrêt du 20 mai 1948 reste donc exécutoire - mais Grasset fait à nouveau opposition.
Son procès a finalement lieu le 27 mars 1950. L'éditeur est cette fois présent mais la Cour ordonne un supplément d'information et renvoie l'affaire au 22 mai. Une nouvelle complication surgit car une lettre due à Dominique Auclères produite devant les magistrats laisse entendre qu'elle aurait pu être dénoncée par l'éditeur aux Allemands en 1940. Or cette dame est la traductrice du livre d'Otto Strasser, Hitler et moi, un ouvrage hostile aux nazisme que la Gestapo a méthodiquement pilonné.
[à poursuivre]
