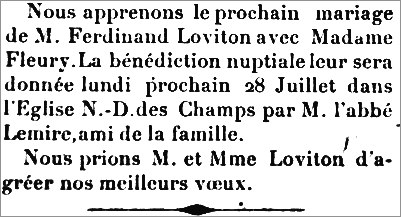Jeanne Loviton
En trente ans, mes recherches au sujet de Jeanne Loviton se sont révélées assez décevantes : elles se réduisent à des dates et à des chiffres, ce qui est moins engageant mais peut-être plus fiable que le « Portrait d'une femme romanesque » tracé sur 300 pages par Mme Célia Bertin en 2008, et qui eut les faveurs de la presse.
J'ai pris le parti de proposer les éléments disparates dont je disposais. Ce sont juste des points de repère classés chronologiquement mais, comme je l'ai vérifié avec Robert Denoël, pour qui j'avais jadis procédé de la même manière, ces dates en télescopent d'autres, des faits en recoupent d'autres, certains noms en appellent d'autres. Une toile se tisse, insensiblement, et parfois, une silhouette s'en dégage, floue mais bien réelle.
La biographie complète de cette femme fascinante reste à écrire car celle de Mme Bertin, qui avait eu le privilège de consulter les archives de sa fille adoptive, Mireille Fellous-Loviton, a laissé tout le monde sur sa faim. J'y ai néanmoins eu recours à plusieurs reprises car, malgré ses non-dits, son livre contient des éléments essentiels, et un « Curriculum vitæ » rédigé en 1969 par Jean Voilier qu'il convient d'utiliser avec prudence mais qu'on ne peut ignorer.
La publication de Corona & Coronilla par Bernard de Fallois offre un choix de poèmes incomparables dédiés à Jeanne par Paul Valéry mais n'est d'aucune aide pour la biographie de son égérie. Le petit livre de François-Bernard Michel, Prenez garde à l'amour, est anecdotique.
L'ouvrage magistral consacré à Paul Valéry par Michel Jarrety est le plus fiable pour la période 1937-1945, ainsi que le volume, longtemps différé, des Lettres à Jean Voilier publié en 2014.
Celui de Carlton Lake : Chers papiers. Mémoires d'un archéologue littéraire, contient d'intéressantes anecdotes sur les tractations commerciales entre Jeanne Loviton et l'archiviste américain en vue de la vente des autographes et manuscrits de Paul Valéry. Le catalogue de la vente « Paul Valéry secret » à Monaco, le 2 octobre 1982, rend quelques bons services.
Le brillant essai de Dominique Bona : Je suis fou de toi. Le grand amour de Paul Valéry, paru en septembre 2014, a parfaitement résumé l'itinéraire chaotique en apparence de cette walkyrie que l'auteur tient à appeler « Jeanne Voilier » tout au long de l'ouvrage. Elle y apporte de nouvelles précisions biographiques que j'ai incorporées ici.
C'est surtout dans la presse et dans les archives publiques que j'ai cherché, et parfois trouvé, Jeanne Loviton et Jean Voilier.
J'ai aussi utilisé les archives de Pierre Frondaie léguées en 2002 par sa veuve à la ville d'Arcachon, et mises à ma disposition en 2008 par un service d'archives comme il en existe peu en France. Louise Staman et moi, y avons reçu un accueil que nous ne sommes pas près d'oublier, grâce à l'ancien maire, le docteur Robert Fleury, décédé depuis.
Robert Fleury a publié en 2007, dans le Bulletin de la Société historique et archéologique d'Arcachon et du pays de Buch, une remarquable « Biographie sommaire de Pierre Frondaie (1884-1914) » (qui devrait être poursuivie par Mme Anne Guillot de Suduiraut), à laquelle j'ai eu recours à plusieurs reprises.
1903
Jeanne Louise Anne Elisabeth Pouchard est née, de père « non dénommé », un mercredi 1er avril 1903, à une heure et demie du soir, au domicile de sa mère, Louise Juliette Pouchard, une « artiste » de 26 ans qui habitait 15 rue Juliette Lamber, dans le XVIIe arrondissement de Paris.
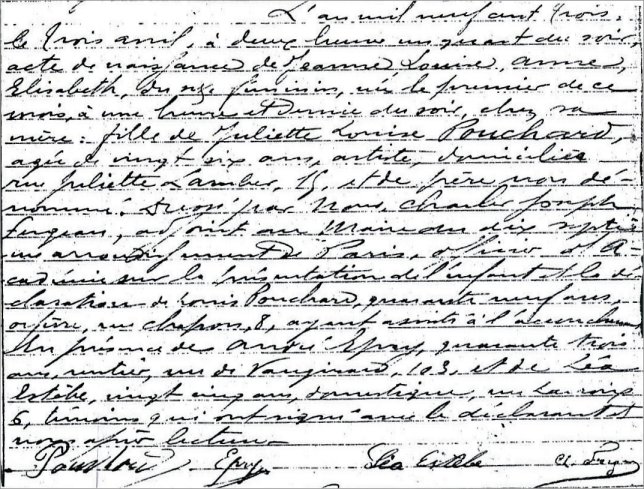
Acte de naissance de Jeanne Loviton, 1er avril 1903
Cette naissance a été déclarée le 3 avril à la mairie du XVIIe par son grand-père maternel, Louis Pouchard, 49 ans, orfèvre 8 rue Chapon, dans le IIIe arrondissement, qui a assisté à l’accouchement de sa fille ce qui, à cette époque, était assez inhabituel. Les deux témoins qui ont signé le document - l'un rentier, l'autre domestique - sont sans doute des anonymes.
La mère de Jeanne, Juliette Pouchard, était née le 3 septembre 1876 à 22 heures au n° 67 de la rue de Bretagne (IIIe arrondissement), chez Isabelle Blanc, une sage-femme qui se chargea de déclarer l'enfant à la mairie, deux jours plus tard. Juliette, née de père « non dénommé », était la fille naturelle de Jeanne Sophie Jotras, brunisseuse, 19 ans, domiciliée place de la Corderie 8, dans le quartier du Marais (IIIe arrondissement).
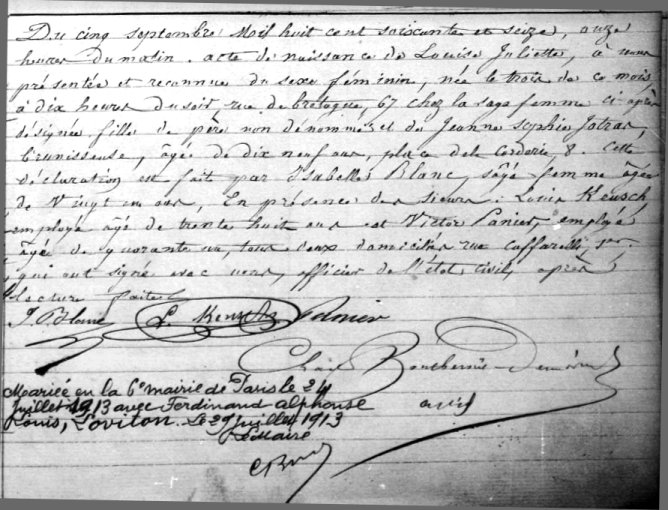
Acte de naissance de Juliette Pouchard, 3 septembre 1876
Sophie Jotras était donc une fille-mère dans le dénuement puisqu'il ne s'est trouvé aucun parent pour déclarer la naissance de Juliette à la mairie du IIIe. Née le 25 septembre 1856 à Auxerre, Sophie était la fille de Baptiste Jotras (décédé à Paris le 20 janvier 1870) et d'Elisabeth Dantin, domestique, alors domiciliée 11, rue Bergère, dans le IXe arrondissement. Elle était « brunisseuse », c’est-à-dire une ouvrière qui polit les métaux précieux pour les patiner.
Le 21 février 1879 la mairie du IIIe arrondissement enregistra un acte du 13 février par lequel Sophie Jotras reconnut sa fille. Le 20 mai, celle du XIe arrondissement enregistra un acte daté du 3 mars par lequel Louis Désiré Pouchard la reconnaissait à son tour.
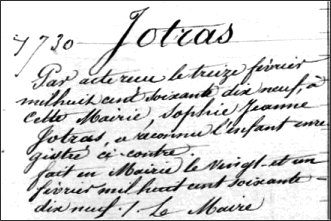
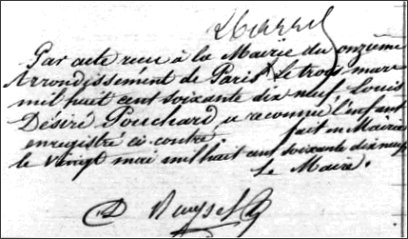
Actes de reconnaissance de Juliette Pouchard par Sophie Jotras et Louis Pouchard, les 13 février et 3 mars 1879
L'orfèvre Pouchard fit ensuite beaucoup plus : le 24 janvier 1880 il épousa - sans contrat de mariage - Sophie Jotras à la mairie du XIXe arrondissement et, à cette occasion, les époux Pouchard-Jotras déclarèrent « reconnaître et vouloir légitimer Juliette, née à Paris le 3 septembre 1876 et enregistrée le surlendemain en la 3e mairie ». Juliette Jotras, la mère de Jeanne Loviton, est donc devenue Pouchard le 24 janvier 1880, quatre ans après sa naissance.
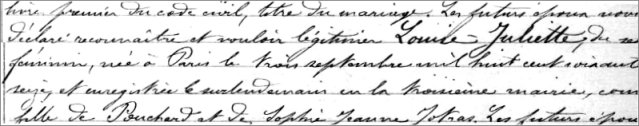
Acte de légitimation de Juliette Pouchard par ses parents, 24 janvier 1880
La régularisation de leur situation ne datait pas de ce jour-là puisque Louis Pouchard et Sophie Jotras étaient, au moment de leur mariage, l'un et l'autre domiciliés 10 rue Pradier, dans le XIXe arrondissement. Cet acte de mariage indique que Louis Pouchard, « argentier », était né le 18 décembre 1853, dans le VIIe arrondissement, et qu'il était le fils de Georges Pouchard (décédé le 4 mai 1867) et de Louise Gastin. Le terme « argentier », tombé en désuétude, désignait au XIXe siècle le métier d'orfèvre. La mère de Georges Pouchard et celle de Sophie Jotras, l'une et l'autre veuves, ont signé le document.
*
Le 10 mai 1903 a lieu, en l'église Saint-Martin-des-Champs, le baptême de Jeanne Pouchard. Pourquoi dans une église du Xe arrondissement, alors que sa mère était, un mois plus tôt, domiciliée dans le XVIIe, où elle a officiellement reconnu sa fille, le 30 avril ? C'est qu'en mai Juliette et Jeanne Pouchard demeurent 56 rue de Lancry, dans le Xe arrondissement. D'autres déménagements auront lieu au cours des mois suivants, notamment au domicile de Louis Pouchard, rue Chapon (IIIe).

Mme Célia Bertin publie une photo de Juliette Pouchard en compagnie de Jeanne, habillée d'une robe qui pourrait être celle de son baptême. Un baptême qu'il n'était sans doute pas opportun de célébrer dans une église de son quartier originel, où elle était connue sous le pseudonyme de Denise Fleury.
Le choix de ce nom est curieux car, en 1907, il est celui d'une courtisane dans « Le Ruisseau », une pièce de Pierre Wolff [1865-1944], qui obtient un beau succès au Théâtre du Vaudeville avec, dans le rôle de l'héroïne, Yvonne de Bray. C'est l'histoire d'une jeune fille de bonne famille entraînée jusqu'au « ruisseau » par la misère et la faim, qui se livre à la prostitution, et qui est sauvée par un peintre riche et célèbre. « Le Ruisseau », qu'on jouera encore en 1934, fut adapté à l'écran en mai 1921.
Cependant la « première » de cette pièce eut lieu au Vaudeville le 21 mars 1907, et l'on trouve le nom de Denise Fleury dans la presse bien avant cette date :
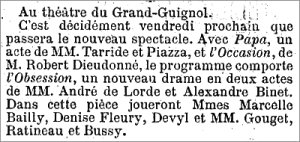

Le Figaro, 10 et 17 mai 1905
Il y avait donc bien à Paris une actrice de théâtre portant ce nom, que Pierre Wolff a utilisé ensuite pour sa pièce.
Elie de Bassan, l'auteur de « La Terreur du Sébasto », et André de Lorde, celui de « L'Obsession », faisaient jouer la plupart de leurs pièces au Théâtre du Grand-Guignol, rue Chaptal (IXe). Créé le 13 avril 1897 ce théâtre proposait le plus souvent des spectacles assez effarants, remplis de scènes sanguinolentes, de viols et de crimes.
André de Latour, comte de Lorde, était né le 11 juillet 1869 dans une famille noble toulousaine. Bibliothécaire le jour à la Bibliothèque de l'Arsenal, il se transformait le soir en auteur infernal. « L'Obsession », drame écrit avec Alfred Binet, est dans cette veine. Ce drame de la folie est sensé terroriser le spectateur et y arrive fort bien en montrant un homme étranglant son petit garçon endormi. L'auteur, mort à Antibes le 6 septembre 1942, a écrit plus de deux cents pièces, la plupart angoissantes ou morbides. Le plus souvent, les acteurs qui y jouaient étaient des « sans grades ».
D'autre part le nom de Fleury est assez répandu dans le monde du spectacle. Le 7 août 1904 Touche-à-tout, une revue hebdomadaire parisienne, mentionne parmi les prix du Conservatoire, un accessit en comédie décerné à « Mlle Fleury, tendre jeune première ». Le 5 mars 1907 Le Figaro rend compte de « L'Escalier de service », une pièce de Sacha Guitry et Alfred Athis où, « dans un rôle épisodique de soubrette avisée, Mlle Fleury se montre comédienne experte, légère et malicieuse ». Ce n'est pas celle que nous cherchons car le même Figaro l'a présentée en 1902 : « Mlle Fleury, 19 ans, 11 mois ». On peut se demander si c'est bien dans ce milieu qu'il faut chercher « l'actrice » Denise Fleury...
Dans Le Journal du 14 janvier 1903 le journaliste Hugues Le Roux a publié, sous le titre « Le Regret de l'enfant », un curieux article où il donne la parole à des courtisanes amoureuses. L'une d'elles lui écrit :
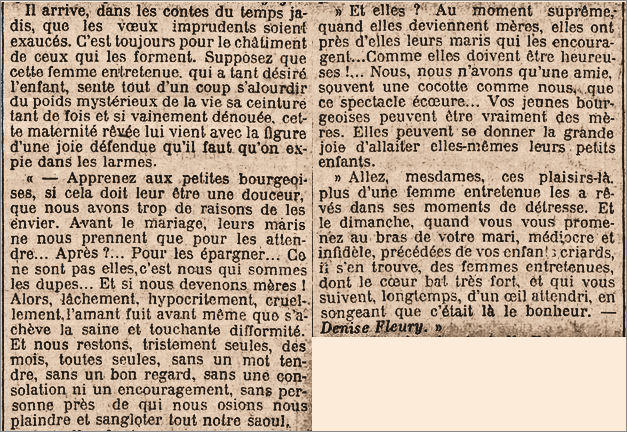
1907
Au mois de juillet Denise Fleury fait la connaissance de Ferdinand Loviton, docteur en droit et éditeur, avec qui elle se liera durant six ans, avant de l'épouser.
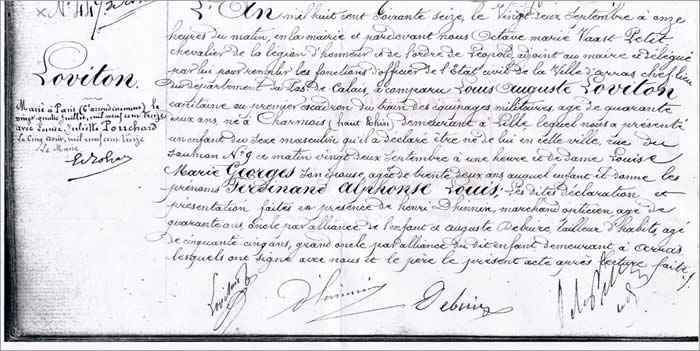
Acte de naissance de Ferdinand Loviton, le 22 septembre 1876 à Arras
Né le 22 septembre 1876 à Arras, rue du Saumon n° 9, Ferdinand Alphonse Louis Loviton est le fils de Louis, 42 ans, habitant Lille, et de Louise Marie Georges, 32 ans. L'enfant avait été déclaré le jour même de sa naissance à la mairie d'Arras par son père, accompagné de son oncle Louis Dhinnin, opticien, et de son grand-oncle Auguste Debuire, tailleur, tous deux habitant la ville.
Louis Loviton, son père, était né le 27 avril 1834 à Charmois, de Joseph Loviton, cultivateur, et de Marie Rassinier. A dix-neuf ans il s'engagea à l'armée mais on s'aperçut alors que, par la négligence d'un fonctionnaire, il n'avait pas été inscrit au moment de sa naissance dans les registres de l'état-civil. C'est par un acte de notoriété passé le 17 avril 1853 devant la justice de paix du canton de Belford que Louis Loviton devint officiellement le fils de son père, et cela ne se fit pas sans mal car Joseph Loviton était déjà veuf et il dut faire appel à sept témoins, tous cultivateurs aux environs de Charmois et plus ou moins apparentés, pour attester de l'existence du couple et de sa progéniture, vingt ans plus tôt. Heureusement l'acte de baptême figurait à sa place dans le registre de l'église de Froidefontaine, paroisse dont dépend Charmois, et les tracasseries administratives s'arrêtèrent là.
Le 22 avril 1853 Louis Loviton fut versé au 90e de Ligne puis au 3e Escadron du Train des Equipages militaires. Nommé brigadier en 1864, maréchal des logis en 1865, sous-lieutenant en 1870, lieutenant en 1873, il termina sa carrière en 1876, avec le grade de capitaine. Il avait participé à plusieurs campagnes : celles d'Afrique [1856-1859 et 1870] où il fut blessé d'une balle à la jambe ; celle d'Italie en 1859, où il reçut un coup de baïonnette au bras au cours de la bataille de Magenta, qui lui valut la médaille militaire. Il combattit aussi les Prussiens en 1871.
Le 7 décembre 1875 il avait épousé Louise Marie Georges [12 janvier 1844 - 7 décembre 1923]. Il fut fait Chevalier de la Légion d'honneur le 6 février 1877, et mourut le 4 juillet 1886 chez lui, 10 rue Neuve à Versailles. Louis Loviton fut enterré, et sa femme après lui, au cimetière Notre-Dame à Versailles, celui-là même où reposent Ferdinand, Denise et Jeanne Loviton.
L'affaire de la régularisation tardive de Louis Loviton était bien une erreur administrative et non, comme chez les Pouchard, d'une reconnaissance de paternité différée, puisque Joseph Loviton avait eu un autre enfant avec Marie Rassinier : le 30 mars 1824 était né Jacques Loviton, dûment enregistré à Charmois le jour de sa naissance. Ce frère aîné embrassa lui aussi la carrière militaire. Il était capitaine au 7e Régiment de Dragons de l'Armée du Rhin lorsqu'il reçut le titre de Chevalier de la Légion d'honneur, le 3 octobre 1871. Jacques Loviton est mort le 21 septembre 1873.
Est-ce que Loviton est un patronyme juif ? Certains dictionnaires généalogiques le disent, d'autres non. Ferdinand Loviton a reçu et transmis une éducation chrétienne à sa fille qui, soixante ans plus tard, parlait encore de sa « vieille famille chrétienne », sans préciser laquelle. Elle ne fut jamais, à ma connaissance, inquiétée à ce sujet durant l'Occupation.
1913
Le 24 juillet : mariage de Juliette Pouchard et de Ferdinand Loviton à la mairie du VIe arrondissement, qui légitimise la petite fille : Jeanne Pouchard devient Loviton ce jour-là, à l'âge de dix ans. Ferdinand Loviton habite alors avec sa mère, présente à la cérémonie, 48 rue Gay-Lussac (Ve).
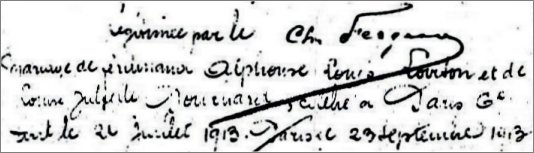
La cérémonie religieuse a lieu quatre jours plus tard en l'église Notre-Dame-des-Champs, qui est la paroisse de la mariée depuis 1909 : 117, rue Notre-Dame-des-Champs (VIe). Le prêtre qui a béni leur union s'appelle Jules Lemire [1853-1928], c'est un vieil ami de Ferdinand Loviton. Dans Le Cri des Flandres, la cérémonie nuptiale annoncée mentionne toujours le nom de Denise Fleury :
Le Cri des Flandres, 27 juillet 1913
Octobre : Jeanne est élève de 6e au Lycée Fénelon, rue Saint-André-des-Arts (VIe), où elle restera trois ans. Cet établissement pour jeunes filles de la bourgeoisie, où la jeune Nathalie Sarraute, qui s'appelle encore Natacha Tcherniak, était inscrite à la même époque, ne comporte pas d’internat : Jeanne rentrait tous les soirs dans sa famille.
1914
Le 14 mai : Première communion de Jeanne en l’église Saint-Séverin (Ve).
Août : déclaration de guerre. Ferdinand Loviton est réformé pour cause de « troubles de vision ».
1915
![]()
La famille Loviton s'installe 9 rue du Val-de-Grâce (Ve), c'est-à-dire : Ferdinand et Juliette, leur fille Jeanne et la mère de Ferdinand, Louise Georges, 79 ans, qui décédera huit ans plus tard.
1917
Jeanne quitte Fénelon pour le collège privé Notre-Dame-de-Sion, 61 rue Notre-Dame-des-Champs (VIe). Cet établissement dirigé par des religieuses offrait aux jeunes filles la totalité du cursus scolaire, de la maternelle à la terminale. Jeanne Loviton y fera ses études secondaires et y passera son baccalauréat.
1918
Septembre : Jeanne passe des vacances à Roscoff avec ses parents. Rencontre son premier petit ami.
1921
Jeanne prend une inscription à la faculté de Droit. Quatre années d’études qu’elle mène avec succès, tout en apprenant le métier de modiste (c’est la volonté de sa mère) et en aidant son père à corriger les épreuves des ouvrages de droit qu’il édite aux « Cours de droit », place de la Sorbonne.
1923
Le 11 septembre, la mère de Ferdinand Loviton est victime d'un accident de la route. Grièvement blessée, elle sera veillée durant quelques semaines par une dame de compagnie, avant de s'éteindre, le 7 décembre. Elle fut enterrée, comme son mari en 1886, et toute la famille Loviton après elle, au cimetière Notre-Dame à Versailles.
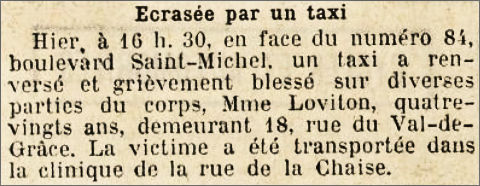
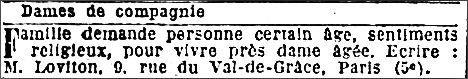
Excelsior, 12 septembre 1923 - L'Echo de Paris, 23 septembre 1923
1924
Le 26 juillet : Jeanne obtient son certificat d’aptitude au grade de licenciée en droit.
1925
Le 20 février, Jeanne obtient sa licence en droit.
Au palais de Justice elle est cornaquée par l’avocat Georges Seguy, un ancien collaborateur de son père qui a déjà un pied dans la fonction publique puisqu'il est, depuis le début de l'année, attaché au cabinet du ministre de la Guerre, Paul Painlevé. En octobre 1934 il est chargé du service parlementaire au cabinet du ministre des Colonies, Louis Rollin. Ce brillant confrère qui, toute sa vie, fera la cour à Jeanne, lui rendra plus tard le service de détenir quelques parts dans la Société des Editions Denoël.
Elle y rencontre le futur bâtonnier Claude-Henri Léouzon Le Duc [1860-1932], qui la reçoit chez lui, rue Bonaparte. Sa femme tient un salon où, une fois par semaine, elle reçoit nombre de personnalités dont Paul Valéry, qui connaît les Léouzon depuis 1903, et Maurice Garçon, qui habite non loin de là, rue de l'Eperon.


Claude Léouzon Le Duc Etienne de Nalèche
Au mois d'août, Jeanne est invitée par les Léouzon le Duc à passer quelques semaines de vacances dans leur château de Chazeron, en Auvergne. C'est là qu'elle rencontre Pierre Frondaie, que Me Léouzon a défendu avec succès en 1922 dans une affaire de titre usurpé, et qui est devenu un ami.
A partir de septembre, elle collabore au Journal des débats, un vénérable quotidien conservateur datant de 1789 et dont le directeur est, depuis 1895, Etienne de Nalèche [1865-1947], qui eut, en 1888, la bonne fortune d'épouser Julia Mesnard de Jannel de Vauréal, la fille de Marie-Angèle Collas dont la famille était, depuis deux ans, l'actionnaire majoritaire du journal.
Il est possible qu'elle y ait été introduite par le comte Xavier de Hauteclocque [1897-1935], qui y publie des articles littéraires et politiques depuis 1923, et avec qui elle a eu une aventure sentimentale, ou par le comte Fernand de Brinon [1885-1947], neveu du directeur et rédacteur en chef, qui restera son ami jusqu'à la Libération.
![Journal des débats politiques et littéraires, 18 septembre 1925 [1er article]](../07presse/img_doss_presse/th_journaldebats180925.jpg)
![Journal des débats politiques et littéraires, 21 septembre 1925 [2ème article]](../07presse/img_doss_presse/th_journaldebats210925.jpg)
![Journal des débats politiques et littéraires, 25 septembre 1925 [3ème article]](../07presse/img_doss_presse/th_journaldebats250925.jpg)


Son premier texte, « L'Evolution intellectuelle de la jeune fille », publié en trois parties dans les numéros des 18, 21 et 25 septembre, est une réflexion sur le rôle de la jeune fille dans la société depuis le début du siècle. Celui qu'elle consacre à la première avocate française, Jeanne Chauvin, le 29 novembre, est de la même veine personnelle.
Son article du 23 avril 1926 (le dernier dans ce journal), « Une belle œuvre sociale », est consacré au sanatorium universitaire de Leysin. Jeanne a-t-elle séjourné dans cet établissement créé en 1922 par le docteur Louis Vauthier et réservé aux étudiants tuberculeux ? Elle aurait alors inauguré une longue série de séjours réparateurs dans des centres de cures. Son témoignage est peut-être de seconde main car son ami Claude Aveline, qui y fut soigné, lui a consacré, plus tard, un discours documenté.
![Journal des débats politiques et littéraires, 4 octobre 1925 [1er article]](../07presse/img_doss_presse/th_journaldebats041025.jpg)
![Journal des débats politiques et littéraires, 9 octobre 1925 [2ème article]](../07presse/img_doss_presse/th_journaldebats091025.jpg)
![Journal des débats politiques et littéraires, 11 octobre 1925 [3ème article]](../07presse/img_doss_presse/th_journaldebats111025.jpg)
![Journal des débats politiques et littéraires, 13 octobre 1925 [4ème article]](../07presse/img_doss_presse/th_journaldebats131025.jpg)
L'enquête qu'elle publie en octobre, en quatre longs articles, est un travail de commande dont on a peine à croire qu'une jeune femme de cet âge ait pu s'y atteler. Interrogeant avec une aisance apparente des ministres et députés représentants du parti radical-socialiste, sur le point de se réunir en congrès à Nice, Jeanne fait la preuve qu'elle s'adapte sans difficultés à toutes les situations.
Le 21 décembre Jeanne a rédigé un article d'une tout autre inspiration : « L'Esprit féminin et l'esprit fasciste », paru dans Le Nouveau Siècle, quotidien fasciste né d'une scission avec L'Action Française et dirigé par Georges Valois [1878-1945]. Je n'ai pu me le procurer mais on en aura une assez bonne idée en parcourant la réplique qu'il s'est attirée de la part d'une militante communiste, Marie-Thérèse Gourdeaux [1882-1960], dans L'Humanité du 27 décembre.

1926
Jeanne Loviton, qui obtient sa carte d’avocate stagiaire le 14 avril, est devenue, dès le mois de février, la secrétaire particulière de Maurice Garçon. Né à Lille le 25 novembre 1889, fils de juriste, avocat au barreau parisien depuis 1911, franc-maçon, grand bibliophile, Maurice Garçon publie depuis plusieurs années des ouvrages curieux sur les sciences occultes. Il a plaidé avec succès dans plusieurs affaires retentissantes et son cabinet occupe à temps plein une secrétaire et deux collaborateurs dont Jacques Mourier, un avocat à la cour d'appel dont on retrouvera le nom dans l'affaire Denoël.


Journal des débats, 23 février 1926
Sur cette photo de presse on aperçoit, assise à la droite de Maurice Garçon, Jeanne Loviton. Son voisin est l'avocat Jacques Mourier, qui plaide aussi dans l'affaire Jollot-Cady, à Melun, le 22 février 1926.
Combien de temps Jeanne est-elle restée au service de Maurice Garçon ? Un an à peine, jusqu'à son mariage avec Pierre Frondaie, ce qui lui valut une grosse colère de son employeur, fâché de perdre une collaboratrice et, peut-être, une maîtresse.
Dans l'un de ses cahiers manuscrits datant de 1926 que Mme Dominique Bona a pu consulter, Garçon a tracé ce portrait de Jeanne Loviton : « J'avais une secrétaire jeune avocate, jolie assez, intelligente moyennement, farcie de littérature et fille de son siècle. Au Palais, elle était l'une de celles dont on ne disait rien de défavorable, ce qui est rare. »
Mais c'était la Jeanne « d'avant Frondaie », une ingénue qui, en quelques mois, s'est affranchie de sa tutelle et qui affiche désormais des toilettes voyantes, des maquillages excessifs et un comportement arrogant : « Elle a rompu avec sa famille, avec ses amis, elle VIT SA VIE, pour parler comme ces gens-là. », écrit-il.
En septembre 1926, après qu'elle lui eût rendu visite, habillée de manière ostentatoire : « Elle pue l'aventure à dix pas. Lorsqu'elle est partie, je l'ai regardée s'éloigner dans son costume de carnaval. Dans mon quartier tranquille où on la connaît, les concierges et les commerçants se sont mis sur leur porte pour la voir passer. Elle était ridicule et avantageuse. D'un coup elle a changé de milieu. Quoi qu'il arrive, c'est une malheureuse déclassée. »
Déclassée : « Qui a perdu sa position sociale ou se trouve dans une classe inférieure à celle à laquelle elle appartenait. » Puisque Jeanne n'écrit pas encore, c'est donc le milieu littéraire où elle s'engage en compagnie de Frondaie qui lui paraît inférieur à celui où il l'avait fait admettre.
Cela ne l'empêchera pas d'être le témoin de Jeanne à son mariage, l'année suivante, mais en offrant aux époux un « bon pour un divorce ». Maurice Garçon était peut-être amoureux, après tout.
Ce n'est pas le cas de l'abbé Jules Lemire [1853-1928], vieil ami de Ferdinand Loviton, qui écrit dans son journal, au printemps 1927 : « Elle veut faire sa vie, elle aura une auto. Elle n'écoute personne. C'est une intellectuelle grisée d'ambition. Les femmes qui n'ont pas de cœur, qui ont poussé en herbe, sont folles et cruelles. »
1927
Pierre Frondaie
Albert René Fraudet, fils de Léon, 43 ans, marchand de meubles au 99 boulevard Haussmann [IXe], et de Marie Louise Meunier, 32 ans, « marchande tapissière », est né le 25 avril 1884 au domicile de ses parents, 3 rue Lavoisier, dans le VIIIe arrondissement de Paris.
Dans les « Mémoires » qu'il entreprit de publier dans L'Ordre de Paris à partir de novembre 1947, Frondaie avoue avoir mené « des études sans suite, interrompues par mes saccades et que n'attesta aucun diplôme : je n'ai que mon permis de conduire », ce que lui reprochait, vers 1915, Claude Léouzon Le Duc, « un de mes meilleurs amis ».
Si ce texte n'est pas plus explicite, une notice autobiographique qu'il avait esquissée en 1944 nous apprend ce que furent ces études : « Fit successivement ses études à l'école communale de la rue de la Bienfaisance [VIIIe], puis au Lycée Condorcet [rue du Havre, IXe], puis au Lycée Carnot [boulevard Malesherbes, XVIIe], avec une interruption d'une année où il fut inscrit à l'Ecole du Commerce, contre son gré. Esprit indépendant, il finit ses études à l'Institution Springer [rue de la Tour d'Auvergne, IXe] (où il fut le condisciple de Georges Mandel). Il refusa de se présenter à des examens après avoir été reçu à la première partie du bachot. »
En 1901, sans diplôme mais amoureux du théâtre, il fait le projet d'entrer au Conservatoire, fréquente la Comédie Française. Cette même année, sa mère meurt subitement à leur domicile de Rueil.
En 1902 il fait la connaissance de la fille d'un lapidaire de la rue de Richelieu à laquelle il est bientôt fiancé : « Afin de pouvoir l'épouser plus tôt, le jeune homme s'engagea au 16e Régiment d'Artillerie, à Rueil. Mais Agathe Garreaud mourut d'une appendicite foudroyante à la fin de 1904. René Fraudet, engagé au printemps de 1903, resta sous les drapeaux jusqu'en 1906. Il refusa tout grade et, dans ses loisirs, il écrivit des pièces de théâtre en vers ».
Après son service militaire, Frondaie quitte la maison familiale de Rueil et s'installe, seul, au 20 de la rue Jacob, dans le VIe arrondissement. Il fréquente assidûment les théâtres parisiens et y propose ses premières pièces, tout en publiant, sous son patronyme, un premier recueil de poèmes (1907), puis un roman (1908).
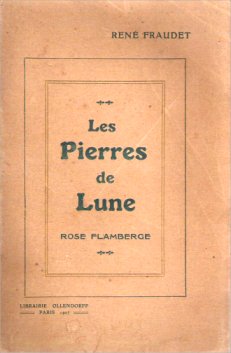
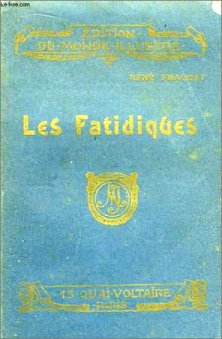
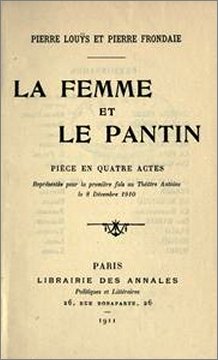
A partir de 1909 il prend le pseudonyme de Pierre Frondaie, qui apparaît au bas des contes qu'il publie dans Le Matin et sur la couverture de La Femme et le pantin, un roman de Pierre Louys qu'il a adapté pour la scène et qui a été joué avec succès au Théâtre Antoine, le 8 décembre 1910. Le 24 novembre 1910 il a fait jouer Montmartre, une pièce dans laquelle débute Valentine Tessier.
C'est à cette époque qu'il a « une liaison passionnée avec l'actrice Andrée Mégard, alors l'une des vedettes les plus en vogue de Paris ». Marie Chamonal dite Andrée Mégard [1869-1952] n'est pas seulement une actrice en vue, elle est aussi, depuis deux ans, la femme de Firmin Gémier [1869-1933], le directeur du Théâtre Antoine, boulevard de Strasbourg : mieux vaut que cette liaison tourne court si le jeune Frondaie veut poursuivre une carrière au théâtre.
Le succès se confirme avec des adaptations de romans de Claude Farrère (L'Homme qui assassina, 1913), de Pierre Louys (Aphrodite, 1914), de Maurice Barrès (Colette Baudoche, 1915), et d'Anatole France (Le Crime de Sylvestre Bonnard, 1916).
Dans plusieurs de ces pièces il a imposé une jeune actrice rencontrée en 1907 qui porte sur scène le pseudonyme de « Michelle » : « il connut Léonie Gillier, alors mineure, et vécut avec elle jusqu'en décembre 1914, date à laquelle il l'épousa (mairie du 8e arrt et église Saint-Augustin) ». Le père de Frondaie est mort ce mois-là.
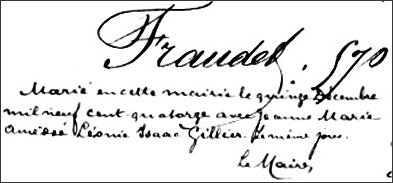
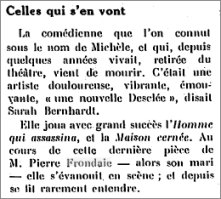
La Rampe, mai 1929
La raison de ce mariage, le 15 décembre 1914, est assez inattendue : « Ce mariage lui sembla indispensable, encore que jusque là il n'y ait point songé, parce qu'il pouvait être tué, ayant été rappelé sous les drapeaux (Il avait été réformé en 1912 au moment d'une période d'instruction militaire et venait d'être versé dans le service auxiliaire). Sa santé semblait alors gravement altérée. Mais naturellement vigoureux, il devait progressivement guérir. »

La Rampe, 23 novembre 1916
Celle de « Michelle », au contraire, se dégrada : « Déjà atteinte par la maladie qui devait l'emporter, à Pau, en 1929, elle s'évanouit en scène le soir de la première [celle de La Maison cernée, le 11 décembre 1919, au Théâtre Sarah-Bernhardt]. On la crut morte. Trois jours encore elle joua, admirablement, le rôle, puis renonça définitivement au théâtre. Elle divorça bientôt et épousa le capitaine Paul Bléry (aviateur). »
D'autres raisons ont poussé Léonie Gillier à divorcer en juin 1922, avant d'épouser Bléry à Arcachon, la même année : Frondaie « avait eu, de son côté, quelques liaisons retentissantes » avec des actrices ou des danseuses de renom, comme Liane de Pougy [1869-1950], ancienne courtisane et future princesse Ghika.
Michelle Gillier ne quitta pas le théâtre aussi rapidement que l'écrit Frondaie et la presse s'indigna qu'elle use du nom de son ex-mari pour obtenir des rôles. Frondaie est gentilhomme et il publie dans Le Figaro, une mise au point, dès le 28 mai 1922 :




Ce n'était pas la première fois qu'il prenait fait et cause pour cette femme qu'il avait trompée et dont il allait divorcer. En 1914, Michelle était intervenue dans une dispute qui opposait l'écrivain à Cora Laparcerie, actrice et co-directrice du Théâtre de la Renaissance, au cours d'une répétition d'Aphrodite. Son mari avait sommé Frondaie d'assumer les paroles de sa femme, et il ne s'était pas dérobé. Un duel eut lieu peu après : Frondaie fut légèrement blessé au bras. Prenait-il de vrais risques ? L'Ouest-Eclair ironise : « Il y avait beaucoup de monde : des photographes, des journalistes, des académiciens et des petites femmes ». Et une caméra était là pour immortaliser l'événement...
L'animosité entre Laparcerie et Frondaie venait d'ailleurs. La comédienne lui avait offert une photo agrémentée de cette dédicace peu amène : « A Pierre Frondaie, qui pourrait tenir un fusil ». C'était une attaque désobligeante car l'écrivain avait voulu s'engager et il avait été réformé à deux reprises, le 13 septembre 1912 et le 29 octobre 1914, pour une hypertrophie coronarienne (dont il devait d'ailleurs mourir en 1948). Il avait répliqué en offrant une photo de lui portant cet envoi canaille (la comédienne avait entretemps pris du poids) : « A Cora Laparcerie, qui pourrait tenir un canon ! »
Cette année-là il avait rencontré Madeleine Charnaux, « remarquablement belle et douée d'un talent déjà puissant de sculpteur (élève de Bourdelle). » Fille de médecin, Madeleine était née à Vichy le 18 janvier 1902 et elle avait exposé ses sculptures bien avant d'épouser Frondaie. Il est probable que c'est à cause d'elle que Michelle Gillier demanda le divorce.

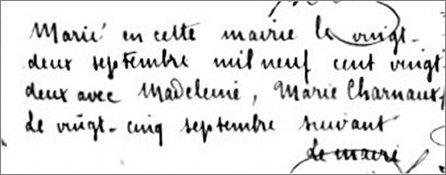
Le mariage de Pierre Frondaie avec Madeleine Charnaux fut célébré le 22 septembre 1922 à Paris, soit quatre mois moins un jour - le délai légal - après son divorce avec « Michelle » Gillier. « Les nouveaux époux voyagèrent », écrit Frondaie, qui ajoute : « C'est à cette époque qu'il commença d'écrire des romans. »

« Les Sablines » au cours des années 1920
C'est aussi à cette époque que Frondaie loua à l'année à Arcachon « Les Sablines », une villa bâtie en 1890 qui avait appartenu à la sœur d'Elisée Reclus, résidence secondaire qu'il conserva jusqu'en 1945, et où il écrivit en partie le roman qui allait le consacrer mondialement : L'Homme à l'Hispano. L'écrivain prenait déjà des vacances à Arcachon en 1912 et il aimait ce paysage dont il écrivait, en 1925, dans L'Illustration : « J'ai vu bien des pays. Je n'en connais pas qui soit moins barbares que celui-ci, et, cependant, il est sauvage ».
L'Homme à l'Hispano, dédié à Madeleine Charnaux, parut entre le 7 mars et le 11 avril 1925 dans cinq fascicules de La Petite Illustration avant d'être édité, en mai, chez Emile-Paul.
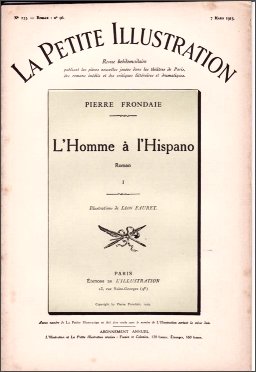
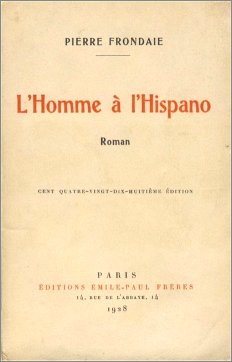
On a du mal à apprécier aujourd'hui ce que fut la carrière extraordinaire de ce roman mondain, salué par une presse unanime, même celle de l'abbé Bethléem qui, dans sa Revue des Lectures, pouvait briser la carrière d'un livre auprès de ses lecteurs catholiques par ses classifications redoutables : le livre figura dès juin 1925 parmi les « romans dont les personnes suffisamment averties peuvent se permettre la lecture » et non dans celle, funeste, des « romans mauvais, dangereux ou inutiles pour la majorité des lecteurs ».
Ecrit dans un style flamboyant, L'Homme à l'Hispano, dont l'action se passe à Biarritz, n'est ni scabreux, ni immoral ; son héros, qui doit bien quelques traits à l'auteur, est désintéressé et il termine sa vie en gentilhomme.
Dans Les Annales politiques et littéraires du 14 juin 1925, Georges de Pawlowski écrit : « Par sa forme poétique, capable de séduire les plus exigeants, par la minutie et l'exactitude de ses descriptions, ce livre est de grande classe. On le lit avec le plus grand plaisir, on le dévore de la première à la dernière page. »
Le succès est au rendez-vous : trois ans après sa sortie de presse, Emile-Paul annonce 200 000 exemplaires tirés, ce qui, chez lui, place L'Homme à l'Hispano juste derrière Le Grand Meaulnes. Frondaie est un homme d'affaires avisé et il négocie très tôt avec son éditeur les droits de son roman à succès contre des parts dans sa société.
Le roman est traduit en Allemagne en 1926, en Russie en 1929. Emile-Paul cède les droits de réédition à d'autres éditeurs pour des collections populaires, comme les Editions de France en 1931 (« Le Livre d'aujourd'hui ») et, surtout, il les négocie avec des producteurs de cinéma.

Julien Duvivier a été le premier à en racheter les droits. Son film, muet, a été tourné en extérieurs à Paris, Bayonne et Biarritz, et il est projeté dans les salles françaises à partir du 13 décembre 1926. En avril 1933 Jean Epstein en a réalisé une nouvelle adaptation sonore avec Marie Bell : c'est celle qui laissera le meilleur souvenir.
Frondaie profite du succès de l'œuvre pour en proposer une adaptation théâtrale en janvier 1928, ce qui donne tardivement de l'urticaire à l'abbé Bethléem, qui doit regretter de ne pas avoir « exécuté » le livre à sa parution : il révèle que L'Homme à l'Hispano est l'adaptation romanesque d'une pièce peu réussie datant de 1924, que Frondaie ressert au public sous un nouveau titre.


Il est vrai que la trame de La Marche au destin est bien celle de L'Homme à l'Hispano, mais qui a jamais regretté que Voyage au bout de la nuit ait été d'abord une pièce de théâtre ? Entre L'Eglise et le roman, il y a un style qui transforme un beau sujet en chef-d'œuvre. C'est aussi le cas pour le roman de Frondaie. Cette charge resta donc sans conséquence.
Est-ce que Pierre Frondaie possède déjà une Hispano-Suiza avant 1925 ? Cette voiture de grand luxe, dont le nom fait référence aux origines hispano-suisses de la marque, alliait l'élégance de sa carrosserie à la puissance de son moteur, et était proposée en 1925 par la société qui la fabriquait près de Paris à 175.000 francs, soit quelque 140 000 euros actuels.
Apparemment, non. Frondaie est un « flambeur » qui dépense plus qu'il gagne mais cette voiture de rêve, dont le nom n'est jamais cité, n'apparaît dans la presse qu'en décembre 1925, c'est-à-dire après qu'il ait acquis sa villa à Arcachon. Et l'écrivain n'est pas très bon conducteur.

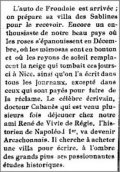

Malgré - ou à cause de - ce succès, le ménage Frondaie-Charnaux se défait rapidement : « Commencée en idylle, l'union ne dure pourtant que trois ans », écrit-il. Dès novembre 1926, en effet, la presse annonce la séparation du couple et, comme Michelle Gillier, quatre ans plus tôt, c'est l'épouse qui demande le divorce.
Frondaie s'y refuse et consulte son avocat, Claude Léouzon Le Duc. C'est à cette occasion qu'il renoue avec Jeanne Loviton, chargée par l'avocat de le persuader de ne pas s'opposer inutilement à un divorce perdu d'avance, lequel divorce sera prononcé le 17 janvier 1927.
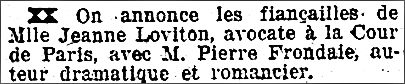
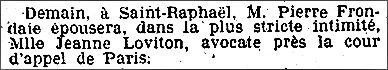
L'Intransigeant, 9 avril 1927 - Le Gaulois, 23 mai 1927
On peut, si l'on veut, adopter la version lovitonnienne de l'idylle qui se noue ensuite entre Frondaie et Jeanne : le fait est que la presse annonce leurs fiançailles trois mois plus tard, et qu'ils se marient le 24 mai 1927 à Saint-Raphaël, après y avoir passé un contrat de mariage, le 17.

Les personnes qui figurent sur la photo de leur mariage méritent d'être citées. Les témoins de Jeanne Loviton étaient Maurice Garçon et René La Bruyère [1875-1951], administrateur de la Compagnie des Messageries maritimes et auteur de romans maritimes ; ceux de Pierre Frondaie, le comte Jacques d'Aiguillon et Jacques Richepin, avec qui Frondaie avait croisé le fer en mars 1914. Derrière Jeanne se trouve Ferdinand Loviton ; à ses côtés, l'actrice de théâtre Cora Laparcerie, l'épouse de Richepin.
Célia Bertin relève que la plupart étaient décorés de la Légion d'Honneur, comme le marié qui, lui, « n'était encore que chevalier ». Frondaie est chevalier de la Légion d’Honneur depuis septembre 1920 (en même temps que Proust), et sera promu officier en août 1929, grâce à l'intervention du ministre Germain-Martin, un ami de Ferdinand Loviton.





Est-ce à cause de son récent divorce que Frondaie impose la discrétion à propos de son nouveau couple ? A une journaliste de la presse féminine parisienne qui lui rend visite au cours de l'été, il présente Jeanne comme sa fiancée. C'est dans la presse d'Arcachon qu'on trouve le plus d'informations à propos du troisième mariage de Frondaie qui, aux yeux de ses habitants, n'est pas le plus attendu. Jamais l'avocate n'y remplacera « l'exquise créature » ni « l'idéale jeune femme » dont la ville a gardé « une vision de grâce et de beauté ».
A Paris non plus l'événement n'a pas été accueilli sans réserve, si l'on en croit les confidences de l'écrivain à Frédéric Lefèvre au cours de son émission « Une heure avec... » :
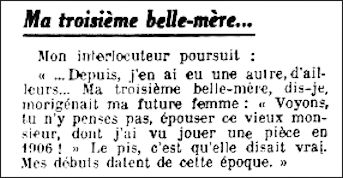
Les Nouvelles Littéraires, 29 juin 1935
Ce mariage a encore irrité quelques unes de ses amies, avec lesquelles Jeanne paraît avoir noué des liens intimes. L'une d'elle, qui signe Alyette, lui écrit le 13 mai à propos de « Zizi », qui habite près de Perpignan et que Jeanne lui aurait préférée : « Pour moi, ceci suffit pour briser à tout jamais, toute confiance et amitié ».
C'est Frondaie qui prend, le 16 mai, la défense de sa femme ; il est persuadé que les deux amies sont victimes d'une machination : « Jeanne n'a rien compris à votre lettre. J'ai aujourd'hui l'habitude de lire sur son beau visage loyal. J'y ai lu, après votre réponse, la stupeur et l'indignation attristée. Il est donc certain qu'elle est une irréprochable amie. Elle juge que vous ne l'êtes plus puisque vous avez douté d'elle. [...] Depuis huit mois déjà, j'ai entendu votre amie me parler de vous. Elle ne me ment jamais. L'amitié qu'elle vous porte, je vous plains de la perdre, sur je ne sais quelle intrigue contre vous deux. Vous avez légèrement attristé un être noble et doux. Permettez à mon expérience déjà longue de vous mettre en garde : derrière toutes les amours, toutes les affections, toutes les pitiés réciproques, il y a des venins et des flèches. »
De quelle amitié s'agissait-il ? En juillet c'est Zizi qui se manifeste, après avoir reçu une « bonne longue lettre » de Jeanne : « J’avais si peur que ton mariage ne t’ait rapprochée de tes parents. On subit souvent sa famille, n’est-ce pas ? Et la vie nous oblige parfois à faire des concessions. En effet je suis malheureusement un peu au courant de tout l’incroyable amas de ragots, de cancans infâmes que seuls des cerveaux malades pouvaient imaginer. Je t’avais écrit chez tes parents, tu venais de les quitter et je n’en savais rien. Selon son habitude ton père a cru bon de lire cette lettre qui ne lui était pas adressée. »
On ne sait ce qu'elle contenait mais Ferdinand Loviton en conçut une « immense fureur. Dans sa colère il a oublié tout souvenir d’éducation et même d’instinctive décence, si jamais ces sentiments ont existé chez lui, ce dont je doute, même à l’état embryonnaire. Je te montrerai peut-être un jour la lettre qu’il m’a écrite, et qui a plutôt l’air d’émaner d’un fou que d’un professeur de droit, considéré jusqu’à maintenant comme jouissant de toutes ses facultés. Dans ma lettre je te racontais la fin tout à fait définitive de notre amitié pour Philotte, de tenir ceci grâce à des cancans tout frais faits par Alyette avec qui je m’étais brouillée complètement et qui avait fait de Philotte sa meilleure amie. »
Ces amitiés contrariées ont amené des propos qui ont pu provoquer la colère du père de Jeanne : « Certes j’ai peut-être qualifié sa conduite en termes sévères, mais j’ai depuis entendu dire qu’Alyette - à qui ma lettre a de suite été soumise - en avait conclu que je voulais faire sous-entendre des goûts de “ prisonnières ” dans la tendresse qu’elle témoignait à sa nouvelle amie. Elle me connaît je crois bien peu pour avoir pu croire que j’aurais “ gazé ” si cela avait été ma pensée. Et d’ailleurs avoue qu’il faudrait être toquée pour imaginer cela d’Alyette dont la vertu est légendaire, et presque excessive. Quant à Philotte, sa vie plaide pour elle et je n’aurais jamais eu l’audace de lui attribuer ces goûts. Et puis quand on a beaucoup aimé des êtres comme j’ai aimé ceux-là, il serait impossible il me semble de les salir ainsi. »
L'amitié de Zizi n'est peut-être pas à l'abri de la calomnie : « Si cela était possible, j’aimerais que tu réclames à ton père les lettres que je t’ai écrites, dont il voudrait faire une arme de presque chantage, et que tu les détruises. »
Jeanne est à présent l'épouse de Pierre Frondaie et sans doute cette amitié encombrante lui cause-t-elle des soucis car Zizi revient peu après à la charge : « Je ne sais si tu es au courant de certains faits survenus après ton départ de chez tes parents. Ce n’est pas de ta faute si Mr Loviton est ton père, et je ne puis t’en vouloir si sa grossièreté a éprouvé le besoin de se déchaîner à mon égard d’une façon si surprenante et si violente que cela relève plutôt du domaine de la folie que de celui de l’éducation. Je te dis tout cela sachant que souvent tu n’étais pas de son avis. »
L'année suivante elle se manifeste à nouveau : « Chérie j’aimerais tant te voir et faire connaissance avec ton mari. Je suis très certaine qu’il me sera très sympathique puisqu’il t’aime et que tu le lui rends. »
Sa dernière lettre, qui date toujours de 1928, semble indiquer que Zizi n'a pas rencontré le couple Frondaie, mais que Jeanne lui a écrit : « Comme je suis reconnaissante à Pierre de te rendre si heureuse, chérie. Je sais qu’il est bon et qu’il t’aime, mais ta lettre me le confirme tellement ! Tu vois tout avec les yeux du bonheur - le froid - les tramways - les amoureux - et même les pauvres. [...] Vive tes petites boucles sur la nuque.Je crois que tu seras peut-être encore plus jolie ainsi, et ce n’est pas peu dire. Zut, Pierre va me doter de goûts “ spéciaux ” si cette phrase lui tombe sous les yeux. »
Frondaie a forcément lu ces phrases équivoques puisque les lettres de Zizi se trouvent dans ses propres archives. Et les relations troublantes de Jeanne et de son père, qui y sont évoquées, lui fourniront un matériau de choix pour un roman paru en 1930 : Béatrice devant le désir. Cela ne l'empêche pas de dédicacer amoureusement ses anciens livres à sa jeune épouse. Il les enverra aussi, un peu plus tard, à la mère de Jeanne.
![Les Fatidiques (1908) dédicacé à Jeanne Loviton [Archives d'Arcachon]](../07presse/img_doss_presse/th_fatidiques-loviton.jpg)
![L'Eau du Nil (1926) annoté par Jeanne Loviton [Archives d'Arcachon]](../07presse/img_doss_presse/th_eaudunil-loviton-2.jpg)

Il n'est pas sans intérêt de relever, sur quelques photos figurant dans les archives Frondaie à Arcachon, la transformation physique assez surprenante de Jeanne Loviton entre 1925 et 1928 :




1928
Après leur mariage, Jeanne et Pierre Frondaie ont rejoint Paris et occupent désormais l'appartement de l'écrivain, 3 rue Beethoven, dans le XVIe arrondissement, où l'on ne cuisine pas : chaque jour les Frondaie déjeunent au Café de Paris et dînent à la Tour d'Argent. Jeanne s'en plaint rapidement : elle mange trop, a mal au ventre et prend du poids.
Maurice Garçon avait introduit Jeanne Loviton dans le monde des avocats, Frondaie la mène en Hispano-Suiza dans celui de la littérature : « Théâtre, littérature, voyages, interviews, publicité », écrit-elle dans son « Curriculum vitæ », en ajoutant qu’elle examine aussi les contrats d’édition et de films de son mari, auteur dépensier et couvert de dettes, « sûr que ses succès finiraient toujours par boucher les trous. »
Frondaie se déplace pour les nombreuses adaptations théâtrales et cinématographiques de ses œuvres et il mène grand train un peu partout en compagnie de sa jeune épouse-secrétaire, qui s'adonne à de nombreux sports et pose pour des magazines de mode, toujours sous le nom de Jeanne Pierre-Frondaie :





Jeanne Loviton avait exigé et obtenu de conserver son activité d'avocate mais il ne semble pas qu'elle se soit beaucoup dépensée en plaidoiries. Je n'ai retrouvé que trois mentions de la présence dans les prétoires de Me « Jeanne Pierre-Frondaie » ; le chroniqueur de Comœdia écrit d'ailleurs, en octobre 1929, que « c'est la première fois qu'elle reprend la toge d'avocate depuis son mariage avec l'auteur dramatique », ce qui n'est pas tout à fait exact : le 19 novembre 1928 Jeanne a plaidé avec conviction à Rouen dans une affaire qui ressemble fort à celle de sa mère : « séduction, promesse de mariage, abandon de la femme, enfant, engagement de l'entretenir »...



Mais sans doute Jeanne se dévoue-t-elle plus efficacement à son bureau. Le 11 février 1928 un architecte parisien lui écrit qu'il accepte de se charger de trouver un terrain à Paris pour la construction d'un théâtre. Un critique littéraire belge, qu'elle a relancé, lui assure qu'il veillera à ce que paraisse dans sa revue un article concernant un livre de son mari.
Après avoir été la secrétaire dévouée de Maurice Garçon, Jeanne devient celle de Pierre Frondaie, ce qui implique qu'elle cesse de seconder son père, place de la Sorbonne.
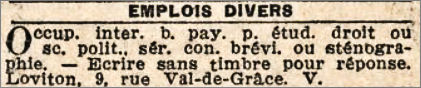
Le Journal, 27 septembre 1928
1929
14 avril : L'Avenir d'Arcachon mentionne la présence à Arcachon du couple Frondaie « pendant au moins deux mois ». En mai le journal annonce que le roman de Frondaie, Deux fois vingt ans, sera porté au cinéma par Léonce Perret et filmé prochainement à Arcachon.
26 décembre : Pierre Frondaie écrit à Xavier de Hauteclocque que sa femme est souffrante. Quelques jours plus tard Jeanne écrit au même pour lui parler d'un accident : elle a fait une chute et elle a le nez cassé. Cette chute a eu lieu au nouveau domicile du couple, 14 rue des Marronniers (XVIe). Célia Bertin met cela sur le compte d'une dispute violente avec Frondaie, en s'appuyant sur une lettre écrite le 18 janvier 1930 par Jeanne à son amie Marguerite Thibon, dans laquelle il est question de « mettre le mot fin à cette nouvelle étape de ma vie. »
Rien, dans la correspondance de Jeanne Loviton, ni dans son « Curriculum vitæ », ne permet de croire que Frondaie fut violent avec elle. Seul Maurice Garçon note dans son journal, à la date du 9 octobre 1926 : « On raconte communément qu'il bat les femmes ». Pourtant son attitude avec ses deux premières épouses plaide en sa faveur. D'ailleurs Mme Bertin ajoute qu'il pourrait aussi bien s'agir d'un avortement ou d'une fausse couche...
Jeanne Loviton fut effectivement hospitalisée à la Villa Molière, une maison médico-chirurgicale d'Auteuil, du 16 décembre au 18 janvier. Entre le domicile des Frondaie et cet hôpital, il y a moins de deux kilomètres, et l'écrivain possède une voiture. C'est pourtant dans une ambulance qu'elle y fut transportée, durant la nuit, et dans l'urgence car l'établissement a mal noté le nom de l'écrivain : la facture qui suivra est libellée au nom d'un M. « Brodey ».



La première facture envoyée par l'hôpital, le 23 décembre, mentionne la location de la salle d'opération de nuit, et une série de médicaments parmi lesquels de l'électrargol, un antiseptique utilisé, jusqu'à la fin des années trente, dans les maternités pour les cas de métrorragies, c'est-à-dire de saignements causés par une grossesse extra utérine rompue, ou consécutifs à l'administration d'œstrogènes (avortement médical).
Elle mentionne aussi la location d'une seconde chambre : Frondaie a accompagné sa femme depuis le début de son hospitalisation. La dernière facture, envoyée le 18 janvier, porte en compte, comme les trois notes intermédiaires, la location de deux chambres : Frondaie est donc resté auprès de Jeanne durant tout son séjour à la Villa Molière.
Le médecin qui envoie, le 19 janvier, sa note d'honoraires à l'écrivain est le docteur François Moutier [1881-1961], gastro-entérologue et chef de laboratoire à la faculté de médecine de Paris. Pierre Frondaie, qui n'était pas aussi désinvolte que le laissent entendre Jeanne Loviton et sa biographe, avait classé soigneusement ces documents dans un dossier à part. Comme c'est lui qui a réglé tous les frais relatifs à ce séjour hospitalier, il n'aurait pas manqué d'y joindre la facture d'un chirurgien, par exemple.
Il est donc possible que Jeanne Loviton ait été hospitalisée d'urgence pour une appendicite aiguë ou pour une fausse couche, mais en aucun cas pour une fracture du nez. Une lettre envoyée le 20 février 1930 à Frondaie par Olivier Jallu, un avocat parisien, ne parle pas d'accident mais de maladie : « Nous n'avons rien su de sa maladie ni du danger qu'elle a couru... Mais dont votre lettre nous dit qu'elle est heureusement sortie. Où en est-elle ? Commence-t-elle à recevoir ? Nous irons la voir aussitôt que nous serons sûrs de ne pas la fatiguer. »
Une lettre de Frondaie, écrite le 30 mai 1940 à Jeanne, montre d'ailleurs les sentiments qu'il continue de témoigner à une femme dont il est alors séparé : « Ton inestimable lettre se termine par : “ Porte-toi bien ”. C’est un vœu que j’ai fait souvent pour toi depuis l’époque de la première opération. A cette époque, je continue à croire que la tendresse, les soins, les prières que j’ai prodigués autour de toi, et à ton intention, ont beaucoup contribué à te conserver une existence que tu as menée, depuis, à ta guise. »
Elle indique aussi que Jeanne a subi une seconde opération, qui eut lieu en janvier 1931. Le 1er février 1931 L'Avenir d'Arcachon, qui mentionne la présence de Frondaie aux « Sablines », ajoute : « Mme Frondaie, qui vient de subir une opération à Paris, viendra bientôt le rejoindre ». Quelle opération ? Les archives Frondaie sont muettes à ce sujet mais on ne peut s'empêcher de faire un rapprochement avec une lettre écrite à sa muse en mai 1945 par Paul Valéry, qui n'ignorait rien de son passé : « Comme par deux fois tu as tué ce qui devait naître de toi. Ainsi tu viens de tuer froidement un être incomparable, un éon dont la beauté ne t'a pas attendrie. Tu l'as tué au nom de ta vie. »
1930
Janvier : Parution de Béatrice devant le désir dans quatre livraisons de la Revue de France, avant d'être publié en librairie par Emile-Paul. Ce roman de Pierre Frondaie est-il destiné à punir son épouse coupable de relations suivies avec Xavier de Hauteclocque ? Le public n'en saura rien et le livre connaîtra le même succès que les précédents mais, comme le rappelle Dominique Bona, l'histoire qu'il raconte ne pouvait manquer de blesser cruellement Jeanne, si attentive à ce que son histoire personnelle ne soit connue.





L'héroïne du roman, élevée dans une institution religieuse de la rue Notre-Dame-des-Champs, orpheline d'une « fille-mère et d'un raté », est élevée par un père d'adoption, amoureux de sa fille au point de décourager tous ses prétendants et de vouloir l'épouser pour la garder près de lui. Dans le livre Béatrice, qualifiée de « bâtarde », mène une vie lamentable au milieu de « gigolos frôleurs et de filles de mauvaise vie », puis rencontre les Léouzon Le Duc sous le nom transparent de Houdan-Farduc...
L'histoire est scabreuse car elle retrace les relations incestueuses de Jeanne et de son père. Frondaie s'est servi des confidences imprudentes qu'elle lui a faites, et des lettres édifiantes qu'elle lui a laissé lire, deux ans plus tôt. Jeanne Loviton veillera par la suite à cadenasser sa biographie. Mais, durant plus de dix ans, Béatrice a apporté de gros tirages aux frères Emile-Pauil, qui en cèderont en 1944 les droits cinématographiques à Jean de Marguenat.
La jeunesse malheureuse de Jeanne Pouchard aura fait les délices de milliers de lecteurs et de spectateurs qui, à aucun moment, n'ont identifié l'héroïne de ce roman freudien. Chez les Loviton, en revanche...
Le 22 avril, le journaliste Max Frantel consacre un long article très documenté à Jeanne, ses débuts et ses talents. On se demande d'abord d'où vient cette subite attention pour une jeune femme avocate, mais on est vite fixé : Me Jeanne-Pierre Frondaie « porte un beau nom ». Celui de son mari, l'écrivain à succès qui publie ses romans en feuilleton dans les journaux, dont Comoedia...

7 mai : Alors que le couple Frondaie passe quelques vacances à Arcachon, une galerie parisienne du boulevard Haussmann expose des toiles du peintre André Paz, dont la plupart sont des portraits ; un journal relève ceux de Frondaie, de sa femme, et d'une de ses amies, l'avocate Simone Penaud. L'année suivante l'artiste expose au Salon des Indépendants et le portrait de Jeanne est celui que choisit Comœdia pour illustrer son article. En août 1934 les portraits du couple Frondaie, réalisés par le peintre russe Georges de Pogédaïeff sont exposés à Arcachon et le journal local s'enthousiasme pour celui de Jeanne, « la perle de la collection ».





Septembre : Les Frondaie sont à Arcachon, où va débuter le tournage de « Deux fois vingt ans », un film de Charles Tavano tiré du roman éponyme de l'écrivain à succès. La presse arcachonnaise signale leur présence dans les salons de thé à la mode, et L'Intransigeant les montre faisant du cheval dans une forêt proche.
C'est pourtant ce mois-là qu'a lieu une première rupture dont témoigne cette lettre adressée d'Arcachon par Jeanne à son mari, rentré à Paris : « Adieu, Pierre. Je suis déjà loin. Tu as, par ta faute, piétiné l’immense amour que j’avais pour toi. Mille fois tu as dit : Tu partiras si tu veux, mais je ne changerai pas. En effet on ne peut changer sa nature, tu resteras le même. Je pars. J’ai signé ma requête en divorce. Rien ne me fera revenir sur une décision que la douleur d’exécuter me faisait seule remettre. Je crève des souffrances accumulées pendant 4 ans et de cet assassinat de mon amour. »
« Tu resteras le même » : Frondaie n'a pu s'empêcher de courir le cotillon, pense-t-elle, et elle en a été informée en ouvrant un courrier : « Tu as près de toi une enfant charmante et douce. Tu lui as écrit qu’elle serait la dernière passion de ta vie, qu’elle le soit donc. [...] Je m’excuse d’avance des procédés judiciaires , il faut en passer par là quand on n’a plus la force d’être malheureuse ni le courage de se tuer. Du plus profond de mon cœur, je souhaite que tu trouves le bonheur et que tu saches le garder. Toute ma vie je prierai Dieu pour toi. »


Cette jeune fille s'appelle Maria Favella, et elle sera bien la dernière passion de Pierre Frondaie. Née le 15 février 1907 à Ajaccio, elle a figuré dans une pièce de l'écrivain, Les Amants de Paris, dont la première eut lieu le 20 octobre 1927 au Théâtre Sarah-Bernhardt. Frondaie en est amoureux et l'a installée dans un hôtel d'Arcachon, où il lui écrit des lettres qui seront, par subterfuge, lues par l'épouse légitime, laquelle décide de lancer une procédure de divorce.
Frondaie - ou Maurice Garçon, l'avocat de Jeanne - l'en dissuade et elle lui écrit plus tard : « Aime-moi, d’avoir, à cause de toi, renoncé à un divorce auquel je tenais plus qu’à tout car il m’assurait une indépendance dont j’ai besoin pour continuer à vivre. »
Cette lettre signée « Ta petite fille modèle » paraît indiquer que l'épouse bafouée avait sans doute réclamé une pension alimentaire, mais elle avait aussi pris d'autres mesures : le 30 novembre, L'Avenir d'Arcachon écrit que le couple Frondaie plaide en divorce et que Mme Frondaie a fait apposer les scellés sur leur villa « Les Sablines ».
On peut aussi se demander si la plaie ouverte en janvier avec la publication de Béatrice devant le désir ne s'est pas envenimée.
1931
Février : A la suite de l'opération mentionnée plus haut, Jeanne Loviton prend quelque repos dans les Alpes, d'où elle écrit à son mari qu'elle attend vainement de ses nouvelles : « L’inquiétude a été si grande que j’ai même écrit à ma secrétaire, la priant de se renseigner sur ton sort avant de recevoir ta dépêche mais cette dépêche m’annonçait une lettre qui n’arrive pas. [...] Pour moi je vais beaucoup mieux c’est-à-dire que outre ma santé qui revient je suis dans la véritable atmosphère qui me convient et me permet de m’épanouir. Neige et silence. Voilà une vitamine que propose mon professeur de ski. »





Considérant sa mine épanouie sur la photo qu'elle envoie alors à son mari, il apparaît que la vitamine proposée par ce galant moniteur de ski s'est révélée efficace. Entretemps, à Paris, la presse mentionne les déboires sentimentaux de l'écrivain. C'est à cette même époque qu'il publie Le Voleur de femmes, un roman sentimental dédié « à Jeanne Pierre Frondaie ».
Frondaie paraît aussi traverser une période financièrement difficile. Le 30 mars il confie à un marchand d'art parisien, Paul Pétridès, un tableau de Maurice Utrillo (« La rue des Saules ») d'une valeur de 50 000 francs. C'est un dépôt valable deux jours, le temps de trouver la somme en question. En mai c'est un bijoutier de la rue Saint-Honoré qui lui réclame le reliquat d'une facture impayée pour une bague et un collier destinés à Mme Frondaie. Or Frondaie est un client de choix : dans une lettre de 1938 il rappelle à l'avocat du bijoutier qu'il lui a acheté « pour plus de 100.000 francs de bijoux ».
Le « Curriculum vitæ » précise qu'à cette époque, « Jeanne Loviton ne songeant pas à refaire sa vie, accepta - par faiblesse peut-être - un modus vivendi d'amitié et de liberté ».
Elle s'installe au 5 de la rue de Champagny (VIIe), dans un immeuble où habite la romancière Germaine Beaumont. Cette petite artère piétonne se trouve derrière l'église Sainte-Clotilde et relie la rue de Martignac à la rue Casimir-Périer, à deux pas de la jonction de la rue de Grenelle avec le boulevard des Invalides, un endroit qu'elle retrouvera quatorze ans plus tard, dans des circonstances dramatiques.

Le 17 novembre elle écrit affectueusement à son « grand petit Pierre » aux « Sablines » pour lui expliquer sa nouvelle existence à Paris : « Il n’y a pas de pendule, pas même de montre ici. Je ne sais ni l’heure ni le jour, la porte de ma chambre est bien fermée, la béatitude m’envahit. Je veux t’écrire, enveloppée de cette douceur, de ce calme, de cet au-delà où je suis. Mes actes n’ont pas d’importance et que j’ai vu tel ou tel, ou celui-ci ou celle-là, qu’importe, voilà l’extérieur de ma vie. Je l’offre à ceux qui me rencontrent et peut-être me connais-tu assez maintenant pour réclamer de moi autre chose que des gestes. Eh bien sache que je suis au chaud en moi-même, que je m’y prélasse comme sur la seule couche où je puisse vraiment dormir ou rêver. Je suis très bien avec moi-même, sans doute parce que j’ai trouvé l’équilibre malgré mes nerfs fatigués, parce que je suis sage et que mes sentiments ont trouvé leur rythme. Je pense aux Sablines où j’ai passé en septembre des jours de ciel, à toi, mon Grand Intérêt Vital, car tu sais que si je souffre souvent près de toi, c’est que je ne sais rien accepter de toi avec indifférence. C’est que tout me heurte ou me comble. » Elle lui demande pour finir de l'appeler au téléphone : « Je veux savoir seulement que nos cœurs sont " d’accord ”. Je t’embrasse tendrement. »
Jeanne Loviton, qui a désormais toute liberté de vivre sa vie comme elle l'entend, croit nécessaire d'assurer son mari qu'elle est « sage ». Longtemps elle restera obsédée par cette image de « petite fille modèle » qu'elle a dû montrer à une famille austère et surtout, à un père dominateur et possessif. En septembre 1945 encore, elle écrit à Robert Denoël : « je veux être heureuse complètement, je me retourne vers les efforts passés avec mélancolie. Avoir été si sage... malgré tant de folies, ce n’était pas de mon âge ! je me suis trop contrainte. Je veux vivre. »
Dans l'immédiat elle voit beaucoup de monde à Paris : écrivains, artistes ou avocats, certains rencontrés en compagnie de Frondaie, d'autres nouveaux venus. Il ne paraît pas qu'elle ait repris son travail d'avocat, mais elle possède probablement un bureau, place de la Sorbonne (où son père a, deux ans plus tôt, adjoint aux « Cours de droit » les Editions Domat-Montchrestien) puisque, dans sa lettre de février, elle parle de « sa secrétaire ».
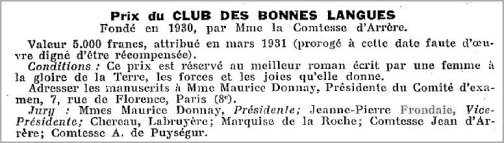
Annuaire général des lettres, 1931
Elle pose rapidement le pied dans le monde de la littérature, qui lui est devenu familier grâce à Frondaie, non par sa plume, qui n'existe pas encore, mais par ses relations : elle fait partie d'un cercle littéraire féminin créé en 1930 par la comtesse d'Arrère qui récompense d'un prix de 5 000 francs « le meilleur roman écrit par une femme à la gloire de la terre, les forces et les joies qu'elle donne ». Jeanne est bientôt vice-présidente de ce « Club des Bonnes Langues ».
1932
Dans son « Curriculum vitæ » Jeanne Pierre-Frondaie écrit qu'elle « recommença à faire du journalisme ». Une carte de presse de rédactrice lui a été octroyée par Paris-Midi, un quotidien qui tirait alors à 80 000 exemplaires et auquel collaborait l'un de ses vieux amis, Bertrand de Jouvenel, qui avait dû lui en faciliter l'accès.
Elle est chargée par son journal de rendre compte de la conférence mondiale pour le désarmement réunissant 62 pays qui se déroule à Genève à partir du 2 février. C'est là qu'elle rencontre Dino Grandi di Mordano [1895-1988], le ministre italien des Affaires étrangères. Fasciste de la première heure, il mènera toute sa carrière politique aux côtés de Mussolini, puis s'exilera en Amérique du Sud, où Jeanne le reverra encore, en 1953.
Elle s'est liée plus tôt avec Claude Aveline, qui l'accompagne au cours d'un voyage d'agrément en Espagne et au Portugal, en août et septembre. Né le 19 juillet 1901 à Paris où ses parents, fuyant les persécutions raciales en Russie, se sont installés en 1891, Eugen Avtsine a publié ses premiers poèmes en 1919 sous ce pseudonyme, qu'il a conservé lorsqu'il est devenu éditeur en 1922.


Dino Grandi en 1930 Paul Valéry et Claude Aveline en 1925, rue Madame
Installé rue Madame à partir de 1925, Aveline a publié en édition de luxe trois œuvres de Paul Valéry : Au crayon et au hasard [1925], Etudes et fragments sur le rêve [1925], et une édition corrigée de Variété [janvier 1926]. En mai 1932 il a cédé son fonds d'édition pour se consacrer à la littérature. Lui aussi gardera d'affectueux contacts avec Jeanne jusqu'à sa mort, survenue le 4 novembre 1992.
Jeanne Loviton n'a pas fait que des voyages et des rencontres amoureuses, cette année-là : elle a rédigé avec son mari un « roman à quatre mains » qui paraîtra l'année suivante chez Emile-Paul. Dès le 23 mars Pierre Frondaie écrit à son éditeur : « J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que Mme Jeanne Loviton, avocat à la Cour, est ma collaboratrice dans le prochain roman dont vous aurez le manuscrit (en avril et mai). Je vous rappelle que, selon nos conventions, je garde le droit de m’adjoindre des collaborateurs anonymes, à charge pour eux de respecter les obligations de notre traité, et à charge pour vous de leur payer directement leurs droits. Les droits de Jeanne Loviton sont de vingt-cinq pour cent des droits totaux. Vous aurez donc à lui payer à la remise du manuscrit 31.250 F. Par dérogation, je suis chargé de vous dire que Mme J. Loviton acceptera des mensualités de frs. 5.000 - à dater d’août 1932, avec le solde de 1.250 F le sixième mois. »
Pourquoi 25 % alors que les deux écrivains se partagent le travail, selon l'avis au lecteur ? Le manuscrit conservé aux Archives d'Arcachon permet de vérifier que, sur les 222 pages que comporte le volume imprimé, seules les pages 98 à 111 [le chapitre 6] sont dues à la plume de l'écrivain débutant. Tout le reste est écrit par Frondaie ou entièrement réécrit par lui.



Dans son « Curriculum vitæ » Jeanne Loviton déclare hardiment qu' « elle écrivit même alors avec lui un roman par lettres qu'elle refusa de signer, voulant situer son nom sur un autre plan, puis se remit à son propre travail ». On ne voit pas trop de quel nom, ni de quel plan, ni même de quel travail il peut s'agir puisqu'en toutes circonstances, elle utilise le nom que lui a donné Pierre Frondaie.
En septembre 1932 Frondaie avait publié un autre roman chez Emile-Paul : Zigoël, et il en avait fait parvenir un exemplaire à la mère de Jeanne, qui le remerçiait ensuite en termes choisis : « A Monsieur Pierre Frondaie qui sait bien pour l'avoir chanté en de beaux vers que la vie ne vaudrait que d'être bâillée si nous n'avions le domaine illimité du rêve et de la poésie, pour y promener notre esprit en robe de gala. »
1934
Février : Voyage en Amérique à bord du « Lafayette » en compagnie de Marguerite Thibon, avec escales à New York, La Havane et dans les Caraïbes. Ce premier paquebot à moteur de la Compagnie Générale Transatlantique, affecté à la ligne Le Havre - New York, mis en service en 1930, sera victime d'un incendie huit ans plus tard au Havre et livré à la démolition.
1935
3 avril : Décès de Xavier de Hauteclocque. Les circonstances de sa mort sont suspectes. Auteur de nombreux articles et ouvrages contre le National-Socialisme, comme A l'ombre de la croix gammée (1933), La Tragédie brune (consacré au camp de Dachau,1934) et Police politique hitlérienne (1935), accusé d'appartenir au 2e Bureau français, Hauteclocque aurait fait l'objet d'un « contrat » : lors d'un séjour en Allemagne en février, il aurait été empoisonné dans une brasserie, et serait mort dans une clinique parisienne au terme de trois semaines d'agonie.
La presse de l'époque est discrète à propos de la mort inopinée de ce jeune homme de trente-sept ans : Le Figaro écrit qu'il a été ravi aux siens « par un mal soudain, qui se développa en quelques jours, et qui ne pardonna pas. »
L'Action Française qui rend compte, le 6 avril, de ses obsèques où figurent Fernand de Brinon, Etienne de Nalèche, Jacques Bainville, Charles Maurras, et qui reproduit le discours d'Horace de Carbuccia, n'aborde pas la question de la mort soudaine du journaliste, pas plus que le Journal des débats où Hauteclocque avait débuté, dix ans plus tôt.
Dans un livre paru en 1987 Adry de Carbuccia écrit qu'elle et son mari, prévenus par Mme de Hauteclocque, s'étaient précipités inutilement à l'hôpital : « Vous arrivez trop tard, Xavier vient de mourir. Avant, il m'a fait jurer " Dis à Carbuccia que les Nazis m'ont empoisonné, que deux officiers dont j'espérais obtenir d'importants renseignements m'avaient invité à prendre un verre, en buvant je m'écorchais la bouche, le verre qu'ils m'avaient offert était ébréché. Je suis sûr qu'ils m'ont inoculé du poison ou un microbe " » [Du Tango à Lily Marlène].
16 avril : Décès, à moins de soixante ans, de Juliette Pouchard dite Denise (ou Denyse) Loviton à son domicile du VIe arrondissement. Elle a été inhumée, trois jours plus tard, dans le petit cimetière Notre-Dame de Versailles :

1er novembre : Parution, dans le Mercure de France, du premier texte littéraire de Jeanne Loviton : « Solange de bonne foi », une nouvelle de 29 pages dédiée à la mémoire de Xavier de Hauteclocque et signée « Jean Voilier ».
C'est une histoire sentimentale qui finit mal, l'héroïne se suicidant à la fin, mais il ne paraît pas qu'un lien doive être établi avec la mort de Hauteclocque, à propos duquel des rumeurs de suicide ont couru Paris : Jeanne Loviton dédie simplement son texte à l'un de ses premiers amoureux qui vient de mourir. Pourquoi le signe-t-elle Jean Voilier ?
« Jean Voilier » est le nom du protagoniste d'un roman sans grand succès de Charlotte Rabette et Fernand Divoire, La Bourgeoise empoisonnée, paru en 1933 aux Editions Cosmopolites (établies au 151 bis, rue Saint-Jacques, près de la Sorbonne, et des Editions Domat-Montchrestien).
Dans son introduction au catalogue d'exposition « Baudelaire to Beckett. A Century of French Art & Literature », Carlton Lake affirmait en 1976 qu'avant de prendre le pseudonyme de Jean Voilier, Jeanne Loviton commença d'écrire sous celui de « Jeanne Larivière », mais je n'ai rien retrouvé à ce sujet. N'explorons pas inutilement le zodiaque, Jeanne Loviton est née sous le signe du bélier et l'élément aquatique n'est pas son point fort.
Pourquoi un pseudonyme masculin ? Dans son « Curriculum vitæ », Jeanne assure que c'est Emile-Paul, l'éditeur qui publiera trois mois plus tard son premier roman, qui le lui a suggéré : « celui-ci lui demanda expressément - puisque de toute façon elle voulait prendre un pseudonyme - de choisir un pseudonyme masculin car, lui, l'éditeur du Grand Meaulnes, de Giraudoux, de Pierre Benoit, de Pierre Frondaie et de tant d'autres, lui, propriétaire d'un très belle librairie place Beauvau, affirmait que les livres de femmes ne se vendaient pas. »
Les éditeurs qui, depuis la fin de la guerre, publiaient avec succès les romans de Colette ou de Maryse Choisy lui auraient-ils fait la même recommandation ? Et est-ce bien Emile-Paul qui lui a suggéré ce changement de sexe littéraire ? Michel Jarrety publie une note datée du 16 mai 1935 extraite des Cahiers de Paul Valéry : « Conduit à l'hôtel de ville par Dame F. Lui conseille pseudonyme Madame Jean. » Depuis le 6 juillet 1933 Jeanne possédait un permis de conduire et « Dame F. » peut désigner Jeanne Frondaie, qui a entretemps renoué avec Valéry.
Le 17 décembre, Le Figaro consacre une belle demi-page au Gala de la Fourrure qui a eu lieu la veille au Ritz, où défilaient toutes les dames du Gotha. Mme Pierre Frondaie, qui veut bien écrire mais sans rompre avec la belle société où son mari l'a introduite, arborait une fourrure mais laquelle : hermine, renard argenté, panthère ou vison ? Comme témoignage de l'authenticité de ces dépouilles, « on présenta un petit renard vivant, tout habillé d'argent ».

Le 27 décembre : A la demande d'Albert Chardeau, avoué rue de Ponthieu représentant Jeanne Loviton, le Tribunal civil de première instance du département de la Seine rend une ordonnance de non conciliation. La plaignante, qui ne demande pas de pension alimentaire, est autorisée à résider 5 rue de Champagny, à Paris. L'acte est signifié à Frondaie par l'huissier Louis Bennet.
![Ordonnance de non conciliation, 27 décembre 1935 [Archives d'Arcachon]](../07presse/img_doss_presse/th_Ordonnancenonconciliation1.jpg)
![Ordonnance de non conciliation (suite), 27 décembre 1935 [Archives d'Arcachon]](../07presse/img_doss_presse/th_Ordonnancenonconciliation2.jpg)
1936
Le 14 janvier : En vertu du jugement de non conciliation rendu le 27 décembre, l'avoué Chardeau avertit Frondaie que sa femme l'assigne pour « injures graves » devant le Tribunal civil de la Seine : l'écrivain « se désintéresse totalement de son ménage et abandonne le domicile conjugal sans motifs ». D'autre part une sommation lui a été faite le 8 juin précédent par un huissier d'Arcachon, auquel il a répondu que, « pour les raisons qu'elle connaît Madame Fraudet sait fort bien que la vie commune est devenue impossible. »
![Assignation devant le Tribunal civil (1), 14 janvier 1936 [Archives d'Arcachon]](../07presse/img_doss_presse/th_Demandedivorce1.jpg)
![Assignation devant le Tribunal civil (2), 14 janvier 1936 [Archives d'Arcachon]](../07presse/img_doss_presse/th_Demandedivorce2.jpg)
![Assignation devant le Tribunal civil (3), 14 janvier 1936 [Archives d'Arcachon]](../07presse/img_doss_presse/th_Demandedivorce3.jpg)
![Assignation devant le Tribunal civil (4), 14 janvier 1936 [Archives d'Arcachon]](../07presse/img_doss_presse/th_Demandedivorce4.jpg)

Quelques jours plus tard paraît chez Emile-Paul le premier roman de Jean Voilier : Beauté raison majeure, dédié à son père, Ferdinand Loviton. Jeanne en a offert un exemplaire sur Hollande à son mari, qui l'a fait relier ensuite en maroquin.



La presse en a aimablement rendu compte et les jurés du Prix de la Renaissance lui attribuèrent, le 27 juin, un prix « hautement mais purement honorique » : le « Prix d'Eté ». Le 15 mai, lors d'une vente de livres au profit des Ecrivains combattants durant laquelle de nombreux artistes s'étaient improvisés vendeurs, Beauté raison majeure avait été « patronné » par Louis Jouvet et Madeleine Ozeray. Paul Valéry l'a soutenue de son mieux et l'a encouragée à poursuivre, lui promettant même de l'aider à rédiger ou à corriger son prochain roman. En octobre son éditeur Emile-Paul sollicita, sans succès semble-t-il, une souscription de la Ville de Paris [Bulletin municipal, 27 octobre 1936].
Le redoutable Abbé Bethléem avait été moins complaisant en classant Beauté, raison majeure parmi les « romans de mauvaises mœurs », aux côtés du Prélude charnel de Robert Sermaise [Revue des lectures, 15 mai 1936]. Albert Willemet se demandait si un sujet aussi scabreux « valait un roman ? et même un conte ? » [La Voix du combattant, 27 juin 1936].





Le modèle de l’héroïne est Marguerite Thibon, son unique amie d'enfance dont elle a, dans son livre, fait une « fille laide ». A l'école maternelle, celle qui s'appelait encore Jeanne Pouchard avait rencontré Marguertite Delsol, née à Meyronne (Lot) le 12 septembre 1902. Elle était la fille de Louis Delsol [Penne-d’Agenais, 9 mars 1870 - Paris XVIIe, 19 mars 1956], avocat et député de la Seine (XIVe arrondissement) entre 1928 et 1932, et d’Adrienne Geraud [1876-].

Le Figaro, 4 juin 1922
Marguerite épousera [sur le conseil de Jeanne Loviton, écrit Mme Bertin] en premières noces, le 6 juin 1922 à Paris XVe, Fernand Bardet, et, en secondes noces, Henri Jacques Thibon, le 18 juin 1936. Elle est morte sans descendance à Paris XVIe le 13 janvier 1981.
C'est à cette même époque que Jeanne a fait la connaissance de Jean Giraudoux. Si l'on en croit son « Curriculum vitæ », c'est à la suite de la parution de ce premier roman, qu'il avait apprécié. Ce qui est sûr est que le dramaturge lui a rendu visite rue de Champagny : la première correspondance qu'il lui adresse est datée du 11 février 1936, le jour même où fut prononcé par le tribunal civil de la Seine son divorce avec Pierre Frondaie.
Juin : Ferdinand Loviton acquiert, avec la participation de sa fille, un petit hôtel particulier situé au n° 11 de la rue de l'Assomption à Auteuil appartenant à l'industriel Auguste Savard, inventeur des bijoux « Fix » et plusieurs fois châtelain. On ne sait quel fut l'apport de Jeanne mais sa fortune récente ne pouvait provenir de la vente de son premier roman, tiré à 3 000 exemplaires (il obtint, le 27 juin, un « Prix d'Eté » sans prime).



Son divorce avec Frondaie lui avait-il apporté quelques liquidités ? Ce divorce, écrit-elle dans son « Curriculum vitæ », fut prononcé « en sa faveur naturellement et sa vie changea totalement ». En quoi sa vie fut-elle modifiée puisqu'elle la menait à sa guise depuis cinq ans ? On se rappellera une confidence qu'elle fit plus tard à Jean Chalon, qui l'a rapportée dans son Journal de Paris : elle remonte à 1930, lorsqu'elle découvrit que son mari était tombé amoureux de Maria Favella : « Celle-là va me remplacer, mais moi, je ne partirai pas comme les autres, il devra casquer, il devra me verser une belle pension alimentaire »
Il est douteux que Frondaie lui ait versé la moindre pension : on en trouverait la trace dans ses archives, et elle y avait explicitement renoncé dans sa demande de divorce. Mais il est possible qu'elle ait obtenu une somme d'argent en échange de son consentement car, si elle vit pleinement sa vie à Paris, lui demeure à Arcachon avec la jeune Maria Favella qui aimerait sans doute régulariser sa situation. Une lettre qu'il envoie à Jeanne le montre bien : « je ne suis pas seul aux Sablines : celle qui y habite et s’y dévoue à moi depuis des années, sans aucune défaillance, y est plus chez elle que moi. Ceci n’est point qu’un fait de droit, c’est l’expression d’une chose juste. Il y a aux Sablines quelqu’un qui ne vit que là, qui ne sort pas de là, qui en a fait son humble et sage univers. » Pierre Frondaie épousera Maria Favella à Paris le 28 décembre 1937.
Il avait aussi souscrit une assurance au profit de Jeanne. Lors d'une rencontre Frondaie lui avait dit : « Elle te servira à élever mon tombeau », et elle avait rétorqué : « Oh ! Mais non ! Ta femme est plus riche que moi ! » Dans une lettre de 1938 il écrit : « Ton œil, je ne te le cache pas, n’était pas très gentil, et j’ai détesté cette réplique. Ma femme n’a ni tes relations, ni ton talent, ni tout ce que tu as pu acquérir par l’instruction solide qu’on t’a donnée. Elle n’héritera pas de son père ; ni de moi, hélas, la pauvre petite. »
A la fin de l'automne Jeanne Loviton quitte donc le petit appartement qu'elle occupait depuis 1931 rue de Champagny pour le charmant hôtel particulier de la rue de l'Assomption, qu'elle a fait aménager durant plusieurs mois.
1937
Deux ans plus tôt Jeanne Loviton avait rencontré Yvonne Dornès, mais on ne sait si c'était avant ou après la mort de sa mère. Arrière petite-nièce de Jules Ferry, née à Paris le 19 avril 1910, Yvonne était la fille aînée de Pierre Dornès et d'Irène de Biedermann, qui eurent ensuite deux autres enfants : Aline en 1917, Daniel en 1920.
Au moment de leur mariage en l'église Saint-François-de-Sales, le 26 février 1908, Pierre Dornès était sous-chef du secrétariat de la présidence de la Cour des comptes à Paris. Fils d'un ingénieur civil mosellan, Auguste Dornès [1845-1893], et de Suzanne Talbot [1850-1935], il était né à Fougères le 13 avril 1878. Il mourut conseiller référendaire à la Cour des comptes, le 1er mars 1948. Son arrière grand-père fut général dans les armées napoléoniennes et mourut au cours de la campagne de Russie en 1812.
Irène de Biedermann naquit le 23 juin 1882 à Budapest dans une famille de la grande bourgeoisie juive. Charlotte Bischitz, sa mère, était morte jeune, le 23 juin 1866. Son père, Albert de Biedermann [Budapest 10 mai 1844 - Paris 23 octobre 1908], avait obtenu la nationalité française le 20 septembre 1897. Ingénieur, il avait participé aux travaux du canal de Suez, du port de Beyrouth, et à de nombreux chemins de fer européens.Vice-président de la régie des chemins de fer et officier de la Légion d'honneur (depuis 1907), il était propriétaire d'un hôtel particulier avenue Gourgaud, n° 9, dans le XVIIe arrondissement, et du château d'Arcy à Chaumes-en-Brie. Irène Dornès mourut à Paris en 1977.
Après des études de droit, de philosophie et d'économie politique au Cours Dieterlen, Yvonne Dornès avait mené une carrière professionnelle dans le domaine de la communication. En 1936 elle est attachée au cabinet du sous-secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères, chargée de la propagande française à l'étranger par le livre. L'année suivante elle est chargée de mission au secrétariat général de la présidence du Conseil, où elle crée la première commission interministérielle du cinéma, dont elle devient secrétaire. En avril 1937 elle réalise un film sur le voyage du président Daladier en Tunisie, qui est primé.
Le 17 novembre 1930 Yvonne Dornès avait épousé Claude Weinbach [25 février 1906 - 26 juillet 1944], dont elle divorça dès 1936, mais dont elle aurait eu un fils, Pierre-Alain, selon sa notice au Who's who. Or Claude Weinbach, qui avait épousé en secondes noces Marguerite Mayer [1913-2004], a eu un autre fils né le 13 janvier 1945 : Jean-Pierre, qui a lui-même quatre enfants.
L'un d'eux s'est demandé qui pouvait être ce premier enfant Weinbach dont mon site lui apprenait l'existence et a interrogé son père, qui a connu ce Pierre-Alain Dornès, lequel a été adopté après la guerre par Yvonne Dornès, et ne peut donc être le fils de Claude Weinbach.
Yvonne Dornès n'eut guère d'autres relations masculines. Le grand amour de sa vie fut Jeanne Loviton, et ce sentiment très fort perdura jusqu'à sa mort, le 10 septembre 1994.
1938
En février, Jeanne a acquis une voiture, une Salmson immatriculée 733. Si cette marque française est moins coûteuse que l'Hispano-Suiza de Pierre Frondaie, le modèle choisi est considéré comme fiable et luxueux. Ferdinand Loviton lui fait aussitôt construire un garage.
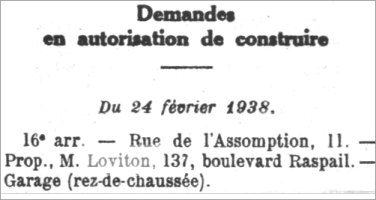
Bulletin municipal officiel de la ville de Paris, 26 février 1938
En mars, Jeanne passe une annonce dans les journaux pour engager une « bonne à tout faire ». Celle qui sera choisie s'appelle Elvira. D'origine yougoslave, elle sera remplacée au cours de l'été 1941 par une compatriote : Sidonie Zupanek, née le 28 janvier 1906 à Salosc, qui sera un témoin-clé dans l'affaire de l'assassinat de Robert Denoël.
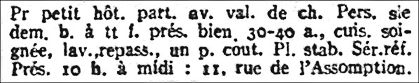
Le Figaro, 23 mars 1938
Entre le 15 avril et le 15 juin, Jeanne séjourne à Arcachon pour y rédiger son deuxième roman, mais pas n'importe où : aux Sablines, la villa où elle vécut durant plusieurs années avec Pierre Frondaie. Et il avait été question d'y amener Paul Valéry, ce qui n'eut finalement pas lieu. Le romancier est accommodant : « Non, ta venue aux Sablines ne me gêne en rien. Je suis enchanté que tu y viennes, si cela t’arrange. [...] Et je te permets d’inviter Valéry : ma propre chambre est habituée aux rêves solitaires des Muses. »
Il n'empêche, même absent, Frondaie doit quelques comptes à Maria Favella, qui l'occupe en permanence : « celle qui y habite et s’y dévoue à moi depuis des années, sans aucune défaillance, y est plus chez elle que moi. Ceci n’est point qu’un fait de droit, c’est l’expression d’une chose juste. Il y a aux Sablines quelqu’un qui ne vit que là, qui ne sort pas de là, qui en a fait son humble et sage univers. Je serais inique, et fort moche, si je n’en tenais compte. Je ne l’ai point consultée (ce n’est pas dans mes manières) mais je l’ai observée quand je lui ai dit que tu viendrais probablement. »
Son deuxième roman, Jours de lumière, est terminé au cours de l'été. Pas tout à fait, car elle a demandé à Frondaie de le « toiletter », ce dont il s'acquitte obligeamment : « En août 1938, tu m’as prié de me pencher " sur le plus grand effort de ta vie ”. Puis tu m’as demandé de l’éplucher : “ Si tu étais un Pierre véritable et toujours égal à toi-même... toi qui es génial ”, etc. » [lettre de Pierre Frondaie à Jeanne Loviton, mai 1940].
Frondaie est galant homme et il veille à la carrière de Jeanne : c'est lui qui contacte un agent commercial américain, le « major » Bodley, pour adapter au cinéma son roman, qui n'existe encore que sous forme de tapuscrit : « j’ai fait lire à Bodley ce Jours de lumière, dont aucune des qualités ne pouvait plus m’échapper, je lui ai dit : “ Traitons cela comme un de mes livres ”. » Jeanne a d'abord dit oui puis s'est rétractée, car le contrat prévoyait un partage des droits en trois, Frondaie étant partie prenante. Elle a donc saboté le contrat, séduit Bodley, puis a tenté de négocier séparément, mais Frondaie en a été averti. L'affaire n'ira pas plus loin pour Jeanne, mais Frondaie, lui, règle tous ses comptes, et il le fera en mai 1941 [Ce que Bodley m'a raconté, Plon].
En réalité deux écrivains ont corrigé et remanié Jours de lumière : Paul Valéry fut, lui aussi, mis à contribution dès avril et durant une partie de l'été. Jeanne lui faisait parvenir les chapitres rédigés, qu'il lui renvoyait annotés. Et c'est lui qui fut chargé d'en corriger les épreuves, avant de les déposer chez l'éditeur Emile-Paul.



Le roman, dont le titre au moins est dû à Jean Voilier, est achevé d'imprimer le 17 octobre et paraît en librairie le 22 décembre. Son dossier de presse est à peine plus consistant que celui de Beauté, raison majeure. Pourtant, si les premiers comptes rendus datent de novembre, dès la fin octobre Le Figaro laisse entendre que le roman, « dû à une dame, paraît-il », aurait des chances au prix Femina.

![Journal des débats politiques et littéraires, 18 novembre 1938 [1ère partie]](../07presse/img_doss_presse/th_journaldebats181138-1.jpg)
![Journal des débats politiques et littéraires, 18 novembre 1938 [2ème partie]](../07presse/img_doss_presse/th_journaldebats181138-2.jpg)

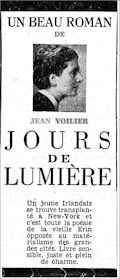




![]()
Si on consulte la presse on s'aperçoit vite que, sauf deux articles bienveillants dans Le Figaro et la Gazette de Lausanne, et un long compte rendu dans le Journal des débats, auquel elle collabora naguère, les autres annonces sont des insertions payantes dues à l'éditeur. La seule critique attentive et sans concession, parue dans L'Homme Libre, est un éreintement : son auteur renvoie Jeanne Loviton à « sa vraie voie » qui est de repriser les chaussettes.
Jours de lumière recueillera tout de même quelques voix au Prix Femina, le 6 décembre 1938, grâce à Valéry qui a intrigué auprès des dames jurés, dont Hélène Vacaresco. Le vieux poète, que la passion égare, lui avait écrit, le 7 octobre : « S'il n'est pas couronné, ce sera un scandale, et parce qu'il y aura des romancières qui seront jalouses ».
Deux comédiens en liront des pages à Radio-Paris, le 15 février 1939. Jeanne paiera un peu de sa personne en participant, le 17 mai 1939, à la « Journée des Ecrivains combattants » au Palais de Chaillot, assistée de Gabrielle Dorziat. Et Ferenczi publie le roman dans sa collection « Le Livre moderne illustré », quelques mois plus tard. Dominique Bona assure que le nom de l'illustrateur est un pseudonyme de Paul Valéry, qui n'a pas voulu signer. C'est manifestement une erreur : le peintre-décorateur-illustrateur Paul Charlemagne [Paris 1892-1972] a illustré plusieurs livres et composé des décors de théâtre au cours des années trente et quarante.
« Jean Voilier », comme l'écrit la chroniqueuse de L'Homme Libre, c'est la femme de lettres un peu vaniteuse qui s'est octroyé ce titre sans demander la permission à personne, et qui s'est fait chaperonner par un écrivain en place auprès des dames des jurys littéraires.
« Exténuée » par le gros effort littéraire qu'elle a dû consentir, Jeanne a quitté Les Sablines à la mi-juin, et s'est octroyée deux mois de vacances. Fin juillet elle séjourne durant une semaine chez Germain-Martin [1872-1948], un ami de son père et ancien ministre des finances qui habite Pont-Salomon (Haute Loire). A partir du 8 août elle est à Royat pour trois semaines. Elle passe ensuite le mois de septembre chez son amie Françoise Pagès du Port.
Françoise Pagès demeure à Castelfranc, où elle est née le 28 octobre 1903. Cette petite commune du Lot se trouve à quelque 80 kilomètres de Béduer, où Jeanne achètera son château un an plus tard, mais elles étaient amies depuis longtemps. C'était une femme de confiance puisqu'elle servit à plusieurs reprises de « courroie de transmission » entre Jeanne et Paul Valéry lorsque certains courriers ou coups de téléphone directs se révélaient délicats ; c'est pourquoi, dans sa correspondance avec Jean Voilier, Valéry l'appelle « Le Relais ».
Françoise Pagès qui habitait aussi Paris, 41 avenue d'Iéna (et, en 1945, 22 rue Ravignan), jouera un rôle important dans l'affaire Denoël, celui de « relais », précisément. Elle est morte à Boulogne-Billancourt le 5 juin 1963.
1939
En janvier, Yvonne Dornès prend le contrôle de l’agence SVP, une société de services destinée aux professionnels créée en 1935, dont elle était depuis quelques mois le conseiller technique, et entreprend sa réorganisation.
Fin février et en mars, Jeanne entreprend un long périple au Maghreb. Durant son absence, Françoise Pagès occupe sa maison, rue de l'Assomption.
Dans son « curriculum vitae », Jeanne écrit : « voyant la guerre approcher, M.Loviton demande à sa fille de chercher pour eux deux un asile dans une région qui, en cas grave, peut être épargnée. » L'éditeur met à la disposition de sa fille une somme de 225 000 francs.
Durant le mois d'avril elle prospecte le centre de la France : elle trouve une petite maison en Dordogne mais, le 5 mai, alors qu'elle allait s'engager, Robert de Billy lui propose d'acheter « pour rien (40 000 francs) » un petit château dont sa belle-mère est propriétaire à Béduer, près de Figeac.
Ce « petit château » est en fait une place forte remontant au XIe siècle, rénovée au XVIIe siècle, ayant appartenu aux seigneurs de Lostanges, avant d’être racheté en 1911 et restauré par Maurice Fenaille [1855-1937], industriel du pétrole et grand amateur d’art.

Le 26 juillet une promesse de vente est signée. La vente sera conclue le 17 juillet 1940 avec la veuve Fenaille pour la somme de 65 000 francs. Le domaine de plus de 14 hectares comprend, outre le château, une cour, un parc, un verger, un potager, une grange, des écuries et des remises.
Elle s'y installe dès le 15 juillet 1939 (donc, avant la date du paiement) et entreprend de l'aménager. Jean Chalon écrit qu'elle « a englouti des sommes énormes et est arrivée à en faire un exemple de perfection ».
En septembre Jeanne est consacrée marraine de l'escadrille 1/34 de bombardement de l'armée française. Cette « promotion » ne peut être due à son père, qui n'a pas été mobilisé en 1914, mais pourrait revenir à son ami influent, l'ancien ministre Germain-Martin.
A partir d'octobre et jusqu'à fin novembre Jeanne est à Figeac, à surveiller les travaux de réfection en cours dans son château. Elle avait promis à Paul Valéry de s'atteler à un nouveau roman mais elle n'en trouve pas le temps : « Je trouve que vous reculez toujours le moment du travail », lui écrit-il, le 26 octobre. Il est vrai qu'elle souffre alors de névralgies faciales.
1940
Jeanne Loviton passe presque toute l'année dans son château de Béduer qui sert donc, comme l'espérait son père, d'asile sûr au moment du conflit. Mais lui, est resté à Paris.
Valéry se désole du manque d'envie d'écrire de sa muse, et lui fait une singulière proposition : « Il m'est venu une idée drôle, pour te forcer à travailler : un roman par lettres, et je ferais la dame. » [23 janvier]. Evidemment « une collaboration ouverte n'est pas possible, hélas. Le roman existe : il est nos lettres mêmes. » [26 janvier]. Apparemment Jeanne ne veut pas de cette formule dont elle a usé naguère avec Pierre Frondaie (De l'amour à l'amour en 1932), d'autant qu'il s'agit de changer de sexe, en somme (ce qu'elle fait très bien dans la vie, mais Valéry l'ignore).
A partir du 5 décembre Jeanne est de retour rue de l'Assomption. L'éloignement forcé où ils se sont trouvés durant des mois a brisé l'intimité avec Valéry, et une aventure douteuse a eu lieu : « Et si tu m'aimes (comme tu dis) comment as-tu pu te laisser racoler par ce - dans la rue ? Moi étant ! N'était-ce pas me tenir pour remplaçable, Moi ? - pour un amant ad libitum - tandis que ce Moi te place hors de tout parangon ? », lui écrit-il, navré, le 31 décembre.
Elle lui a parlé d'une sorte de « partage », ce à quoi il se refuse . « J'attends un appel ou un adieu », écrit-il, c'est à elle de choisir.
D'autre part il devient clair que Jeanne ne croit plus guère à son avenir dans la littérature. L'affaire du prix Femina manqué a blessé sa vanité. Elle s'est néanmoins attelée à l'écriture d'une longue nouvelle : Ville ouverte.
1941
Le 1er janvier Valéry, qui se sent en péril, lui adresse une lettre très lucide. Il avait placé Jeanne bien au-dessus des autres femmes, capable de créer une œuvre personnelle et de se soustraire à « l'amusement désordonné et perpétuel qu'offre la vie moderne ». Or il la voit qui se prête désormais à toutes les futilités d'une vie de luxe.
Il met en cause ses bonnes amies, « ces trois parques, conseillères intimes, qui ont tant d'influence sur toi. D'après ce que tu m'en dis, j'ai l'impression de cervelles des plus basses, nourries des clichés les plus désolants ». Il évoque encore cette rencontre de la veille, qui l'a rendu malade. Et puis un coup de téléphone l'interrompt : elle a choisi de lui revenir. Tous les reproches sont balayés, mais cette première alerte prélude à une autre scène, beaucoup plus cruelle, qui aura lieu le 1er avril 1945.

Béduer, août 1941 : le docteur Jacques Mallarmé, Paul Valéry, Jeanne Loviton, Ferdinand Loviton, Françoise Pagès du Port
Jeanne passe janvier et février à Figeac, rentre à Paris, repart à Figeac en avril. Ces allers et retours ne cesseront plus durant l'Occupation, grâce à des « ausweis » à répétition obtenus on ne sait où. A partir du 22 juillet elle séjourne (jusqu'en novembre) au château de Béduer, où Valéry sera invité du 11 au 25 août, en compagnie de quelques amis - dont une des trois « parques » évoquées par le vieux poète. Une autre, qui n'apparaît pas sur le cliché, était présente : Yvonne Dornès. La troisième, la plus discrète, est Simone Penaud-Angelelli, avocate à la Cour et son amie depuis 1930 au moins. A aucun moment Valéry ne qualifie ces trois femmes de « grâces » : à ses yeux, c'est bien de parques dont il s'agit.
Début décembre Jeanne séjourne à Senneville, chez son amie l'actrice Amélie de Pouzols. Elle a envoyé le manuscrit de Ville ouverte à Paul Valéry qui est chargé de le « toiletter » et surtout, de l'illustrer. Apparemment c'est Robert de Billy qui en a eu l'idée. Le poète, qui dessine très bien, songe à utiliser l'eau-forte, la lithographie ou la pointe sèche, car il veut qu'Emile-Paul, l'éditeur de Jeanne et de Frondaie, réalise une édition de grand luxe.
Malheureusement son atelier, 46 avenue Foch, n'est pas chauffé, il manque de matériel, et Jeanne ne lui laisse pas beaucoup de temps pour mener à bien cette illustration.
Cependant qu'elle séjourne à Senneville, Henri Langlois se rend à Béduer pour y dissimuler 61 caisses de films anciens dans les caves de son château. Jeanne a cédé difficilement aux instances de son amie Yvonne Dornès, soucieuse de mettre à l'abri ces trésors cinématographiques.
1942
Le 23 janvier, Ferdinand Loviton est mort subitement chez lui à Paris, 83 boulevard St Michel. On ne sait de quelle affection mais sa santé était mauvaise depuis avril 1941. Dans une lettre du 24 janvier à Jeanne, Valéry parle d'une « mort prévue et soudaine ».
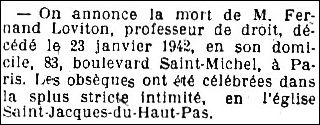
Journal des débats, 27 janvier 1942
Sa fille décide de poursuivre les activités de ses deux maisons d’édition qu'il avait, en novembre 1938, fait transporter aux n° 158 et 160 de la rue Saint-Jacques, face à la Faculté de droit. Elle ajoute à la copie des cours de droit, celle des cours de l’Institut d’études politiques et du Centre d’études politiques.
Jeanne demande alors à Yvonne Dornès de l'aider à réorganiser ces différentes affaires. Elle « est heureuse de pouvoir te servir », lui écrit Valéry, qui n'a pas encore pris la mesure de l'amitié étroite qui unit les deux femmes.
Valéry a pris contact en avril avec Jean-Gabriel Daragnès, directeur artistique chez Emile-Paul, pour tirer ses crayonnés en lithographie. Ville ouverte, achevé d'imprimer le 15 mai 1942 à 430 exemplaires numérotés, est une réussite typographique mais l'ouvrage broché ne sortira de presse qu'en juin, avec un prix de vente de mille francs. Pour comparaison, une édition illustrée par Gen Paul de Voyage au bout de la nuit, parue en mars chez Denoel, coûtait 60 F sur papier ordinaire, et 350 F en tirage de tête. L'illustration de Valéry est partout appréciée : « Tout le monde me parle des lithos ! », s'étonne-t-il, le 7 mai.
Entretemps Jeanne est partie se reposer à Senneville, souffrant à nouveau de névralgies faciales. En son absence c'est Mireille Fellous qui occupe sa maison de la rue de l'Assomption, en compagnie de Sidonie Zupanek, sa nouvelle bonne depuis un an. Elle rentre à Paris début juillet.



A ces trois ouvrages se limite l'apport de « Jean Voilier » à la Littérature française. C'est pourtant en qualité de « Femme de Lettres » qu'elle fut nommée Chevalier de la Légion d'Honneur par décret du 1er septembre 1953, paru au Journal Officiel du 4 septembre 1953, pris sur le rapport du ministre de l'Education Nationale qui, à cette époque, était l'avocat radical-socialiste André Marie [1897-1974].
Après de brèves carrières d'avocat, de journaliste, puis de femme de lettres, Jeanne Loviton se lance donc dans l'édition, ce qui signifie qu'elle va, selon son habitude, s'introduire dans ce milieu en multipliant les invitations et les rencontres avec les éditeurs, comme elle a couru les avocats, les journalistes et les écrivains.
L'un des premiers est Pierre Amiot. Né le 28 janvier 1911 à Levallois-Perret, il a d'abord publié en 1943 des livres pour enfants et des romans policiers à l'enseigne de La Nouvelle Edition, 213 bis boulevard Saint-Germain, avant de créer en 1946, avec Jean Dumont, Le Livre contemporain qui deviendra Amiot-Dumont en 1948, avant de disparaître en 1959. Ce jeune éditeur sans grande expérience fut surtout un soupirant jusqu'en 1944.
On ne connaît de lui qu'une lettre qu'il écrivit le 16 juin 1949 à Albert Paraz : « Croyez que je suis absolument sincère, lorsque je vous dis que j'ai été un des premiers admirateurs de Céline. J'avais vingt ans, quand je me suis battu pour le Voyage au bout de la nuit qui venait de paraître. J'habitais à cette époque la charmante petite rue de l'Abreuvoir, à deux pas de chez Gen Paul, chez qui je suis venu une ou deux fois, il y a une dizaine d'années. »
Raymond Durand-Auzias, né le 10 décembre 1889 à Corbeil, était l'un des deux dirigeants de la Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, rue Soufflot. Concurrent direct de Ferdinand Loviton, avec qui il entretenait de bonnes relations, ce voisin proche des Cours de Droit était alors président du Syndicat de l'Edition et ses compétences lui avaient valu d'être nommé en 1940 administrateur provisoire de plusieurs maisons d'édition confisquées à des israélites, et lui vaudraient sans doute d'officier à la Libération dans des maisons d'édition accusées de collaboration.
Durant l'été Valéry, de plus en plus épris, multiple les projets en faveur de sa muse éditrice : rédiger un volume de « Vues personnelles sur le Droit » pour Domat-Montchrestien, s'essayer à faire son portrait (« C'est Manet qu'il te faudrait... Je ne vois pas d'autre peintre possible. »
Le 30 juillet Jeanne quitte Paris pour Figeac. Valéry relit Ville ouverte : « Jouissez du bonheur d'avoir écrit une œuvre qui est un chef-d'œuvre. » [31 juillet], et la plupart des poèmes qu'il a écrits pour elle et que, déjà, il songe à réunir sous le titre « Couronne » (futur Corona).
De retour à Paris fin septembre, Jeanne repart pour Figeac le 25 octobre et en revient le 3 novembre. En dépit de ces voyages incessants elle trouve le temps de travailler à ses différentes maisons d'édition. C'est du moins ce qu'assure Paul Valéry qui lui écrit, le 3 novembre : « Mais tu te dépenses tant... C'est inouï. Je ne connais pas un homme entre tous ceux que je vois capable de mener ce que tu mènes, et de faire ce qui est plus difficile que de créer, - d'improviser une réforme radicale. Mais quel sacrifice, et quelle dépense d'être... »
1943
C'est au cours du mois de janvier qu'eut lieu la rencontre avec Robert Denoël. Il s'était rendu, en compagnie de Marion Delbo, à un déjeuner rue de l'Assomption. Jeanne et Marion, qui avaient dû se rencontrer, grâce à Frondaie, dans les milieux théâtraux, étaient amies depuis une vingtaine d'années. La comédienne connaissait l'éditeur depuis septembre 1942 : sur le conseil de Jean Cocteau elle lui avait soumis le manuscrit de son premier roman, Monsieur Durey, qu'il allait publier en mai. Par la suite Jeanne confirma cette version : « J’ai fait la connaissance de Robert Denoël en janvier 1943. Il fut amené chez moi par notre amie commune Mme Marion Delbo. »
Denoël avait été séduit immédiatement, selon Marion : « A la suite de ce déjeuner, dans les jours qui ont suivi, M. Denoël m’a fait part qu’il trouvait Mme Loviton très sympathique. » En effet une carte de visite fut envoyée rapidement à Auteuil : « Vous m’avez promis une visite. Après votre délicieux accueil de l’autre jour, comment hésiterais-je à vous le rappeler ? », écrivait Denoël, qui signait « très respectueusement » son invitation. Trois mois plus tard ils sont amants.
Denoël sait, dès alors, que Jeanne est la maîtresse de Valéry, et le vieux poète n'ignore pas le nom de l'éditeur puisqu'il mentionne son nom dans une lettre à Jeanne à propos d’un échantillon de papier fourni par lui à Jeanne pour sa maison d’édition, échantillon que le poète « ne trouve pas épatant ».
Les affaires ne sont cependant pas absentes de leur relation passionnée : dès le 22 mai, les Editions Denoël prêtent 200 000 francs [quelque 70 000 euros] aux Editions Domat-Montchrestien ; cette somme garantie par une traite à trois mois émise ce jour-là, et renouvelée à six mois, sera remboursée le 3 novembre 1943.
Domat-Montchrestien
Cette S.A.R.L. au capital de 30 000 francs fut créée le 7 octobre 1929 par Ferdinand Loviton avec pour associés : Alexandre Gougeon (professeur de droit né à Paris le 20 décembre 1869) et Louis Frémont (né à Paris le 1er novembre 1899, et imprimeur à Verdun). Elle avait pour objet exclusif l'impression et l'édition d'ouvrages juridiques et économiques. Loviton apportait à la Société 15 600 F ; Gougeon, 9 900 F ; Frémont, 4 500 F.
Le capital social était divisé en cent parts de 300 F attribuées ainsi : 52 parts pour Loviton, 33 parts pour Gougeon, 15 parts pour Frémont. La société, dont le siège social était 3 place de la Sorbonne, Paris Ve, avait deux gérants : Ferdinand Loviton et Alexandre Gougeon. L'acte notarial fut enregistré au greffe du tribunal de commerce le 26 octobre 1929 sous la cote 241 324 B.
Le 30 juillet 1930 le capital de la société fut porté à 60 000 francs par les trois associés, dans les mêmes proportions que précédemment, et cent parts nouvelles leur furent attribuées. Ferdinand Loviton en détenait alors 104, Alexandre Gougeon 66, et Louis Frémont 30. Le 6 septembre 1930 son siège social fut transféré à la nouvelle adresse de la maison d'édition : 160 rue Saint-Jacques, Paris Ve.
Le 21 décembre 1938 Ferdinand Loviton et Alexandre Gougeon ont apporté à la société une somme de 340 200 F par la création de 1 134 parts de 300 F chacune, ce qui a porté le capital social de la société à 400 200 F. Loviton a versé 212 400 F, Gougeon 127 800 F. Cette augmentation de capital a réparti le nombre de nouvelles parts de chacun dans les proportions suivantes : Loviton 708, Gougeon 426. Le troisième associé, Louis Frémont, s'est retiré de l'affaire et a cédé ses trente parts aux deux autres [18 à Loviton, 12 à Gougeon].
Désormais Domat-Montchrestien, s.a.r.l. au capital de 400 200 F, n'a plus que deux associés. Ferdinand Loviton, dont l'apport total fut de 249 000 F, détient 830 parts. Alexandre Gougeon, qui a investi 151 200 F dans l'affaire, en détient 504 [acte enregistré au greffe du tribunal de commerce de la Seine le 11 janvier 1939].
A la mort de Ferdinand Loviton, le 23 janvier 1942, et conformément à l'article III des statuts, la gérance devait être exercée par « les autres gérants survivants », en l'occurrence Alexandre Gougeon. Mais l'article 19-I prévoyait aussi qu'en cas de décès de l'éditeur, « la société continuera d'exister entre le ou les associés survivants et la personne qui se trouvera être propriétaire des parts sociales de M. Loviton à la suite du décès de ce dernier, à défaut si ses parts, dépendant purement et simplement de la succession de M. Loviton, la présente société continuera entre le et les associés survivants et les héritiers et représentants de l'associé prédécédé. »
En d'autres termes, la gérance des Editions Domat-Montchrestien devait être exercée conjointement par Alexandre Gougeon, second gérant, et Jeanne Loviton, unique héritière de son père. Selon Mme Denoël, des difficultés ont surgi entre eux et Alexandre Gougeon s'est alors retiré de la société après avoir cédé toutes ses parts, et démissionné de ses fonctions de gérant.
Toujours selon Mme Denoël, cette opération eut lieu le 18 décembre 1942. Ce jour-là Alexandre Gougeon aurait cédé les 504 parts qu’il possédait dans la société à raison de 502 parts à Mme Loviton et deux parts à M. Germain-Martin, ancien ministre des Finances et professeur de droit, ami personnel de Ferdinand Loviton : « il n’intervenait, en l’occurrence, que pour conserver la société, mais il n’avait que deux parts. »
Le capital social est alors réparti de la manière suivante : 1 332 parts à Mme Loviton et 2 parts à M. Germain-Martin.
Mme Denoël assure qu'une modification essentielle a eu lieu dans la Société des Editions Domat-Montchrestien, le 18 août 1943 : Jeanne Loviton, qui en détient toutes les parts, sauf deux, en a cédé la moitié à Yvonne Dornès. Jeanne reste propriétaire de 666 parts, et Yvonne en détient autant.
Or le même jour, Germain-Martin a cédé ses deux parts à Yvonne Dornès qui, avec les 666 parts acquises de Jeanne, devient donc majoritaire chez Domat-Montchrestien avec 668 parts.
Habituellement un changement aussi radical dans la répartition des parts d'une société est lié à une modification de ses statuts. Il n'y aura rien de tel chez Domat-Montchrestien avant le 8 janvier 1946.
Ce jour-là, Mmes Loviton et Dornès signent entre elles une nouvelle cession de parts dans la Société des Editions Domat-Montchrestien. Mme Dornès cède à Mme Loviton 335 parts sur les 668 qu’elle détenait dans la Société des Editions Domat-Montchrestien. Mme Loviton redevient alors largement majoritaire avec 1001 parts, tandis que Mme Dornès n'en conserve que 333.
Ce jour-là aussi, les statuts de la société sont modifiés : Domat-Montchrestien, éditeur de droit, devient éditeur de littérature : l'objet de la société devient désormais « la mise en vente de tout ouvrage, publication, revue, qu'elle soit périodique ou non, de caractère littéraire, technique, artistique, ou publicitaire. »
*
Chez Denoël, des changements spectaculaires sont survenus à la même époque : pour compenser l'effondrement du franc, l'éditeur a persuadé son associé allemand d'injecter de nouveaux capitaux dans l'affaire et, le 22 février, la Société des Editions Denoël a augmenté son capital qui passe de 365 000 francs à 1 500 000 francs. Denoël reste majoritaire dans sa société avec 1 150 parts, tandis qu'Andermann en détient 1 120.
Le 8 avril Jeanne s'est rendue, en compagnie de Valéry, à une exposition de reliures organisée par Marie Dormoy à la Bibliothèque Jacques Doucet. Paul Léautaud note, dans son journal : « Il est accompagné d’une jeune femme brune, grande, jolie, sans chapeau ».
Début avril, sans doute du 9 au 11, Jeanne est à Béduer en compagnie de Robert Denoël, qui lui écrit peu après : « ces quelques jours de vie commune nous ont unis plus étroitement que tous les mois qui ont précédé. [...] Douceur de ces nuits passées près de toi, joie profonde qui me tient tout entier quand je te vois dormir, le visage serein, le corps paisible ».
Le 3 mai Paul Valéry et Jeanne Loviton assistent au concert de la Pléiade, à la Galerie Charpentier, faubourg Saint-Honoré. Ils seront encore présents à celui du 10 mai.
Début juin Jeanne est à Béduer, jusqu'au 11. Le 10, Denoël lui écrit : « Tu m’as donné de quoi vivre cent ans en ces quelques semaines », mais il se sent indigne d'une telle passion. D'autres sont venus à Auteuil, bien avant lui : « les fameux fantômes assis sur les chaises, sur les fauteuils, sur ton divan, cachés dans les plis de ta robe ou sous les coussins, me murmuraient à voix fort pressante que je faisais une méprise. » Et si tout cela « n’était qu’un abandon précaire, qu’un entraînement merveilleux et sans lendemain » ?
Denoël n'a pas d'inutiles illusions quant à ses nombreuses relations amoureuses, il se demande simplement s'il est désormais le seul qui importe : « Tu es habituée, Jeanne chérie, à semer les enchantements et à récolter l’amour, il pousse en herbe folle sous tes pas, il modèle tes gestes, il te vêt, fait foisonner ta chevelure, briller ton regard. Comprends que je craigne de te parler, comprends mes folles hésitations. »
Alors qu'il couvrait Dominique Rolin d'une bienveillance amoureuse un peu condescendante, il se demande, à plus de quarante ans, s'il a le droit d'aimer cette femme qui lui paraît supérieure, et qui le fait fondre, à chacune de leurs rencontres : « je ne me savais pas craintif, désemparé, inquiet. Il n’y a que ta présence pour me rassurer, reviens vite, que ta chaleur soit sur moi, que j’entende ta voix et son murmure tendre » [14 juin].
Valéry, lui, n'a pas encore perçu de refroidissement dans leurs relations, qui commencent à se raréfier, et il en est toujours à lui dire que la vie serait améliorée si on pouvait, de temps à autre, « consommer ensemble une bonne demi-journée partie au XLVI [son bureau], partie au 11 [rue de l'Assomption], avec concours de tous les arts, tendre goûter, trempette anglaise, croquenlèvre et fioritures vago-sympathicotoniques. » [22 juin].
En juillet, alors que le poète reproche à sa muse, châtelaine pour trois mois à Béduer, de se dissiper dans un tourbillon de mondanités, Denoël en reste ébloui comme un provincial fraîchement débarqué : « Je ris avec toi, je partage tes ennuis et tes soucis, je me réjouis de toutes les victoires que tu remportes sur les gens et sur la vie. Je t’aime et je t’admire ».
Le 6 août Valéry lui écrit qu'il espère que son propre séjour à Béduer pourra s'organiser (il aura lieu en septembre) et, en attendant : « amuse-toi avec ta troupe, directrice de la Comédie Béduère ». Dans cette « troupe » dont on n'a pas le décompte figurait Robert Denoël, invité du 7 au 11.
Aussitôt rentré à Paris il règle les affaires courantes aux Editions Domat-Montchrestien, habitude qu'il a prise durant les - nombreuses - absences de la patronne, et déjà il s'inquiète à son sujet : « Je t’ai vue fragile, exténuée, au bord des larmes et déjà, tant cette fatigue était grande, tes beaux cils battaient, humides d’un pleur que tu ne voulais pas verser ; je t’ai vue rieuse, aucun visage ne rit comme le tien, si proche de l’enfance, si lumineux de joie [...] Sonnez, trompettes de Béduer ! Le prisonnier n’échappera pas, les chaînes sont bonnes.» [12 août].
La « Comédie Béduère » est bien au point. Jeanne a beau « faire retraite » comme elle dit, à Senneville, à Béduer ou ailleurs, et plus souvent qu'elle n'est présente à son bureau, elle parvient à persuader ses amis et amants que son métier d'éditeur, qu'elle pratique depuis quelques mois à peine, l'exténue, comme l'écriture de ses petits romans, ou la réception d'invités au château de Béduer. Et s'ils l'ignorent, elle ne manque pas de le leur faire savoir : « Ne vous tuez pas ; ou plutôt, ne continuez pas à vous tuer [...] Je veux savoir que vous allez mieux », lui écrit Valéry, le 17 août. Et deux jours plus tard : « Je t'en prie, ménage-toi. Tu veux tellement que tout soit parfait chez toi que tu vas te tuer pour tes Messieurs et Dames. »
Denoël aussi demeure fasciné et il se remémore son séjour à Figeac « Je te vois, allant et venant, dans tes chambres hautes, veillant au bonheur prochain de tes invités, je te vois au téléphone, je te vois avec les gens du pays, organisant tes plaisirs, jouant à peine de ta séduction pour obtenir tout ce que tu désires. Et ta réussite constante me donne une joie, je ris tout seul, silencieusement, comme les trappeurs de Fenimore Cooper, quand je pense à tous les triomphes que tu remportes. » [15 août].
Il s'agit simplement d'organiser ses plaisirs et elle le fait parfaitement. Pourquoi faut-il y ajouter on ne sait quelle plénitude exceptionnelle ? Mais l'éditeur est amoureux : « Pendant ces cinq jours, j’ai eu le sentiment délicieux que tu m’appartenais, j’ai vécu en toi et par toi, soumis à ton sourire, sans autre volonté que ton plaisir qui était le mien à chaque minute. [...] Mais Béduer s’inscrit dans mon souvenir comme un couronnement radieux, soie et velours, lumière et chant d’oiseaux, grâce incomparable et magnificence, bonheur des yeux et du cœur et ta chaleur aimée quand ton corps nu reposait près du mien. »
Deux jours plus tard son exaltation n'a pas disparu : « je pensais à ton courage, à cette énergie rayonnante et soutenue qui te permet d’entreprendre sans cesse et de réussir en dépit de tous les obstacles. J’admire cette vitalité du cœur et de l’esprit qui fait que tu donnes ton temps, ta grâce à des centaines de gens sans jamais t’éparpiller. Il y a en toi, malgré ta santé fragile, une faculté de renouvellement qui m’émerveille. Tous les jours tu es prête à combattre sur n’importe quel terrain. » [17 août]. Tout de même une petit inquiétude est perceptible : « dis-moi que je suis toujours dans ton cœur, que tu as renvoyé la cohorte trépignante qui t’entoure et que tu es bien décidée à me donner la première place dans la fameuse " organisation " ».
Ce mot, chez Jeanne Loviton, est capital. Elle organise tout, même sa vie amoureuse, surtout sa vie amoureuse. Et celle de Denoël, marié et père d'un enfant, n'est pas simple non plus : « Les obstacles, les séparations, seront notre lot, quelles que soient les circonstances. La vie nous entravera, je le sais. Quand je pense à cela, j’y pense pour toi, qui souffriras de l’absurdité de cette situation sans issue, parce que, généreuse, tu es avide et que tu veux, à raison, tout avoir. » [25 août]. A cette époque la situation lui paraît sans issue. La seule serait le divorce mais il ne l'envisage pas encore.
Cependant que Denoël se remémore avec mélancolie les belles heures passées à Figeac, Paul Valéry trépigne de ne pouvoir s'y rendre avant septembre. Il y séjournera du 6 au 15 septembre : « Ce furent les heures alcyoniennes de ma vie », écrira-t-il plus tard à Jeanne. C'est durant cette semaine heureuse qu'il la dessine écrivant sur la terrasse du château, armée de ses grosses lunettes de myope, et qu'il pose en sa compagnie sur la même terrasse.

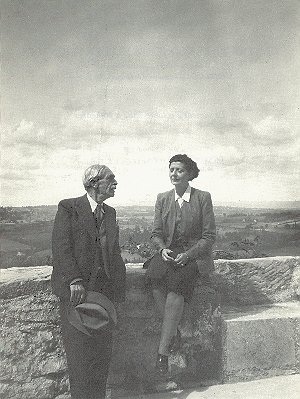
Jeanne est de retour à Paris le 18 septembre. Dès le 15 novembre elle se dit « éreintée ». Le 10 décembre Valéry évoque son visage « si fatigué ». Et Denoël n'est pas en reste : « Je ne connais rien de plus ignoble que la souffrance physique, elle n’a aucune signification, on n’en tire rien. Mais c’est un signal, il faut absolument y remédier. Je te supplie, mon doux chéri, de te soigner, de prendre un vrai repos, je ne veux pas que tu aies mal. [...] Te revoilà dans ton bureau - t’es-tu reposée au moins ? - avec toutes tes souris rongeuses, ton téléphone et les spectres grimaçants des 10.000 abonnés ? »
L'organisation des Editions Domat-Montchrestien est peu connue. Constituée d'un personnel essentiellement féminin, la maison de la rue Saint-Jacques a deux piliers : Mireille Fellous, une jeune femme qui s'occupe de la comptabilité, et qui sera plus tard l'unique ayant droit de Jeanne Loviton.
Elle n'apparaît dans la correspondance de Denoël qu'en juillet 1945, et dans celle de Valéry en juin 1943. On ne sait rien d'elle, sauf ce qu'en dit Jeanne dans son Curriculum Vitae : « Depuis longtemps elle avait voué à une enfant qu'elle avait connue lorsqu'elle était devenue orpheline de père et de mère une affection profonde. Elle l'avait prise auprès d'elle dans ses affaires auxquelles elle se dévoua comme personne n'aurait pu ou su le faire. »
Cette demoiselle menue à tête d'oiseau de nuit, que Carlton Lake décrit en 1979 comme une personne sans âge, sans personnalité, et ne disant mot, est telle que je l'ai rencontrée, l'année suivante, avenue Montaigne.
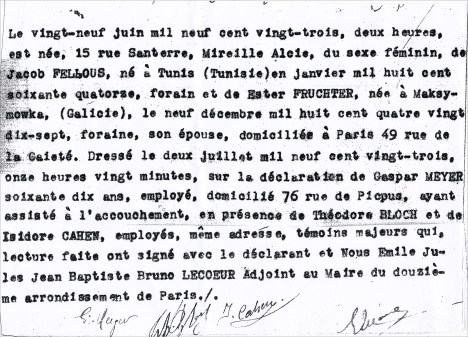
Fille d'un couple de forains, elle était née le 29 juin 1923 à l'Hôpital Rothschild, dans le XIIe arrondissement. Son père, Jacob Fellous, était né à Tunis en janvier 1874. Sa mère, Ester Fruchter, était née le 9 décembre 1897 à Maksymowka, une ville de Galicie (aujourd'hui Belarus). A cette époque, les Fellous-Fruchter étaient domiciliés 49 rue de la Gaieté à Montparnasse. On ne sait si le couple s'est défait (plus de vingt ans les séparaient), s'il est reparti sur les routes en abandonnant la petite fille, ou s'il a été déporté et disparu.
La seconde est d'une autre trempe. Elle n'apparaît, elle aussi, dans la correspondance de Denoël qu'en 1945 mais elle était en place chez Domat-Montchrestien bien plus tôt.


Germaine Decaris, née le 31 août 1899 à Sotteville-les-Rouen, était la sœur aînée du graveur Albert Decaris [1901-1988]. Militante communiste, elle fut journaliste littéraire et cinématographique aux Nouvelles Littéraires, au Populaire, à L'Humanité, au cours des années trente. Elle était, dès 1942, la « femme à tout faire » de la maison : correspondances avec les auteurs, lecture des manuscrits, corrections d'épreuves, cette fidèle maîtresse de Jeanne Loviton se chargeait de tout. Dans une lettre à Marie Dormoy datée du 18 juin 1948, Paul Léautaud, qui l'a reçue chez lui, écrit : « Cette demoiselle Decaris est bien laide, et sa compagne idem ». Elle eut une fin étrange en 1955 : son corps fut repêché dans la Seine, et on ignora toujours si elle s'y était jetée ou si on l'y avait poussée.
La librairie des Cours de Droit, qui lui est voisine, occupe l'angle de la rue Saint-Jacques et de la rue Cujas, et la secrétaire-réceptionniste s'appelle Marcelle Boussion [1896-1973].
Le 24 décembre Valéry écrit : « C'est bien triste de ne pas se voir aujourd'hui - de ne pas se prendre dans les bras, et se sentir s'aimer si tendrement que nous nous aimons ». C'est que Jeanne a d'autres plans : « Voici, mon beau chéri, le premier Noël que nous allons fêter ensemble : la joie est dans mon cœur. Je t’aime, Jeanne chérie, et je sais que c’est pour toujours. J’attends maintenant tous les Noëls de la vie, toutes les fêtes et tous les jours pour être heureux avec toi », lui écrit Denoël, le même jour.
1944
Depuis plusieurs mois Paul Valéry est souffrant et Jeanne, toute à ses nouvelles amours, ne lui accorde plus autant d'attention, ce dont il se plaint amèrement, le 28 janvier : « et depuis quand je n'ai rien de toi... un coup de téléphone ? - Pas un mot, un signe, une marque - rien, rien, pendant que je passais ici de vrais jours durs [...] J'avais beau t'appeler - tu n'es pas venue. Tout cela t'est choses vaines. »
Le 31 janvier Jean Giraudoux est mort des suites d'une pancréatite aiguë. Jeanne l'apprend par la radio, alors qu'elle déjeune dans un restaurant de Saint-Germain-des-Prés en compagnie de l'éditeur Pierre Amiot. Le lendemain elle rédige une note de onze pages qui résume leur relation et conclut : « Ta maison, défendue par ta mégère à qui tu m'as sacrifiée, ne me verra pas en larmes au pied de ton corps léger qui se serrait contre le mien voici un mois encore. »
Ce texte montre comment « fonctionne » Jeanne Loviton quand il s'agit de prendre date avec on ne sait quelle postérité. Elle a rencontré Giraudoux en février 1936, est devenue sa maîtresse peu après, et une correspondance s'est établie entre eux jusqu'en juin 1943, date à laquelle elle a rompu. Le dramaturge n'a donc pu se serrer contre elle, un mois plus tôt.
Est-ce la crainte d'affronter des veuves vindicatives ? On ne l'a jamais vue aux obsèques de ses amants, pas même celles de Pierre Frondaie, à qui elle était restée attachée et dont la veuve, Maria Favella, ne lui voulait aucun mal. Sans doute valait-il mieux qu'elle gardât le lit, comme elle fit toujours, quand on sait à quelle pantomime elle s'est livrée en décembre 1945 à la morgue de l'hôpital Necker, pour saluer la dépouille de son amant assassiné.
Denoël, dès le lendemain, lui écrit : « Chérie, je suis tout triste de ton chagrin et triste aussi de ne pouvoir mieux te consoler. J’ai pensé à toi tard dans la nuit, j’aurais voulu être près de toi, que tu reposes sur mon épaule, tes pleurs se seraient doucement taris, j’aurais endormi ta peine, tu te serais sentie si près de moi, si sûre de moi que tu te serais mise à penser à notre avenir heureux, à tout ce que je pressens d’harmonieux et de tendre entre nous. L’horreur de ce deuil se serait atténuée. »
Denoël est un amant attentif et compréhensif : il lui écrira des mots aussi réconfortants après la mort de Paul Valéry. Est-ce que Valéry connaissait la liaison qu'avaient longtemps entretenue Jeanne et Giraudoux ? On l'ignore. Il ne lui écrit pas un mot à son sujet, mais il participe à l'hommage collectif des hommes de lettres publié le 5 février dans Comœdia - peut-être pour lui faire plaisir.
Rue Amélie, le travail a repris normalement : « je travaille assez péniblement, fatigué toujours. Les Editions, elles, n’ont jamais été si florissantes. Elles auront ma peau ! », écrit Denoël à Paul Vialar, le 6 mars. Jeanne aussi est éreintée et elle s'en plaint comme toujours auprès de Valéry, qui se désole : « Je pense surtout à ce que tu m'as dit. Je t'assure qu'il faut prendre garde à cela [...] D'ailleurs, tout symptôme, dans l'état d'éreintement où tu t'établis, a son importance et peut servir à éclaircir ces névralgies et autres maux dont tu te plains si souvent. » [4 mars].
Début avril Jeanne se repose à Senneville. Ellle s'est légèrement blessée au cours d'une promenade : « Ton genou me fait mal. Fragile chérie, enfant imprudente que l’on ne peut laisser seule sur les routes sans qu’elle ne se blesse ! », lui écrit Denoël, qui y passera ensuite quelques jours : « j’ai emporté de ta petite maison une image de soleil et de bonheur, j’ai été heureux dans ces murs clairs où tu fais retraite ».
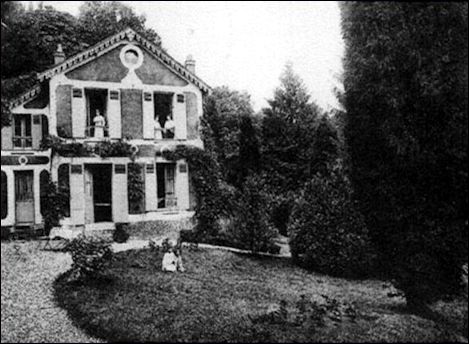
Cette jolie villa où Jeanne a pris l'habitude, dès 1941, de « faire retraite », appartenait depuis 1927 à Maurice Donnay. Elle s'y rendait généralement en fin de semaine, afin d'éviter le long trajet pour Figeac, qui est à 600 kilomètres de Paris. L'académicien est mort le 31 mars 1945 et Jeanne a fait alors l'acquisition de sa villa.
Les relations entre Jeanne et Valéry se ressentent immanquablement de cette liaison. Elle s'est encore absentée durant quelques jours, début mai, et il l'apprend par Sidonie, qui n'a aucun message pour lui : « Je t'avoue que je crois sentir que tu m'aimes moins que naguère », lui écrit-il le 12 mai.
Au cours de ce même mois de mai, Denoël entreprend de liquider plusieurs affaires. Le 8 mai il cède à des prête-noms les parts qu'il détient dans l'encombrante Société des Nouvelles Editions Françaises et, la semaine suivante, démissionne de ses fonctions de gérant. Le 9 juin il vend sa librairie des « Trois Magots » , avenue La Bourdonnais. Rue Amélie, aucune modification ne peut avoir lieu sans l'aval de son associé allemand mais, le 3 juillet, il nomme son fidèle employé Auguste Picq directeur commercial des Editions Denoël, ce qui lui permettra de contrôler une affaire dont il sait qu'il sera bientôt exclu.
Les parts qu'il détenait dans les NEF au capital minimal de 25 000 francs ne lui avaient sans doute pas rapporté grand-chose puisqu'il en était le vrai propriétaire, mais la vente des « Trois Magots » était bien réelle et, selon l'acte de cession datant du 1er juin, il en avait reçu 500 000 francs. Sa veuve assura plus tard qu'un « dessous de table » de 250 000 francs avait été réalisé, à son profit, en ajoutant : « mon mari avait la spécialité de créer des sociétés fictives ou de les continuer sous le couvert de prête-noms, et d’investir, également sous le couvert de prête-noms, des capitaux dans des sociétés existantes, en faisant signer à ces prête-noms des cessions de parts en blanc, c’est-à-dire sans indication de date et sans indication du nom de l’acquéreur de ces parts » [lettre de Cécile Denoël au juge Gollety, 8 janvier 1950].
En juillet Paul Valéry corrige le texte de son allocution sur Henri Bergson, que Jeanne lui a proposé de publier chez elle, et qui inaugurera une nouvelle collection littéraire.
Le 1er août Jeanne organise, rue de l'Assomption, une lecture de Mon Faust. C'est Valéry qui, dès avril, a dressé la liste des invités mais elle en a ajouté quelques uns, dont Robert Denoël. Une trentaine de personnes somnolèrent ce jour-là en écoutant la voix monocorde de l'auteur. Gaston Gallimard, assez dépité, confia à Maurice Toesca : « La grande œuvre qu'il avait en vue, il ne la réalisera plus maintenant ». Denoël adressa, huit jours plus tard, une lettre assez hypocrite au vieux poète : « Durant que vous lisiez, j'éprouvais profondément le sentiment de votre existence et de son caractère irremplaçable ». En mai 1945, c'est-à-dire après qu'il eut appris son infortune, Valéry écrivait à Jeanne : « Il n'y manquait même pas un éditeur étranger qui se montra déjà très satisfait ».
Un éditeur « étranger » qui, dès le 18 août, quitte son domicile et sa maison d'édition. Denoël sait que sa tête est mise à prix et il se réfugie alors chez les Lemesle, machinistes de l'Opéra-Comique, rue Favart, qui lui ont aménagé un petit gîte dans le magasin où l'on entrepose les décors. Ils lui ont rendu ce service parce que leur fille Noëlle donnait des leçons de piano au fils de l'éditeur. Denoël y resta une quinzaine de jours, avant de gagner un petit appartement loué au nom de Jeanne depuis le 1er avril, 39 boulevard des Capucines.
Ce pied-à-terre de quatre pièces où il avait entreposé ses livres et ses dossiers professionnels lui servit de retraite durant plus d'un an. Il y recevait quelques amis sûrs, évitait d'utiliser le téléphone, et se faisait appeler « Monsieur Marin », en souvenir de son pseudonyme littéraire des années Vingt.
Denoël avait fait ce choix pour éviter à Jeanne d'être mise en cause : « Je suis arrivé dans cette maison le cœur oppressé, navré de ton chagrin et d’en être l’auteur, mais certain d’avoir bien agi pour ta sécurité de demain et ta liberté d’action. C’est cela qui a guidé ma résolution avant tout, crois-le. Où pouvais-je être plus heureux que près de toi ? Où ces heures tristes et déprimantes pouvaient-elles couler plus doucement ? » [18 août 1944].
Aucun auteur ni aucun ouvrage publié par Domat-Montchrestien n'avait figuré sur les listes de proscription durant l'Occupation, ni à la Libération. La maison d'édition Loviton était irréprochable. Certes Jeanne avait bien été vue dans les soirées mondaines de son ami l'ambassadeur Fernand de Brinon, mais cela ne paraissait pas porter à conséquence.
Denoël avait tenu à la mettre à l'abri de toute calomnie, et il s'en expliquait à son amie Champigny : « Je n’ai en ce moment ni bureau, ni domicile fixe. Je vis en bohémien, en attendant des événements qui ne peuvent pas être très agréables. [...] Je ne sais pas si demain je pourrai encore exercer mon métier. Il n’est pas tout à fait sûr que je ne sois pas expulsé. »
Voilà une raison assez inattendue à la prudence de l'éditeur. Il sera suspendu de ses fonctions, le 30 août, et un administrateur provisoire sera nommé à la tête de sa maison d'édition, le 20 octobre. C'est une mesure qui fut prise pour plusieurs éditeurs accusés de collaboration.
Mais Denoël est citoyen belge et personne, à cette époque, ne sait quel sort sera réservé aux « collaborateurs » étrangers. Dépossédé de sa société, il pourrait aussi être extradé. Son associé allemand, par exemple, n'a jamais été dédommagé de son investissement : ses parts seront saisies le 19 août 1944 comme biens ennemis et vendues au prix coûtant le 2 février 1951 par l'administration des Domaines à... Jeanne Loviton.
Denoël a, dès le 20 août, demandé à Paul Vialar d'occuper son appartement, rue de Buenos-Ayres, « pour qu'il ne fût pas occupé, comme le craignait l'éditeur, par quelque résistant au petit pied. », tandis que Cécile trouvait refuge durant quelques jours dans un hôtel de la rue de Lille, avant de s'installer chez Albert Morys, 5 rue Pigalle. Elle y resta jusqu'au 8 mars 1945, puis réintégra son domicile.
Le 30 septembre Denoël et sa femme ont cédé à Albert Morys le bail de leur appartement, et lui ont « vendu » tous les meubles qu'il contenait. L'éditeur, qui vit alors caché, demande à Morys de lui trouver une boutique à louer dans le VIe arrondissement, et, le 14 novembre, ses deux prête-noms (Morys et Percheron) transforment la raison sociale des Nouvelles Éditions Françaises en Éditions de la Tour, dont l'adresse provisoire sera celle de Morys, rue Pigalle.
A ce moment il paraît rasséréné : « Je me débats actuellement dans les histoires d’épuration. On me reproche certains livres à succès et mon succès tout court. Mais je pense m’en tirer sans de trop graves dommages. » [lettre à Jean Rogissart, 20 septembre 1944].
Un mois plus tard tout s'assombrit car il a essuyé un humiliant refus auprès d'écrivains qu'il avait publiés et aidés durant l'Occupation : « J’attendais de deux auteurs de ma maison auxquels j’ai toujours témoigné la plus vigilante et la plus active amitié, une aide décisive. Elle m’a manqué et cela m’est cruel. » [lettre à Rogissart, 31 octobre 1944].
A ce moment Denoël comprend qu'il est bien seul. Ses confrères le détestent ou guignent sa maison d'édition, ses auteurs à succès sont en fuite ou en prison, et les auteurs communistes qu'il a publiés ne lui sont d'aucun secours : « Je leur ai demandé de m’aider... ils m’ont répondu : c’est impossible, on vous a supporté pendant la guerre... Vous ne pouvez pas savoir le calvaire que ce fut pour nous d’être publiés à côté de Céline et de Rebatet, dans la même maison qu’eux », racontera plus tard Jeanne Loviton à Pierre Assouline.
Denoël n'avait rien compris au « double jeu » de ces deux auteurs qui étaient censés le tirer d'affaire. Louis Aragon et Elsa Triolet l'avaient ignoblement doublé. Sa planche de salut, la seule désormais, est Jeanne Loviton.
Paul Valéry, quoique resté « obstinément silencieux et méprisant » durant l'Occupation [Le Figaro, 2 septembre], sera courtisé par tous, à commencer par le général de Gaulle qui l'invite à dîner au ministère de la Guerre, le 4 septembre. Le 7 l'Académie Française vote une motion qui interdit de candidature ceux qui, de près ou de loin, ont collaboré, et Valéry l'a cautionnée. Claude Morgan lui a demandé de devenir membre du Comité National des Ecrivains, et il a accepté, signant et corrigeant même le « Manifeste des écrivains français » qui sera publié le 9 septembre dans Les Lettres Françaises.
Il adhère à la plupart des manifestations publiques du CNÉ où, seule, la présence d'Aragon, qu'il méprise depuis longtemps, paraît l'indisposer. La publication de listes noires, où figurent nombre de ses amis, ne paraît pas l'affecter, pas même celle du 21 octobre où apparaît le nom de Sacha Guitry qui, durant l'Occupation, l'a si souvent accueilli à sa table, lui a procuré tabac et café, et mis sa voiture à sa disposition.
Valéry, il est vrai, n'assiste jamais aux réunions du CNÉ mais cette absence cautionne les décisions d'un comité à direction communiste, furieusement épuratrice. En revanche il accepte de présider en octobre une réunion des membres du PEN Club français, dirigé par Henri Membré, un écrivain devenu résistant pur et dur depuis le 17 août.
Partout fêté et adulé, son audience est désormais considérable et il intervient auprès du général de Gaulle en faveur de Charles Maurras, d'Henri Béraud et de Robert Brasillach, qui risquaient la peine de mort. Mais Paul Valéry est alors, physiquement, « au bout du rouleau ».
1945
Jeanne Loviton, malgré ses nombreuses relations mondaines, n'a pas vraiment d'appuis politiques, car elle n'appartient à aucun parti. Durant plusieurs mois elle va intriguer en toutes directions pour sortir d'embarras son amoureux. Ce n'est pas chose facile, Denoël s'étant fait beaucoup d'ennemis. Sa meilleure alliée sera Yvonne Dornès, qui a longtemps rechigné à intervenir en raison de son peu de sympathie pour l'éditeur. La seconde sera son amie très proche, Suzanne Borel, qui deviendra Mme Georges Bidault le 28 décembre.
Le dossier de l'éditeur belge n'est pas très bon. Le 2 février une Commission consultative d’épuration de l’Edition a été nommée par le ministre de l'Information, Pierre-Henri Teitgen. Quatre jours plus tard son président Raymond Durand-Auzias écrit au ministre : « Il serait aussi préjudiciable, pour le prestige français, de voir subsister certains noms de firmes comme " Editions Denoël " que de laisser par exemple subsister le nom de certains journaux comme Gringoire ou Le Pilori, même avec une direction nouvelle ».
Le 6 février Robert Denoël s'est présenté devant le juge d'instruction Achille Olmi, chargé de son dossier. Certains ont prétendu qu'en raison des attaques dont il faisait l'objet dans la presse, il se serait rendu spontanément au palais, en vue de réclamer une protection policière.
Dans « Cécile ou une vie toute simple » Albert Morys assure que c'est le juge Olmi qui l'avait convoqué à son adresse, rue de Buenos-Ayres, que c'est Cécile qui reçut le pli et qui demanda au magistrat un délai de deux ou trois jours, son mari étant « momentanément absent de son domicile ». Morys dit avoir remis la convocation à Denoël à son pied-à-terre, boulevard des Capucines. Cette version me paraît plus crédible.
Au terme de cette audition, Denoël fut laissé en liberté mais inculpé, le 19, pour infraction à l’article 75 du Code pénal et atteinte à la sûreté de l’Etat. Que dit au juste cet article 75 qui concerna des milliers de personnes à la Libération ? « Tout Français qui aura porté les armes contre la France sera puni de mort. Ses biens seront confisqués. »
C'est à cette époque qu'eut lieu, rue Saint-Lazare, chez l'avoué Jean Streichenberger, une réunion où figuraient Robert Denoël, Jeanne Loviton, Maximilien Vox, et un administrateur de la banque Worms : « en vue d’obtenir le concours financier d’établissements bancaires, sous forme de découvert, en raison de l’incertitude de la trésorerie, j’ai provoqué une réunion en vue de déterminer dans quelles conditions M. Denoël pourrait céder ses parts à Mme Loviton, soit à titre privé, soit en tant que gérante des Editions Domat Montchrestien. [...] A l’issue de cette réunion, tout le monde s’est trouvé d’accord sur le principe de la cession de parts qui était souhaitable, mais qu’elle [ne] serait réalisable qu’avec l’assentiment de l’Administration des Domaines, en tant que porteur de parts de l’associé Andermann. » [déclaration de Maximilien Vox à la police, 8 octobre 1946].
Jeanne Loviton a confirmé cette version : « Vers février 1945, à la demande de M. Maximilien Vox, administrateur provisoire des Editions Denoël, nous nous sommes rendus, M. Denoël et moi, chez M. Streichenberger, conseiller juridique, rue Saint-Lazare. Assistaient à cette entrevue M. Maximilien Vox, M. Pouvrot [sic pour Pouvreau], secrétaire général des Editions Denoël, un représentant de la banque Worms, M. Denoël et moi. M. Maximilien Vox a exposé la nécessité pour trouver des capitaux de céder les parts Robert Denoël à une société d’édition ayant du crédit. M. Denoël et moi n’étions allés à cette réunion qu’en observateurs. » [déclaration à la police, 15 janvier 1950].
Le 15 février Denoël écrit à l'Administration des Domaines pour l’aviser de son intention de céder ses parts dans sa société, pour le cas où celle-ci aurait désiré exercer son droit de préemption. La réponse fut négative et il envisagea alors de les céder à un nouvel associé, en l'occurrence la Société des Editions Domat-Montchrestien.
Le 19 février eut lieu, rue Saint-Jacques, « une délibération des associés des Editions Domat-Montchrestien décidant, en principe, l’achat des parts Denoël, étant bien entendu qu’au préalable " serait assurée la libre disposition du vendeur ". [...] En d’autres termes, les Editions Domat-Montchrestien ne voulaient pas se porter acquéreurs avant que soit terminée l’instruction pour intelligence avec l’ennemi. Si, en effet, M. R. Denoël devait être renvoyé en Cour de Justice, la confiscation de ses biens aurait, de toute évidence, entraîné, de la part de son séquestre, une demande en nullité de la vente opérée par lui, de l’élément essentiel de sa fortune, dans une période éminemment suspecte. »
Yvonne Dornès, associée majoritaire dans la Société à cette époque, confirma la version de Jeanne, en ajoutant : « je sais qu’ils avaient fait le projet du groupage [sic] de leurs maisons d’édition dont Mme Loviton devait assumer la direction administrative et financière et M. Denoël la direction littéraire et technique. » [déclaration à la police, janvier 1950].
Le 15 février un commissaire de police s'est présenté au domicile des Aragon-Triolet, muni d’un questionnaire factuel. Jeanne Loviton, très active, avait imaginé ce stratagème, dont elle était justement fière, soixante ans plus tard : faire répondre les deux écrivains par oui ou par non à des questions précises concernant des sommes d’argent que Denoël leur a prêtées ou avancées durant l'Occupation, et à des Israélites que l'éditeur a aidés à passer en zone libre.
Dès le 26 février Denoël charge Albert Morys de mettre au point les couvertures de brochures « patriotiques » à paraître aux Editions de la Tour qui, à cette époque, sont domiciliées 5 rue Pigalle, au domicile de Morys, leur gérant.
Le 27 février Paul Vialar signe avec les Editions Denoël un contrat pour trois romans dont le premier sera La Caille. Il fut livré à l'éditeur à la date prévue au contrat, le 1er mars, et parut à l'automne à cause du retard pris par l'éditeur. Les deux autres devaient être livrés le 1er novembre 1945 et le 1er juillet 1946. Job parut en avril 1946 et Le Voilier des îles, un roman pour la jeunesse (prévu tout d'abord aux Editions de la Tour), en octobre 1947.
Le 8 mars paraît aux Editions Domat-Montchrestien, tiré à 950 exemplaires numérotés, un Voltaire par Paul Valéry. Il s'agit d'un discours prononcé à la Sorbonne le 10 décembre 1944 à l'occasion du 250e anniversaire de la naissance de Voltaire. C'est le premier titre d'une collection littéraire, la première chez Domat-Montchrestien : « Au Voilier », et Jeanne a demandé à Valéry d'en dessiner la vignette de couverture.
Le 15 mai Jeanne y publiera un second texte de Valéry : Henri Bergson, qui est le texte d'une allocution prononcée à l'Académie, le 9 janvier 1941, et publié tout d'abord dans un recueil collectif en août 1941.
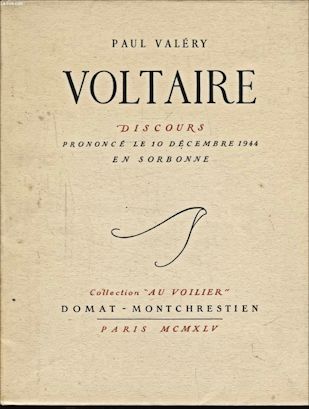
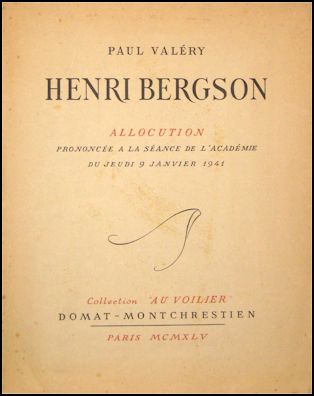
Trois semaines plus tard les Editions Denoël publient Le Premier accroc coûte deux cents francs. Ce recueil de nouvelles d'Elsa Triolet obtiendra le Prix Goncourt 1944 (non décerné cette année-là), le 2 juillet.
C'est au cours de ce même mois que Paul Vialar signe avec Domat-Montchrestien un contrat pour son grand roman, La Mort est un commencement. L'écrivain déclarera en janvier 1950 à la police : « Ce contrat a été signé par l’intermédiaire de M. Denoël qui m’avait mis en rapport avec Mme Loviton au mois de mars 1945 [...] En effet M. Denoël, au mois de mars 1945, m’avait fait part de son désir de céder les parts qu’il détenait dans la société Denoël à Mme Loviton. »
Auguste Picq, le 18 septembre 1946, déclarait à la police : « M. Denoël s’occupait également des Editions Domat-Montchrestien, dont Mme Loviton était la gérante. Je ne pense pas qu’il avait des intérêts directs dans cette société d’édition, mais le fait qu’il amena dans cette société des auteurs importants, dont Paul Vialar, me laisse à penser qu’il devait avoir une part dans l’exploitation de cette affaire. C’est en effet depuis qu’il collaborait avec Mme Loviton dans les Editions Domat-Montchrestien, que celles-ci publièrent des ouvrages littéraires. Précédemment, elles n’éditaient que des ouvrages de droit. »
Quelque chose reste à vérifier quant aux relations qu'entretenaient Vialar et Jeanne. En janvier 1980 il avait rédigé à mon intention un témoignage où l'on trouve cette phrase : « Il [Denoël] était tombé amoureux d'une femme qui avait été mon amie de jeunesse et tenu une place importante dans la vie de Claude Aveline ». Pourtant le 24 juillet 1947 Jeanne lui avait écrit, alors qu'elle entreprenait de redresser les finances de la maison Denoël dont elle était devenue l'héritière légale quelques semaines plus tôt : « J'y arriverai. Vous me connaissez assez maintenant pour m'avoir vue à l'œuvre. »
Sur le plan familial bien des choses ont changé chez les Denoël, où les absences répétées de l'éditeur amènent des scènes interminables. Albert Morys déclara à la police, le 20 septembre 1946 : « Je savais qu’une femme existait dans sa vie, depuis fin 1943, parce qu’il lui arrivait de découcher depuis cette époque. Il avait d’ailleurs informé Mme Denoël que, connaissant quelqu’un, ils allaient se trouver dans l’obligation de se séparer. [...] Vers fin 1943, le jour où M. Denoël annonça à sa femme sa résolution de la quitter, ils eurent une scène violente, à la suite de laquelle Mme Denoël tomba malade. Néanmoins, au moment de leur séparation définitive, en août 1944, leurs rencontres étaient plutôt cordiales, chacun ayant pris son parti de la chose. »
Ainsi, « chacun ayant pris son parti de la chose », Denoël vit avec Jeanne mais revoit Cécile, notamment rue Pigalle, chez les Bruyneel, entre août 1944 et mars 1945 : « Pendant un mois et demi, M. Denoël vint prendre ses repas de midi chez mon père. Il continua par la suite à y rendre visite à sa femme jusqu’en mars 1945, époque à laquelle celle-ci réintégra son appartement de la rue de Buenos-Ayres », dit Morys.
Cécile connaît la plupart des escapades de son mari, qui finit toujours par lui revenir. Ici pourtant le mot « divorce » a été formellement prononcé, pour la première fois. Cécile ignore totalement qui est cette nouvelle venue et elle charge Gustave Bruyneel de s'informer à son sujet : « Au début de l’hiver 1944 Mme Denoël ayant appris que son mari avait une liaison avec Mme Loviton, me chargea d’aller me renseigner sur cette personne. C’est ainsi que je me présentai aux Editions Domat-Montchrestien où, sous un prétexte, je fus reçu par Mme Loviton, ce qui me permit de la décrire physiquement à Mme Denoël », déclare-t-il à la police, le 11 octobre 1946.
L'épouse trompée sait que l'affaire est sérieuse car sa rivale appartient à un tout autre monde que le sien. Le 8 mars, au moment de rentrer chez elle, rue de Buenos-Ayres, elle fait parvenir ce mot à son mari : « Comme tu le sais, je rentre aujourd'hui à la maison que nous avons quittée avec tristesse lors des événements. Penses-tu que nous y voyant, le Finet et moi, tu ne regretteras pas notre vie familiale ? Il est encore temps Bobby de la reprendre si tu le désires. »
Denoël ne revint plus chez lui et la question du divorce traîna plusieurs mois avant que Cécile s'adresse, le 29 juin, à un avocat : Me Roger Danet, 5 rue de Richelieu, pour entamer la procédure : « d’accord entre les parties, Mme Denoël avait fait à son mari une sommation de réintégrer le domicile conjugal et celui-ci avait répondu par le refus formel qui était prévu. » [lettre de Me Armand Rozelaar au juge Gollety]. Manifestement, Denoël a pris sa décision puisque, le mois précédent, il a aussi rompu avec Dominique Rolin.
De son côté Jeanne a mis les choses au point avec Paul Valéry. Elle a choisi le dimanche 1er avril, jour de Pâques, jour de son anniversaire et jour de visite traditionnel du poète rue de l'Assomption. De manière très « lovitonienne » elle le reçoit couchée, et lui annonce gaiement son mariage prochain avec Denoël, qui la secondera efficacement dans sa maison d'édition, où elle épuise ses forces depuis des années. Cela ne changera rien à leurs relations privilégiées, assure-t-elle au vieil homme effaré : au contraire, elle disposera de plus de temps pour lui...
C'est, en somme, un nouveau « partage » qu'elle lui propose, comme en décembre 1940 à propos d'un amant de passage. Tout s'effondre pour le poète mortellement blessé qui voyait en elle « une femme complète, comme il y en eut à la Renaissance, femmes créatrices, hautes amoureuses, esprits riches et libres, capables de toutes les valeurs d'action et de volupté », et qui, désormais, doit la regarder telle qu'elle est : « je suis obligé maintenant de te considérer à la propre lueur que tu as tirée de toi-même, et dont tu m'as affreusement ébloui. Je te vois dans toute la médiocrité de ton désir, la vulgarité de tes projets, la perfidie de ton cheminement. » [Jarrety, op. cit., p. 1188].
Ce sont des notes intimes qu'il rédige à son propre usage, et dont les lettres qu'il lui enverra ensuite ne portent pas trace, mais dont la lucidité tardive contraste avec le message du 3 avril, qui est celui d'un homme qui se noie, dont la fenêtre le tente, et qui demande encore pardon d'importuner : « Tu sais combien j'ai toujours eu égard à ta sensibilité et fait de mon mieux pour ne pas la choquer. Mais aie pitié de ce moi en détresse. Je suis comme empoisonné et il faut que ce soit bien affreux pour que j'envoie ceci à celle que j'aime avec cette épouvantable puissance de douleur. »
Il se sent en proie à un châtiment inouï, expiant peut-être le crime d'avoir pendant des années « exalté de toute ma puissance de poète et de toute ma sensibilité un sentiment... élevé de toutes mes forces jusqu'au zénith de l'absurde un monument de tendresse dont toute la masse, d'un coup, me tombe sur ma vie. »
Le 4 avril Robert de Billy a convié quelques amis à un déjeuner, et Valéry est stupéfait d'y trouver Jeanne : « Ce n'est pas moi qui ai incité R à vous inviter. Certes non ! J'y ai été avec la terreur physique de vous rencontrer, la peur de l'animal hébété, blessé et assommé de la même main qui lui donnait à vivre. Bien au contraire, j'ai pensé que vous aviez refusé de venir pour ne pas me voir. »
Valéry commence-t-il à deviner le cœur d'airain de sa belle infidèle ? Il lui écrit, le même jour : « Vraiment, je ne puis pas penser que toi, tu aies imaginé et préconçu ce que tu allais me faire dimanche. Ce serait trop affreux. C'est que tu serais alors littéralement capable de tout ! »
Comment en serait-il autrement ? Ils ne se voient plus guère qu'une ou deux fois par mois : Jeanne a eu tout le temps de préparer cette rencontre, à une date symbolique, et sur le ton indigne qu'elle a choisi de lui donner. Valéry résume alors leur malheureuse idylle : « Tu sais bien que tu étais entre la mort et moi. Mais hélas il paraît que j'étais entre la vie et toi... Je ne vois pas d'issue. Ce jour de la Résurrection me sera celui de la mise au Tombeau. »
Pourtant il n'a pas encore compris le caractère machiavélique de sa maîtresse qui, au cours de cette rencontre douloureuse, a trouvé le moyen de le culpabiliser : « voyez comme je suis malheureuse si je vous crois triste... »
Et c'est apparemment à cette occasion qu'elle eut aussi l'idée saugrenue de le prier d'intercéder en faveur de son amant, inculpé de collaboration le 19 février. Puisque son amie Yvonne Dornès a accepté de lui rendre ce petit service, elle doit se dire que Valéry en fera autant. C'est un faux-pas : Valéry refuse tout net.
Le 13 avril elle tombe opportunément malade. On ne sait pas de quoi elle souffre alors, car le surmenage dont elle se plaint en permanence lui occasionne quantité de maux, dont des crises de névralgie faciale qui l'obligent parfois à porter un masque. Célia Bertin, peu suspecte d'indulgence pour son héroïne, écrit : « Jeanne, comprenant soudain ce qu'elle vient de faire, réagit selon son habitude. Elle rentre chez elle et se couche. Elle est malade, elle l'appelle. » Valéry en oublie sa propre peine : « Ma Malade, ma pauvre Malade... [...] je ne te parlerai pas de mon état : il y a le tien. Oh comme je voudrais prendre ton mal ; et qu'il m'emporte... », lui écrit-il. Le 23 avril il a rencontré son médecin : « Il m'a dit que tu es en bonne voie, que cela a été sérieux, mais qu'il est satisfait maintenant. » Le nom de ce médecin n'est pas cité mais il devait s'agir du docteur Jacques Mallarmé, 7 rue Saint-Dominique, qu'on a déjà rencontré à Béduer en 1942 et qu'on y trouvera encore en 1946.
Entretemps Valéry la distrait avec des anecdotes concernant sa soudaine reconnaissance littéraire. Louis Jouvet a, au cours d'une conférence, parlé de son immense gloire en Amérique du Sud : « Cela veut dire sans doute que je suis bon à enterrer, mûr pour nécrologies... Mais qui pourrait imaginer que ce grand homme échangerait tout ce rayonnement contre le sort d'un certain simple... éditeur... » [13 avril].
Ce sentiment l'accable. Alors qu'il prêtait à sa muse les plus hautes pensées amoureuses, elle s'abaissait à une liaison charnelle sans grandeur : « une situation de roman tout banal s'est créée. Je ne me pardonnerai jamais cette avilissante défaite. Je finis cette vie en vulgarité, victime ridicule à mes propres yeux, après avoir cru l'achever dans un crépuscule d'amour absolu incorruptible et de puissance spirituelle reconnue par tous comme sévèrement et justement acquise. » [13 avril].
Le 18 avril il ne peut s'empêcher de revivre douloureusement la scène de rupture qu'elle lui a infligée, trois semaines plus tôt : « tu m'as sacrifié en exécution d'un calcul sage, bien raisonné, nécessaire peut-être - mais bien caché, pendant que nos relations demeuraient intimes et confidentes. Et cela est atroce à penser, que tu m'avais condamné, et qu'au moment de t'engager tu n'avais pas senti je ne sais sais quel pincement au cœur, imaginé ce qui se passerait en moi quand j'apprendrais que j'étais trahi ; et dans les conditions les plus banales, et mêmes les plus ridicules - qui feront certainement rire de nous deux, et triompher divers amis ou amies ».
Le 24 avril Valéry regrette encore ce qu'elle représentait pour lui : « une promesse, une virtualité, un vivant chef-d'œuvre " en puissance " - mais qui s'ignorait dans une grande mesure. » Malheureusement, « vint l'époque où tu fus contrainte de peiner. Peut-être ton besoin de luxe a-t-il eu sur toi trop de prise ? Tout se paye, surtout ce qui paye. Ce n'est pas ta santé seulement que cette vie infernale a compromise. La tête dans les affaires, les problèmes pratiques pressants, les jours sans cœur et sans poésie, la volonté tendue, l'usage habituel de ta séduction, tout cela, et surtout, le calcul perpétuel, l'obligation de ne penser qu'en fonction des intérêts, oui, tout cela atteint la sensibilité dans ses parties divines. Je la voyais dépérir. [...] Et j'ai eu peur que tu ne te vulgarises. Car la poursuite excluvive d'un but matériel, cela rend vulgaire, cela finit par exténuer la substance de tendresse et le charme magique que tu avais à un point si extraordinaire. »
On peut se demander si Robert Denoël, très amoureux lui aussi, aurait eu la même puissance intuitive à propos de sa maîtresse. Il est vrai qu'il n'avait pas le recul de Paul Valéry, qui la connut durant plus de dix ans. Cela n'empêche pas le poète, qui ne peut se passer d'elle, de retourner la voir, rue de l'Assomption, puisqu'aussi bien elle se dit toujours malade. Mais quand il rencontre Henri Mondor dans une rue de Paris, le 27 avril, il lui confie : « L'heure de l'épitaphe arrive : P.V., tué par les autres ». L'ulcère gastrique dont il souffre depuis de longs mois lui occasionnent de violentes crises de toux, des hémorragies et des évanouissements.
En mai, Jeanne a rappelé à Valéry le livre qu'il avait entrepris en 1942 (« Vues personnelles sur le Droit ») et qu'il destinait aux Editions Domat-Montchrestien, mais il n'est plus en état physique et moral pour le mener à bien : « Je crois qu'il aurait fait honneur, honneur singulier, à la Maison... Mais la Maison elle-même... doit suivre un sort nouveau qui ne peut guère m'inspirer d'entreprendre ce que j'aurais certainement, un jour ou l'autre, fait pour elle. » [15 mai].
Valéry connaît le projet de Jeanne Loviton et de Robert Denoël, qui est d'associer les Editions Denoël aux Editions Domat-Montchrestien, et il n'a aucune envie de le favoriser.
C'est à cette même époque qu'il rédige à l'intention de Jeanne une longue lettre où il passe en revue la plupart de leurs bons et moins bons moments : « depuis bien longtemps je souffrais de voir ton esprit, accablé de ses affaires, se désintéresser tout à fait de ce qui relève un esprit de ses fonctions naïvement pratiques.Tu ne demandais plus une conversation d'ordre délié, car tes soucis toujours nouveaux et urgents ne te laissaient pas la liberté de le désirer. Nous ne parlions que de ce qui t'importait et te pressait dans le moment même, ou bien des " événements " , ou de petites choses mondaines. »
Il ne manque pas d'évoquer cette lecture de Mon Faust, rue de l'Assomption, en août 1944 : « Il n'y manquait même pas un éditeur étranger qui se montra déjà très satisfait. » Ni le « coup de hache » du 1er avril 1945 : « Tout était prêt dans ta pensée et dans les circonstances. Tout était disposé dans la pénombre. Ton cœur était prêt, dégagé... Ton projet arrêté. L'homme était là. Point de surprise. Au signal, tout s'exécute conformément au plan. »
A ce moment Paul Valéry travaille toujours mais « à n'importe quoi. Il s'agit de fuir la pensée de fond - et ce fond est touché à chaque instant. Tu auras été le diamant et le stylet dans mon cœur. Et encore, le breuvage qui rend la jeunesse et qui tue. » [25 mai]. Il avait fait le projet de se rendre la veille chez Jeanne mais son médecin lui a prescrit d'éviter toute fatigue et de ne plus sortir. Il la prie de passer le voir rue de Villejust, mais elle n'ira pas.
Dans une des dernières lettres qu'il lui envoie, le 27 mai, Valéry écrit : « Je ne sais si tu avais besoin de constater la gravité du coup porté, mais tu le vois maintenant, combien ma vie était pénétrée de toi. Oui, je me suis laissé aller au don de toute ma sensibilité à mon idole. Je me demande si tu imaginais que je serais si atteint ? » Et il conclut en se demandant : « Qu'est-ce que tu es, AU FOND ? »
Michel Jarrety a bien résumé cette étrange relation amoureuse : Paul Valéry attendait de sa maîtresse qu'elle le ressourcât, cependant qu'en retour, il façonnerait son talent. C'était un pari insensé car son talent littéraire était mince. Céline aurait dit : « Dieu, qu'elle était lourde ! » Son vrai talent consistait à séduire les êtres, hommes ou femmes, afin d'en tirer le meilleur parti, à son profit. Jeanne Loviton était ce qu'on pourrait appeller un succube, et qui vécut jusqu'à l'âge de quatre-vingt-treize ans.
Plus on avance dans sa biographie, plus on se dit que cette femme est une comédienne qui, jamais, ne descend de l'estrade qu'elle a conçue et où elle attire ses amis et amants de tous sexes, forcés de participer à une pièce non écrite qui, tôt ou tard, tourne à la tragédie - sauf pour elle.
Quand elle rompt avec ses amants, elle déclame. En 1930 elle écrit à Pierre Frondaie : « Adieu, Pierre. Je suis déjà loin. Tu as, par ta faute, piétiné l’immense amour que j’avais pour toi », alors qu'elle charge un huissier de faire poser des scellés sur sa villa d'Arcachon.
Sa lettre de rupture avec Giraudoux est un modèle d'emphase : « Ta présence n'est que le fin contour d'une absence démesurée. Tu aurais pu m'adoucir l'une par l'autre. Tu ne l'as pas voulu. Tu as laissé à nos éloignements leur rigueur, tes retours ont manqué d'harmonie. Je t'avais rêvé, je ne te juge pas. Je renonce à ce bonheur en coup de poing, je ne veux plus te revoir. »
Il est inutile de s'appesantir sur la scène grotesque mais tragique de la rupture avec Paul Valéry : cette femme est, comme l'écrit un peu tard le poète, « littéralement capable de tout ». Robert Denoël n'a rien vu de tout cela.
En juillet, elle « fait retraite » à Figeac avant de gagner Divonne-les-Bains, où il ira la rejoindre durant quelques jours. Jeanne s'y est fait conduire, en compagnie de Mireille Fellous, par Abel Gorget, son chauffeur, et ce long périple ne manque pas de l'inquiéter : « Il fait chaud, très chaud et j’ai peur, harassée comme tu l’es, que le voyage ne te soit très pénible. » Il est vrai que, durant des mois, Jeanne a multiplié les démarches en sa faveur, et il se sent un peu responsable de son état de santé : « Pour moi qui t’ai donné tant d’angoisses toute cette année et qui ai assisté, impuissant, à ta prodigieuse dépense, sois sans inquiétude. » [6 juillet].
Denoël vit alors chez elle, rue de l'Assomption : « Tout seul à la table bleue et ta chaise-longue, s’alanguissait un homme amoureux. » Mais c'est un amoureux inquiet, qui a les mêmes préoccupations que Paul Valéry : « L’orage couvait et je pensais que tu en souffrais dans cette mauvaise voiture, que Gorget se lamentait et qu’avec Mireille tu supputais les ennuis qui t’attendaient à l’arrivée, que tu faisais l’inventaire de tout ce que tu avais laissé derrière toi, pas encore tout à fait capable de renoncer aux catastrophes parisiennes mais prête déjà à la guerre du Lot. » [7 juillet].
Le lendemain, la Peugeot est tombée en panne, et c'est une catastrophe dont elle lui rend compte par télégramme : « Quelle série noire ! Vraiment, tout s’oppose à ton repos. Ironie suprême ! Ton télégramme est daté d’un village appelé " Vatan ". Aller tomber en panne dans un pays qui vous invite aussi expressément à partir, c’est vraiment jouer de malheur. Tu avais raison de redouter cette voiture. » [8 juillet].
C'est assurément une voiture peu fiable, ce qu'il aura l'occasion de vérifier quatre mois plus tard, mais il ne s'agit, après tout, que d'un voyage d'agrément, alors que la plupart des Français doivent subir cet été chez eux. A l'occasion de ce message sans grande importance figure une réflexion qui mérite d'être retenue : « Et moi, je suis là, une fois de plus réduit à assister à tes difficultés sans pouvoir y remédier. Tu ne sais pas à quel point cette situation me pèse. Si je ne t’en parle pas souvent, c’est que je n’aime pas les considérations platoniques. Tant que je serai incapable par situation, par impossibilité matérielle, de résoudre les problèmes à ta place, je serai bien obligé de demeurer dans le silence. Mais je vois maintenant poindre le jour où tout cela va changer. Dès octobre, ta vie va prendre une autre tournure parce que je pourrai y jouer un rôle vraiment actif. Mes petites affaires seront sorties de la période préparatoire et seront en plein rendement. Quant aux tiennes, je les conjuguerai avec les miennes pour une part tout au moins et tu commenceras tout doucement à t’en éloigner pour les quitter ou, en tout cas, en secouer la servitude dans le courant 1946. A ce moment j’aurai repris un rôle actif au grand ou au demi-jour ».
Voilà le vrai motif des soucis de l'éditeur : se trouver mis à l'index et dans l'impossibilité de publier, autrement que sous le paravent d'une maison d'édition fictive, des livres de qualité. Il escompte bien être « blanchi » au cours de la semaine suivante et reprendre la direction de ses affaires, en les conjuguant, « pour une part tout au moins », avec celles de Jeanne Loviton.
Entretemps Jeanne lui envoie des messages alarmistes : « Souffres-tu ? Es-tu malade ? Ou bien cette température est-elle le contrecoup de tes dernières journées et de la fatigue extrême du voyage si péniblement accompli ? » Il est sûr que les routes de France sont tuantes durant l'été, mais moins peut-être que celles de Paris : « Aujourd’hui, par un soleil torride, j’ai beaucoup couru : j’ai sué dans tous les métros pendant des heures, ma moto ayant encore fait des blagues. » [9 juillet].
Malgré le charme de Divonne où elle peut se reposer à l'ombre, Jeanne est pleine de soucis majeurs : « Tous mes pronostics et mon anxiété de juin concernant les vacances étaient hélas une fois de plus fondés. [...] Cela m’ennuie de te parler de tout cela mais mon imagination inquiète prévoyait tout ce que je vois. Il y a eu beaucoup d’improvisation dans notre organisation de vacances et Dieu sait pourtant si ce mois me tenait à coeur ! [...] Comme en plus je ne me sens pas bien du tout : névralgies encore, douleurs dans les jambes, lassitude extrême, cauchemars, je suis découragée. »
Denoël prépare la « rentrée » aux Editions de la Tour, où trois volumes de demi-luxe ont paru avant l'été et où trois autres sont en préparation. Comme il est à peu près seul pour leur mise en train, il y consacre la meilleure partie de son temps. Jeanne ne t'entend pas ainsi : « En 1945 il faut savoir une fois pour toutes que chaque petite satisfaction exige une lutte, une prévision, une patience, une persévérance infinies. Je te supplie, pour moi, mon amour, de dominer ta tendance naturelle à l’optimisme, au tout ira bien, pour " organiser " nos joies. Oui le voilà ce mot affreux, mais il le faut. Il faut abandonner un peu la lecture et te poser les problèmes quotidiens de notre confort, de nos aises, sans quoi il n’y a pas de joie. Il ne faut plus me laisser seule relancer les amis, prier l’un, supplier l’autre, courir ici ou là frapper aux portes, il faut que tu agisses aussi parce que je suis à bout. Je ne t’ai jamais dit ces choses aussi nettement parce qu’il ne s’agissait pas de nous, de notre seul mois de bonheur paisible, or j’ai assisté ahurie à ta... légèreté ! oui chéri ! tu passes à côté des questions, il faut fabriquer du réel, après nous pourrons rêver. [...] il faut me pardonner si je cherche à te réveiller. C’est exact, j’ai parfois l’impression qu’hors de ton travail précis, tu dors. Je nous veux heureux or je me sens très malade et j’ai peur. » [11 juillet].
L'éditeur doit impérativement rester à Paris car son procès est fixé au 13 juillet : il bénéficie d'un non-lieu. C'est un jugement très important mais il n'en a pas fini avec la justice car sa société d'édition reste poursuivie : « J’ai vécu une année beaucoup trop riche en angoisses pour penser à des vacances. Je te dirais même que dans mon esprit il n’en était pas question. Je ne croyais pas arriver à la solution aussi tôt. Et pour toi, Béduer me paraissait tout indiqué. Quant à mon intervention personnelle dans les commodités de notre vie future, n’en doute pas un instant. Mais il m’a été à peu près impossible toute cette année de faire une démarche utile. Ce n’est que très lentement que se dessine pour moi un statut à peu près normal. Je n’ai qu’une ambition, te voir abandonner au plus vite une vie qui n’est pas faite pour toi. En 1946 ce sera chose accomplie, cela je te le jure. » [17 juillet].
Le dessein de Denoël paraît clair : il veut alors associer sa maison d'édition avec celle de Jeanne Loviton. C'est ce que déclarera Yvonne Dornès à la police, en juillet 1950 : « Au début de l’année 1945, je sais qu’ils avaient fait le projet du groupage [sic] de leurs maisons d’édition dont Mme Loviton devait assumer la direction administrative et financière et M. Denoël la direction littéraire et technique. »
Si un tel « groupement » était financièrement viable, il n'en allait pas de même quant à l'image de leurs maisons d'édition, qui s'adressaient à des publics fort différents. Il n'était pas pensable de les fondre en une seule : ce ne pouvait donc être qu'un arrangement financier, chacun restant maître chez lui quant au programme d'édition, mais dépendant de l'autre grâce à des prises de participation.
Yvonne Dornès ajoute : « M. Denoël a projeté de céder la totalité des parts qu’il possédait dans les Editions Denoël aux Editions Domat-Montchrestien, projet dont j’ai personnellement accepté le principe en tant qu’associée des Editions Domat-Montchrestien ».
Pour Mme Dornès, il ne fait aucun doute que c'est sa société qui prendra le contrôle de celle de Denoël. Ce projet, qui s'est concrétisé par une cession de parts datée du 25 octobre 1945, est précisément au cœur des procès intentés début 1946 par la veuve de l'éditeur : sans ce document, il n'y aurait pas d'affaire Denoël.
Le 20 juillet, Paul Valéry est mort chez lui. Depuis le début juin il vivait alité, soigné en permanence par des piqûres d'antibiotiques. Jeanne est passé le voir à une ou deux reprises, notamment le 6 juillet, en apportant des fruits.
Le même jour elle a quitté Paris pour Béduer avant de gagner Divonne-les-Bains, le 18. Ce jour-là Denoël, tout heureux du non-lieu dont il a bénéficié le 15, écrit à Paul Vialar que Jeanne, « éreintée par tant de travail et de soucis, est partie pour Divonne où des soins judicieux et un large repos la mettront en état de passer de bonnes vacances avec moi au mois d’août. » Denoël ne quittera Paris que le 3 août, pour rejoindre Jeanne à Divonne.
Il se trouvait donc à Paris au moment du décès de Valéry et peut-être a-t-il assisté à son enterrement, le 24, ou à ses obsèques nationales, le lendemain. Jeanne avait été prévenue téléphoniquement de sa mort le jour même par Paule Gobillard, la belle-sœur du poète, et elle écrit à son amant, le 20 : « J'ai pleuré à travers bois et champs cet après-midi. Je mesure ma perte, pour moi elle est immense, pour lui je crois qu'il valait mieux qu'il disparaisse, il n'aurait pas supporté mon bonheur. »
Le 21 Denoël, toujours attentif, la console en écrivant qu'elle lui avait appporté ses dernières joies, lui avait imprimé ses dernières œuvres... Mais il fait beaucoup mieux que cela : « Pense à tout ce qui est perdu, mais pense aussi à tout ce qui a été créé entre vous, pense à ses tourments, mais pense surtout à l’aiguillon que tu as été pour sa pensée et pour son cœur. Après la soixantaine, la plupart des écrivains ne font plus que balbutier : grâce à toi, il a vécu avec une agilité de l’esprit et un goût de la vie, une passion d’homme en pleine force. »
Cette lettre est d'un gentilhomme lettré qui a parfaitement compris qu'il n'est pas le premier, surtout de cette taille, et qui espère simplement être le dernier.
Comme pour Jean Giraudoux, Jeanne éprouva le besoin de raconter sa version de la liaison quelle eut avec Valéry mais, contrairement au texte qu'elle avait rédigé au lendemain de la mort du dramaturge, celui-ci date de 1969 et prend place dans son « Curriculum vitae » : « En 1945, Jean Voilier envisagea de refaire sa vie avec un grand éditeur qui avait son âge, la même culture, les mêmes goûts et le respect de ses affections. [...] Elle l'apprit à Paul Valéry qui, malgré la peine qu'il pouvait ressentir à savoir qu'elle ne serait plus absolument " libre " demain, non seulement le comprit, mais donna des preuves de son estime à l'homme dont elle avait accepté de partager la vie. »
Si Jeanne Loviton avait préféré « faire retraite » ailleurs qu'à Paris à un moment crucial pour son amant mourant, son « ambassadrice », Yvonne Dornès, fut bien présente à ses obsèques : « Beaucoup de monde, de fleurs - les tiennes, magnifique gerbe de glaïeuls de chez Lachaume - mais très peu d'émotion. Occasion de rencontrres, de bavardages, de mondanités - Les fils très guillerets. La veuve, à qui j'exprimais tes condoléances (absence, maladie) a été sublime : elle m'a dit qu'elle pensait à toi, devinait ta peine, que ta lettre était arrivée après la mort (elle a dû la lire), qu'elle l'avait mise près de lui, et l'y a laissée jusqu'au départ. »
Il s'est trouvé au moins une personne pour s'étonner de l'absence de Jeanne Loviton : Robert de Billy, ami des deux amants : « je lui ai dit que tu étais trop bouleversée et malade et que moi-même t'avais suppliée de ne pas rentrer. » Yvonne Dornès est une maîtresse qui sait assumer les errements de sa dulcinée, dont les vacances à Divonne-les-Bains sont d'ailleurs contrariées : « La Maison Verte » est située trop près du chemin de fer, ce qui doit gâcher son sommeil réparateur, et elle a entrepris d'insistantes démarches auprès de la gardienne du golf tout proche pour s'y installer : « Jamais personne n'avait eu assez d'imagination pour risquer cette proposition », écrit-elle à Denoël, le 20 juillet.
C'était à coup sûr une nouvelle victoire, mais l'endroit qu'elle a trouvé pour abriter ses nouvelles amours présente quelques inconvénients : la chambre est à peine plus grande que le lit, il n'y a pas d'eau courante, et elle est infestée de mouches et de moustiques. Célia Bertin met cela sur le compte du nouvel élu qui, « on le découvre ici, ne dispose pas de grands moyens financiers ». Le 29 juillet Denoël avait pourtant écrit : « Ne te soucie pas de la question argent. J’ai tout réglé ici. J’emporte avec moi assez d’argent pour notre séjour. Nous règlerons ces comptes à la rentrée. Et à partir de novembre, je crois bien que la question d’argent ne se posera plus du tout entre nous. »
Apparemment cette question du logement ne pose pas trop de problèmes à Denoël, qui lui écrit : « A nous la cage à mouches, à moi, mon amour, mon beau, mon doux, mon tendre chéri. » Les amants passeront quelques semaines à Divonne, puis à Béduer, d'où Denoël reviendra à Paris, le 4 septembre.
Jeanne reste à Figeac pour une semaine encore. Elle écrit aussitôt : « nous avons été heureux malgré mes maudits accidents de santé. Je sais quel est le ton de notre bonheur et ce qu’il serait si je n’avais pas cette tempe douloureuse qui me rappelle constamment à l’ordre et me dit : " tout doux, ne t’emballe pas, on n’a pas le bonheur si facilement ni à l’état pur ". Pourtant je veux être heureuse complètement, je me retourne vers les efforts passés avec mélancolie. Avoir été si sage... malgré tant de folies, ce n’était pas de mon âge ! je me suis trop contrainte. Je veux vivre. Vivre, c’est croire avec toi ! car je compte sur toi pour tout, sauf bien sûr pour le linge et les détails de la vie que ton esprit n’arrivera jamais à retenir ! » [3 septembre].
Editions de la Tour
Il n'y a plus guère d'échanges épistolaires entre les amants au cours des trois mois suivants puisqu'ils sont l'un et l'autre rentrés à Paris, et que Robert habite le plus souvent rue de l'Assomption. Il reçoit ses auteurs et amis dans son pied-à-terre du boulevard des Capucines, et travaille tantôt rue Saint-Jacques, tantôt boulevard de Magenta.
Or à cette dernière adresse, Albert Morys s'occupe à peu près seul depuis le mois de juin des Editions de la Tour. Il ne prend aucune initiative, suit à la lettre les directives de Denoël, et s'est prêté depuis l'année précédente à toutes sortes d'opérations plus ou moins fictives. Le 16 mai 1944 il a « racheté » les parts de Denoël dans Les Nouvelles Editions Françaises, dont il est devenu le gérant, et qu'il a domiciliées chez lui avant d'en transformer, en novembre, le nom en Editions de la Tour, puis de les transférer, le 1er juin 1945, au 162 boulevard de Magenta.
Morys est un parfait homme de paille qui sert aussi, à l'occasion, de « faux-nez » pour des opérations plus personnelles : le 30 septembre 1944 il a « racheté » tous leurs meubles aux époux Denoël qui, le 7 octobre, lui ont en outre cédé le droit au bail de leur appartement.
Ces cessions complaisantes ont eu lieu en vue de la Libération dont chacun pressentait qu'elle donnerait lieu à de nombreux règlements de comptes et à des confiscations arbitraires. Denoël avait reçu des menaces inquiétantes sous forme de petits cercueils, d'appels téléphoniques anonymes ou d'articles hostiles dans la presse clandestine. Il prit donc avec Morys les mêmes dispositions qu'avec Jeanne Loviton pour les Editions Denoël.
Si Jeanne a contesté la fictivité de ces écritures quand elles la concernaient, Morys eut le mérite d'exposer à la police comment Denoël avait procédé, le 8 mai 1944, pour lui céder provisoirement, ainsi qu'à Maurice Percheron, sa petite maison d'édition : « Le jour de cette cession, M. Denoël, s’entourant de garanties, nous fit signer, au docteur Percheron et à moi, une rétrocession de ces parts par blanc-seing, non daté, et sur lequel ne figurait pas également le nom de l’acquéreur. M. Denoël avait remis ces blancs-seings à son homme d’affaires, M. Hagopian, 24 rue de Bondy » [Témoignage de septembre 1946].
Dans un mémoire adressé le 21 décembre 1949 au procureur de la République, Me Armand Rozelaar, l'avocat de Cécile Denoël, a confirmé cette déclaration : « Robert Denoël était un homme assez mystérieux, menant son existence et ses affaires d’intérêt d’une manière très personnelle. Il se confiait à certains de ses intimes et il avait surtout la manie de contrôler des sociétés par personnes interposées, en faisant signer à ses hommes de paille des actes de cession de parts en blanc. C’est ainsi que R. Denoël contrôlait effectivement trois entreprises d’édition. »
C'était en réalité une pratique initiée par l'éditeur depuis ses débuts, en 1928, comme le confirma Cécile Denoël dans un mémoire remis au juge Gollety, le 8 janvier 1950 : « Mon mari avait la spécialité de créer des sociétés fictives ou de les continuer sous le couvert de prête-noms, et d’investir, également sous le couvert de prête-noms, des capitaux dans des sociétés existantes, en faisant signer à ces prête-noms des cessions de parts en blanc, c’est-à-dire sans indication de date et sans indication du nom de l’acquéreur de ces parts. »
Si Denoël n'avait rien à redouter de ses prête-noms, neutralisés par les blancs-seings qu'il détenait, il pouvait se faire quelque souci quand l'un d'eux venait à lui réclamer des comptes. C'était le cas d'Albert Morys. Depuis 1942 il occupait, pour un loyer minuscule, une chambre de bonne située au dernier étage du 1 rue de Buenos-Ayres, appartenant aux Denoël - auxquels il rendait de multiples services quand sa vie de comédien le lui permettait.
En 1941 il fut par intermittence le gérant des Nouvelles Editions Françaises. En avril 1945 il avait abandonné le cinéma et le théâtre (qui était la passion de sa vie) pour se consacrer à l'entreprise éphémère des Editions de la Tour, où il jouait à temps plein le rôle de gérant mais avec un salaire de salarié : « Tous les profits revenaient à M. Denoël. Il ramassait d’ailleurs la caisse tous les soirs, mais mon salaire réel était de 4 000 francs par mois, plus 3 % sur les affaires. » [Interrogatoire par la police, 20 septembre 1946].
Morys, aidé de temps à autre par un coursier, prenait sur lui un travail considérable et il s'estimait floué : « En août 1945, j’ai fait comprendre à M. Denoël que le salaire mensuel qui me revenait pour la gestion des Editions de la Tour, était par trop faible et ne correspondait pas aux engagements verbaux intervenus entre nous. A l’époque, il me devait déjà une somme qu’il m’est difficile de préciser aujourd’hui, mais qui a été fixée entre nous à la date du 31 décembre 1945, à 191 190 francs. Au mois d’octobre, je lui ai à nouveau présenté mes griefs et nous avons établi un accord aux termes duquel M. Denoël reconnaissait me devoir la somme précitée et s’engageait à me régler cette somme. De mon côté, je prenais l’engagement de quitter la maison à l’époque fixée, c’est-à-dire le 31 décembre. » [Déclaration à la police, 18 octobre 1946].
Maurice Percheron proposa une autre version de l'incident : « Une quinzaine de jours avant sa mort, Robert Denoël m’avait mis au courant d’un grave différend qu’il avait eu avec M. Bruyneel qui, selon Denoël, avait commis des malversations et avait exercé envers lui une tentative de chantage. Denoël avait rétabli la situation en faisant signer à Bruyneel un accord par lequel celui-ci résiliait sa fonction de gérant et liquidait ses comptes » [Déclaration à la police, 8 octobre 1946].
Armand Rozelaar remit les montres à l'heure, le 21 décembre 1949 : « M. Bruyneel consulta un avocat et ce dernier lui expliqua que, dans la mesure où R. Denoël, dont il n’était que l’homme de paille, lui avait promis de lui verser un fixe et des commissions atteignant un certain taux, il lui suffisait, à lui, Bruyneel, d’user de ses fonctions et de ses pouvoirs de gérant dans la société d’Edition de la Tour et de ne remettre, en définitive, à R. Denoël que l’argent se trouvant dans la caisse, défalcation faite de ce qui lui était dû à lui, Bruyneel. Ceci fut fait. Mais Denoël en conçut aussitôt un vif dépit. Il s’en ouvrit à Mme Loviton et l’on décida de mettre à la porte M. Bruyneel, d’utiliser les cessions de parts signées en blanc et de réunir un certain nombre de personnes intéressées aux affaires Denoël, le 3 décembre 1945 ».
C'est aussi en octobre 1945 que Denoël rédigea, à la demande de son avocate Simone Penaud, une lettre destinée à sa femme dans laquelle il détaille ses griefs en vue du divorce qu'elle réclame et où l'on trouve ceci : « Il est certain pour moi, à la lumière de tout ce qui a précédé, que tu es la maîtresse de Maurice. Ce n’est pas un mauvais garçon. Il a des qualités de cœur, du dévouement. Il te plaît. Il te plaît plus que quiconque, moi compris, car tu l’étonnes, tu le domines, tu le possèdes. Nous allons divorcer prochainement. Pourquoi ne l’épouserais-tu pas ? Tu as l’habitude de lui, vous avez les mêmes goûts, les mêmes relations, les mêmes amis. Il travaillera. Je l’y aiderai au besoin. »
Des considérations personnelles ont donc pu se glisser dans le différend commercial entre les deux hommes, et c'était fort dommageable pour Denoël qui, jusque là, avait soutenu la gageure de confier à deux camps rivaux le soin de veiller à ses intérêts.
On ne peut écarter l'influence de Jeanne Loviton dans l'affaire car elle déclara ensuite : « J’ai financé durant toute l’année 1945 les Editions de la Tour pour une somme de 1 million 450 mille francs. D’autre part j’ai donné au nom de la Société Domat-Montchrestien, ma garantie à M. Bruyneel pour des traites tirées au profit des Editions de la Tour dont Bruyneel était le gérant à titre fictif. [...] Comme il désirait, en raison des avances que je lui avais faites pour cette société, que j’en devienne propriétaire par personne interposée, il m’avait remis l’abandon de gérance de M. Bruyneel et avait sollicité une de mes amies, Mlle Pagès du Port, 22 Rue Ravignan, pour qu’elle acceptât la succession de Bruyneel en ce qui concerne les parts fictives qu’il détenait. » [Déposition à la police, 10 octobre 1946].
La lettre de licenciement datait du 31 octobre et Morys dut reconnaître qu'elle contenait une clause particulière : « En ce qui concerne la mention concernant la cession à titre gracieux à toute personne que m’indiquera M. Denoël, des 32 parts que je possède dans la Société Les Editions de la Tour, elle s’explique facilement par le fait que je n’étais que propriétaire fictif de ces parts et que cette nouvelle cession ne pouvait se faire que fictivement à un homme de paille de M. Denoël. J’ignore totalement à qui M. Denoël voulait céder ces parts. Mon impression toutefois est que M. Denoël voulait, sous la pression de Mme Loviton, céder ses parts à l’une de ses amies. »
Cette amie était Françoise Pagès, et son audition par la police confirma la déposition de Jeanne Loviton : « En octobre ou novembre 1945, au cours d’un dîner chez Mme Jean Voilier, M. Denoël m’a dit qu’il était décidé à se séparer de M. Bruyneel et qu’il cherchait une personne qui puisse accepter la cession des parts possédées par Bruyneel dans les Editions de la Tour. Dans son esprit, en acceptant la cession de ses parts, je lui permettais d’assurer leur sécurité de façon à ce que Mme Voilier (qui avait financé largement les Editions de la Tour) puisse un jour rentrer en possession de son argent. » [18 octobre 1945].
Celle d'André Brulé, l'imprimeur des Editions de la Tour, allait dans le même sens : « J’avais appris par Denoël, dans le courant du mois de novembre, qu’il avait décidé de se séparer de M. Bruyneel et qu’il l’en avait informé par lettre recommandée. Je savais qu'à la date du 30 novembre, il ne faisait plus partie du personnel des Editions de la Tour. » [18 octobre 1945].
Toutes ces déclarations paraissent indiquer que Robert Denoël, toujours si soucieux de diversifier ses placements, avait, fin 1945, décidé de les concentrer dans un seul et même panier, celui de Jeanne Loviton. La cession des parts de Morys et de Percheron aurait dû avoir lieu, selon Françoise Pagès, le 3 ou le 4 décembre, chez l'homme d'affaires Hagopian.
Il est fort possible que Jeanne Loviton ait aidé financièrement Denoël pour développer les Editions de la Tour : Robert Beckers l'avait fait en mars à hauteur de 200 000 francs ; Philippe Marette avait été sollicité le même mois [200 000 francs], mais l'opération n'eut pas lieu : c'est Maurice Percheron qui lui prêta cette somme peu après ; Guy Tosi le 5 mai [25 000 francs] ; Jacques Thibon fin juin [300 000 francs] ; André Brulé en août [100 000 francs] ; Roger Danheisser à la mi-novembre [100 000 francs] ; Philippe Foucard le 19 novembre [200 000 francs] ; Auguste Picq en novembre [50 000 francs]
Denoël aurait donc emprunté, entre mars et novembre 1945, 1 175 000 francs à huit amis et connaissances. Jeanne Loviton, elle, lui aurait avancé 1 450 000 francs « durant toute l'année 1945 ». Soit en tout : 2 625 000 francs [environ 328.000 euros].
C'est beaucoup d'argent pour une petite société au capital minimal de 25 000 francs [3 000 euros], qui, entre mars et novembre, a publié quatre volumes de demi-luxe [vendus 500 F], 20 brochures populaires [5 F], et trois livres illustrés pour la jeunesse [180 F] - la plupart tirés à moins de mille exemplaires, et ne donnant lieu à aucun droit d'auteur puisqu'il s'agit d'écrivains et de textes du XIXe siècle. Seuls les illustrateurs, qui n'étaient pas des artistes de premier plan, eurent droit à des honoraires. Maurice Percheron, pour ses petites brochures patriotiques, reçut des droits d'auteur inférieurs à 100 000 francs.
Il serait vain, sans disposer de la comptabilité de cette maison d'édition éphémère, de tirer des conclusions à partir des chiffres partiels dont on dispose. Mais qui ne serait tenté de comparer les sommes démesurées que l'éditeur y aurait investies, avec les 757 500 francs [95 000 euros] qu'il aurait acceptés de Jeanne Loviton, le 25 octobre, pour la cession de ses 1 515 parts dans la Société des Editions Denoël, au capital de 1 500 000 francs [187 000 euros] ?
*
Venons-y donc, à ce document qui déclencha tant de procès. On sait que Denoël avait, le 15 février 1945, prévenu les Domaines, propriétaires des parts de son ex-associé allemand, qu'il voulait vendre les siennes, et l'administration n'y avait vu aucune objection.
Pourtant rien ne s'était fait. Jeanne Loviton déclara à la police que ses associés dans la Société des Editions Domat-Montchrestien [c'est-à-dire Yvonne Dornès et elle-même] avaient décidé de surseoir à l'achat de ces parts tant que Denoël « n'aurait pas été officiellement et légalement en droit de disposer de sa propriété ».
Or le procès de l'éditeur s'était soldé, le 13 juillet, par une décision de classement, et il n'avait été informé de nouvelles poursuites concernant sa société d'édition, que le 8 novembre.
Pourquoi un 25 octobre ? En réalité l'acte de cession a bien été rédigé en mars 1945 par l'administrateur de biens Jean Lucien, 11 rue Bernoulli (VIIIe) mais, comme il l'expliqua ensuite à la police, « Dans l’incertitude de la personne qui signerait l’acte au nom des Editions Domat-Montchrestien, aucun nom n’avait été porté sur cet acte. »
En mars 1945 en effet, Yvonne Dornès (alors majoritaire dans la société) et Jeanne Loviton alternaient à la direction des Editions Domat-Montchrestien. Mais, dès après le 13 juillet 1945, il aurait été possible de compléter ce document puisque Denoël avait été acquitté en cour de justice.
Jeanne déclara qu'elle faisait alors une « cure », que Denoël vint la rejoindre en août, qu'elle ne fut de retour à Paris que le 15 septembre, et que, « débordés par nos occupations, nous n’eûmes pas le temps de régulariser la cession de parts avant le 25 octobre ».
Si les mots ont un sens, il s'agissait donc bien, le 25 octobre 1945, de régulariser un acte en attente depuis six mois, c'est-à-dire de payer à Robert Denoël les 1 515 parts sociales qu'il détenait dans sa Société des Editions Denoël pour la somme fixée préalablement à 757 500 francs, et de remplir les cases en blanc du document : le nom de la gérante des Editions Domat-Montchrestien et la date de l'opération.
Jeanne Loviton est précise : « l’acte fut définitivement établi le 25 octobre 1945 à 19 heures dans le Cabinet de M. Lucien, qui en a témoigné. » Jean Lucien a en effet déclaré à la police : « Le dit acte a été complété par le nom de Mme Loviton et par la suite le 25 octobre1945, la signature n’a pas eu lieu plus tôt, M. Denoël étant jusqu’alors sous le coup d’une instance en Cour de Justice. »
L'acte de cession de parts aurait donc été complété ce jour-là, ce qui suppose que toutes les conditions étaient enfin réunies, pourtant il en manquait une : le paiement des 757 500 francs.
Jeanne Loviton s'en est expliquée à la police : « Ma trésorerie ne me permettant pas le règlement de l’achat des parts au 25 octobre 1945, s’élevant à 757.500 francs, l’acte étant rédigé pour donner quittance de cette somme, nous avons prié M. Lucien de garder l’acte en dépôt jusqu’au jour où le règlement interviendrait. Le 30 novembre 1945 j’ai réglé cette somme à Robert Denoël en espèces et sans témoin. C’est Robert Denoël qui a téléphoné à M. Lucien pour lui dire que le règlement était intervenu et qu’il fasse enregistrer les actes. »
C'était une somme considérable pour la trésorerie des Editions Domat-Montchrestien, aussi c'est Jeanne qui lui vint en aide : « c’est Mme Loviton qui dut faire l’avance des fonds à la Société des Editions Domat-Montchrestien et elle ne put la faire que fin novembre 1945. Le 30 novembre, M. Robert Denoël recevait les fonds en espèces (depuis les poursuites, il n’avait aucun compte en banque) et il téléphona aussitôt au Cabinet Félix pour l’aviser de ce paiement et lui demander de procéder à l’enregistrement des actes. C’est dans ces conditions que lesdits actes furent enregistrés le 8 décembre. »
Jean Lucien déclara ensuite : « Quelques temps après le 30 novembre, je crois, M. Denoël m’a téléphoné en m’informant qu’il avait été réglé du prix de sa cession et que je pouvais faire enregistrer l’acte, ce qui a été fait le 8 décembre. »
Ces incongruités comptables furent sanctionnées le 24 décembre 1948 par le Tribunal de commerce, d'autant que Jeanne Loviton avait cru devoir déclarer aux enquêteurs, le 10 octobre 1946, que la somme qu'elle avait remise à Denoël lui avait permis de rembourser ses dettes, « notamment auprès de MM. Thibon, Brulé, et Beckers. Tout au moins je le suppose d’après ce qu’ont pu en dire ces divers créanciers. »
L'agenda de l'éditeur porte, à la date du vendredi 30 décembre 1945, une série impressionnante d'opérations financières mais aucune ne concerne les trois créanciers qu'elle a cités, sauf André Brulé, son imprimeur.
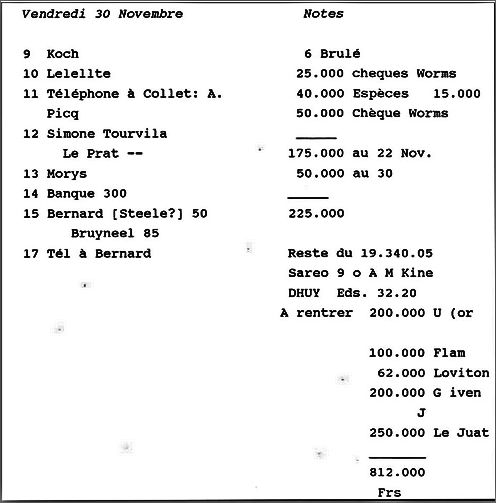
André Brulé avait avancé 100 000 francs à Denoël en septembre 1945 contre une traite venant à échéance le 30 novembre. L'argent avait été déposé ce jour-là à la Banque Worms par Albert Morys, qui régla l'imprimeur le 10 décembre. Dans l'agenda, Brulé apparaît à côté d'un chiffre 6 qui doit signifier 60 000 francs puisque cette somme est comptabilisée dans le total (à devoir, on le suppose) de « 175 000 francs au 22 nov. »
Robert Beckers lui avait prêté quelque 130 000 francs en février ou en mars 1945, « qu’il m’a rendue 8 ou 10 jours avant sa mort », déclara-t-il à la police, avant de se raviser : « Après la conversation que nous avons eue l’autre jour, j’ai eu la curiosité de rechercher dans mes papiers la date exacte du remboursement que m’a fait Robert Denoël. Il a eu lieu le vendredi 30 novembre, donc deux jours avant sa mort et il s’agissait d’une somme de 200 000 francs. »
Le nom de Beckers n'apparaît pas à la date indiquée, pas plus que celui de Jacques Thibon, le directeur des Papeteries Job qui, en juin 1945, avait avancé 300 000 francs à l'éditeur, somme dont il dit avoir été remboursé - mais quand, exactement ? : « Je lui ai remis les 300 000 frs en espèces et il m’en a donné reçu. Je lui ai rendu ce reçu lors du remboursement de la somme, c’est-à-dire à la fin du mois de novembre. »
Quant à Jeanne Loviton, elle figure bien sur cette page mais pour une somme de 62 000 francs (à recevoir ?) Les livres comptables des Editions Domat-Montchrestien mentionnaient qu'elle avait, le 21 novembre 1945, versé en espèces 757 500 francs à la caisse de sa maison d'édition, pour la retirer le 30 novembre, mais le tribunal y voyait, « par l'impossibilité d'en vérifier la réalité », des écritures « de complaisance », d'autant que la comptabilité de cette petite maison d'édition ne portait la trace, entre le 30 juin 1945 et le 1er juillet 1946, que d'un seul versement en espèces (20 000 francs, en juillet 1945) de Jeanne Loviton à la caisse de sa société.
Les juges consulaires, qui avaient examiné l'agenda de l'éditeur mais sans lui accorder un caractère de preuve qu'il ne comportait pas, estimaient que l'éditeur manipulait des fonds importants « provenant d’autre source que celle de la vente de ses parts qui suffisent à expliquer, en dehors de tout apport de capitaux par Dame Loviton, les paiements opérés par lui dans les quelques semaines qui ont précédé sa disparition. »,
En conséquence, la vente des parts de Denoël à Jeanne Loviton était annulée, avec des attendus sévères pour la Société et sa gérante, qui s'étaient adjugés des titres qui ne leur avaient pas été régulièrement transmis, et qui avaient « abusé d’une situation aggravée par des circonstances qui leur imposaient une réserve circonspecte ». C'était aussi une remise en cause du montant de la cession de ces parts.
Outre les conditions anormales du règlement des parts, le Tribunal de commerce avait jugé « surprenant » que l'acte n'ait été enregistré que le 8 décembre 1945, soit une semaine après la mort de l'éditeur, et que sa signification à la Société Domat-Montchrestien n'ait eu lieu que le 9 janvier 1946.
Il avait aussi examiné le document, émaillé de multiples coquilles, où l'impression de hâte était partout manifeste. Cette opération tardive sentait la précipitation et l'improvisation. Et les juges avaient été soumis à de rudes pressions, comme en témoigna l'un d'eux : « Jamais nous n’avons reçu tant de sollicitations et des plus diverses. Si les juges officiels ont manqué de tenue, comme on l’a prétendu, dans ce procès nous avons tenu à prouver que le Tribunal de Commerce savait rendre justice » [Combat, 4 décembre 1949].
*
Examinons-en les termes, à défaut de pouvoir le reproduire. Le premier à y avoir eu accès est le professeur Harry E. Stewart. Ce professeur de français à l'Université de Clemson (Caroline du Sud), spécialisé dans l'étude de l'œuvre de Jean Genet, avait, en 1985, sollicité et obtenu du ministre français de la Justice, Robert Badinter, l'autorisation de consulter ses dossiers de procès, et il en avait publié le résultat dans trois articles et un volume de biographie.
Stewart s'était aperçu que Notre-Dame des fleurs avait été publié clandestinement en 1943 par Robert Denoël et Paul Morihien : bien conseillé par Brigitte Lainé, la probe et courageuse archiviste française qui n'avait pas encore, à cette époque, subi les foudres de sa hiérarchie, il demanda en 1989 au procureur général près la cour d'appel de Paris une dérogation pour consulter le dossier de non-lieu [27 juillet 1950] de Robert Denoël aux Archives de la Seine, entreposé à cette époque à Villemoisson sous la cote 1019 W 26.
Le procureur ayant acquiescé, il fallait encore obtenir l'accord du préfet de Paris et celui du ministre de l'Education nationale. La dérogation fut obtenue en 1992, mais sans autorisation de reproduction.



En 1998 Jean-Yves Mollier, professeur d'histoire contemporaine, obtint la même autorisation du préfet de police de Paris en vue de se documenter pour son ouvrage Edition, presse et pouvoir en France au XXe siècle [Fayard, 2008], mais entretemps le dossier avait changé de place : il figure aux Archives de la préfecture de police de Paris, rue de la Montagne Sainte-Geneviève (Ve) sous la cote H 5563.
S'agit-il du même dossier ? M. Mollier a utilisé des documents qu'on retrouve dans celui du professeur Harry Stewart mais il ne s'est pas servi de celui-ci.
Harry Stewart non plus ne s'en est pas servi car il ne s'y trouvait rien qui concernât Jean Genet. Il confia le dossier à Louise Staman qui en tira en 1997 un essai resté inédit : « The Tricolor Zebra. The Life and Death of Robert Denoël ».
Mme Staman réécrivit le tout pour en faire With the Stroke of a Pen. A story of ambition, greed, infidelity, and the murder of french publisher Robert Denoël, qui parut en 2002 chez St. Martin's Press à New York puis, dans une traduction française édulcorée, aux Editions e-Dite à Paris en 2005. Le document n'a pas servi, ici non plus.
Pour ma part, je n'ai reçu qu'une seule autorisation en trente ans, celle de Maurice Bruyneel qui, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa femme, Cécile Denoël, décédée le 20 janvier 1980, m'a permis, le 28 janvier 1981, « d'utiliser les documents, notes, correspondances » que sa femme et lui m'avaient confiés, ainsi que les photographies dont la plupart représentaient Robert Denoël, les membres de sa famille et les personnes avec lesquelles il était en relation. Cette autorisation, écrivait Morys, « vaut copyright ».
En attendant de pouvoir disposer d'une reproduction de la cession de parts originale, j'en propose donc la transcription du professeur Harry Stewart :
Cession de parts Robert Denoël - Jeanne Loviton
25 octobre 1945
Entre les soussignés :
1° M. Robert Denoël, demeurant à Paris, 19, rue Amélie, d’une part
2° Mme Jeanne Loviton, éditeur, demeurant à Paris, 11 rue de l’Assomption,
agissant au nom et en qualité de gérant de la Société dénommée « Les
Editions Domat-Montchrestien », société à responsabilité limitée au
capital de 400.200 francs dont le siège est à Paris, 160 rue
Saint-Jacques, d’autre part
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
M. Denoël a, par les présentes, cédé sous les garanties ordinaires et de droit à la Société « Les Editions Domat-Montchrestien », ce qui est accepté pour ladite société par M. [sic] Loviton, ès-qualité
mille cinq cent quinze parts de cinq cents francs chacune de la Société à responsabilité limitée « Les Editions Denoël » lui appartenant, sans indication de numéros.
Ladite société constituée au capital de 300.000 francs avec siège à Parprix [sic], 19, rue Amélie, aux termes d’un acte sous signatures privées en date à Paris du 10 avril 1930, enregistré à Paris (1er S.S.P.) le 11 avril 1930 n° 324 aux droitq [sic] de 9022 frs 50 pour une durée de 99 années à compter du 1er avril 1930.
Etant fait observer que le capital a été porté à 1.500.000 frs divisé en 3.000 actions de 500 francs chacune aux termes d’un acte sous signatures privées en date à Paris du 22 février 1943 enregistré à Paris (1er S.S.P.) le 3 mars 1943, n° 48.
Lesdites parts appartiennent à M. Denoël tant pour avoir été souscrites par lui en espèces aux termes des statuts sus-énoncés que pour lui provenir de l’augmentation de capital en espèces également sus-énoncée.
Au moyen de cette cession la Société « Les Editions
Domat-Montchrestien » sera propriétaire des parts cédées à compter de ce
jour et elle aura droit aux bénéfices y afférents à compter également
de ce jour.
En conséquence M. Denoël met et subroge la Société « Les Editions
Domat-Montchrestien » dans tous ses droits et actions contre la Société «
Les Editions Denoël » à concurrence du montant des parts cédées.
La présente cession est consentie et acceptée moyennent la raison de 500 francs par part le prix principal de 757.500 francs que M. Loviton [sic], ès-qualité avec des fonds appartenant à la Société « Les Editions Domat-Monchrestien » a payé comptant à M. Denoël qui le reconnaît et lui en donne bonne et valable quittance.
Pour l’exécution des présentes, domicile est élu par M. Denoël en sa demeure et pour la Société « Les Editions Domat-Montchrestien » à son siège social.
Mention des présentes est consentie partout où besoin les présentes pour les faire signifier et pour remplir toutes formalités de publications et autres.
Fait en quintuple exemplaire dont un pour l’enregistrement, à Paris le 25 octobre 1945.
Bon pour cession de 1515 parts
Robert Denoël
Bon pour achat de 1515 parts
Pour la Société Domat-Montchrestien
Leur gérante
J. Loviton
[Acte enregistré le 8 décembre 1945 au greffe du Tribunal de commerce de la Seine sous le n° 7575 ; copie déposée par Jeanne Loviton à la Brigade Criminelle le 2 décembre 1946]
*
Le 8 novembre 1945, le Commissaire du Gouvernement informe Robert Denoël qu’une plainte a été déposée contre sa société, en l’invitant à produire un mémoire de défense dans un délai de dix jours. Une dizaine de maisons d'édition sont dans le même cas.
Ce mémoire a déjà été constitué puisque l'éditeur fut personnellement blanchi de faits de collaboration, trois mois plus tôt. Il s'agissait alors de justifier ses publications « collaborationnistes ». C'est toujours de cela dont il s'agit, mais l'enjeu n'est pas le même. Denoël risque la confiscation de son entreprise et l'exclusion de la profession. Il a contre lui des épurateurs féroces, comme Raymond Durand-Auzias qui, le 6 février 1945, écrivait au ministre de l'Information : « Il serait aussi préjudiciable, pour le prestige français, de voir subsister certains noms de firmes comme " Editions Denoël " que de laisser par exemple subsister le nom de certains journaux comme Gringoire ou Le Pilori, même avec une direction nouvelle ».
Le dossier de Robert Denoël est bien établi et il a parfaitement servi sa cause en cour de justice. Puisque les livres qu'on lui reproche sont les mêmes qu'en juillet 1945, que peut-il y ajouter ? Personne n'a vu ce dossier disparu mais tout le monde croit savoir ce qu'il contenait : la dénonciation de ses confrères.
C'est dans Libération du 4 décembre 1945 qu'on trouve cette affirmation : « Il avait, paraît-il, affirmé qu'il ferait des révélations mettant en cause d'autres éditeurs. A-t-on voulu l'empêcher de parler ? »
L' « information » est reprise cinq ans plus tard par Paul Bodin : « vers le milieu du mois de décembre Denoël devait comparaître devant le Comité d’épuration de l’Edition. Bien qu’il ne risquât plus grand-chose, il en avait assez, disait-il, d'être le bouc émissaire de l'édition. Il avait constitué un dossier dont on parlait dans tout Paris et qui mettait en cause d'autres éditeurs. » [Carrefour, 17 janvier 1950].
Deux journaux ont donc avancé l'idée que Denoël pouvait avoir été supprimé à cause de son mémoire en défense. C'était une explication parmi d'autres, et qui fut souvent répercutée, mais d'où venait-elle ?
C'est Albert Morys qui, le 20 septembre 1946, déclara à la police : « Il devait comparaître devant un Comité Interprofessionnel dans les premiers jours de décembre. Il s’était promis de produire un dossier renfermant uniquement des extraits de la Bibliographie de la France, prouvant que tous les éditeurs français, à l’exception d’un, avaient édité, comme lui, des livres ayant servi la propagande allemande ou celle de l’Etat français. Il ne s’agissait pas, pour lui, de défendre son cas personnel, sa défense était basée sur le fait que tous les éditeurs français se trouvaient dans son cas, alors que tous n’étaient pas frappés. »
Le 7 octobre 1946 Robert Beckers fit de même : « Il m’avait dit avoir établi un dossier de défense dans lequel il minimisait son cas par rapport aux cas de ses confrères non inquiétés. »
Le 9 octobre 1946 René Barjavel déclara que Denoël « avait préparé un mémoire en vue de sa comparution prochaine devant la Commission d’Epuration interprofessionnelle du Livre. Denoël m’avait lu une partie de ce mémoire. Il y expliquait ses difficultés financières et se défendait d’être le bouc émissaire de l’Edition. Il montrait d’autre part qu’il n’avait pas été le seul à publier des livres compromettants, alors qu’il était un des seuls à être poursuivis. »
Ces déclarations de trois collaborateurs de l'éditeur datent de la seconde enquête de la Brigade criminelle, qui aborde cette question dans son rapport de novembre 1946, mais sans en tirer de conclusions.
Au terme de la troisième enquête menée entre janvier et mai 1950 par la Police judiciaire, le commissaire Henri Mathieu tient un tout autre raisonnement. Ses inspecteurs ont entendu Fernand Houbiers, le cousin de Cécile Denoël, qui a déclaré : « Il m’a dit avoir préparé un dossier, pour la Commission d’Epuration du Livre, en vue d’assurer sa défense. Il m’a dit que s’il était inculpé, beaucoup d’autres éditeurs le seraient en même temps que lui car son dossier contenait des preuves. Il m’a affirmé avoir été menacé mais sans me donner de détails. »
Dans son rapport daté du 25 mai 1950 le policier écrit : « C’est ainsi que pour se justifier, il aurait constitué un dossier important, comportant notamment la photocopie des titres d’ouvrages publiés par ses confrères pendant l’Occupation, la plupart blanchis par ce Comité d’Epuration. [...] Les intentions de Denoël, dont il ne paraissait pas faire mystère, ont pu indisposer certains de ses confrères qui avaient escompté, peut-être, l’élimination dans la profession d’un concurrent dangereux et en éprouver un certain ressentiment. D’ailleurs la question se pose de savoir pourquoi ce dossier soi-disant sans importance n’a jamais été retrouvé. [...] Il n’est pas interdit de penser que ce dossier, au contraire, peut être la cause indirecte de l’assassinat de Denoël. »
Jeanne Loviton est restée très discrète à propos d'un dossier qu'elle avait contribué à constituer. Le 15 novembre 1946 elle avait déclaré aux enquêteurs : « Elle croit pouvoir affirmer qu’il est absolument faux que, pour sa défense, il avait fait le projet de mettre en cause d’autres éditeurs parisiens. »
Lors d'une confrontation avec Cécile Denoël dans le cabinet du juge d'instruction, le 28 avril 1950, elle déclare : « Voilà quatre ans que j’entends parler d’un dossier qui n’a jamais existé. Robert Denoël avait lu tous les livres de collaboration publiés pendant la guerre, il était au courant de la situation exacte de l’édition, il n’a jamais été dans ses intentions de se conduire en dénonciateur. »
Il était tout à son honneur de certifier que son amant n'entendait pas dénoncer des confrères pour sa propre défense, mais pourquoi déclare-t-elle alors que ce dossier n'a jamais existé, alors qu'elle assurait, en 1947, qu'il se trouvait chez Me Joisson, rue de Chaillot, leur avocat ? Etrange avocat d'ailleurs qui, sollicité par la police à ce sujet, « déclare se retrancher derrière le secret professionnel et n'avoir rien à dire. » Etrange juge d'intruction aussi, qui avait le pouvoir, dans le cadre d'une instruction criminelle, d'obliger l'avocat à lui remettre ce document, et qui n'en a rien fait.
*
Le mémoire de Robert Denoël était destiné à sa défense devant la Commission d’Epuration du Livre, dont le siège se trouvait au 117 Boulevard St-Germain. Après sa mort, la plupart des journaux écrivirent que l'éditeur aurait dû passer devant cette Commission au cours du mois de décembre 1945. Certains avancèrent que ce devait être le 3, ou le 4, ou le 8 décembre.
En réalité personne n'en savait rien, mais il était tentant d'avancer une date proche de sa mort pour laisser entendre que ses assassins voulaient l'empêcher d'y paraître. Auguste Picq déclara que Denoël devait comparaître « au cours de la semaine qui a suivi son décès », Robert Beckers la situait « prochainement », Raymond Durand-Auzias « en décembre ». Jeanne Loviton déclara : « Je crois savoir qu’il était convoqué à la date du 17 décembre pour comparaître devant cette Commission d’Epuration. »
L'inspecteur Ducourthial s'est penché sur la question : « Le dossier de M. Denoël n’était pas encore entièrement constitué à la Commission Nationale interprofessionnelle d’Epuration, 47 rue Dumont d’Urville à Paris (16e) lors de son décès. D’après les renseignements recueillis, il en était encore à la phase de formation et aucun rapporteur n’avait été désigné. »
C'est lui qui avait raison. L'important, pour le ministère de l'Information, était de signifier à temps à l'éditeur que sa société restait poursuivie mais, quant à l'enquête proprement dite, elle restait à faire, et ce ne fut que le 31 janvier 1946 que le commissaire du gouvernement, M. Richard, entreprit les premières démarches auprès des services de police compétents.
Après s'être assuré des ouvrages mis en cause, ce qui a pris plusieurs semaines, l'inspecteur de police chargé de les réunir remet son rapport le 22 février 1946. Le commissaire du gouvernement suspend alors le dossier, en raison de la mort de l'éditeur. Le procès de la Société des Editions Denoël ne sera repris que deux ans plus tard.
Le mobile de l'exécution d'un éditeur trop bavard à la veille de sa comparution devant la Commission d'Epuration du Livre a vécu.
*
Le mois de novembre a été fort chargé pour Denoël en raison des publications qu'il menait alors pour les Editions de la Tour et qu'il voulait voir paraître avant la fin de l'année. Plusieurs brochures de la collection La Guerre des hommes libres, dues à Maurice Percheron, avaient pris du retard, deux volumes de demi-luxe étaient en cours, ainsi que la mise en route d'une nouvelle édition de Dan Yack dont il avait négocié avec Cendrars les droits début octobre. Il apportait tous ses soins à un petit almanach des dames dû à Lucien François, qu'il destinait aux étrennes : Le Bonheur du jour.
Il prenait aussi le temps de vérifier, rue Amélie, si tout se passait selon ses vœux, rencontrait ses collaborateurs à son pied-à-terre du boulevard des Capucines, supervisait les affaires des Editions Domat-Montchrestien, et ne manquait jamais de consacrer les matinées de chaque dimanche à son fils Robert.
On a du mal à imaginer une telle activité dans Paris à une époque où les taxis sont rares, les bus à peu près inexistants et les métros pris d'assaut par des cohortes d'usagers. Les rapports de police que j'ai consultés indiquent que l'éditeur se déplaçait en vélo et en moto - jamais en voiture - mais sa petite maison d'édition pouvait alors compter sur les services du chauffeur de Jeanne Loviton, pour les livraisons. D'autre part les Editions de la Tour étaient distribuées par Hachette, qui disposait de camionnettes pour l'enlèvement des volumes chez l'éditeur.
Le 21 novembre, le général de Gaulle a formé un gouvernement provisoire qui attribue aux communistes tout le secteur économique. Celui qui investit le ministère du Travail s'appelle Ambroise Croizat. On apprend, mais pas dans la presse, que ce gouvernement va nationaliser les banques, avant de dévaluer le franc.
Denoël n'a pas attendu ce signal : en prévision d'une dévaluation du franc inéluctable (qui aura lieu le 26 décembre 1945), il convertit depuis 1943 ses francs en or et en dollars. A partir du mois d'août 1944, il les place dans un coffre de son petit appartement du boulevard des Capucines, loué au nom de Jeanne Loviton. Il s'agit d'argent liquide. Personne ne peut donc en faire le compte. Pourtant, tout le monde s'y est risqué, dans la presse et devant les tribunaux, et c'est alors qu'on comprend le mobile inavoué de toute cette agitation : la cupidité.
*
Si Cécile Denoël ne sait pas grand-chose des activités éditoriales nouvelles de son mari, elle connaît la valeur des actions qu'il possède dans sa société d'édition. Lorqu'elle est avisée par Maximilien Vox, le 10 janvier 1946, que Jeanne Loviton a, en tant qu'actionnaire majoritaire, provoqué une réunion rue Amélie en vue de faire nommer un nouveau gérant, elle comprend vite que la succession de l'éditeur risque de passer dans d'autres mains, et elle fait poser les scellés sur l'appartement qu'il occupait, boulevard des Capucines - mais c'est trop tard : il a été passé à l'aspirateur. N'y subsiste qu'un carton contenant des vêtements usagés... Le coffre où il serrait ses papiers personnels et son argent est vide.
Denoël a loué cet appartement au nom de sa maîtresse. Elle est donc la seule qui puisse y avoir légalement accès, et elle a disposé d'un bon mois pour y faire le ménage. Si des objets ont disparu, elle en est la seule responsable. Mais quels objets ? Il n'existe aucun inventaire de son contenu, et sa veuve n'y a jamais mis les pieds. Ceux qui y sont venus, comme René Barjavel, ont bien vu des livres rangés sur les rayons de la bibliothèque, mais Mme Loviton assure que Denoël les a vendus « pour des raisons de nécessités pressantes ». Des vêtements qui s'y trouvaient entreposés ont été offerts à de vieux serviteurs (Georges Fort, l'emballeur de la rue Amélie, ou son propre chauffeur). Sa montre en or a été remise à René Barjavel. Tout le monde en a, en effet, témoigné.
Qu'y manque-t-il ? Indépendamment de son argent personnel, sa vraie fortune tenait en deux feuillets de papier timbré : une cession de parts en blanc, et une rétrocession de ces mêmes parts, toujours en blanc. Il suffisait de compléter la première, et de détruire la seconde, pour s'assurer de sa succession.
Telle est l'accusation portée par la veuve de l'éditeur à l'encontre de sa rivale amoureuse. Elle l'étaye par la révélation des opérations financières intervenues dans la Société des Editions Domat-Montchrestien. Si Jeanne Loviton soutient qu'elle a aidé financièrement son amant en 1944 et 1945, Cécile Denoël veut démontrer que c'est Denoël qui a renfloué la petite société de sa rivale, avant d'en prendre le contrôle, et cela dès 1943. Le 22 mai 1943, en effet, la Société des Editions Denoël a consenti un prêt de 200.000 francs à Domat-Montchrestien. Le 18 août, Jeanne a cédé 668 parts sur les 1 332 qu'elle détenait dans sa société à Yvonne Dornès, qui en est ainsi devenue actionnaire majoritaire mais ce n'est que subterfuge, assure Cécile : derrière le prête-nom qu'est Mme Dornès, il y a Robert Denoël, qui ne pouvait appparaître en nom propre.
Le fait est que le 8 janvier 1946, Yvonne Dornès a cédé 335 parts sur les 668 qu'elle détenait à Jeanne Loviton, laquelle est redenue majoritaire chez elle, avec 1001 parts. On en a profité pour modifier l'objet de la société : Domat-Montchrestien, éditeur de droit, devient éditeur de littérature. Cécile rappelle encore que l'acte de cession de parts par Denoël de toutes ses actions en faveur de sa maîtresse, daté du 25 octobre 1945, n'a été enregistré que le 8 décembre 1945, six jours après sa mort, et d'ailleurs, Jeanne Loviton n'a pu apporter la preuve du paiement des actions, qui eut lieu, assure-t-elle, le 30 novembre, « en espèces et sans témoin ».
Il y avait là matière à procès : le 28 janvier 1946, Cécile Denoël déposa contre Jeanne Loviton une plainte avec constitution de partie civile pour vol, escroquerie, abus de confiance, faux, usage de faux et abus de blanc seing. En même temps, elle obtenait en référé la mise sous séquestre de la cession des parts de son mari.
Alors que l'enquête sur la mort suspecte de l'éditeur va durer cinq ans, la procédure civile sera promptement bouclée : le 30 octobre 1946, le juge chargé du dossier rendit une ordonnance de non-lieu et débouta Cécile Denoël. Le 20 décembre, la Chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Paris confirma le non-lieu.
Cécile Denoël et son fils étaient ruinés. Jeanne Loviton entra victorieusement rue Amélie le 27 janvier 1947. La veuve de l'éditeur ne se tint pas pour battue : le 28 décembre 1949, elle obtint la réouverture de l’information sur l’assassinat de Denoël, en ayant apporté « un certain nombre d’éléments de nature à faire rejeter la version d’un crime crapuleux pour faire admettre la possibilité d’un crime commis par intérêt. »
En clair, Cécile accusait Jeanne Loviton d'avoir fait assassiner Robert Denoël pour s'emparer de ses biens. C'était risqué car, malgré de nombreuses suspicions, la maîtresse bien en cour de l'éditeur avait parfaitement organisé sa défense et s'était assurée d'appuis politiques décisifs. Le 1er juillet 1950 Antonin Besson, procureur de la République, concluait dans son réquisitoire qu'il n'y avait pas lieu à poursuivre. Cinq jours plus tard, le juge chargé du dossier prononçait un non-lieu dans l’enquête sur l’assassinat de l'éditeur, et ce non-lieu fut confirmé le 13 décembre 1950 par un arrêt définitif de la Cour d’appel de Paris.
*
Au cours de ces années éprouvantes, Jeanne Loviton joua avec conviction son rôle de « fiancée inconsolable » mais sans aller au-delà de la limite décente car, entre 1945 et 1951, elle avait eu des liaisons amoureuses avec Guy Tosi, Billy Fallon, Curzio Malaparte, Emile Henriot, sans oublier Yvonne Dornès, sa maîtresse en titre - et tout cela se savait à Paris, où on la qualifiait alors, chez les mauvaises langues, de courtisane de luxe.
La vie qu'elle mena ensuite n'est pas sans intérêt, mais il convient de relever qu'elle vendit sans tarder à Gaston Gallimard tout le patrimoine de Robert Denoël. Il n'y avait pas pire injure à faire à sa mémoire que de céder les Editions Denoël à un concurrent détesté qui, vingt ans plus tôt, avait juré de racheter sa maison d'édition.
Jeanne Loviton endossa sans remords apparent ce rôle-là : après avoir liquidé en juin 1947 plus de deux cents ouvrages au tiers de leur prix, elle entreprit avec Gallimard des pourparlers en vue du rachat intégral du fonds, de la maison et de la société d'édition. Le 15 octobre 1951, la majorité des actions de la Société des Editions Denoël furent cédées à la Société Zed appartenant à Gaston Gallimard. Ce jour-là, Jeanne Loviton enterra une seconde fois Robert Denoël, après avoir dirigé sans conviction sa maison d'édition durant trois ans. Il est juste de dire que, durant cette même période, Cécile Denoël ne fit pas mieux dans le domaine de l'édition mais elle avait l'excuse d'un manque de pratique et surtout, de moyens financiers.
*
« Il faut abandonner un peu la lecture et te poser les problèmes quotidiens de notre confort, de nos aises, sans quoi il n’y a pas de joie [...] tu passes à côté des questions, il faut fabriquer du réel, après nous pourrons rêver », écrivait Jeanne à Denoël, le 11 juillet 1945. On peut se demander si un tel couple aurait eu quelques chances de perdurer. Ces deux-là ne regardaient pas dans la même direction. L'éditeur ne repoussait pas les mondanités et l'aisance financière, mais il mettait au-dessus de tout son métier, qui était de faire connaître la littérature. Jeanne Loviton, elle, n'avait qu'un souci : s'assurer de revenus confortables pour mener à sa guise une existence de luxe « avec un tour d'esprit très XVIIIe siècle », comme disait Maurice Noël .
« Je me suis trop contrainte. Je veux vivre », écrivait-elle en septembre 1945, comme si toute sa vie n'avait été faite que de renoncements aux joies de l'existence, à l'exemple de son père adoptif qui, pendant cinquante ans, s'était astreint à des travaux sans grandeur derrière un bureau d'éditeur.
Dès sa rencontre avec Pierre Frondaie, elle avait rompu avec cette vie-là : « Elle pue l'aventure à dix pas [...] D'un coup elle a changé de milieu. Quoi qu'il arrive, c'est une malheureuse déclassée », écrivait en septembre 1926 son ancien patron, Maurice Garçon. Jeanne ne rêvait que de mondanités et surtout de voyages. Toute son activité, qui pouvait être prodigieuse, ne tendait qu'à cela. Jamais éditrice ne fut aussi peu présente à son bureau, rue Saint-Jacques, où l'essentiel du travail était accompli par des collaboratrices dévouées : Jeanne Loviton avait cette qualité, qui manqua toujours à Denoël : elle savait déléguer. Accablée de maux dus à une existence trépidante, disait-elle, elle « faisait retraite » à Senneville ou à Béduer, où l'attendaient quantité d'occupations futiles mais astreignantes. Après la guerre, elle entreprit d'incessants voyages un peu partout.
Je ne sais pourquoi, en parcourant la liste de ses innombrables déplacements, une image saugrenue s'imposa un jour, celle d'un personnage assez fantasque que Céline comparait à un « animal extravagant l'ornithorynx qu'est si habile, le faux castor incroyable, qu'a un bec énorme d'oiseau, qu'arrête pas aussi de plonger, de fouiner, de revenir... Il disparaissait imprévisible la même chose Yubelblat... Plaf !... Il enfonce, plonge dans les Indes... on le voit plus... Une autre fois c'est dans la Chine... dans les Balkans... dans les ombres du monde... [...] Il était souple à l'infini... extraordinaire à regarder, mais au bout des poignes par exemple, il avait aussi des griffes... et des venimeuses comme l'ornithorynx... »
A cet endroit, je me suis demandé s'il n'était pas nécessaire de revenir aux origines de toute cette agitation, à commencer par sa véritable biographie, qui n'est pas écrite et qu'elle a volontairement biaisée.
En publiant son Portrait d'une femme romanesque en 2008, Célia Bertin fit l'impasse sur la biographie de Jeanne Loviton car elle avait eu accès à ses archives personnelles en échange d'une discrétion absolue quant à ses origines, de sorte qu'elle ne put que parsemer son texte de petites allusions quant au nom du vrai géniteur de son héroïne, qui se croyait d'ascendance noble, alors qu'elle était née dans le ruisseau.
Quelques personnes connaissaient le secret de sa naissance illégitime. Célia Bertin mentionne Paul Valéry et Yvonne Dornès, mais on peut y ajouter Marguerite Thibon, son amie d'enfance, Mireille Fellous, sa fille adoptive, et Pierre Frondaie, qui a publié en 1930 Béatrice devant le désir, un roman autobiographique dont l'héroïne, « élevée dans une institution religieuse de la rue Notre-Dame-des-Champs, orpheline d'une " fille-mère et d'un raté ", est élevée par un père d'adoption ».
Ce père biologique, dont Jeanne découvrit le nom en 1932 sur un vieux billet à ordre daté de 1913, portait le même nom à particule qu'un historien, archiviste-paléographe spécialiste du XVIIIe siècle, né la même année qu'elle. C'est par lui qu'elle obtint le nom de ce père inconnu : c'est donc par lui qu'il convient de commencer.
Aucun des confidents privilégiés n'avait jamais prononcé le patronyme proscrit, mais Paul Valéry fit allusion, dans une lettre à Jeanne datée du 23 décembre 1941, à son « cousin » H. de V. qui lui avait écrit pour solliciter un rendez-vous. Les guillemets sont de Valéry : il savait que c'était un parent « de la main gauche ».


René Héron de Villefosse en 1938 Blason des Héron de Villefosse
Ce « cousin » que Jeanne a rencontré en novembre 1932 s'appelle René Héron de Villefosse. Né à Paris le 17 mai 1903, il a obtenu en 1926 le diplôme d'archiviste paléographe, et il s'affirmera bientôt comme l'un des meilleurs historiens de la ville de Paris.
Son père, Antoine Héron de Villefosse [1845-1919], lui-même archiviste paléographe, ne pouvait donc être le géniteur mais c'est bien un apparenté porteur du même patronyme qu'il convient de découvrir, et Célia Bertin le confirme : René « n'est pas son frère, tout juste un lointain cousin » : l'homme recherché est donc un cousin d'Antoine Héron de Villefosse, né sans doute entre 1870 et 1880, comme celle qu'il engrossa au cours de l'été 1902.
Dans une lettre à sa secrétaire du 16 novembre 1947, Louis-Ferdinand Céline écrit que René Héron de Villefosse « est très renseigné sur la mère Voilier » : c'est lui qui lui apprit que Jeanne était la maîtresse d'Yvonne Dornès, mais l'historien en savait bien davantage à son sujet, puisque Jeanne fut épisodiquement sa maîtresse dès novembre 1932 et qu'il lui désigna son véritable géniteur.
La biographe écrit encore que « l'infidèle l'a abandonnée pour épouser une cousine qui, elle aussi, était enceinte de ses œuvres ». Il aurait donc connu charnellement cette cousine et Juliette Pouchard au cours de l'été 1902.
Les registres de l'état-civil parisien mentionnent une Marie Louise Antoinette Héron de Villefosse née le 12 septembre 1903 dans le 6e arrondissement et baptisée le 25 septembre en l'église Saint-Sulpice. Sa mère ne se trouva donc pas enceinte en même temps que Juliette Pouchard, puisque Jeanne était née le 1er avril 1903 : l' « infidèle » avait fait son choix et délaissé Juliette, enceinte de trois mois, pour en épouser une autre : ce n'était donc pas un mariage réparateur.
Les parents de Marie sont Jean Félix Marie Héron de Villefosse et Marie-Thérèse d'Isoard de Chénerilles. Ils se sont mariés à Paris (Ier) le 7 octobre 1902. A cette époque Jean était artiste peintre et il habitait 17 rue d'Assas (VIe). C'est là que naquit la petite Marie, demi-sœur de Jeanne Pouchard.
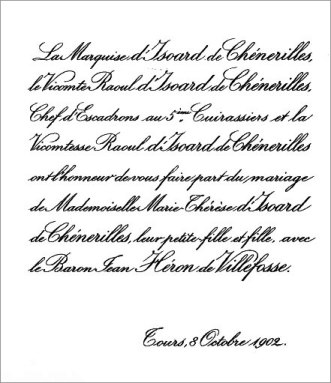

Né le 10 décembre 1874 au château de Féricy, Jean était fils de Léon [1841-1881] et d'Anne de Maussion de Ménerville [1841-1874]. Orphelin à sept ans, il fut élevé par le colonel Thomas de Maussion, l'oncle de sa mère, ce qui l'amena à embrasser la carrière militaire, avant de se consacrer, à partir de 1925, à sa profession d'ingénieur agronome. Il mourut à Versailles le 23 janvier 1953.
Marie-Thérèse naquit le 25 mai 1882 à Meaux et mourut le 7 décembre 1960 à Versailles, après avoir mis au monde quatre enfants entre 1903 et 1914. Elle était la fille de Charles d'Isoard de Chénerilles, chef d'escadron au 5e Cuirassiers basé à Senlis, et de Marie Antoinette Héron de Villefosse [1860-1928], ce qui faisait d'elle, en effet, la petite cousine de Jean.

Le Figaro, 22 septembre 1902
Célia Bertin émaille son texte de commentaires qu'on ne trouve pas dans les documents officiels mais qui recoupent mes recherches : elle parle d'un « ingénieur agronome, vivant près de Paris, possédant un haras, et un bureau à Paris près de la gare St Lazare, où il exerce le métier d'expert, évaluant des propriétés ». Jeanne l'a rencontré « quelques mois » après la mort de son père [23 janvier 1942], sous un faux motif, et l'a trouvé « bien ordinaire. Il n'a aucun des traits de caractère correspondant à sa classe sociale ». La biographe relaie manifestement la version de Mme Loviton, transmise par sa fille adoptive, Mireille Fellous.
La famille Héron de Villefosse est vaste et ses racines nobles remontent au XIIIe siècle. Son blason qui porte d'azur au chevron d'or, accompagné de trois grenades tigées et feuillées du même, ouvertes de gueules, est prestigieux et le baron Léon, père de Jean, qui mourut à quarante ans au château de Féricy, était chevalier de la Légion d'Honneur depuis le 12 octobre 1872. La plupart de ses représentants sont présents dans les sciences et les beaux-arts.
Est-ce que le baron Jean Héron de Villefosse qui, comme sa mère, fut « artiste » à l'époque de la naissance de Jeanne, puis cavalier émérite (surveillant de 2e classe au haras de Pompadour en Corrèze jusqu'en 1899), et ingénieur agronome quand elle le connut, manquait de la « tenue » qu'elle prêtait à une classe de la société qui n'était, et ne sera jamais, la sienne ? Sa déconvenue fut totale et elle choisit d'oublier définitivement son existence.
Marie Héron de Villefosse mourut le 7 décembre 1995 dans le XVe arrondissement de Paris, six mois avant Jeanne. Contrairement à sa demi-sœur qui rêva toujours d'appartenir à la noblesse, Marie épousa le 4 août 1925 André Verlynde [1898-1987], un roturier lorrain dont elle eut quatre enfants, et dont elle divorça le 5 juillet 1943, avant de se remarier à Alger le 15 mai 1945 avec André Moyne, qui mourut comme elle en 1995.
Sa vie fut plus paisible que celle de Jeanne Pouchard-Fleury-Loviton-Frondaie-Voilier qui, faute d'avoir choisi un nom, n'en a honoré aucun, comme en témoigne sa tombe dans un petit cimetière de Versailles.
*