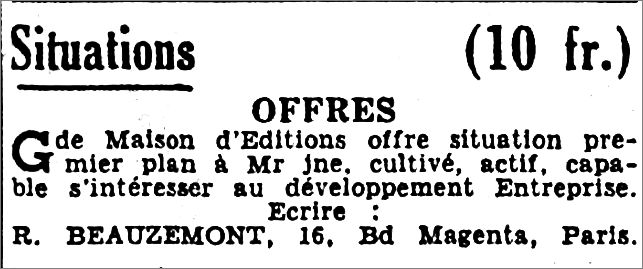1940
Janvier
Albert Morys est engagé pour tourner dans un film d’Alexandre Ryder : Après " Mein Kampf ", mes crimes, où il tiendra le rôle de Hitler jeune. Ce film où Alain Cuny fait ses débuts, alternant documents originaux et scènes de fiction, sortit dans les salles parisiennes le 17 mars 1940, avant d’être saisi. En 1945 le producteur Jacques Haïk en fit un montage à partir des éléments sauvés. En 2002 les Films Régent ont réalisé un DVD présentant la version intégrale de 1939, ainsi que la fin de la version de 1945.


Morys s’en explique : « Un producteur m'avait demandé pour tourner un film de propagande anti-nazi au titre significatif : " Après mein Kampf... mes crimes ". Pour quel rôle ? Celui d'Hitler, pas moins ! Au moment de l'avancée fulgurante des armées allemandes, fin mai 1940, d'immenses affiches couvraient les murs de la capitale et de sa banlieue où, sous le titre, on pouvait admirer le visage de l'homme à la mèche et à la petite moustache. » Ce rôle compromettant allait lui valoir quelques difficultés pour obtenir sa carte de comédien durant l’Occupation.
Le 2 : Céline écrit à Marie Canavaggia : « Si vous passez chez Denoël voulez-vous être gentille (ou lui téléphoner) que je réclame sa réponse - Il s’agit d’argent vous le pensez bien. Il ne me paye rien - plus rien depuis des saisons ! C’est la crapule absolue et belge et patriote et neutre et jésuite et tout sauf juif ce qui lui permet encore d’autres saloperies... »
Le 5 : Le paquebot français Chella éperonne un torpilleur anglais près du rocher de Gibraltar. Louis-Ferdinand Céline s'y trouvait depuis le 1er décembre en qualité de médecin de bord. Son nom n'est pas mentionné par la presse car l'écrivain avait veillé à se faire enregistrer sous le seul nom de Destouches.
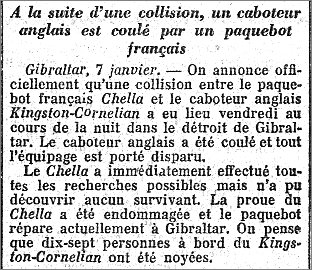

L'Action Française, 8 janvier 1940 La Justice, 9 janvier 1940
Le 13 : Décès à Angers de Simon Kra, fondateur des Editions du Sagittaire.
Le 15 : Refus des autorités belges de laisser les troupes françaises et britanniques traverser son territoire.
Février
Le 2 : Céline a reçu du comptable des Editions Denoël les comptes qu'il réclame depuis des semaines. Auguste Picq lui ayant sans doute objecté que les dépôts chez Hachette ne sont réglés qu’en fin de trimestre, l’écrivain lui écrit : « Je ne connais pas et n’ai pas à connaître Hachette. Tout ce qui est sorti de rue Amélie est pour moi vendu, sauf 10 % de dépôts et la passe. Rien de plus rien de moins (voir contrats). C’est avec Denoël que je traite, pas avec tiers. Je n’admets aucun dépôt chez Lustucru, Hachette ou Dache ! Pour Bagatelles et L’Ecole il est entendu que nous attendrons pour régler la fin des hostilités ».
Le 3 : Robert Denoël prononce, au Club du Faubourg, une conférence sur le thème : « Pourquoi j'ai créé Notre Combat ». Sa revue patriotique, dont le premier numéro est paru le 21 septembre 1939, en est alors à sa 19e livraison. André Fribourg [1887-1948], qui y publie une chronique hebdomadaire sur l'évolution des événements de la guerre et qui a rédigé le dernier numéro de l'année précédente sur le « Désastre allemand à l'Est », lui tient compagnie.

Notre Combat, n° 4, 26 janvier 1940
Le 6 : Gaston Gallimard envoie à Aragon des contrats pour Les Voyageurs de l’Impériale et Le Crève-Cœur, et lui propose des droits mensuels de 2 500 francs à partir du 1er mars 1940, ce que l'écrivain accepte aussitôt.
Le 11 : Décès à Paris de J.-H. Rosny aîné. Né Joseph-Henry Boëx le 17 février 1856 à Bruxelles, il avait choisi son pseudonyme en souvenir d'un séjour à Rosny-sous-Bois. Précurseur du roman préhistorique et de science-fiction, Rosny avait publié Les Xipéhuz [1887] et La Guerre du feu [1909], qui sont devenus des classiques de ces genres littéraires.

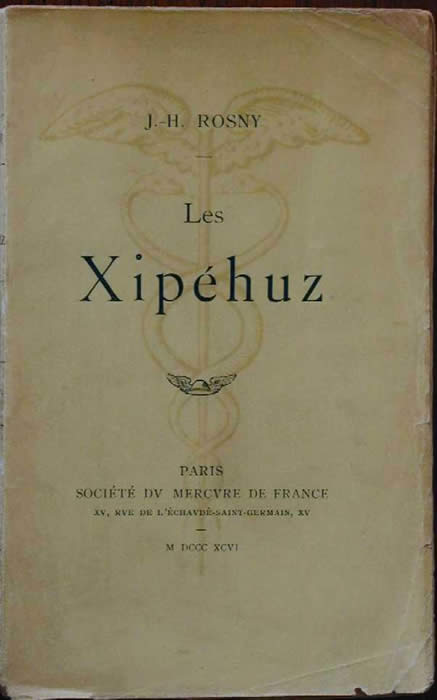
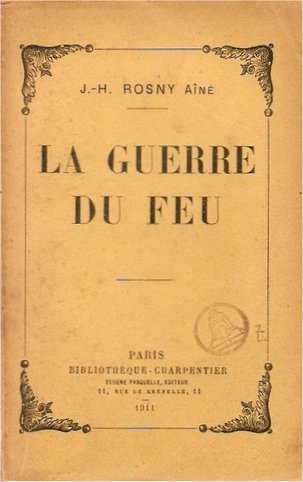
Membre dès 1903 de l'Académie Goncourt dont il deviendra président en 1926, il fut, six ans plus tard, l'un des acteurs malheureux d'une élection controversée, en couronnant Les Loups au détriment de Voyage au bout de la nuit.
Le 21 : Le Journal publie une petite annonce insolite (répétée le 22 et le 23), qui demande à être décryptée :
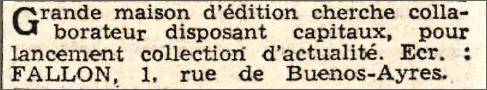
Le Journal, 21 février 1940
Billy Ritchie-Fallon, le frère de Cécile, est alors domicilié chez les Denoël, 1 rue de Buenos-Ayres, et il détient (fictivement) 18 parts dans « La Publicité Vivante », une société créée le 15 octobre 1937 par Robert Denoël avec son voisin Robert Beauzemont.
Quelle peut être la « grande maison d'édition » qui s'apprête à lancer une collection d'actualité, sinon Les Editions Denoël, mais où Fallon n'a jamais détenu aucune part ? Et de quelle collection s'agit-il ? La revue Notre Combat paraît depuis septembre 1939 avec des fortunes diverses, mais elle appartient à la Société des Trois Magots.
Il ne peut donc s'agir que d'une nouvelle collection à paraître rue Amélie. A moins d'une nouvelle entreprise restée sans suite, je ne connais que la collection « Les Grandes figures d'aujourd'hui », dont deux titres parurent en effet en octobre 1939 [Gamelin par Maurice Percheron] et en février 1940 [Le Cardinal Verdier, par Joseph Ageorges], à l'enseigne des Editions Documentaires Nationales, avant d'être abandonnée, à cause de la guerre.
Mais si Denoël utilise le nom de Fallon, qui est l'un de ses prête-noms, c'est qu'il s'agit alors de modifier l'une de ses sociétés, où Fallon est partie prenante. C'est donc probablement « La Publicité Vivante » qu'il s'agit de renflouer et qui deviendra, le 20 novembre 1940, Les Nouvelles Editions Françaises. Quant à la collection projetée, elle s'appellera « Les Juifs en France » et ses premiers titres seront publiés fin novembre. Denoël n'aura finalement pas trouvé de partenaire commercial puisque c'est Auguste Picq, son comptable, qui reprendra les parts de Billy Fallon.
On peut s'interroger sur l'état des finances d'une « grande maison d'édition » qui recrute par petite annonce un collaborateur « disposant de capitaux » pour lancer un collection nouvelle sous le paravent d'un prête-nom habitant une chambre de bonne au domicile privé d'un éditeur qui ne dévoile pas son identité...
On peut même se demander si Denoël n'a pas usé du même subterfuge, l'année d'avant, en utilisant comme prête-nom son voisin et associé Robert Beauzemont :
Le Figaro, 23 juin 1939
Mars
Max Dorian, qui a repris en février 1938 la publication du Document, le magazine créé en 1934 par Denoël, en modifie le nom. On note qu'il considère que la revue en est à sa sixième année. Il est vrai qu'il en avait assuré la direction rue Amélie en 1934 et 1935.
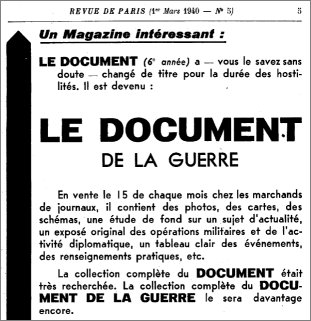
Revue de Paris, 1er mars 1940
Le 20 : la journaliste Claudine Chonez entreprend une enquête auprès des éditeurs pour l'hebdomadaire Marianne et commence par visiter la rue Amélie, où Robert Denoël, qui vient d'obtenir deux prix littéraires avec des romans de Jean Malaquais et de Paul Vialar, lui fait part de ses projets éditoriaux :

Marianne, 20 mars 1940
Il va, dit-il, publier « incessamment » Le Fer et la forêt de Jean Rogissart, La Foire aux femmes de Gilbert Dupé, un Mallarmé l'obscur de Charles Mauron, un volume de pièces médicales du professeur Delbet, une biographie de la reine Mary par Elizabeth de Grammont. Quand les circonstances le lui permettront, il sortira aussi le dernier roman de Louis Aragon, Les Voyageurs de l'impériale, et un « magnifique Céline qu'il tient en réserve » : Casse-pipe
Tous ces projets seront bouleversés deux mois plus tard. Si le roman de Rogissart fut bien édité en avril, celui de Dupé ne vit le jour qu'en mai 1941, l'essai de Mauron sur Mallarmé parut en novembre 1941, celui de Mme de Grammont fut abandonné, et la parution du volume de Pierre Delbet fut repoussée jusqu'en avril 1942. Quant aux romans d'Aragon et de Céline, aucun ne fut édité chez lui. Et Denoël ignore encore qu'Aragon a traité depuis un mois avec Gaston Gallimard pour Les Voyageurs de l'impériale.
Avril
Importante lettre non datée, mais du début du mois, de Robert Denoël à sa femme : «Comme je te le disais hier, ma chérie, me voilà de nouveau privé de tout ou partie de mon courrier selon les jours et les heures. J'ai fait mener une enquête par plusieurs de mes amis et ces enquêtes n'avaient pas abouti. L'un d'entre eux vient d'arriver à la source de mes ennuis, à l'endroit même où mon courrier subit une purge qui varie entre trois semaines et quatre jours. Là enfin, on était au courant, on savait ! Il parait que je suis soupçonné d'activités anti-nationales. C'est incroyable mais c'est comme ça.
Depuis douze ans je passe ma
vie à servir les idées, le goût et la culture françaises,
j'aide les jeunes écrivains, je crée une firme d'édition
justement renommée, mais entièrement vouée aux lettres
françaises ; je n'ai même pas comme mes confrères de
rayon de littérature étrangère. Je n'aime pas publier
de traductions, tu le sais. Je suis entouré de l'estime parfois même
de l'amitié de tout ce qui a un nom dans la littérature. Demain,
je trouverais dix cautions de ma moralité, de mon attachement à la
France, et sur la foi d'une dénonciation calomnieuse - du moins je
suppose qu'il ne peut en être autrement - on me tient pour suspect.
Et cela au point que l'on m'a retiré ma carte de circulation. C'est-à-dire
que actuellement je ne peux plus sortir de Paris !
Depuis la guerre mon activité n'est pour ainsi dire que nationale. 'Notre Combat' qui a l'approbation de toute la presse, de toute l'opinion, du Grand Quartier Général, du Ministère de l'Information, a dû, ou susciter des jalousies mal fondées car 'Notre Combat' est loin d'être une affaire brillante !, ou être soupçonné d'abriter on ne sait quelles machinations. C'est invraisemblable, ahurissant, tout ce que tu veux, mais c'est comme ça.
L'ami qui s'est occupé de la question n'a eu de rapport qu'avec un officier subalterne. Il a demandé un rendez-vous avec son supérieur pour mettre les choses au point dans le plus bref délai. S'il n'y arrive pas, je vais aller voir l'Ambassadeur de Belgique pour lui demander de faire une démarche officielle.
A côté de 'Notre Combat' j'ai publié deux brochures, un Gamelin et un Ct Verdun, une brochure sur les atrocités allemandes en Pologne et un livre intitulé Une Finlandaise dans la tourmente que tu as dû recevoir ces jours-ci. Les deux volumes publiés avant la guerre [La Rose de la Mer et Les Javanais] et qui ont eu les prix littéraires, ne font pas à proprement parler partie de mon activité de guerre.
Je puis donc dire que mon activité de
guerre est entièrement consacrée à servir la cause des
alliés et de la France, à répandre les idées
qui sont à la base de toute l'action gouvernementale. Mieux que cela,
dans deux ou trois jours, Roger Giron, chef des services de la presse à la
Présidence du Conseil, me remettra le texte d'une étude sur
M. Paul Reynaud, étude approuvée par le Président, cela
va sans dire - qui paraîtra dans la collection les 'Grandes Figures
d'Aujourd'hui'.
Je me trouve donc dans la situation suivante : le Président du
Conseil honore ma firme en y laissant publier par un de ses collaborateurs
immédiats une étude sur sa carrière. Le Ministre des Colonies
encourage ma revue en faisant distribuer des numéros aux troupes coloniales.
Le G.Q.G. fait pareil pour les troupes métropolitaines. Le Ministre
de l'Information souscrit des numéros de ma revue pour ses Centres de
Documentation en France et à l'étranger.
Et d'autre part, dans le même moment, un service indépendant
de ces Ministères, me brime d'une manière extrêmement pénible,
dérange toutes mes affaires, me vaut mille avanies de la part de mes
correspondants, s'acharne contre ma vie privée en retardant tes lettres
et contre la vie commerciale qui est entièrement bouleversée.
Comment ne pas voir là une vengeance, une machination ? Si je suis suspect, que l'on m'interroge, que l'on m'accuse ! Mais pourquoi ces mesures vexatoires ? Pourquoi des lettres commerciales émanant de firmes connues traînent-elles 15 jours dans des dossiers avant de m'être remises ?
Je te pose ces questions, non
pour que tu y répondes. Je me parle un peu à moi-même
aussi. Tu n'imagines pas à quel point cette histoire me tracasse,
je pourrais dire me hante.»
Apparemment, Denoël ne fait pas le lien entre ces brimades et la position neutraliste affichée depuis trois mois par la Belgique dans le conflit qui s'annonce. Il ne le fera pas davantage, huit mois plus tard, quand il sollicitera en vain un prêt au Crédit National de France.
Le 1er, il écrit à Jean Rogissart : «Nous allons pouvoir réaliser très rapidement maintenant l’impression de votre ouvrage. C’est en partie grâce à une combinaison avec les Editions Sequana, que nous pouvons arriver sans plus de délai à faire paraître ce volume. Les Editions Sequana souscrivent tous les mois un roman pour un public d’abonnés étrangers. Ce roman est pris dans tous les fonds d’éditeurs parisiens, sur épreuves.
Les Editions Sequana payent une redevance assez faible, mais fournissent leur papier et leur brochage. Les volumes paraissent sous une couverture spéciale et ne sont pas vendus en librairie. Pour un auteur, c’est une très bonne réclame, puisque le volume choisi de la sorte est expédié en Amérique, en Angleterre, en Italie, en Espagne, au Portugal et même en République Argentine ; cela étend la clientèle du dit auteur pour d’autres ouvrages et facilite parfois les traductions.
Comme mes Editions sont encore dans une situation très difficile, je n’aurais pas pu ce mois-ci sortir l’ouvrage. Grâce à la combinaison " Sequana ", je pense que nous arriverons à le mettre en vente pour fin avril.» Le Fer et la forêt sortit de presse le 5 mai.
Le 4 : André Breton demande à Léon Pierre-Quint des nouvelles de son Anthologie de l'humour noir, que Denoël a accepté d'éditer, après le désistement de sa maison d'édition.
L'entreprise remonte à 1935. Breton avait accepté de rédiger cet ouvrage à la demande des Editions du Sagittaire. Plusieurs fois abandonné, le manuscrit fut remis à l'éditeur en 1937, alors qu'il n'avait plus les possibilités financières de l'éditer. L'écrivain l'avait alors proposé à Robert Denoël, qui l'avait accepté et avait entrepris de le faire imprimer chez A. Rey à Lyon : l'ouvrage est annoncé dans Arts et métiers graphiques du 15 mars 1937. La déclaration de guerre, en septembre 1939, avait tout arrêté.
Le 8 : Léon Pierre-Quint écrit à Breton qu'il est désolé d'apprendre que son livre est à nouveau en panne, «mais ravi qu'il y ait une possibilité pour nous - Sagittaire - de le reprendre. J'ai écrit immédiatement dans ce but à M. Denoël, que je vais voir à la fin de la semaine. »
Le 9, Céline écrit à Denoël, probablement à propos de L’Ecole des cadavres : « Je voudrais voir tous mes livres invendus. Chez vous et chez Hachette. Voulez-vous m'envoyer vos comptes. Et puis j'irai moi-même les compter où ils sont. Les livres ne sont pas des zéphyrs. Cela se voit, se touche, se compte... Ne me dites pas qu'il y en a 3000 chez Gadant. Il y en a au plus 500. La vérité, c'est que vous êtes bien décidé de ne me donner un rond de plus que le traité. Vos comptes seront ajustés sur ce principe majeur. Je vais voir comment vous faites. [...] La destruction est de 3000. Je possède le chiffre exact des tirages. Aux aveux ! Robert ! »
Le 16 : Gaston Gallimard, qui est intéressé par le livre de Breton, écrit à Edmond Bomsel, administrateur de la Société des Editions du Sagittaire : « Je viens de voir Denoël, qui va me faire parvenir tous les détails relatifs à l'Anthologie de l'humour noir. Denoël prétend qu'il n'y a rien d'autre à payer à l'imprimeur, pour obtenir le livre, que les frais faits strictement sur le livre. L'ouvrage est entièrement composé, corrigé, le bon à tirer de l'auteur est donné, les papiers sont achetés, il reste donc le tirage. »
Le 19 : Robert Denoël propose un rendez-vous à Gaston Gallimard, peut-être toujours à propos de l'Anthologie de l'humour noir :
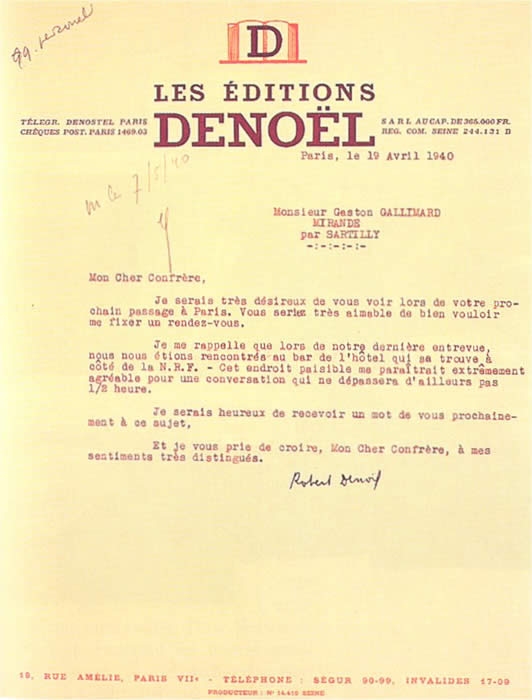
Selon François Nourissier, ils se rencontreront au bar du Montalembert le 7 juin suivant [Un siècle Nrf, p. 213].
Le 22 : Auguste Gouy, entrepreneur parisien de destruction d'archives, établit une déclaration de mise au pilon de 6.882 exemplaires de L’Ecole des cadavres «pour le compte de Mr Gadant libraire 168 Bd Saint-Germain à Paris ». On ignore la raison de ce pilonnage, et pourquoi il est fait à la demande d’un libraire grossiste - à moins que ce Gadant soit le dépositaire pour Paris du stock des Editions Denoël, auquel cas il aurait remis, à la demande de l'éditeur, les volumes dont il a la charge, au pilon.
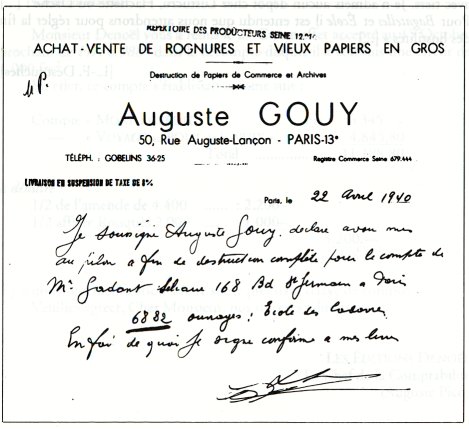
Le 9 avril, Céline parlait de 3 000 exemplaires à détruire. Ici, on a affaire à plus de 25 % du tirage initial du livre, qui était de 25 000 exemplaires. Pourquoi Denoël aurait-il sacrifié ce livre, qui était toujours en vente mais amputé, depuis septembre 1939, de trois feuillets litigieux ? On ne peut imaginer que l'éditeur, qui traverse les pires difficultés financières, ait fait détruire ces volumes pour n'avoir pas à régler Céline de ses 18 % de droits d'auteur.
Le 23 : Le huitième prix Populiste est décerné à Jean-Paul Sartre, alors mobilisé, pour Le Mur (Gallimard).
Le 24 : Léon Pierre-Quint et Edmond Bomsel ont négocié avec succès, l'un avec l'éditeur, l'autre avec l'imprimeur, pour récupérer l'Anthologie de l'humour noir. Le premier écrit à André Breton : « Votre livre est enfin dépanné. Les opérations de cession ont été réalisées entre Denoël et Le Sagittaire. Nous nous sommes d'autre part mis en rapport avec l'imprimeur qui demande environ six semaines pour achever le travail. »
Le 29 : Breton paraît heureux de cette issue et répond à Pierre-Quint : « Vous savez que j'avais composé ce livre à l'intention du Sagittaire : je suis enchanté qu'il lui revienne. »
Mai
Le 10 : Début de l’offensive allemande en Hollande, au Luxembourg et en Belgique, dont l'armée capitule le 28. Tandis que la reine Juliana se réfugie à Londres, et la grande-duchesse de Luxembourg en France, le roi Léopold choisit de ne pas quitter la Belgique.

Le Figaro, 11 mai 1940
Le 11 : Denoël, mobilisé, donne pleins pouvoirs à Auguste Picq pour diriger l’affaire en son absence, et part à la recherche de son régiment, le 2e Corps médical basé à Gand, en Belgique, et qui doit se trouver alors dans la région de Clermont-Ferrand. Il est accompagné de Robert Beckers, l’un et l’autre sans uniforme.
Sa femme et son fils se sont réfugiés à Souillac,
avant de gagner Saint-Rémy-de-Provence, chez Marie Mauron. Cependant
le séjour chez l'écrivain ne pouvait s'éterniser : « Cécile
ne voulait pas abuser d'une hospitalité, aussi adorable fut-elle. Robert
ne voulait toujours pas que l'enfant rentre à Paris ‘ dans les
circonstances actuelles ’ ; Cécile lui téléphona
donc qu'elle retournait à ‘ Retirance ’ », écrit
Morys.
« Retirance » était une petite maison, dans le Malvent, entre Saint-Paul-de-Vence et Cagnes-sur-Mer, que Cécile et Robert avaient achetée en août 1935, mais dans laquelle ils avaient permis aux locataires, leurs amis Manon et Adrien Caillard, proches parents du peintre Christian Caillard, de demeurer. Morys assure que cette petite maison fut offerte par Denoël à Claude Caillard, leur fils, pour son mariage, « durant l’Occupation ».
« Cela dura quelques mois, mais la guerre commentait à bouger et l'on se demandait si l'Italie toute proche ne se mettrait pas de la partie. Le poète André Verdet [1913-2004], un ami très cher, et sa famille insistaient pour que Cécile se réfugie à Saint-Pons, minuscule petit hameau près de Gréolières où ils avaient une maison », écrit Morys.
Grâce aux nombreux télégrammes qu’il envoie alors à sa femme, on peut suivre une partie du périple de Denoël à travers la France :
Le 2 : « Te croyais partie en montagne... Télégraphie nouvelle décision ».
Le 10 : « Impossible malgré violent désir venir vous embrasser [...] partirai demain pour Anvers adresse T.A.S.S. deuxième corps médical première compagnie Anvers [...] ne bougez pas sans nécessité absolue ».
Le 11 : « je pars ce soir [...] reste Gréolières ou Saint Paul jusqu'à nouvelles instructions. stop. espère revenir Paris avant trois mois ».
Le 12 : « Départ remis subitement voudrais aller vous voir mais préfère rester pour démarches argent ».
Le 13 : « Ne partirai sans doute pas avant plusieurs jours. Demeurez tranquillement Gréolières ».
Le 16 : « Partirai demain matin instructions suivent ». Selon Robert Beckers, Denoël se trouvait alors à Pont-Saint-Esprit : « Nous ne trouvâmes que les Chasseurs Ardennais, dont le colonel nous proposa de nous équiper. Nous l’évitâmes, n’ayant l’un et l’autre aucun goût pour les militaires. Et les uniformes proposés étaient de bien mauvaise qualité. »
Le 22 : « Partirai définitivement ce soir avec Beckers. Direction provisoire Narbonne. Télégraphierai adresse. Ne bouge pas ».
Le 29, de Montpellier : « Provisoirement dégagé. Rentrerai Paris sous deux jours». Beckers m’écrivait : «Il m’a laissé à Narbonne, profitant d’une voiture de rencontre remontant sur Paris ». Le Roi des Belges ayant déposé les armes la veille, Denoël se trouve « dégagé » de toutes obligations militaires.
Le 30 : « Suis retenu Montpellier faute sauf-conduit. Garde courage confiance ».
Le 31, de Paris : « Me remets travail ».
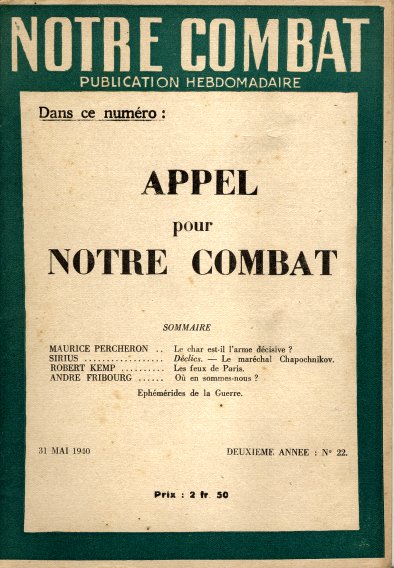
C’est du 31 mai qu’est daté le dernier numéro de Notre Combat. Entre-temps, Beckers est rentré à Liège.
Juin
Au cours des premiers jours de juin, la presse française se déchaîne contre le « roi félon » qui a déposé les armes prématurément. Le gouvernement belge, réfugié à Limoges, flétrit la capitulation « dont Léopold III a pris l'initiative et dont il portera la responsabilité devant l'histoire » et considère qu'il est désormais dépositaire du pouvoir royal. Place de la Concorde, des Belges réfugiés se sont réunis au pied de la statue équestre du roi Albert Ier pour manifester contre l'infamie de leur souverain. André Billy, qui passe par-là, assure que, « aussi longtemps que je vivrai, ce spectacle d'un peuple trahi par son roi me restera gravé dans les yeux. »


Le Matin, 1er juin 1940 - Marianne, 12 juin 1940
Le 6 : Denoël, en tant qu'étranger, ne pouvant plus télégraphier, c'est son comptable qui signe ce télégramme à Cécile : « Patron conseille départ avec bagages Souillac ou environs. Picq. »
A Gréolières, où le bureau de poste est inondé de télégrammes denoéliens, le maire écrit à Cécile que « la somme de 450 francs, portée sur notre budget communal destiné au transport gratuit des télégrammes aux hameaux de St Pons et Laval est presque totalement absorbée par la quantité de télégrammes imprévus transportés à ce jour.
Il serait urgent que vous vouliez bien accepter de payer à partir du 10 juin 1940 tous les exprès télégraphiques qui peuvent vous être destinés sous peine de me voir obligé à prendre une autre décision et délibération municipale. Il demeure bien entendu que les télégrammes qui vous parviendraient sans express par le service du facteur au passage de la distribution des lettres sera comme par le passé gratuit. »
Peu après Cécile et son fils prennent le train pour Souillac, où ils retrouvent « Jacqueline Chausse, la femme de Bill [Ritchie-Fallon], qui avait été catapultée là avec tout le personnel de la maison qui l'employait. On leur trouva une chambre chez Madame Chassaing, aubergiste du cru. Mais les Allemands arrivaient à grands pas à travers la France.
Cécile se trouva absolument sans ressources pour faire vivre son fils, payer sa chambre et se nourrir elle-même. Elle n'avait plus de nouvelles de Paris d'où d'ailleurs Robert était reparti à nouveau à la recherche de son régiment fantôme dont nul ne savait où il était passé », écrit Morys.

Le Journal, 28 juillet 1940
« Certains journaux avaient ouvert à leurs lecteurs une rubrique permettant aux familles dispersées de tenter de se retrouver. Toujours sans nouvelles de son mari, Cécile y passa des annonces pour demander à tous les amis, à tous les auteurs de la maison, à tous ceux qui connaissaient Robert de donner de leurs nouvelles et, bien entendu, elle donnait son adresse. De son côté, Robert cherchait sa femme qu'il ne savait pas arrivée à Souillac, écrivait partout au hasard. Tout le monde cherchait tout le monde. Cécile reçut des réponses inattendues :
De Luc Dietrich : " Donnez-moi de vos nouvelles ma petite Cécile. Êtes-vous bien, en bonne santé ? Et Robert où est-il ?..."
De Wladimir Pozner : " Des amis ont découpé, à mon intention, votre petite annonce [...] où est Denoël ? J'ai eu de ses nouvelles pendant la retraite : un sergent qui le connaissait, lui, et me connaissait, moi, m'a dit qu'il était à Montpellier. Est-ce vrai ? Y est-il toujours ? Est-il démobilisé ? Que compte-t-il faire ?..."
De son côté Denoël s’inquiétait des uns et des autres. Aragon lui répond le 29 juillet : " Cher ami, votre lettre du 20 m'est arrivée le 26. Elsa a écrit aussitôt à Cécile et à vous une lettre qui dit au fond ce que je voulais vous écrire. Mais comme vous êtes un distrait vous aviez simplement oublié l'adresse, votre adresse, un timbre postal effacé nous a appris que vous étiez à Souillac, sans plus. Ce qui fait que le mot d'Elsa risque de ne pas vous arriver, pour adresse incomplète.
Là-dessus, hier, dans Le Journal, tout à fait par hasard tombé entre nos mains, E[lsa] a découvert une annonce mise par une certaine Mme Robert Denoël, avec adresse complète. Alors je vous récris. Je n'ai, dans mes voyages, rencontré qu'un neveu d'André Gide avec qui j'ai fait jadis ma philosophie (le neveu, pas Gide). Puis la guerre finie, à Javerlhac (Dordogne) j'ai vu arriver ma femme sans crier gare : avouez qu'il n'y a qu'elle pour savoir faire ça, elle s'était promenée sur les routes cherchant quelqu'un qui portât le soleil d'Austerlitz, insigne de ma division, et elle avait trouvé mon général...[...]
Pour ce qui est de la plaque de marbre des Editions Denoël, apprenez que je porte désormais la croix de cette guerre à côté de celle de l'autre (citation à l'ordre de la brigade). Encore deux ou trois guerres, et je ferai un excellent portier de boîte de nuit. Il me plaît que vous pensiez au théâtre, et ne désespériez pas de la scène française. Qui voyez-vous dans ' Le Maître de Ballantrae ' ? Nous embrassons Cécile, Finet et vous. Et à bientôt, bien affectueusement. A."
Pour tromper le temps, Denoël avait écrit
une pièce de théâtre d'après le roman de Stevenson. »
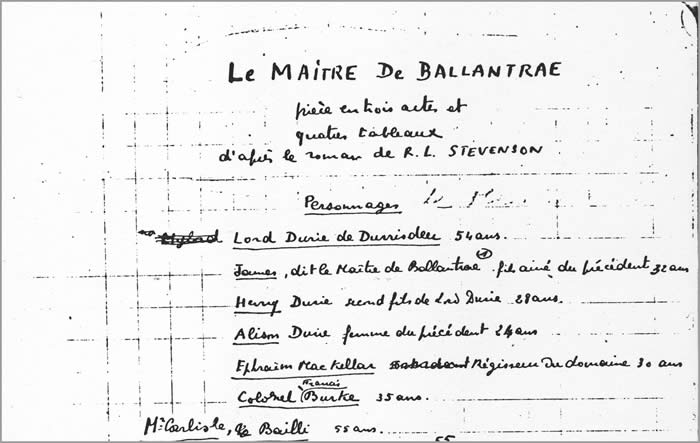
Le 10 : L'Anthologie de l'humour noir est achevé d'imprimer. Il restera chez l'imprimeur jusqu'au printemps 1941, en attendant son visa de censure, qui ne vint jamais car l'ouvrage fut interdit par le gouvernement de Vichy, sans doute à cause de la « désertion » de l'auteur et de l'illustrateur de la couverture, Marcel Duchamp, qui avaient quitté la France pour les Etats-Unis. Sa mise en vente, qui passa inaperçue, n'eut lieu qu'après la Libération.
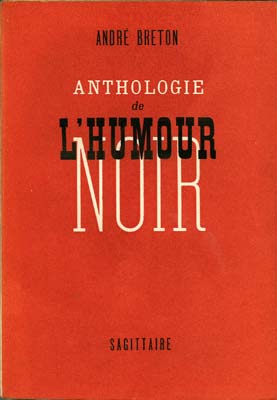

André Breton par Frida Kahlo
Le 10 : Elsa Triolet quitte Paris pour Bordeaux grâce à une voiture de la légation du Chili, avec l'aide du conseiller d'ambassade Arellano Marin. Elle retrouvera Aragon à Javerlhac, le 29 juin.
Le 13 : Sophie Morgenstern, une des premières analystes d'enfants, qui est restée à Paris, se suicide.
Le 14 : Entrée des Allemands à Paris, déclarée ville ouverte. Confiscation de tous les drapeaux français au fronton des édifices, immédiatement remplacés par des drapeaux à croix gammée. La circulation en ville est interdite entre 21 heures et 5 heures du matin. Quelques autres mesures contraignantes sont annoncées par voie d'affiches.
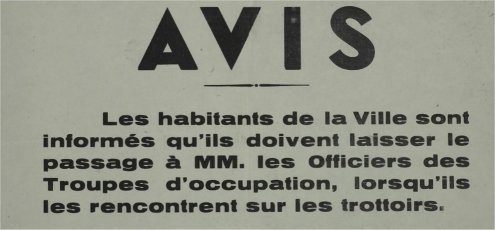
Le 14 : Suzanne Borel [1904-1995], qui n’est pas encore Mme Bidault mais déjà « Mlle Crapotte », et son amie Yvonne Dornès « foncent vers le Sud » à la poursuite de leur ministère. Elles s’arrêteront à Vichy, où la première demeurera jusqu’en mai 1944, avant de fuir « pour échapper à l’arrestation ». Elle restera ensuite cachée dans les environs de Hyères jusqu’à la Libération [selon son livre de souvenirs, Je n’ai pas oublié...]
Le 16 : Démission du président du Conseil Paul Reynaud, et formation d’un gouvernement présidé par le maréchal Pétain. Reparution du premier journal parisien, dirigé par Stéphane Lauzanne : Le Matin, quotidien antisémite, antimaçonnique et anticommuniste, traversa l'Occupation avec des tirages oscillant entre 220 000 et 260 000 exemplaires. Il se saborda le 17 août 1944. Stéphane Lauzanne, son rédacteur en chef, fut condamné à vingt ans de travaux forcés. Son propriétaire, Maurice Bunau-Varilla, mourut opportunément le 1er août 1944.
Le 17 : Les autorités allemandes se rendent rue Amélie « pour procéder à l’arrestation de Monsieur Denoël, et à la saisie des ouvrages », dira Auguste Picq, qui les reçut ce jour-là, « en l’absence de l'éditeur ».
On a vu que le 11 mai, il avait donné pleins pouvoirs à son comptable pour diriger la maison d'édition en son absence. Mais Denoël est rentré à Paris le 31 mai et, le 7 juin, il a rencontré Gaston Gallimard, rue de Grenelle. Pourquoi est-il absent dans une telle circonstance ? A-t-il eu vent de son arrestation possible par les autorités allemandes ?
Les volumes seront en fait saisis en trois endroits : au siège de la maison d'édition, aux Messageries Hachette, et chez l'imprimeur La Technique du Livre, rue du Moulin-Vert, qui imprime la revue Notre Combat.
Aux deux premières adresses, 91 877 exemplaires de 41 titres sont saisis, pour une valeur de 1 356 635, 50 F, ce qui représente, au prix fort de vente, une somme de 1 728 214 F.
A la Technique du Livre, 146 329 exemplaires de Notre Combat sont saisis, représentant 371 578,50 F.
Denoël dira que cela représentait près du tiers de son stock existant en 1940. Il est à noter que l'éditeur parle de 41 titres, alors que les différentes listes Otto publiées à partir d'octobre 1940 n'en mentionnent que 31.
D'autre part, Auguste Picq et Albert Morys m'ont assuré qu'une partie des stocks destinés au pilon avait pu être dissimulée au 21 rue Amélie, où l'on pénétrait par une porte dérobée dans le magasin voisin appartenant à Robert Beauzemont.
La maison d'édition a été fermée le même jour et les scellés apposés. Auguste Picq poursuit provisoirement ses activités aux Trois Magots, avenue de La Bourdonnais.
Au même moment, Guillaume Hamonic, qui n'a pas quitté Paris et qui dirige les Editions Grasset en l'absence de l'éditeur réfugié en zone sud, est convoqué par la police allemande et interrogé à plusieurs reprises à propos de l'écrivain anti-nazi Otto Strasser dont Bernard Grasset a publié, quelques mois plus tôt, Hitler et moi.
La maison Grasset n'est pas fermée par les autorités d'occupation, comme le bruit a couru dans Paris, elle est simplement fermée parce que l'éditeur est absent, et que le personnel est dispersé sur les routes de l'exode. Néanmoins, Hamonic est prié de ne la rouvrir qu'avec leur assentiment.
Le 17 : Le maréchal Pétain appelle les Français à cesser le combat et leur fait « don de sa personne pour atténuer leur malheur ». Le lendemain, le général de Gaulle les appelle à la résistance depuis Londres.


17 juin 18 juin
Le 22 : L’armistice est signé à Rethondes. Cécile, toujours sans nouvelles de Robert, apprend que son frère Billy, qui est Anglais puisque né à Cap Town de père anglais, avait pu rejoindre l’Angleterre, sans savoir encore qu'il s’était engagé dans la Royal Air Force. Pour des raisons administratives, elle fera inscrire son frère chez elle, rue de Buenos-Ayres, le 13 septembre.
Selon Morys, Cécile avait décidé de partir, elle aussi, avec son fils et Jacqueline Fallon, en Angleterre où elle avait de la famille qui lui permettrait sans doute de retrouver Billy et, par lui, Robert : « Une filière était possible. Elle avait tout organisé dans le moindre détail. Il fallait profiter de partir avant que les Allemands envahissent toute la France malgré le traité. C'était donc bien décidé : le départ était pour le lendemain. » Le lendemain, Robert arrivait à Souillac.
Denoël y resta quelque temps à se reposer de ses randonnées en zig-zag, en profita pour terminer son « Maître de Ballantrae », et envoyer des lettres dans tous les azimuts, notamment celle-ci, à Luc Dietrich : « Après d’étonnantes aventures de mobilisé, de démobilisé, d’évacué et de réfugié dans un grand nombre de villes et de villages de France, j’ai pu gagner Souillac où j’ai retrouvé Cécile et le jeune Robert. [...] Je vais rester quelques jours ici. Dès que le gouvernement aura regagné Paris, je rentrerai. Je repars à zéro mais avec la certitude que mon heure est venue. » [collection famille Dietrich].
Voilà une affirmation assez surprenante de la part d'un éditeur qui vient d'apprendre par son comptable que les Allemands ont saisi 30 % de son stock, que sa maison est sous scellés pour plusieurs mois, et qui n'a toujours pas de bailleur. La lettre n'a pas été datée par son expéditeur, mais elle a bien été envoyée de Souillac, où Denoël est resté durant le mois de juillet.
Cet optimisme est peut-être de façade car Léon Pierre-Quint, qui prétend avoir rencontré Denoël à Vichy au cours du mois d'août, l'a trouvé « fort désemparé, et qui ne songeait alors qu'à se retirer, à ce moment-là au moins, à la campagne. »
La présence de Robert Denoël à Vichy est confirmée par un écho du quotidien France, publié à Londres :
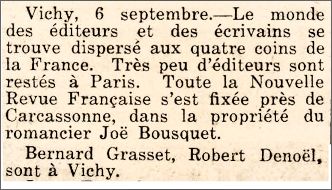
France, 7 septembre 1940
Le 23 : Reparution du quotidien Paris-Soir, sous contrôle allemand. Le chancelier Hitler visite Paris.
Le 24 : Réouverture de la Bibliothèque nationale. Elle avait été fermée le 10, quand le gouvernement a quitté Paris.
Le 28 : Quelques éditeurs restés à Paris annoncent la réouverture partielle de leurs maisons pour honorer les commandes des libraires :
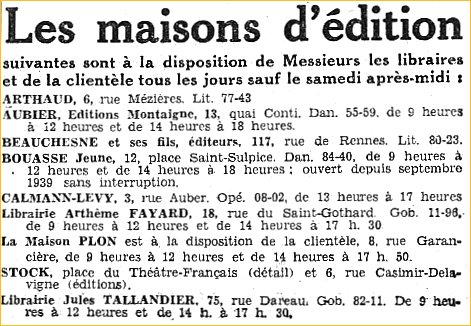
Le Matin, 28 juin 1940
Le 29 : Le gouvernement français quitte Bordeaux pour Vichy.
Le 30 : Premier numéro du quotidien La France au travail, dirigé par Charles Dieudonné, pseudonyme de Georges Oltramare, avec l'appui financier des services d'Otto Abetz. Avec un tirage initial de 80 000 exemplaires, ce journal était sensé gagner la confiance des milieux ouvriers. Il manqua son objectif et disparut en mai 1941.
Oltramare anima ensuite des émissions culturelles et politiques à Radio Paris et s'enfuit en septembre 1944 à Sigmaringen. Arrêté par les alliés et extradé en Suisse, il fut condamné à mort par contumace, le 12 janvier 1950, par la cour de justice de la Seine. Il est mort au cours d'un accident de voiture à Genève le 16 août 1960.
Les Allemands réquisitionnent les Messageries Hachette.
Juillet
Le 3 : La Royal Navy attaque la flotte française à Mers-el-Kébir : 1 297 marins français sont tués.
Le 4 : Le gouvernement de Vichy rompt les relations diplomatiques avec la Grande-Bretagne.
Le 6 : Les scellés sont apposés chez Fernand Sorlot.
Le 7 : Radio-Paris reprend ses émissions. Le Matin écrit que le matériel avait été rendu inutilisable par le «gouvernement irresponsable » de Paul Reynaud.
Le 10 : L'Assemblée nationale donne pleins pouvoirs au maréchal Pétain.
Le 11 : Premier numéro de La Gerbe, hebdomadaire dirigé par Alphonse de Châteaubriant et Marc Augier.
Le 12 : Premier numéro de l'hebdomadaire Au Pilori, « organe de combat contre la judéo-maçonnerie ».
Le 14 : Céline et sa femme sont de retour à Paris.
Le 14 : A la suite d'un article de François Mauriac paru le 29 juin dans Le Figaro où l'académicien incitait la population à « traiter avec une indifférence pleine de mépris la horde des envahisseurs et les visiteurs indésirables venant d'Allemagne », Le Matin, relayant la Deutsche Allgemeine Zeitung, écrit : « L'orgueilleux M. Mauriac qui, six jours après l'armistice, ose employer l'expression " horde des envahisseurs " peut être comparé au bourgeois français incorrigible qui n'a rien compris parce qu'il ne veut rien comprendre. Que seraient devenus les milliers de réfugiés sur les routes des territoires occupés, si l'armée allemande victorieuse les avaient ignorés et traités de la même manière que l'avaient fait quelques jours auparavant les divisions françaises en retraite ? »
Dans Les Beaux Draps, six mois plus tard, Céline ne dira pas autre chose : « J’ai vu des tanks de 40 tonnes bousculer nos orphelins, nous bazarder dans les colzas pour foncer plus vite au couvert, la foire au cul, orageante ferraille à panique. [...] L’Armée qui fuit c’est pas convenable, ça propage des vents de panique. De Meuse à Loire c’était qu’un pouet, une foire unanime. Qui qu’a fait la plus grosse diarrhée ? les civils ou les militaires ? C’est pas une raison de pavoiser, d’afficher des souverains mépris ».
Le 17 : Les juifs naturalisés sont déchus de la nationalité française. Parmi eux, le grand éditeur d'art Daniel-Henry Kahnweiler [1884-1979], dont la maison à Boulogne sera occupée par Michel Leiris et sa femme afin de préserver son patrimoine.
Le 18 : Première émission radiophonique quotidienne de la France Libre sur les ondes de la BBC, sous la direction de Maurice Schumann. « Ici la France » qui, à partir du 6 septembre, deviendra « Les Français parlent aux Français », est diffusée tous les soirs entre 20 h. 30 et 21 heures. Son impact sur le public français est immédiat.
Le 18 : Bernard Steele, sa femme et ses deux filles, arrivent à New York à bord du paquebot « Manhattan » venant de Lisbonne.
Le 18 : Le Journal Officiel publie l'une des premières mesures prises par le gouvernement de Vichy en vue d'épurer l'administration et qu'on peut résumer par : « Tout fonctionnaire devra être né de père français ».
Le 22 : L’armistice est signé. Les réfugiés sont autorisés à rentrer chez eux dans toutes les zones, à l'exception de la zone Nord (Nord et Pas-de-Calais qui dépendent de l'administration allemande en Belgique) et de la zone Est (l'Alsace-Lorraine, sous contrôle allemand).
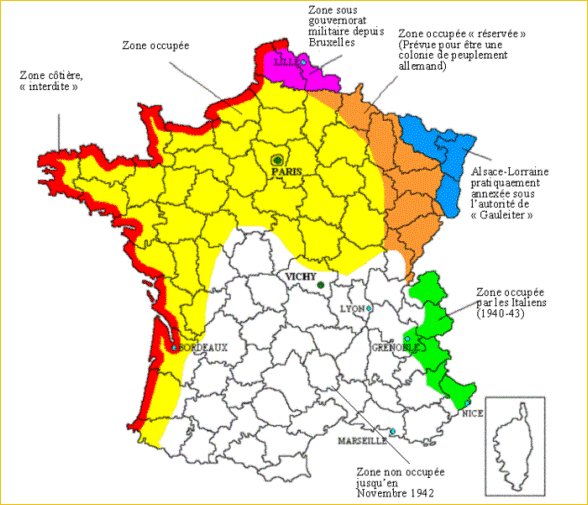
Le 25 : La radio française annonce que Georges Huisman [1889-1951], directeur général des Beaux-Arts, et Julien Cain [1887-1974], administrateur de la Bibliothèque Nationale, ont été révoqués de leurs fonctions pour avoir abandonné leur poste irrégulièrement et s'être rendus au Maroc à bord du Massilia, sans autorisation du ministre de l'Education nationale.
Le 29 : Elsa Triolet répond à un courrier de Denoël : « J'ai pu retrouver Louis après à peine quelques miracles et nous sommes ensemble depuis le début du mois. Il va fort bien, mais a les tempes tout à fait blanches et l'allure d'un général en retraite et certainement dans le besoin. Il ne sort jamais sans une canne à manche d'ivoire, cadeau d'un curé, en Belgique. Cela fait qu'avant de voir ses galons tout le monde salue ce noble militaire qui a tout perdu sauf l'honneur...
Javerlhac est un petit pays charmant, bien plus petit que Souillac, mais il pleut que c'est un scandale, surtout quand on n'a pas autre chose à faire que de se promener. D'ailleurs je m'entends mal avec la campagne, je deviens laide, grasse et j'ai peur des vaches.[...] qui sait, peut-être irons-nous ou viendrez-vous nous voir et nous écouterons la pièce ' Le maître de Ballantrae '. Comment allez-vous Cécile ? La santé ? Finet doit être plus grand que moi ! Toujours aussi merveilleusement blond ? »
Aragon sera officiellement démobilisé deux jours plus tard, au terme d'une campagne très méritoire qui lui vaudra plusieurs citations. Celle-ci, qui date du 26 mai 1940, en rappelle une autre : « A donné au cours de la campagne l'exemple de l'abnégation la plus complète. Toujours volontaire pour les missions périlleuses, a relevé sous le feu le 22 juin 1940 des blessés n'appartenant pas à la division et a permis, par la rapidité de son intervention, de sauver la vie à plusieurs d'entre eux... »
Louis Aragon obtient la même Croix de guerre avec palme que Louis Destouches, vingt-six ans plus tôt, mais il considère cette distinction avec plus de détachement : « Encore deux ou trois guerres, et je ferai un excellent portier de boîte de nuit », écrit-il à Denoël, le 29 juillet 1940. Il est vrai qu'il n'en rapporte, lui, aucune infirmité.
Août
Denoël est de retour à Paris. La circulation étant relativement aisée pour les démobilisés qui rejoignent leur domicile, il a pu remonter vers la capitale sans grosses difficultés. Robert Beckers, rentré lui aussi à Paris, s’occupera essentiellement de publicité, rue Amélie.
Pour sa propagande, l'occupant avait donné trois jours aux parisiens qui avaient de la famille en zone non occupée pour aller la chercher et la ramener au bercail. Denoël n’en fit rien et écrivit à sa femme qu'il lui avait été impossible de venir parce qu'il se sentait fatigué.
« En fait, Cécile apprit plus tard qu'il était bien venu en zone libre... mais pour chercher Thérèse, sa maîtresse d'alors, et le petit Jacques qu'elle avait déjà d'un inconnu lorsqu'il avait fait sa connaissance quelques années plus tôt », écrit Morys.
C’est de cette jeune femme que parle Elsa Triolet dans sa préface à l’édition « Folio » du Cheval blanc : « En 1942, Robert Denoël apparut à Nice lors d'un voyage, si je ne me trompe, avec une amie qu'il avait emmenée au Portugal : elle était juive, et peut-être anglaise et il voulait la mettre en lieu sûr. Ce voyage était un risque dévoué, passionné ».
Morys pense que cette maîtresse inconnue était d’origine canadienne. Quant à son fils, il devint acteur de théâtre après la guerre sous le pseudonyme de Jacques... Denoël.
Comme je l'interrogeais à ce propos, Morys m'écrivit que « cette Thérèse avait un fils qu'elle n'avait pas emmené avec elle ». Ce fils était resté en pension à Paris et, dit Morys, c'est Robert Denoël qui lui apportait des friandises qu'il dérobait chez lui. Cécile s'en aperçut, interrogea son mari qui finit par avouer :
- Je préfère tout te dire. Tu sais la vérité au sujet de Thérèse...
- Oui. Tu es venu pleurer dans mes jupes quand elle t'a quitté. Alors ?
- Son fils est en pension... il n'a personne...
- Et c'est toi qui t'occupe de lui.
- ...
- Pauvre gosse. Et tu ne le disais pas ! Je ne te dirai pas ce que je pense de sa mère, mais l'enfant n'y est pour rien. Il est de toi ?
- Oh ! non ! Il a cinq ans de plus que le Finet.
Cécile resta un instant sans rien dire, puis : ' Tu me diras une fois pour toutes quels jours tu le vois. Il y aura pour lui un paquet dans l'entrée ; ne t'inquiète pas, il ne manquera de rien.' »
Vers 1947 ou 1948, écrit Morys, alors qu'il attendait Cécile aux Deux Magots, Jacques, qu'il avait connu au cours d'art dramatique, vint le saluer, puis Cécile survint et dit :
- Vous êtes le fils de Thérèse ? Je suis heureuse de vous connaître. Mon mari m'a parlé de vous. Il y a bien longtemps. Je crois qu'il vous aimait bien et je comprends que vous ayez choisi son nom pour vous faire connaître.
J'ai fait quelques recherches à propos de ce Jacques Denoël, né le 10 mars 1923 et décédé le 3 avril 1977. Il a figuré au générique de quelque quatorze films entre 1941 et 1961, toujours dans de petits rôles.

Jacques Denoël [1923-1977]
Il ne correspond pas exactement au portrait tracé par Morys dans « Cécile ou une vie toute simple », puisqu'il aurait « cinq ans de plus » que le fils de Robert Denoël, né en 1933, mais Morys ne dit pas quand la scène des friandises a eu lieu. D'autre part Jacques Denoël a tourné dès 1941 sous ce pseudonyme.
« Robert écrit ensuite à Cécile 'de se débrouiller pour revenir à Paris'. Mais cela était devenu beaucoup plus difficile, surtout pour les étrangers. On voulait bien la rapatrier en Belgique avec son fils ; mais pas question pour elle de revenir à Paris », écrit Morys.
Denoël s’énervait de ces atermoiements : « Mon chéri, Après la visite du brave garçon qui est venu m'apporter ton mot et tes nouvelles, je ne comptais plus guère sur ton retour pour le 19. Hier soir, cependant, j'ai eu une émotion en entendant à plusieurs reprises la sonnerie de la porte de l'immeuble. Faux espoir ! Et je me suis couché tristement dans cette chambre si grande et si vide quand tu n'y es pas. Il faut absolument que tu rentres, vous ne pouvez pas vous éterniser à Souillac.
Tout le monde rentre à Paris, et je ne comprends vraiment pas comment tu n'as pas pu te débrouiller. Dis-toi bien que les autorités allemandes sont beaucoup plus complaisantes qu'on ne le dit en région libre. En plus, avec un enfant, tu as une sauvegarde. Puisque tu ne parviens pas à monter dans un train à Souillac, ce qui n'a pas fini de m'étonner, tu vas aller à Brive. Je pense qu'il n'existe aucune difficulté pour se rendre à Brive par le train ! Là tu iras à la sous-préfecture, tu demanderas à voir le sous-préfet personnellement et tu lui remettras la lettre ci-incluse.
Je veux être pendu par les ongles si ce sous-préfet ne te délivre pas sur l'heure un ordre de mission en bonne et due forme qui te permettra de prendre un train-poste - en payant ta place - et qui t'amènera sans difficulté et probablement dans la journée, à Paris. Tu diras à ce sous-préfet que tu es la femme de l'éditeur et que comme telle ta présence est indispensable à Paris. Ton charme naturel fera le reste [...]
J'espère rouvrir ma maison le 1er Octobre.
En attendant, je travaille aux ‘Trois Magots’ avec Collet, Picq
et Georges. Ce n'est pas drôle, rien n'est drôle, mais j'ai les
plus solides espoirs. Je pense donc que tu vas faire des pieds et des mains
pour arriver au plus tôt. Ta place est ici.[...] Fais mille amitiés
autour de toi, embrasse le chéri et pars pour Brive au reçu
de cette lettre [...] Je t'embrasse, bien impatient, bien pressé de
te revoir, follette, bien désireux de te tenir dans mes bras. Robert.
PS. Si tu ne vois pas le sous-préfet, demande le Secrétaire Général de la Préfecture. Dis-lui que je suis l'éditeur de Pierre-Jean Launay, très connu dans la région. Si tu n'obtiens rien, vas voir le directeur du journal local, dis-lui la même chose, tu dois réussir. »
« Cécile alla à Brive, à Tulle, partout », écrit Morys. « Elle vit le sous-préfet, le préfet, les directeurs de journaux. Tous la reçurent aimablement mais ils se moquaient bien que l'éditeur ait besoin de sa femme et, toujours très aimablement, lui dirent leur impuissance quant à l'aider, en tant qu'étrangère, à rejoindre Paris.
En fin de compte, c'est par hasard et tout près de Souillac qu'elle trouva la clef qui devait lui ouvrir la voie : la sympathie d'un vénérable membre d'une société fraternelle lui permit, grâce à de faux papiers et à toute une chaîne de sympathisants, de franchir sans encombre et avec son fils la ligne de démarcation si bien cadenassée».
Robert Denoël serait donc allé chercher son amie Thérèse et son fils en zone libre, mais Morys ne précise pas où. Or, Léon Pierre-Quint, le directeur des Editions du Sagittaire, se trouvait à Vichy en août 1940, et il y a vu son confrère belge : « J'ai rencontré Denoël à Vichy en août dernier, fort désemparé, et qui ne songeait alors qu'à se retirer, à ce moment-là au moins, à la campagne. Je n'ai vu depuis son nom mentionné dans aucun journal et personne ne m'a parlé de lui à Vichy. D'ailleurs certains auteurs, en zone libre, liés par contrat avec des éditeurs parisiens de retour à Paris, se considèrent comme libres dans la situation actuelle, pour cause de force majeure.»
C'est justement le cas de l'écrivain à qui Pierre-Quint envoie cette lettre, le 3 janvier 1941 : René Laporte, dont Denoël annonçait un « roman exotique » en janvier 1939, et qui s'est réfugié à Antibes.

Léon Pierre-Quint (© Serge Jacques)
Né Steindecker, juif de gauche, homosexuel et toxicomane, Léon Pierre-Quint [1895-1958] s'est prudemment retiré, dès octobre 1939, à Anjouin, dans l'Indre : « Il ne saurait être question que je rentre personnellement à Paris car mon activité passée, littéraire, politique et sociale,m'interdit non seulement ce retour, mais me fait vivement désirer [...] de me rendre aux Etats-Unis le plus tôt possible », écrit-il le 19 août 1940 à son ami Edouard Roditi.
Faute de pouvoir obtenir les visas nécessaires, Pierre-Quint restera à Anjouin jusqu'à ce que les Allemands envahissent la zone libre, le 11 novembre 1942. Il installera ensuite les Editions du Sagittaire à Marseille, dans l'immeuble occupé par les Cahiers du Sud, sur le Vieux Port - lui-même restant caché jusqu'à la Libération.
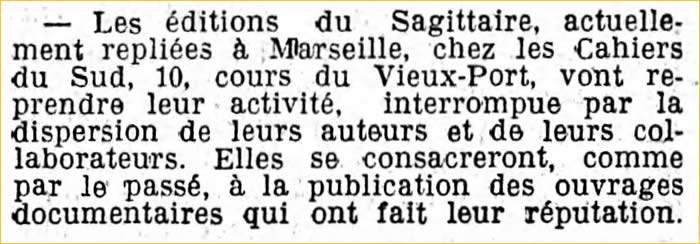
Le Figaro, 16 novembre 1940
Entre 1941 et 1944, les Editions du Sagittaire publieront 31 ouvrages, avant de réintégrer leurs locaux parisiens de la rue Rodier, en avril 1945. Léon Pierre-Quint est mort le 21 juillet 1958.
Le 1er : La radio d'Etat diffuse ses premières émissions antijuives.
Le 2 : Le tribunal militaire de Clermont-Ferrand condamne à mort par contumace le général de Gaulle.
Le 2 : Le Matin, un quotidien dont la création remonte à 1883 et qui, depuis le 17 juin 1940, est devenu la propriété de Maurice Bunau-Varilla [1856-1944], inaugure une série d'articles antisémites qui dureront toute l'Occupation :

L'article concerne les juifs qui, entre le 10 mai et le 30 juin, ont quitté la France. On y trouve des banquiers (Maurice de Rothschild, André Meyer, un des dirigeants de la banque Lazard), des fonctionnaires (Georges Huisman et Julien Cain), des commerçants (Edouard Jonas, antiquaire, Maurice Levitan, industriel), des journalistes (Georges Weiskopf dit Gombault), etc.
Le 5 : Les services de la Propaganda adressent une note aux éditeurs, libraires et distributeurs, leur recommandant de cesser la vente d’ouvrages d’émigrés allemands, ou défavorables au Führer, au Duce, et à leurs régimes. Ces volumes doivent être retournés par les libraires aux éditeurs concernés ou pilonnés de leur propre chef.
Le 8 : Arrestation de Léon Blum, Edouard Daladier, Georges Mandel et du général Gamelin, jugés responsables de la défaite.
Le 13 : Le maréchal Pétain annonce le début de la Révolution nationale, dont la devise « Travail, Famille, Patrie » remplace la devise républicaine « Liberté, Egalité, Fraternité ».

Le 14 : Le Journal Officiel publie le texte d'une loi édictée la veille interdisant les associations secrètes. Ce vocable imprécis permet d'englober toutes les obédiences maçonniques, mais aussi les associations supposées influencées par elles : les spirites, les rose-croix, les naturistes, les pacifistes, les Quakers, les B'Nai B'rith, et même le Rotary-Club.
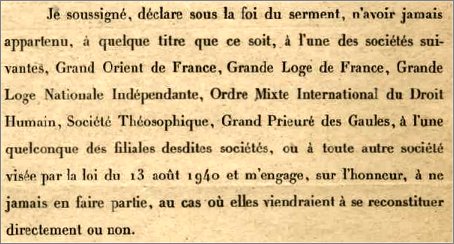
Le 11 août 1941, une nouvelle loi permettra la divulgation, au Journal Officiel, des noms de quelque 18 000 dignitaires francs-maçons. Le juif et le franc-maçon incarnent, selon le discours officiel du gouvernement de Vichy, tous les malheurs de la France, et la plupart des éditeurs collaborationnistes s'empresseront de publier des ouvrages et libelles qui réunissent ces deux entités « maléfiques ». Il est juste d'ajouter que si des maçons français ont été arrêtés ou déportés, c'était en raison d'activités de résistance ou de leur judaïté, et non de leur appartenance à l'un de ces ordres. Robert Denoël, quant à lui, ignorera, durant toute l'Occupation, la question maçonnique.
Le 17 : Reparution de l'hebdomadaire L'Illustration.
Le 26 : Le Pays réel, organe du parti rexiste, qui avait cessé de paraître au début des hostilités, reparaît à Bruxelles.
Le 27 : Abrogation du décret-loi Marchandeau d'avril 1939 interdisant la propagande antisémite dans la presse.
Le 27 : A huit heures du matin, les troupes allemandes perquisitionnent les bibliothèques et les librairies pour en retirer les « livres indésirables », c'est-à-dire contraires aux intérêts allemands, en application d'une liste établie assez sommairement à Berlin et à Leipzig par leurs services.

Cette liste appelée « Liste Bernhard » comporte 143 noms d'auteurs ou titres d'œuvres à caractère politique. Avant la fin du mois, plus de 700 000 volumes auront été saisis et pilonnés.
Il s'y trouve trois ouvrages parus chez Denoël, qui figureront ensuite sur les listes Otto : Les Dictateurs de Jacques Bainville [1935], La Victoire des vaincus d’André Fribourg [1938], et La Croisade gammée de Louis Roubaud [1939]. Tous les numéros de sa revue patriotique Notre Combat s'y trouvent aussi.
Au cours de cette même matinée Bernard Grasset, devançant les exigences de l'occupant, s'est rendu à l'ambassade d'Allemagne afin d'assurer qu'il était prêt à publier davantage de traductions d'auteurs allemands, pour autant que les ouvrages « conseillés » ne contiennent « rien de contraire aux intérêts français », et d'y montrer son catalogue auto-censuré : « 22 écrivains et 33 titres étaient ainsi offerts en sacrifice expiatoire et volontaire aux autorités allemandes afin qu'elles comprennent à quel point leurs volontés étaient partagées », écrit Jean-Yves Mollier [Edition, presse et pouvoir en France au XXe siècle , p. 69].
En procédant de la sorte, Grasset est, apparemment, le seul éditeur qui ait limité les interdictions dans son catalogue puisqu'on retrouve exactement ces 22 écrivains et 33 titres sur la Liste Otto qui paraîtra le 4 octobre.
La Commission interprofessionnelle d'épuration de l'Edition considéra, en mai 1946, qu'il s'était gravement compromis par ses prises de position et plusieurs lettres qu'il avait écrites au cours de ces semaines décivives.
Celle, notamment, qu'il adresse le 31 juillet, à Alphonse de Châteaubriant, en rappelant sa qualité de Français « authentique, sans nul de ces alliages malsains que l'Allemagne condamne à juste titre [...] Si haut que l'on remonte dans les deux branches, on ne peut trouver un Juif ou une Juive. » [J.-Y. Mollier, op. cit., p. 66]
Celle, surtout, qu'il écrit à son fondé de pouvoirs, Guillaume Hamonic, le 3 août, pour lui annoncer son retour à Paris en vue de négocier avec les Allemands la réorganisation de l'édition, ajoutant que « Les occupants sont essentiellement racistes. J'ai une très nette tendance à l'être. En somme, sur de nombreux points que j'appelllerai de " doctrine " - opposant " doctrine " et " politique " -, je partage beaucoup de leurs sentiments. » [Id.]
Le Figaro, 3 août 1940 Le Figaro, 17 août 1940
A Vichy, Grasset a rencontré Pierre Laval en vue de se faire introniser représentant de l’édition dans ces négociations qui s'annoncent serrées. Dans son esprit, les choses sont claires : « les éditeurs français doivent franchement accepter la censure politique de l’occupant, sans ordres ni consignes, de leur propre chef. »
« Ce système », écrit Pierre Assouline, « c'est la prison surveillée par les prisonniers méritants, le camp de concentration maté par les kapos. L'éditeur saisi par le doute a néanmoins la faculté de faire lire ses manuscrits par la censure qui lui indiquera ce qu'il faut en penser. La contrepartie de l’autocensure, c’est l’attribution
du contingent de papier. Au diable la déontologie ! On est sous la botte. » [Gaston Gallimard, p. 275].
Le texte de la convention de censure qui sera publié un mois plus tard ira dans ce sens. En cas de doute sur l’opportunité de publier tel ou tel livre, le syndicat de l’Edition n’aura pas à prendre de décision : c’est la Propaganda Staffel, section des publications (Gruppe Schriftum), 52 Champs-Elysées, qui s’en chargera.
Ce qui choque le plus Assouline, « c'est la célérité avec laquelle la corporation des éditeurs français, dans sa quasi-totalité, choisit de collaborer alors que l'entrevue de Montoire n'a même pas encore eu lieu et que la photo de la poignée de main Hitler-Pétain ne fait pas encore la " une " des journaux. »
Dans sa quasi-totalité, écrit Assouline. Qui sont les réfractaires ? Il ne cite qu'une seule maison : les Editions Emile-Paul qui, dès le mois d'août, « transforment leurs bureaux de la rue de l'Abbaye en " boîte aux lettres " avec Jean Cassou, Pierre Abraham et Claude Aveline pour confectionner des tracts. »
Il convient pourtant de remarquer que les frères Albert et Robert Emile-Paul n'ont pas fermé ces bureaux : ils ont bel et bien publié des ouvrages, en nombre restreint il est vrai, durant toute l'Occupation. Certes, à côté des multiples rééditions du Grand Meaulnes, on trouvait surtout des éditions de luxe d'auteurs du XIXe siècle, des livres illustrés, des textes de Rilke, Samain, Péguy, Jammes, Corbière, Mallarmé..., et quelques titres de contemporains comme Toulet, Mac Orlan, Léon-Paul Fargue, ou... Jean Voilier.
A priori, aucun texte compromettant. On peut tout au plus épingler le livre de Jean Voilier, Ville ouverte, qui est d'inspiration collaborationniste, mais tiré à 430 exemplaires, donc en édition à diffusion restreinte. Il n'empêche que les Editions Emile-Paul ont dû, comme les autres éditeurs, demander leurs visas de censure et le papier nécessaire à la confection de leurs volumes.
Comme l'écrit encore Pierre Assouline : « En ces temps troublés, la responsabilité de l'éditeur se mesure à l'aune du contingent de papier. En avoir ou pas. Pour en obtenir, il faut passer par les Allemands, leurs exigences et leurs desiderata. Ainsi soit-il. On collabore. »
La question se pose en effet de savoir si les éditeurs qui n'ont pas publié d'ouvrages imposés par l'occupant mais qui ont eu recours à ses différents services, et qui ont donc participé au système mis en place en août 1940, devaient rendre des comptes à la Libération.
La réponse a été donnée dès septembre 1944 par les services du ministère de l'Information dirigé par Pierre-Henri Teitgen [1908-1997] : les maisons d'édition Emile-Paul, Champion, Delagrave, Garnier, Lemerre, Payot, Firmin-Didot, Perrin, Fasquelle, ont été considérées comme « irréprochables ».
Septembre
© Life
Jeune Front, mouvement créé au cours de l'été par Robert Hersant [1920-1996], installe ses bureaux dans les locaux de l'Office du tourisme anglais, sur les Champs-Elysées. Affichant ouvertement leurs sympathies pour l'occupant, ses membres se signalent principalement par deux activités : la distribution de l'hebdomadaire Au Pilori, et le bris de vitrines des magasins juifs voisins. Pris à partie à l'Assemblée nationale en 1956, après avoir été élu député de l'Oise, Hersant dira que Jeune Front avait duré très exactement trois semaines et qu'il l'avait quitté précisément parce qu'il prenait une tournure politique qui lui interdisait d'y rester.
On ne sait quelle « nouvelle » tournure avait pris Jeune Front. Lors de l'inauguration officielle, le 25 août, les discours de Pierre Clémenti et de Robert Hersant, rapportés par Le Matin du lendemain, avaient justement précisé les buts de leur mouvement, qui était avant tout « antijuif et antimaçonnique ». En 1947 Hersant fut condamné à dix ans d'indignité nationale.
Robert Denoël refuse le manuscrit de Voltaire antijuif. Henri Labroue [1880-1964] l'avait, dès novembre 1938, proposé sans succès à plusieurs éditeurs (Baudinière, notamment), en faisant intervenir des journalistes tels que Béraud, Brasillach ou Horace de Carbuccia. En novembre 1940 il le propose à Robert Pierret, du Pilori, qui édite occasionnellement des brochures antisémites, mais le secrétariat général à l'Information de Vichy lui refuse l'imprimatur. L'ouvrage paraîtra finalement en 1942 aux Editions Le Pont de Gerhard Hibbelen.
Le 1er : Ouverture de l'Institut allemand, 57 rue Saint-Dominique, dirigé par Karl Epting.
Le 5 : Louis Aragon adresse à son ami américain Matthew Josephson une lettre qui résume parfaitement sa situation d'auteur proscrit, qui doit être celle d'écrivains réfugiés, comme lui, en zone Sud : « Comme en zone occupée mes livres, ainsi que ceux de beaucoup d'écrivains français, ne sont plus mis en vente, et qu'en zone libre la question ne se pose même pas, puisque les stocks de livres sont restés à Paris d'où rien ne peut venir, il paraît tout à fait impossible de vivre désormais comme écrivain. »
Le 6 : La BBC londonienne lance, sur l'air de la « Cucaracha », le slogan fameux : « Radio-Paris ment, Radio-Paris est allemand ». Un décret signé du garde des Sceaux, Raphaël Alibert, déchoit de leur nationalité française tous les membres de la famille Rothschild.
Le 8 : Sous le titre « L'activité littéraire reprend à pas menus », Le Figaro donne des nouvelles des éditeurs, qui restent dans l'expectative. Gaston Gallimard, hôte du poète Joë Bousquet, attend dans l'Aude. Fayard annonce un livre d'Henry Bordeaux. Albert Pigasse s'installe à Lyon et compte y poursuivre sa collection « Le Masque ». Fernand Sorlot s'est fixé à Clermont, Etienne Chiron à Royat, Flammarion à Lyon, Quillet à Montpellier. En fait, tout le monde attend le retour de Bernard Grasset, chargé par le gouvernement de prendre contact avec les autorités allemandes à Paris à propos du statut de l'édition. Seul René Julliard reste actif à Vichy et annonce une seconde brochure des Actes du maréchal Pétain aux Editions Sequana.
Le 10 : Premier numéro du journal Aujourd'hui, dirigé par Henri Jeanson. Ce quotidien anti-conformiste qui bénéficia des plumes brillantes de Jean Anouilh, Marcel Aymé ou Jean Galtier-Boissière, tira jusqu'à 100 000 exemplaires jusqu'en novembre, c'est-à-dire jusqu'à la démission forcée de Jeanson, qui avait refusé de publier un article favorable à l'entrevue de Montoire. Son remplacement par Georges Suarez, collaborateur de droite, ne fut pas sans influence sur les tirages, qui tombèrent à 60 000 exemplaires, un an plus tard.
Le 14 : André Billy, dans Le Figaro, se demande si le prix Goncourt sera décerné cette année, la plupart des académiciens s'étant dispersés aux quatre coins de la France : Lucien Descaves est à Senonches, Rosny jeune en Bretagne, Léo Larguier dans le Gard, Léon Daudet près de Limoges, Jean Ajalbert dans le Cantal, Roland Dorgelès à Marseille, Francis Carco à Nice, Sacha Guitry à Paris. René Benjamin, le secrétaire de la Compagnie chargé de réunir tous ses membres, reste introuvable.
Les éditeurs n'ont pas, comme de coutume, déposé au début du mois d'août les sept ou huit douzaines de volumes destinés à concourir, et ils ne sont pas prêts à le faire pour novembre. Faudra-t-il porter son choix sur les rares volumes publiés au printemps 1940 ? André Billy se résigne à poser la question : « Et au vrai, quel rang au juste peut tenir cette année le prix Goncourt dans l'ordre hiérarchique de nos préoccupations ? »
Le 15 : Anticipant de quinze jours la loi sur le statut des juifs, Le Matin rend compte d'une réunion des membres de la Fédération des comités du haut commerce de Paris, séance au cours de laquelle il fut question de l'assainissement indispensable de la corporation : «Trop de juifs encombrent les industries de luxe de Paris qui représentent aux yeux du monde le chic, le goût français. » Ses dirigeants ont décidé qu'un panonceau portant l'indication « Maison française » serait délivré aux maisons dont la direction est exclusivement française.

Le 21 : Reparution du quotidien L'Œuvre, sous la direction de Marcel Déat et de René Château. Son tirage moyen durant la guerre sera de quelque 120 000 exemplaires.
Le 23 : Apparition des premières cartes de ravitaillement.
Le 27 : Ordonnance allemande relative aux mesures contre les juifs, par laquelle les personnes entrant dans la catégorie de « juif » sont ainsi définies : « Sont reconnus comme juifs ceux qui appartiennent ou appartenaient à la religion juive, ou qui ont plus de deux grands-parents (grands-pères et grands-mères) juifs. »
Le 28 : René Philippon, président du Syndicat des Editeurs, co-signe avec le chef de l'administration militaire allemande en France une convention sur la censure des livres (nouveautés et réimpressions).
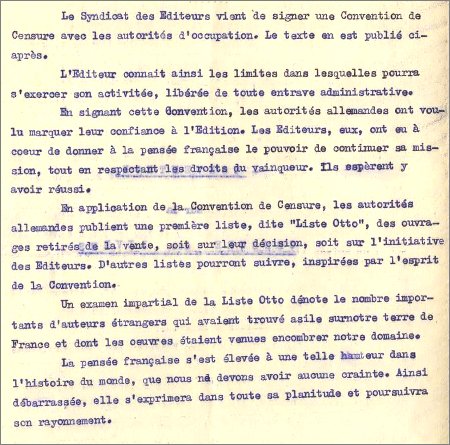
Une première « Liste Otto » est mise en circulation. Tirée à 40 000 exemplaires, elle est diffusée dans le numéro du 4 octobre de la Bibliographie de la France. Elle concerne 1 060 titres publiés par 135 maisons d'édition.
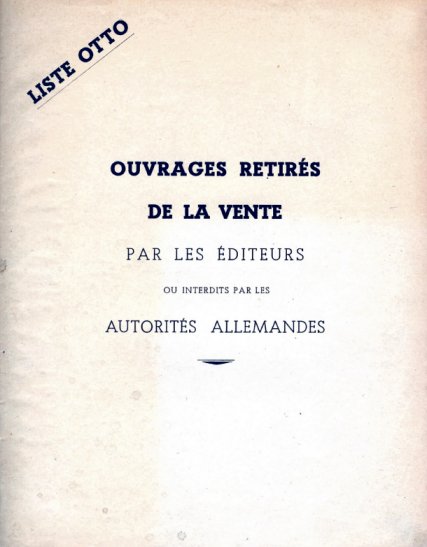
Octobre
Le 3 : Loi sur le statut des juifs en France. Son texte, dû au nouveau garde des Sceaux, Raphaël Alibert, mais rédigé, dit-on, par Marcel Peyrouton, le ministre de l'Intérieur, est publié le 18 au Journal Officiel.
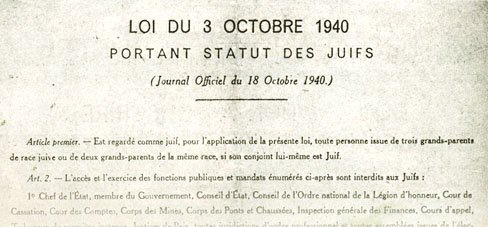
Si l'ordonnance allemande du 27 septembre se référait à la seule religion, la loi française - en raison du principe de laïcité - lui substitue la notion, non définie, de race : « Est regardé comme juif, pour l'application de la présente loi, toute personne issue de trois grands-parents de race juive ou de deux grands-parents de la même race, si son conjoint lui-même est juif ». Pour le cas où cette définition paraîtrait obscure à ses lecteurs, Le Matin la commente par un croquis :
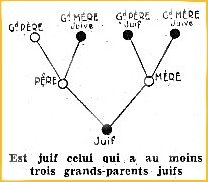
Le Matin, 5 octobre 1940
Le 4 : Jeanne Valensi cède à Robert Denoël les 16 parts qu’elle possède dans la société « La Publicité vivante » moyennant la somme de 4 000 francs.
Mlle Valensi, qui avait, le 1er mars 1938, acquis ces parts de Georges Wenstein pour 8 000 francs, les cède à Robert Denoël pour la moitié de leur valeur nominale. Jeanne Valensi est donc bien un autre prête-nom de Denoël.
A cette date les seuls associés dans la société sont : Robert Denoël, qui détient 32 parts, et son beau-frère, Guillaume Ritchie-Fallon, qui en détient 18.
Le 4 : Publication, dans Bibliographie de la France, de la liste des ouvrages indésirables figurant sur la « Liste Otto ». Chez Denoël, trente titres sont mis à l’index, et tous les numéros de sa revue Notre Combat.
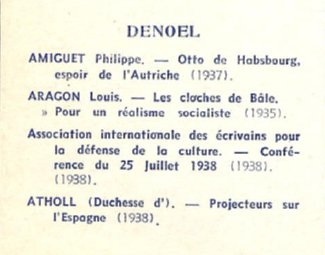
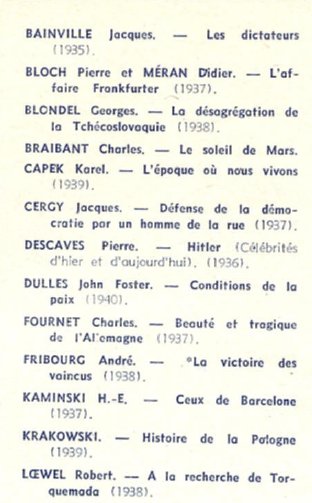
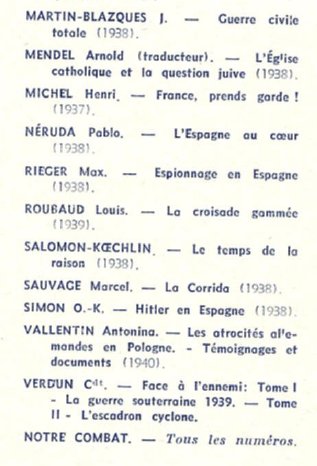
Il s’agit d’ouvrages défavorables à l’Allemagne et à l’Espagne franquiste, ou dus à des auteurs juifs. Un seul auteur littéraire est mis à l’index : Aragon, pour Les Cloches de Bâle [1934] et Pour un réalisme socialiste [1935].
Curieusement on y trouve Introduction à la psychanalyse des enfants, une brochure d'Anna Freud attribuée à d'inexistantes « Editions Psychanalytiques » et publiée en réalité dans la Revue Française de Psychanalyse. C'est un tiré à part de 12 pages distribué depuis 1931 par Denoël et Steele dans leur « Bibliothèque Psychanalytique ».
On n’y trouve pas un seul titre publié par les Editions La Bourdonnais. On peut penser que leurs tirages confidentiels ont préservé certains ouvrages politiques qu’elles avaient édités entre 1934 et 1939.
A noter encore six volumes publiés entre 1931 et 1938 par des Editions Documentaires qui n'ont aucun rapport avec l'enseigne éponyme créée fugitivement par Robert Denoël en 1939.
Les éditeurs qui y figurent avec plus de cinquante titres sont : Tallandier [54], les Presses Universitaires de France [103], Fayard [108], et Gallimard [146].
Le 5 : Arrestation par la police parisienne de quelque 300 militants communistes.
Le 8 : Reparution à Paris du Petit Parisien. Ce quotidien de droite justifiait, avant guerre, des tirages supérieurs au million d'exemplaires. Dès décembre 1940 il aura regagné une grande partie de son lectorat : 912 000 exemplaires.
Le 8 : Sous le titre « Les juifs renieraient-ils leur origine ? », Le Matin ironise sur le nombre restreint de juifs qui se déclarent comme tels depuis le 3 octobre, alors qu'ils se réclamaient de la « race élue » avant la guerre, comme en témoignait un article de Pierre Lazareff paru en septembre 1933 qui citait des dizaines de noms de politiciens, d'écrivains, d'acteurs, d'avocats ou de journalistes fiers d'être juifs.
Le 10 : Paul Riche, dans Au pilori, publie un incroyable papier sur la N.R.F. : « Une bande de malfaiteurs a fonctionné dans la littérature française de 1909 à 1939 sous les ordres d’un chef bandit : Gallimard. Trente ans d’abjecte et sournoise propagande en faveur de l’anarchie, des révolutionnaires de tout poil, des ‘ anti ’ : antifasciste, antinationale, anti-n’importe quoi. Trente ans de nihilisme littéraire, spirituel, humain ! Gallimard et sa bande ont préparé les cadres d’une voyoucratie distinguée ».
L’attaque se fait plus personnelle : « Gallimard veut rentrer ! Déjà, les nègres, négroïdes et négrophiles gallimardeux attendent aux Deux Magots leurs prochains trente deniers [...] Assassin de l’esprit, Gallimard ! Pourrisseur, Gallimard ! Chef de malfaiteurs, Gallimard ! La jeunesse française vous vomit ! »
Ce « journaliste », qui sera fusillé le 29 mars 1945, et qui s’appelle en réalité Jean Mamy, n’a pourtant pas eu de manuscrits refusés rue Sébastien-Bottin, il est comédien [Mamy a tenu un rôle important dans Les Cenci en 1935] et réalisateur de cinéma ; il met sa plume au service de l’occupant en vilipendant les juifs et les francs-maçons dans des organes de presse extrémistes.
Il faut dire que le mot de l’ambassadeur Otto Abetz selon lequel il y avait trois puissances en France : le communisme, les banques et la NRF, avait largement circulé, et que la NRF passait pour anti-allemande et judéo-bolchéviste. Mais on trouvera en 1945 de semblables plumitifs pour dénoncer d’autres éditeurs dans d’autres feuilles extrémistes : seuls les noms auront changé.
Le 11 : Jacques Boulenger [1879-1944], critique littéraire et spécialiste de la littérature médiévale, dont Denoël publiera en 1943 Le Sang français, inaugure dans Le Matin une série d'articles antisémites qui lui seront comptés à la Libération. Il achèvera de se rendre insupportable aux yeux du CNÉ en publiant plusieurs articles anti-communistes dont le premier, paru dans Le Matin du 21 février 1942, porte le titre : « Pourquoi je hais le communisme ».


Le Matin, 11 et 15 octobre 1940
Le 12 : George Montandon écrit à Léon de Poncins [1897-1976] qu'une « brochure » lui est réservée et qu' «un certain Denoël » souhaiterait qu'il écrivît un article sur les juifs. Tel est le résumé ambigu d'une lettre conservée dans les archives du Centre de Documentation Juive Contemporaine, fonds George Montandon.
Montandon veut-il dire à de Poncins que Denoël lui a demandé un texte à publier dans sa collection « Les Juifs en France » (Comment reconnaître le juif ? sortira de presse deux mois plus tard), ou que Denoël lui a demandé de solliciter de Poncins pour cette même collection ?
De Poncins avait, en effet, sa place dans la collection « d'intérêt national » que préparait Denoël. En 1932 il avait publié Les Juifs, maîtres du monde et, quatre ans plus tard, La mystérieuse Internationale juive, l'un et l'autre chez Bossard. Mais on ne connaît jusqu'à présent aucun lien entre Denoël et cet auteur antisémite et anti-maçonnique.
Le 12 : Inauguration par Fernand de Brinon de l'exposition « La Franc-Maçonnerie dévoilée » au Petit Palais, organisée officiellement par Jean Marquès-Rivière et Jacques de Lesdain, directeur de L'Illustration, en réalité par l'ambassade d'Allemagne.

Le Petit Parisien, 15 octobre 1940
Les organisateurs annoncent un million de visiteurs à Paris, entre octobre et novembre 1940. L'exposition est montrée à Nancy, Bordeaux, Rouen, avant d'être présentée à Berlin au cours de l'année 1942. Le Matin insiste sur son aspect pédagogique : elle a permis d'apprendre que pas moins de 126 Lévy étaient inscrits au Grand Orient de France, rue Cadet.
Le 15 : Denoël est convoqué dans les bureaux de la Gestapo, avenue Foch, où, selon Auguste Picq, « il fut mis en demeure de publier autant d’ouvrages allemands ou pro-allemands, qu’il en avait publiés d’anti-allemands, s’il voulait conserver sa liberté. »
Le comptable ignore quels furent les termes du « contrat », mais il assure
que « les Editions Denoël qui avaient publié soixante-six ouvrages
anti-allemands, n’en publièrent que sept à la convenance
des Allemands ». Picq n'a pas précisé lesquels, et je regrette aujourd'hui d'avoir renoncé, considérant son âge et son état de santé, à lui demander de me les indiquer formellement.
Le même jour, levée des scellés chez Denoël. Bagatelles pour un massacre et L’Ecole des cadavres sont remis en vente, avec de nouvelles bandes-annonces.
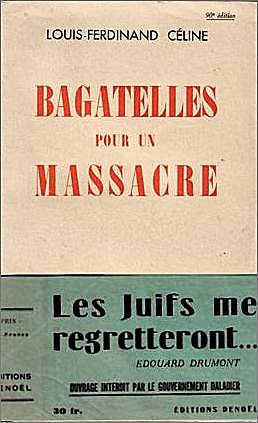
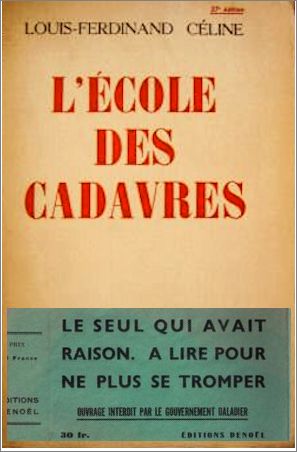
René Barjavel, mobilisé en septembre 1939 comme caporal d'intendance dans un régiment de zouaves et qui, après l'armistice, s'est installé dans les Pyrénées avec sa famille, rentre à Paris et reprend son travail rue Amélie.
Le 19 : Premier numéro du Cri du peuple, quotidien de Jacques Doriot et organe officiel du Parti Populaire Français. La plupart des journaux publient et commentent le texte de la loi sur le statut des juifs publiée la veille au Journal Officiel.

Si le commentaire du Matin reste assez neutre [« Israël est désormais exclu de toute fonction publique »], à Paris-Soir qui tire alors à 900 000 exemplaires, les rédacteurs appointés par la Propaganda Staffel ne se brident pas dans leurs titres et sous-titres : « L'épuration commence... Les juifs enfin chassés de toutes les fonctions publiques de la Nation ».


Le Matin, 1er novembre 1940
Les petits commerces devront bientôt afficher à l'intérieur de leurs vitrines des pancartes jaunes portant, en caractères noirs : « Entreprise juive ». Si l'un des associés, comme ci-dessus, n'est pas israélite, une mention spéciale pourra être apposée : « Maison française » ou « Catholique ». D'emblée certains journaux déplorent que les commerçants juifs rusent avec la nouvelle réglementation : ou bien ils placardent l'affichette de manière peu apparente, ou bien ils retirent la plaque commerciale « à consonnance sémite » de leur devanture pour travailler en appartement.
Le 21 : Réouverture des Editions Corrêa. Le 24 mai, Edmond Buchet avait quitté Paris et rejoint la Suisse, son pays d'origine. En juin les Allemands avaient, comme pour d'autres maisons d'édition, posé les scellés sur l'immeuble du boulevard Montparnasse.
C'est son associé Jean Chastel qui, resté à Paris, a reçu les autorités d'occupation et obtenu la levée des scellés, « sans prendre aucun engagement », écrit Buchet. La réouverture de la maison d'édition est conditionnée par la mise au pilon sans indemnités de onze titres :
« Aussi longtemps que nous pourrons exercer notre profession dignement, nous l'exercerons ; elle est plus que jamais utile. Au moment où l'on voit déjà tant d'éditeurs incliner vers la collaboration, il est bon qu'il y en ait qui restent au-dessus de la politique et continuent à fournir aux esprits, presque aussi affamés que les ventres, leur nourriture [...]
Dans tous les cas, nous nous promettons de n'éditer sous l'occupation que des livres que nous aurions publiés sous un régime libre. Si les Allemands voulaient nous forcer à faire autrement, nous fermerions la maison. »
On peut croire que les Editions Corrêa ont respecté ce programme puisque, dès le 19 novembre 1944, elles font partie du groupement « Pour le Livre » composés d'éditeurs « restés dignes durant l'Occupation » tels que Seghers, les Editions de Minuit, Raymond Durand-Auzias, Hartmann, Emile-Paul, et quelques autres.
Mais, « sous un régime libre », Buchet aurait-il vraiment publié les Œuvres de Wagner [1941], Révolte dans la montagne de Conrad Meyer [1942], Flammes de Siegfried Wolf [1943], et une biographie de Goethe par John Charpentier [1943] ?
Le 22 : Gaston Gallimard, qui s’était replié à Carcassonne chez Joë Bousquet, rentre à Paris. Le lendemain c'est Bernard Grasset qui rouvre sa maison :
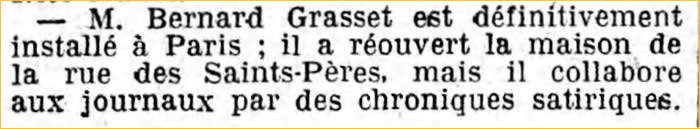
Le Figaro, 26 octobre 1940
Le 24 : Entrevue Hitler-Pétain à Montoire.
Le 25 : Les Allemands se présentent avec un camion au siège des Editions Corrêa, 166 boulevard de Montparnasse, pour emporter les ouvrages qui figurent sur la liste Otto : « Nous en avons une quinzaine », écrit Edmond Buchet. Les différentes listes Otto diffusées à partir de septembre 1940 et jusqu'en 1943 n'en mentionnent que dix chez Corrêa.
Buchet cite aussi des ouvrages de Benda et Maurois, et l'entièreté du tirage de Chez l'armée anglaise de Blaise Cendrars, « qui n'a pas eu le temps de sortir ». Il est vrai que tous les ouvrages de Benda et Maurois, auteurs juifs, ont été interdits durant l'Occupation, et que celui de Cendrars ne devait pas figurer sur les listes d'interdiction puisqu'il n'avait pas circulé.
Le 26 : Sous le titre « L'Edition à Paris », Le Figaro annonce les nouvelles parutions des principaux éditeurs parisiens : Calmann-Lévy, Connard, Gallimard, Plon, Stock, Editions de France. A côté d'ouvrages classiques, on trouve de nouveaux romans chez la plupart d'entre eux.
Le nom des Editions Denoël continue de briller par son absence : comme il l'écrira le 19 décembre à Jean Rogissart, Denoël, qui a obtenu la levée des scellés rue Amélie le 15 octobre, établit « le bilan de la catastrophe. Je ne publie rien encore. » C'est dans les bureaux de son agent d'affaires qu'il prépare sa rentrée en créant une nouvelle société : les Nouvelles Editions Françaises, où paraîtront en novembre des ouvrages qui constituent sans doute le prix à payer pour conserver sa maison d'édition.
Le 30 : Discours du maréchal Pétain annonçant qu'il « entre dans la voie de la collaboration ».

Novembre
Le 1er : Premier numéro du quotidien Les Nouveaux Temps, sous la direction de Jean Luchaire, et avec l'aide financière des services d'Otto Abetz. Premier numéro du mensuel Le Réveil du peuple, dirigé par Jean Boissel. La presse annonce de nouvelles mesures relatives au recensement des juifs.

Le Figaro, 1er novembre 1940
Le 9 : Les scellés sont apposés chez Gallimard. Gaston Gallimard a refusé une prise de participation allemande dans sa société. A plusieurs reprises il sera amené à rendre visite à la Propaganda pour reprendre possession de son entreprise, et l’accord qui intervient peu après implique que la NRF sera dirigée par Drieu la Rochelle, collaborateur idéal aux yeux de l’occupant. Les scellés sont retirés début décembre, grâce à l'intervention de Drieu et du lieutenant Heller.
Le 11 : Mort à Paris de Carlos Larronde, foudroyé par une crise cardiaque à l'âge de cinquante-deux ans. Cet « idéaliste des ondes » était l'un de ces originaux qu'aimait fréquenter Robert Denoël, qui lui avait édité trois ouvrages entre 1930 et 1936.

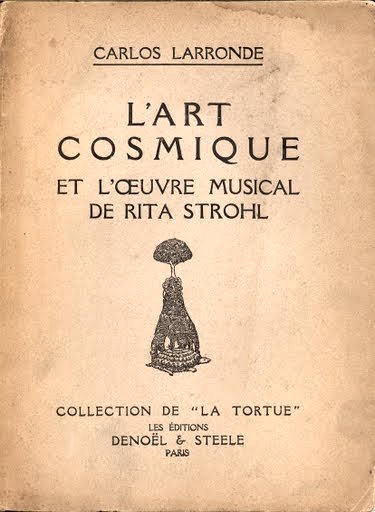
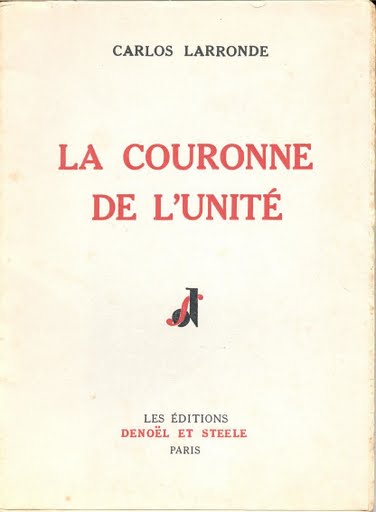
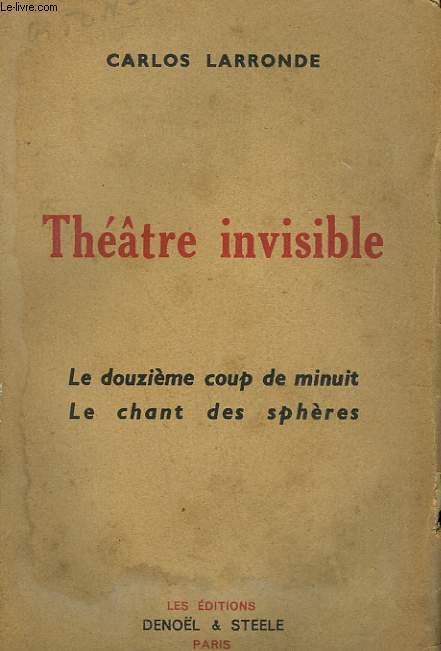
Originaire d’une vieille famille de la haute bourgeoisie bordelaise, né le 15 septembre 1888, Larronde, bohème et cultivé, fut journaliste sportif, radio-reporter, producteur de radio. En 1913 il avait fondé le «Théâtre Idéaliste », fait amitié avec Milosz avec qui il fonda le Centre Apostolique, qui transforma la maison de Balzac pour en faire un musée, dont Larronde fut nommé conservateur.
Durant la Grande Guerre il fit partie du groupe des amis de Milosz qui fonda le cercle « Les Veilleurs » : société initiatique, co-maçonnique, ésotérique, théosophique, alchimique. Son fils Olivier fut, en 1943, l'ami de cœur de Jean Genet.
Le 15 : La maison Albin Michel est autorisée à reprendre ses activités. Bernard Grasset publie la première brochure de sa nouvelle collection « A la recherche de la France », dans laquelle il « étudie les causes de la défaite et suggère les disciplines nécessaires à la renaissance du pays ».
Le 20 : A 15 heures, les membres de la Société « La Publicité vivante » sont réunis en assemblée générale extraordinaire, 19 rue Amélie, sur la convocation de Robert Denoël. La réunion est « présidée par M. Denoël vu qu’il possède le plus grand nombre de parts ».
En fait, Denoël est seul en compagnie de son homme d’affaires, Georges Hagopian, puisque son beau-frère, Billy Ritchie-Fallon, a quitté la France en juin pour l’Angleterre. Le but de la réunion est de modifier la dénomination de la société : « La Publicité vivante » devient « Les Nouvelles Editions Françaises », et Robert Denoël en est nommé seul gérant.
Les 50 parts restent attribuées comme précédemment, à savoir : 32 parts pour Denoël, 18 parts pour Billy Ritchie-Fallon. L’adresse du siège social est toujours : 19, rue Amélie.
On peut s'interroger sur le choix d'une dénomination aussi anodine, qui n'est annoncée nulle part ailleurs qu'au Registre du Commerce. Denoël, manifestement, ne cherche pas à faire la moindre publicité à cette maison-croupion accolée à la sienne et qui, sans doute, n'a pas pavillon sur rue. Bien plus, les NEF restent domiciliées, comme la société qu'elles remplacent, au 19 rue Amélie. Ce n'est qu'en janvier 1941, lors d'une modification de l'acte de constitution de la société, qu'elles sont déplacées au 21 - par une simple correction manuscrite, non signalée au Registre du Commerce. Mais il est avéré par Auguste Picq, le comptable, que les volumes étaient bien entreposés au 21.
Le sigle « NEF », qui se retourne aisément (Editions Françaises Nouvelles), a servi maintes fois pour des publications aussi diverses que non compromettantes : poésie, théâtre, art, radiophonie, tant à Paris qu'en province.
On le trouve au 24 rue de Gramont en 1909, au 7 rue Boissonnade (XIVe) en 1928, au 35 rue du Rocher (VIIIe) en 1929, au 47 bis rue des Saints-Pères en 1934, à Clermont-Ferrand en 1942...
L'éditeur choisit donc une enseigne passe-partout qui, dans un premier temps, remet en vente deux livres pour enfants publiés initialement en 1933 par Denoël et Steele, avant de publier deux opuscules antisémites à la fin du mois.
Le 23 : Antonin Artaud, enfermé depuis le mois de février 1939 à l'hôpital psychiatrique de Ville-Evrard, écrit à Cécile Denoël : « Vous abstenir plus longtemps de venir me voir quand vous savez l'urgence essentielle qu'il y a à me soulager serait un crime, quelques agressions, sollicitations ou obstacles que vous puissiez rencontrer dans l'accomplissement de ce devoir. Robert Denoël est mort aujourd'hui vers midi pour avoir ' douté ' qu'il ne faille me soulager et pour s'être refusé à le faire quand il en avait le moyen et c'est le Mal qui l'y a poussé. Je désespérerai de votre salut si vous ne réussissiez à venir me voir demain. »
Le 23 : Guillaume Ritchie-Fallon cède à Auguste Picq, comptable des Editions Denoël, les 18 parts qu’il détient dans la Société des Nouvelles Editions Françaises, moyennant la somme de 4 500 F, soit à 50 % de leur valeur nominale. C’est Robert Denoël qui, par procuration de son beau-frère, signe l’acte en présence de Georges Hagopian. L’adresse du siège social est toujours : 19, rue Amélie.
Auguste Picq explique que « cette société a été créée pour pallier la fermeture des Editions Denoël par les Allemands, et pour éviter que les ouvrages imposés par l’occupant paraissent sous la firme Denoël. Les Beaux Draps de Céline ont servi de faire-valoir aux N.E.F., ainsi la Propaganda Staffel n’avait rien à dire.
Au 21 rue Amélie se trouvait une boutique gérée par Robert Beauzemont qui y vendait, avant guerre, des appareils de radio de marque allemande. Beauzemont était également libraire d’ancien, boulevard Voltaire et ensuite rue du Quatre Septembre.
Nous nous servions de cette boutique qui communiquait avec les Editions Denoël et nous a permis ainsi d’y pénétrer malgré les scellés apposés aux Editions Denoël par l’occupant. On ne pouvait faire autrement que rééditer Les Beaux Draps aux N.E.F. puisque le copyright avait été pris pour cette firme, et que les bons de papier nous étaient délivrés au nom des N.E.F., dont l’activité était des plus réduites. »
Sur la constitution de cette s.a.r.l. : « Il n’y avait que des Français dont le Dr Percheron, moi-même et peut-être un autre dont je ne me souviens plus. »
Picq anticipe un peu : Maurice Percheron n’est entré dans cette société qu’en 1944, en même temps qu’Albert Morys. Quant à Robert Beauzemont, son nom apparaît dans les répertoires du Syndicat de la Librairie Ancienne et Moderne à partir de 1944 [26, boulevard Voltaire, XIe] ; en 1959, sa librairie est domiciliée 20, rue du Quatre-Septembre, dans le IIe arrondissement. Ses spécialités sont : « Editions originales, Livres illustrés du XVIIIe siècle, Livres romantiques, Livres illustrés modernes ». Il paraît avoir cessé ses activités en 1967.
On peut se demander pourquoi Denoël n’utilise pas les Trois Magots pour publier les ouvrages qui lui sont imposés par l’Occupant. Mais il y a l’éloignement de l’avenue de La Bourdonnais, quand le « 21 » de la rue Amélie est si commode pour stocker les volumes, et, d’autre part, il semble que cette société se soit trouvée en déconfiture au moment de la déclaration de guerre, si l’on se rapporte au bilan des Editions Denoël établi par Picq le 15 juin 1941, où la « Librairie 60 avenue de La Bourdonnais » se retrouve dans le passif à hauteur de 203.474,35 francs.
Morys écrit : « Cécile avait interdit à Robert d'éditer Les Beaux Draps et celui-ci fonda ‘ en catimini ’ une autre maison d'édition : " Les Nouvelles Editions Françaises " et, ne pouvant utiliser l'argent des Editions Denoël, fit appel à des fonds étrangers, à l'insu de sa femme, par une association avec une certaine Veuve Constant. Cécile ne l'apprit que bien après l'assassinat de son mari. »
On peut douter de cette assertion, puisque Denoël avait précisément choisi Morys pour s’occuper activement des N.E.F. Le 14 février 1941, c’est lui qui envoie à la presse le « prière d’insérer » des Beaux Draps, accompagné d’une lettre qu’il signe du titre de « Secrétaire Général ».
Interrogé à ce sujet, Morys répondait : « Mon rôle rue Amélie ? Aucun. Je n'y allais que très rarement. Je voyais Denoël chez lui et un peu partout mais pratiquement jamais aux Éditions. Sur le plan matériel, je composais des couvertures de livres, préparais des mises en pages, faisais de la technique, des recherches à la Bibliothèque Nationale, etc. Mais ce qui comptait réellement dans l'amitié qui nous liait, Robert Denoël et moi, se passait sur le plan psychique. Ceux de ses auteurs ou de ses amis qui remarquaient ma présence auprès de lui disaient que j'étais son ombre. (Le mot est de Philippe Hériat, mais repris par Cocteau, Louise Hervieu, Vialar et bien d'autres).
Il avait, comme beaucoup de gens en vue, à se méfier de tout le monde. Je puis dire que je fus certainement le seul ami sur lequel il savait pouvoir s'appuyer sans hésitation, comme le faisaient également sa femme et son fils. Sauf lorsque mon métier exigeant m'en empêchait, j'étais toujours présent lorsqu'il le souhaitait à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit.
Dès le premier instant de notre rencontre, un véritable amour me lia à Robert, à Cécile et à leur fils. Denoël avait besoin de moi comme d'un talisman. En réalité, je lui servais de ‘chambre de réflexion’ : lorsqu'un problème d'une certaine importance le tourmentait, sur quelque plan que ce soit, même le plus intime, il me le confiait et cela lui permettait d'en trouver la solution la meilleure sans que j'aie à lui donner mon sentiment, sans que j'aie à dire le moindre mot ; il m'arrivait seulement parfois d'éteindre mon regard. Il me parlait sans crainte, sachant que mon silence serait total... même après son passage en l'autre monde.
La présence de ma photographie sur son bureau a fait jaser bien des imbéciles en mal de ragots. Sa seule raison d'être là était d'ordre psychique. De tout ceci, je n'ai jamais parlé à quiconque et je ne pense pas qu'il l'ait fait. Seule sa femme avait compris, mais elle ne m'a jamais posé de questions qui eussent été indiscrètes, même après 1945. J'étais encore auprès de lui la veille de sa mort, nous travaillions ensemble au Bonheur du Jour. »
Sa présence chez les Denoël dut en effet faire jaser puisque Morys éprouve le besoin de s’en expliquer : « Un jour j'étais l'amant de Cécile. Le lendemain, le petit ami de Robert ! Celui-ci s'en amusait follement et il en rajoutait. Lorsque nous marchions côte à côte dans la rue et qu'il apercevait une de ces mauvaises langues, il me prenait ‘tendrement’ par la taille et se penchait vers moi pour me parler à l'oreille. Ce qui ne laissait aucun doute à personne ! J'étais alors vraiment joli garçon et faisais des ravages tant dans le cœur des dames que dans celui de certains messieurs en refusant de comprendre leurs désirs », écrit-il.
Le 25 : Radio-Paris, qui offre à ses auditeurs des prix quand ils identifient les citations qui leur sont proposées, a choisi dans son émission de la veille une phrase extraite de L'Ecole des cadavres. On trouve la réponse dans Le Matin et dans Le Petit Parisien :
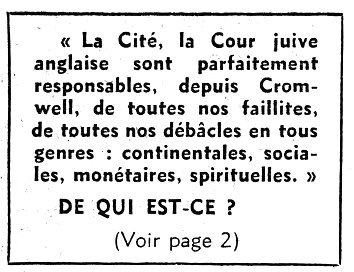

Le Matin et Le Petit Parisien, 24 et 25 novembre 1940
En fin du mois paraît aux Nouvelles Editions Françaises le premier volume de la collection « Les Juifs en France » : Comment reconnaître le Juif ? par George Montandon, suivi, peu après, par celui du docteur Fernand Querrioux : La Médecine et les juifs.
Le Nouveau Journal de Bruxelles, annonçant le second dans son numéro du 7 février 1941, mentionne par erreur une préface de Louis-Ferdinand Céline, erreur qu'il corrige dans son numéro du 21 février. Curieusement, Cassandre, autre hebdomadaire bruxellois, commettra la même erreur dans son numéro du 16 février.
Tous les titres de cette collection - quatre en tout - seront répertoriés par les services allemands de Wintermayer dans la catégorie « Littérature active », c’est-à-dire directement axés sur la propagande ou influencés par la Propaganda Staffel, rubrique : « Littérature anti-juive ».

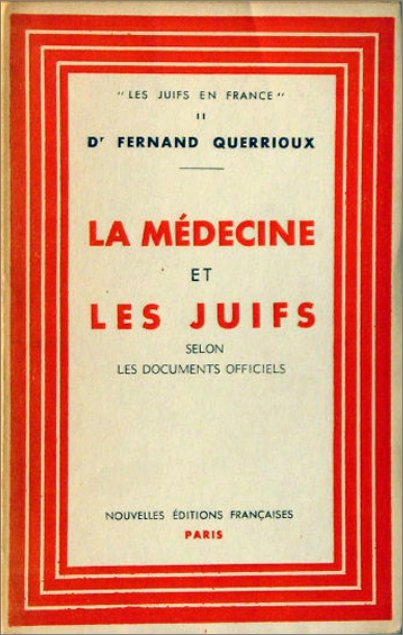
Dans le même esprit Bernard Grasset lance les premiers titres de sa collection « A la recherche de la France », favorable à la ligne tracée par Vichy et la Propaganda, signés de Jacques Chardonne, Bernard Faÿ, Alphonse de Châteaubriant, Drieu la Rochelle, Paul Morand, Abel Bonnard.
Est-ce que ces collections encouragées ou imposées par l'occupant avaient le succès escompté ? Les éditeurs obtenaient-ils des comptes rendus favorables dans les organes de presse acquis à la collaboration ? En cour de justice, Robert Denoël dira qu'il a abandonné sa collection antisémite « en voyant les mesures prises contre les Juifs » mais aussi, sans doute, en raison de son peu de succès : un an après leur parution, les ventes des quatre volumes « plafonnaient » en moyenne à 3 000 exemplaires.
Action antijuive, le bulletin de presse de l'Institut d'étude des Questions juives, ne signalait celui de Montandon que dans son numéro du 29 mai 1941, soit six mois après sa sortie de presse. A côté de ce compte rendu tardif, l'auteur avait écrit en marge de l'article : « Ils se réveillent ! » [document CDJC].
Décembre
Le 1er : Sortie du film de Veit Harlan, « Le Juif Süss » sur les écrans parisiens, projeté pour la première fois en Allemagne le 24 septembre 1940. Dans sa chronique cinématographique du Petit Parisien Lucien Rebatet (qui signe François Vinneuil) le qualifie d' « œuvre saisissante et forte, dont l'intérêt dramatique empoigne dès le début le spectateur et ne se dément pas un seul instant. » (2 mars 1941).
Ce film de propagande était l'antithèse de celui qu'avaient pu voir les Parisiens en 1934, dû à Lothar Mendes, qui était une satire de l'antisémitisme national-socialiste.
Le même jour Le Matin, qui se demande ce que devient le cinéma français, annonce qu'on tourne bien entre Nice et Marseille, mais « nos vedettes brûlent d'envie de rentrer à Paris » : Max Dearly, Raimu, Fernandel, Viviane Romance, « attendent que les producteurs de la capitale leur fassent signe. »

© Roger-Viollet
Le 2 : Réouverture des Editions Gallimard, et reparution de la Nouvelle Revue Française, sous la direction de Pierre Drieu la Rochelle. « Plus nouvelle que française », disait-on dès cette époque.

Le Figaro, 21 décembre 1940
Le 4 : Raymond Durand-Auzias est nommé administrateur provisoire des Editions Ferenczi, dont les propriétaires sont juifs.
Le 6 : L'expédition des livres de la zone occupée à la zone libre, interrompue depuis l'armistice, est rétablie.
Le 8 : Camille Mauclair [1872-1945] qui, depuis quelques années, vitupère l'art « dégénéré » en France, consacre un article incendiaire aux « gangsters de la peinture » :

Le Matin, 8 décembre 1940
« Sous prétexte de modernisme, d'originalité, d'indépendance, ce qui s'est appelé l'Art vivant a été depuis 1920 une entreprise juive, liée à une entreprise révolutionnaire pour démolir la tradition française qualifiée de " goût bourgeois " », écrit-il, avant de passer en revue tous les mercantis qui foisonnent dans ce milieu :
« Les grands marchands juifs : Wildenstein, Bernheim, Hessel, Rosenberg, avec les Vollard et Paul Guillaume (non-juifs mais dignes de l'être) devaient, pour réussir leur coup : 1° faire place sur le marché pictural en ruinant la cote d'artistes sérieux par des manœuvres de baisse boursière ; 2° réunir de gros stocks en faisant surproduire certains peintres en série ; 3° caser dans la presse les propagandistes d'une violente réclame publicitaire ; 4° intéresser à l'entreprise des femmes d'affaires, des fonctionnaires et des politiciens. »
Ces buts, écrit Mauclair, ont été atteints grâce à des critiques d'art qui n'étaient que des courtiers déguisés et incompétents : les juifs Mayer dit Vauxcelles, René Jean, André Salmon, Florent Fels, Claude Roger-Marx, le juif polonais Waldémar George, le juif autrichien Basler, lesquels servaient l'entreprise de concert avec quelques non-juifs, comme le Belge Fierens, les Suisses Fosca et Jeanneret dit Le Corbusier ; les ex-anarchistes Fénéon, Tabarant, Francis Jourdain ; le communiste Jean Cassou, agent bolchéviste en Espagne rouge, protégé par Jean Zay...
« Tels étaient les principaux séides du syndicat juif dont ils vantaient la marchandise, sous le couvert des grands impressionnistes, de Van Gogh, de Gauguin, de Cézanne. » Et ces marchands avaient tous élu domicile à Montparnasse, « où pullulaient les métèques amoraux apatrides et ratés internationaux. »
Ils pouvaient aussi compter sur les démolisseurs sociaux, ceux qui avaient inventé l'art de gauche et qui s'agitaient à la Maison de la Culture et à l'Association des artistes et écrivains révolutionnaires, tels André Lhote, Cassou, Aragon ou Jean-Richard Bloch, aux beaux temps du Front populaire, sous la protection Blum - Zay - Huisman, triplement juive.
Ces nouveaux maîtres du marché ont bénéficié de l'inertie de l'opinion, de la sottise des snobs, de l'avidité des faux amateurs achetant pour revendre, et traitant la peinture comme une valeur d'investissement : « Il était inévitable qu'une telle inflation fût suivie d'un krach. La crise européenne l'a amené. La tapageuse exposition de 1937 au Petit-Palais, faite pour le triomphe mercantile, n'a pu en déguiser la chute financière et aussi morale, car beaucoup de jeunes artistes se sont sentis trompés par des sophistes et indignés de la tyrannie des chambardeurs et des juifs. »
Après une telle charge, le lecteur pouvait s'attendre à ce que Mauclair préconisât des mesures pour assainir l'art français, mais il se contente, pour cette fois, d'écrire : « Il faut que la mafia que fut cette franc-maçonnerie pseudo-artistique se parant du titre d'Art vivant ne puisse nuire. »
Certes Camille Mauclair l'écrivait déjà en 1929 dans La Farce de l'Art vivant, mais, après six mois d'occupation allemande et la promulgation régulière de lois antijuives de plus en plus contraignantes, ses propos outranciers risquaient fort d'avoir d'autres conséquences pour les personnes nommément désignées.
Dans la presse parisienne, on ne se formalise guère de ses nouvelles élucubrations : « Grâces soient rendues à notre contempteur : parmi les maux de la défaite, la sottise serait intolérable mais M. Mauclair a le tact de la rendre gaie. » [« M. Mauclair amuse Paris », Le Figaro, 4 janvier 1941].
Le 12, Denoël écrit à Jean Rogissart : « Depuis que je suis rentré dans ma maison, le 15 octobre dernier, j’avais demandé partout où vous vous trouviez, personne n’avait pu me donner de vos nouvelles.
Ma maison a été fermée pendant près de quatre mois par les autorités allemandes. Tous les livres concernant la guerre, ou concernant l’Allemagne, ont été saisis et mis au pilon. C’est vous dire que le coup a été très dur pour moi.
Je suis en train de négocier actuellement, afin de trouver de nouveaux capitaux, pour repartir au début de l’année prochaine. J’espère y arriver, malgré les difficultés inouïes auxquelles on se heurte pour tout actuellement.
J’ai remué un peu la presse, en faveur du Fer et la forêt et j’ai obtenu quelques articles. Malheureusement, les résultats matériels sont faibles. Je compte vous envoyer un peu d’argent dans le courant de la semaine prochaine et reprendre des versements réguliers à partir de janvier. Est-ce que le second volume est déjà fort avancé ? Parlez-m’en dans votre prochaine lettre. La vie littéraire reprendra peu à peu ses droits et j’espère même qu’elle ira en se développant dans le courant de 41. »
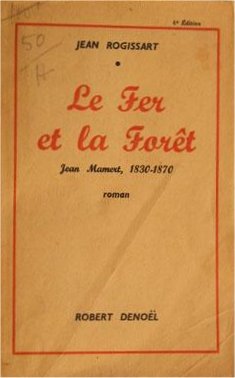
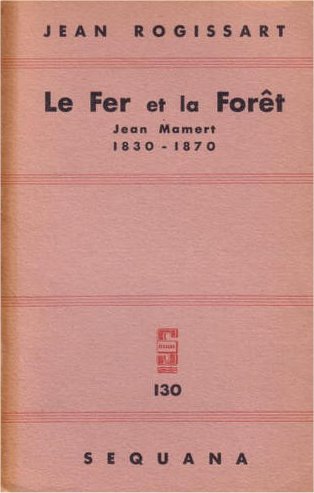
Le roman de Jean Rogissart - sélectionné par Sequana - était probablement imprimé au moment de la déclaration de guerre. De retour à Paris, en juin, Denoël a trouvé sa maison fermée par les autorités allemandes. Il a alors rejoint Auguste Picq qui, depuis le 17 juin, gérait les affaires courantes aux Trois Magots, avenue de La Bourdonnais.
C'est la raison pour laquelle il met le livre en vente à l'enseigne « Robert Denoël, éditeur », dont l'adresse est celle de la librairie de ses débuts. La première « relance » commerciale du livre de Rogissart paraît le 7 novembre dans Le Petit Parisien.
Le 14 : Edouard Aubanel donne au Figaro une interview à propos de la « renaissance de l'édition » : « Je crois qu'elle est en bonne voie », explique l'éditeur avignonnais, dont les activités se multiplient depuis la fin des hostilités du fait de la « décentralisation littéraire ». Et de citer les projets éditoriaux de plusieurs écrivains qui se sont installés en zone non occupée. L'éditeur algérois Edmond Charlot ne donne pas d'interview mais les annonces de livres nouveaux qu'il publie dans le même journal témoignent de sa récente bonne fortune.
Le 19, lettre-bilan de Denoël à Rogissart : « Voilà une triste année en effet ! Et si je regarde autour de moi, je ne vois que deuils, ruines, séparations, gêne, atmosphère presque irrespirable. J’ai perdu un collaborateur, un ami, presque un fils : François Dallet, tué le 6 juin à Soissons au moment où il conduisait un camarade blessé à l’ambulance. La confirmation officielle est arrivée il y a quelques jours.
Je n’ai aucune nouvelle de ma famille depuis le mois d’août. Mes cinq frères s’étaient engagés : j’en ai rencontré deux dans l’affreuse débandade sur les routes. Je sais qu’ils ont pu regagner Liège mais c’est tout. Mon jeune beau-frère est en Angleterre et je suis aussi sans nouvelles. Heureusement, ma femme et mon fils sont avec moi.
Rue Amélie, c’est la maison du silence. Toute l’activité d’autrefois a disparu. Les quelques personnes qui travaillent, font des inventaires, chiffrent, établissent le bilan de la catastrophe. Je ne publie rien encore. Tout le monde vit au ralenti. Les échanges sont rendus très difficiles par la difficulté des transports. Mes meilleurs amis ne sont pas encore rentrés. On ne voit pour ainsi dire personne.
La vie littéraire est comme morte, je veux dire ce qui en faisait la régularité, l’agrément. Il est difficile de se passionner pour les œuvres d’art en un moment où la hantise alimentaire domine tout. Les gens sont transis dans leur chair et dans leur esprit. On ne sait pas ce qu’ils espèrent si l’on sait ce qu’ils redoutent !
Mais malgré tout le poids de cette misère, je ne veux pas désespérer. Je sais que cette situation ne peut plus se prolonger fort longtemps. La fin de l’hiver marquera sans doute le point culminant. Je veux croire à une paix prochaine et à l’édification, lente certes, pleine d’incertitudes et de remous, mais à l’édification d’un monde nouveau où vous aurez, où nous aurons notre place.
Je suis persuadé que cet incroyable brassement de matière humaine, auquel nous assistons avec une sorte de stupeur, prépare quelque chose d’autre, imparfait sans doute, mais supérieur à notre décomposition de ces dernières années. J’ai confiance à travers tout.
Vous avez bien raison de continuer Jean Mamert et j’admire votre courage dans cette épreuve. Le travail littéraire peut vous être d’un grand secours, vous aider à passer cette période douloureuse. Et je suis sûr que le second volume ira loin. Vous savez en quelle estime je tiens le premier et quel immense progrès il marquait sur Mervale.
Je vais écrire aux journaux que vous me signalez. Vous seriez très aimable aussi de me dresser une liste des journalistes de province qui ont repris leur rubrique littéraire. Je manque de renseignements à ce sujet. Je vous ai envoyé cinq cents francs. J’espère faire le double en janvier. Et continuer en février et dans la suite.
Pour le moment, je négocie en vue d’obtenir des capitaux, les capitaux indispensables à une reprise sérieuse de mon activité : c’est difficile, mais je crois que je vais arriver au résultat voulu dans le courant de janvier.
Je pense pour Mervale à une transformation des retours, c’est-à-dire à changer la couverture, à rogner les exemplaires et à les remettre en vente à un prix de 10 francs, par exemple. Je vous envoie Les Chasses de novembre [de René Laporte] que j’avais transformées de la sorte et dont les bouillons se sont bien vendus.
Voulez-vous demander à votre fils de me faire un petit dessin, selon le procédé employé pour ce livre ? La couverture sera naturellement identique comme couleur et aspect général au modèle que je vous envoie. »
Le 20 : Réouverture des Editions Sorlot, rue Servandoni, où un administrateur provisoire avait été nommé le 11 novembre. Fernand Sorlot a obtenu son départ et la réouverture de sa maison en acceptant, deux semaines plus tôt, de signer la convention de censure du 28 septembre. L'éditeur avait à se faire pardonner des publications anti-allemandes d'avant-guerre, notamment Mein Kampf en 1934.
Firmin-Didot annonce la réédition de l'Essai sur l'inégalité des races du comte de Gobineau : « Il est superflu d'insister sur l'intérêt actuel de ces deux volumes, traduits et commentés avec passion dans toute l'Europe, sauf dans la patrie de leur auteur... », écrit Le Matin.
Le 27 : Raymond Durand-Auzias est nommé administrateur provisoire de la Librairie Fernand Nathan, dont le propriétaire, Fernand Cahen dit Nathan, sera prié de donner, en avril 1941, sa démission du Syndicat des Editeurs, et dont tous les associés sont juifs.
Le 27 : Denoël, qui adresse des encouragements littéraires à Rogissart, a aussi été sensible à son offre de ravitaillement : « Le ravitaillement ici est fort pénible et je vous serais très reconnaissant de préparer immédiatement le plus grand nombre de provisions que vous pourrez trouver et que quelqu’un de la maison ira chercher sur place jeudi prochain.
Je vous enverrai mon commis, Marcel, que vous n’avez peut-être pas connu, car il était à la guerre lors de votre dernier passage. Il fera sur place des expéditions en colis postaux et ramènera avec lui tout ce que vous pourrez trouver, aussi bien comme volailles, jambons, haricots, fromages de chèvres, etc. Dès que nous aurons reçu votre lettre d’accord, il partira.
Il pourrait être à Parthenay jeudi prochain, par exemple, et revenir le vendredi. Ces envois seront répartis entre les collaborateurs de la maison, qui vous sauront gré de votre proposition magnanime. Si vous trouvez de temps en temps une livre de beurre, vous pouvez me l’envoyer par la poste, dans une petite boîte de bois ou de métal, avec la mention " provision ". Cela m’arrivera sans aucune difficulté. »
Outre Jean Rogissart, Denoël a pu compter ensuite sur Jean Proal et Urbain Brousté, pour le ravitaillement.
Le 28 : Denoël adresse au Crédit National une demande de prêt d’un million de francs, offrant en garantie son stock évalué au prix de vente aux libraires à 5.251.691,95 F, soit 45 % du prix de vente au public. Son programme d’édition est nettement tourné vers des ouvrages « patriotiques ».
La plupart des prix littéraires [Goncourt, Renaudot, Femina, Interallié] ne sont pas attribués. Les prix Goncourt et Renaudot 1940 seront décernés le 24 juin 1946.
*
Au terme de cette année funeste, et en ne considérant que Gallimard, Grasset et Denoël, on peut se poser la question : ces éditeurs ont-ils dû payer le prix fort pour rouvrir leur maison d'édition, le premier en acceptant Drieu la Rochelle pour diriger la NRF, le deuxième en publiant sa collection « A la recherche de la France », le troisième en éditant celle des « Juifs en France » ?
On a beau observer que la NRF est restée la revue de référence durant toute l'Occupation, que certains titres de la collection publiée par Grasset ont atteint les 5 000 exemplaires, alors que les petits volumes des Nouvelles Editions Françaises - maison créée pour la circonstance et vite disparue - ne dépassaient pas 3 000 exemplaires, c'est bien cette collection qui, de nos jours, est considérée comme la plus représentative de la collusion des éditeurs français avec l'autorité allemande.
Les Nouvelles Editions Françaises ont publié quatre libelles antisémites entre novembre 1940 et avril 1941. La collection « Les Juifs en France » devait, suivant l'annonce figurant au second plat des couvertures, en comporter sept. A ma connaissance, les textes annoncés n'ont pas paru chez d'autres éditeurs.
Au cours de son procès en cour de justice, le 13 juillet 1945, Robert Denoël dira que cette collection devait au départ comporter une dizaine de titres et qu’il l’a arrêtée après le quatrième volume « en voyant les mesures prises contre les Juifs ».
Les « mesures » prises contre les juifs ont débuté dès le 17 juillet 1940 [déchéance de la nationalité française pour les juifs naturalisés] et se sont poursuivies durant toute l'Occupation. Denoël fait sans doute allusion à d'autres mesures, plus brutales : les premières arrestations et déportations de juifs étrangers en région parisienne datent du début mai 1941. Et le volume de Rebatet, quatrième et dernier volume paru, fut imprimé le 5 avril 1941.
Il semble aussi que l'éditeur ait peu à peu modifié son projet et le choix des textes à publier. En comparant les annonces qui figurent en 4e de couverture des volumes, on peut voir que l'ordre des titres a été bouleversé :

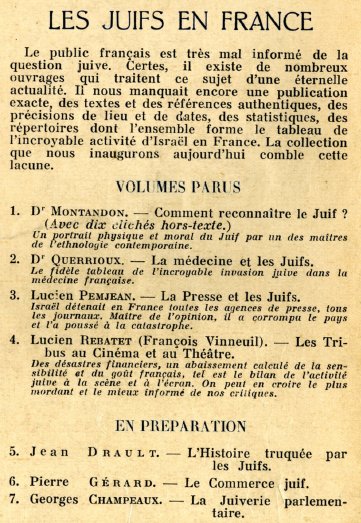
Couverture du premier volume, paru en novembre 1940, et celle des trois suivants, parus entre décembre 1940 et avril 1941
Les auteurs qui ont signé ces libelles ont probablement été sollicités par Robert Denoël en raison de leur connaissance du « dossier juif », mais l'éditeur ne pouvait imaginer quelle serait leur « carrière » durant l'Occupation et, moins encore, leur réputation sulfureuse soixante-dix ans plus tard.
George Montandon [1879-1944]

Premier titre paru en novembre 1940 : Comment reconnaître le juif ? Dans Le Droit antisémite de Vichy [1996], Dominique Gros affirme que l'auteur aurait écrit cet ouvrage sur commande de l'administration, mais il ne dit pas laquelle. Marc Knobel, lui, écrit : « Je pense plutôt qu’il s’agissait d’une initiative strictement personnelle ». Sur la page de garde du volume, un ouvrage en préparation : « L'Etnie juive ou ethnie putain », jamais paru mais dont des fragments ont été publiés dans diverses revues durant l'Occupation.
Ethnologue né le 19 avril 1879 à Cortaillod (Suisse), fils d'industriel, naturalisé français le 29 mai 1936. En mai 1938, il proposait de faire subir aux femmes juives condamnées de moins de quarante ans, une opération assez particulière qui « consisterait à les défigurer en leur coupant l’extrémité nasale car il n’est rien qui enlaidisse davantage que l’ablation, telle qu’elle se réalise spontanément par certaines maladies, de l’extrémité du nez. »
Deux ans plus tard il proposait d'étendre ce « traitement » aux actrices juives en expliquant « qu’il y aurait une modalité élégante de faire se terrer les jolies juives. Vous savez qu’il n’y a rien qui enlaidisse d’avantage une femme que de rendre béantes ses deux ouvertures nasales. Pas besoin d’opération à grand spectacle, avec assistants, narcose, etc... ! Il suffit d’un coup de pince coupante – ou d’un coup de dents. Comme nous l’avons vu un jour splendidement opérer – le danger d’hémorragie mortelle est nul. Mais la jolie juive qui devra subir la circoncision de l’appendice nasal, automatiquement ne remontrera plus sur les tréteaux… » [lettre du 13 août 1940 à un correspondant non identifié, CDJC].
En 1943 il y revient encore en proposant que l'on pratique systématiquement « une opération défigurante
pour les " belles juives " » [Le Cahier Jaune, 5 avril 1943]. Où Montandon avait-il pris cette idée incongrue et monstrueuse de défigurer les femmes ? En Ethiopie ou en Abyssinie, qu'il a parcourues avant la Grande Guerre, et où la pratique est courante ? Il s'avère qu'il a « pu constater dans un cas de cet ordre l'excellent effet d'une telle opération pratiquée par morsure » au cours de son stage de jeune médecin à la clinique universitaire de Zurich, entre 1906 et 1908.
Collaborateur actif du Cahier Jaune et de l'odieux libelle « Je vous hais ! », directeur de l’Institut d’Etudes des Questions Juives et Ethnoraciales et de L'Ethnie française, ce professeur suisse avait délivré durant toute l'Occupation des certificats d’appartenance ou de non-appartenance à la race juive (qualité qui pouvait se négocier). Il représente aujourd'hui le prototype parfait du savant dévoyé.
En 1990 un Cercle franco-hispanique – association d’extrême-droite affichant sa sympathie pour les mouvements nationalistes français et espagnols – a fait paraître un Guidargus du livre politique sous l’Occupation répertoriant les ouvrages politiques en langue française publiés officiellement sous l’Occupation, avec une courte biographie de l’auteur, un rapide descriptif du contenu, et une cote de vente.
« Pour quelle raison le professeur Montandon a-t-il été massacré ? » s'interroge le rédacteur anonyme : « à cause de son Comment reconnaître le Juif ? » dont l'édition originale se vend couramment 600 francs [120 euros] mais dont il existe des réimpressions à l'identique faites en 1990 et vendues dans des librairies d'extrême-droite parisiennes.
Blessé au cours d'un attentat chez lui à Clamart le 3 août 1944. Meurt des suites de ses blessures dans un hôpital de Fulda le 2 septembre 1944.
Fernand Querrioux [1894-1945]
Deuxième titre paru en décembre 1940 : La Médecine et les juifs. Né le 30 juillet 1894 à Saint-Pierre-les-Eglises, une petite paroisse proche de Chauvigny, dans la Vienne, le docteur Fernand Lucien Isidore Querrioux, fils de Lucien et de Marie-Louise Ponty est l'auteur d'une thèse soutenue à l'université de Bordeaux : « Gestation et néphrectomie pour bacillose ». Marié deux fois, la première en 1925 à Saint-Savin avec Maria Palfrène, la seconde à Saint-Ouen en 1931 avec Jane Dublan. Dès 1938, il collabore à La France enchaînée où il est chargé de la rubrique sur l'invasion juive dans la médecine. Membre actif de l'Institut d'études des questions juives, auteur de la partie médicale de l'exposition « Le Juif et la France », il établit dès 1941 des listes de confrères juifs indésirables et intervient auprès des autorités à propos de médecins étrangers qui exercent leur métier en dépit de la nouvelle réglementation : le docteur Querrioux s'est transformé en délateur, et ses articles parus dans le Cahier Jaune sont rétribués. Une lettre du capitaine Sézille à un commissaire de la préfecture de police, datée 17 janvier 1942, indique que Querrioux reçoit des menaces téléphoniques en raison de son attitude anti-juive et de la publication de son livre [document CDJC n° XIf - 37].
Ayant quitté la France en août 1944 pour Baden-Baden puis Sigmaringen, il serait mort en Allemagne en avril 1945 dans un convoi bombardé par l'aviation américaine - et non, comme on l'a gravé par erreur en avril 1990 [son nom a été effacé depuis] sur le monument aux morts de la Faculté de médecine de Paris, parmi les médecins assassinés à Auschwitz. Son acte d'état civil mentionne qu'il est décédé le 24 avril 1945 à Immenstadt, à proximité de la frontière suisse.
Lucien Pemjean [1861-1945]
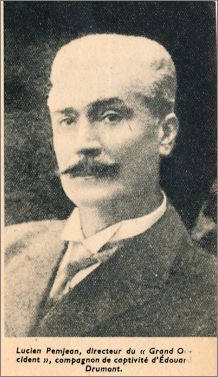
Troisième titre paru en mars 1941 : La Presse et les juifs. Ce vieil anarchiste rallié à Edouard Drumont durant l'Affaire Dreyfus fut directeur littéraire des Editions Baudinière au cours des années vingt, fondateur de la revue Grand Occident qui, entre 1934 et 1939, dénonçait les juifs et les francs-maçons, et collaborateur du Pilori entre 1941 et 1944. Ami proche de Jean Boissel. Dans son Journal à la date du 10 février 1941, Jean Galtier-Boissière le décrit comme un « très vieux monsieur, mis à la mode de 1890 », et assure qu'il aurait inventé la francisque et trouvé le slogan fameux : « C'est Pétain qu'il nous faut ». Dans Phénix ou Cendres [1942] Bernard Payr commente longuement l'opuscule de Pemjean qui « donne un aperçu impressionnant du développement et de l'ampleur de l'enjuivement de la presse française ». Arrêté le 20 août 1944 par des FFI. Meurt à l'hôpital le 10 janvier 1945.
Lucien Rebatet [1903-1972]
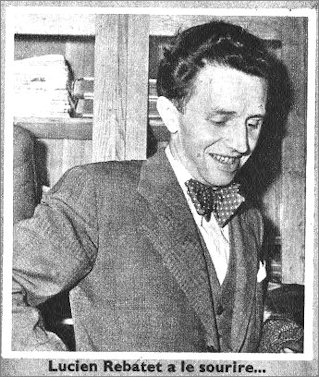
Quatrième titre paru le 5 avril 1941 : Les Tribus du cinéma et du théâtre. Journaliste antijuif à Je suis partout et auteur des Décombres, le livre à succès de l'Occupation, Lucien Rebatet, qui signait ses chroniques théâtrales, cinématographiques et musicales du pseudonyme de François Vinneuil (ce qu'a rappelé Denoël sur la couverture de son livre), n'est plus à présenter. Il personnifie la collaboration intellectuelle avec l'occupant. Son petit livre peut être considéré comme un morceau détaché de ses Décombres en gestation à la même époque : c'est le même style, documentation en prime. Mort le 24 août 1972 à Moras-en-Valloire, où il était né le 15 novembre 1903.
Il n'est peut-être pas inutile de s'intéresser aux trois autres auteurs sollicités par Denoël pour figurer dans sa collection « d'intérêt national » :
Jean Drault [1866-1951]

Cinquième titre annoncé et non paru : « L'Histoire truquée par les juifs ». Né Alfred Gendrot, doyen des journalistes antisémites, auteur de romans militaires humoristiques [Le Soldat Chapuzot], et d'une Histoire de l'antisémitisme [1941], président d'honneur de l'Association des journalistes antijuifs en 1942 ; dirige La France au travail en 1940 et Au Pilori à partir de 1943. Arrêté chez lui en septembre 1944. Condamné en novembre 1946 à sept ans de réclusion et à la confiscation de ses biens - peine commuée en décembre 1947 à cinq ans de réclusion. Libéré en 1949. Meurt le 11 septembre 1951.
Pierre Gérard [Paris 24 mai 1915 - ?]
Sixième titre annoncé et non paru : « Le Commerce juif » qui, à l'origine, s'intitulait : « De la rue des Rosiers aux Champs-Elysées ou le Commerce juif ». L'auteur fait partie, dès mai 1937, du Rassemblement antijuif de France de Louis Darquier de Pellepoix, où il publie Le Juif... notre maître, l'année suivante. Pierre Gérard est condamné, le 26 juillet 1939, à un mois de prison et à 500 francs d'amende pour un article publié dans La France enchaînée, au titre du décret-loi Marchandeau. Attaché à l'Institut d'études des questions juives entre 1941 et 1943. En janvier 1943, il était adjoint au Cabinet du Commissariat Général aux Questions Juives, ensuite directeur de la propagande. Secrétaire général de l'Union Française pour la Défense de la Race, une association créée le 7 février 1943 par le même Darquier. Auteur d'une brochure de 48 pages publiée en 1943 par les Editions CEA : Les Juifs et la guerre. Condamné à l'indignité nationale au procès du CGQJ, qui eut lieu du 7 au 11 juillet 1949.
Georges Champeaux
Septième titre annoncé et non paru : « La Juiverie parlementaire ». Ancien combattant, ami lyonnais de Lucien Rebatet, quitte le parti communiste en 1923, journaliste à Gringoire et à L'Assaut avant la guerre, critique de cinéma au Cri du peuple ; critique, sous le pseudonyme de Georges Devaise, les disques nouveaux à Je suis partout à la fin de l'Occupation. Auteur de La Croisade des démocraties publié en 1941 et 1943 aux Editions Inter-France de Dominique Sordet. Jean Quéval le qualifie de « cabochard, sympathique, un cœur en or, intellectuel sans doute mais Français moyen plus encore, et personnage de Courteline par son franc-parler ».