Commentaires
Le 28 juillet 1950, la Chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue le 6 juillet précédent par Ferdinand Gollety, magistrat instructeur en charge du dossier de l’instruction du meurtre de Robert Denoël.
On appelle non-lieu l'abandon d'une action judiciaire en cours de procédure. En France, il est prononcé par le juge d’instruction, lorsque les éléments rassemblés par l'enquête de police ne justifient pas de prolonger plus longtemps les investigations.
L’action de la justice française s'est éteinte il y a cinquante-huit ans. Qui voudrait relancer l'instruction devrait apporter des éléments nouveaux justifiant que la Cour de Cassation en ordonnât la réouverture.
Je me suis donc tenu strictement à commenter les différentes enquêtes de la Brigade Criminelle puis de la Police Judiciaire, et les investigations menées par Cécile Denoël, partie civile, et son avocat, Armand Rozelaar.
*
La première enquête, menée durant moins de deux mois par la Brigade Criminelle, fut incontestablement bâclée. Ses inspecteurs considérèrent apparemment cette affaire comme un simple fait divers : des rôdeurs, nombreux à cet endroit, avaient agressé un homme qui réparait le pneu de sa voiture, et l’avaient abattu alors qu’il cherchait à se défendre. Son portefeuille n’avait pas été délesté des 12 000 francs qu’il contenait parce que deux passants étaient arrivés inopinément sur les lieux.
L’inspecteur Ducourthial, qui menait l’enquête, avait bien trouvé « bizarre » la disparition rapide des malfaiteurs, mais ni la personnalité de la victime, ni celle des deux « passants », ne l’avaient engagé à poursuivre ses investigations.
Sur le plan professionnel, plusieurs erreurs d’appréciation ont été relevées. La voiture de Jeanne Loviton, qui aurait dû être mise sous scellés, fut restituée sans examen à son chauffeur dès le lendemain. Une dizaine de témoins seulement furent interrogés, dont l’un aurait dû attirer l’attention du policier : le portier de nuit du ministère du Travail, André Ré, auprès duquel les enquêteurs rédigèrent leur rapport, à trois heures du matin, après avoir interrogé Jeanne Loviton au poste de police de la rue de Grenelle.
Ré leur avait appris que Pierre Roland Lévy, chef de Cabinet au ministère, avait quitté le bâtiment avant l’heure du crime, pour y retourner, accompagné d’un ami, peu après l’attentat. Contacté le lendemain matin, Lévy leur adressa une lettre justifiant sa présence sur les lieux, sans donner le nom de la personne qui l’accompagnait, et qui n’appartenait pas aux cadres du ministère.
L’inspecteur Ducourthial ne chercha pas à connaître son identité, et ne mentionna pas André Ré, dont il n’avait pas pris la déposition, dans son rapport. Seul lui parut important le témoignage de Jeanne Loviton, dont il s’appliqua à vérifier qu’elle était bien absente du lieu de l’attentat à l’heure où il fut commis.
On peut s’interroger sur le rôle du commissaire de police du quartier du Gros-Caillou, M. Joseph Duez, dont les bureaux se trouvaient au n° 6 de la rue Amélie et qui connaissait Denoël. Le soir même de l’attentat, il rejoint les inspecteurs de la Brigade Criminelle et paraît prendre en charge l’enquête. C’est lui qui reçoit les journalistes au cours de la nuit et leur donne son sentiment : crime crapuleux. Le lendemain, c’est encore lui qui permet au chauffeur de Jeanne Loviton d’enlever la Peugeot « accidentée », sans l’avoir examinée. Dans son rapport, l’inspecteur Ducourthial, qui s’est interrogé sur l’étrange itinéraire emprunté par Denoël pour se rendre à Montparnasse, écrit qu’il en a discuté avec Duez : « Mais nous avons admis que c’était tout de même la direction pour se rendre au Théâtre de la Gaîté. »
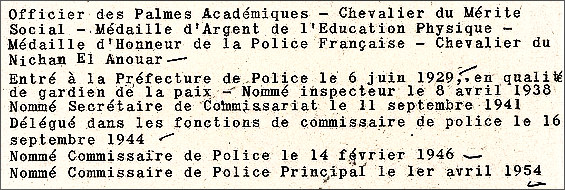
Fiche du ministère de l'Intérieur, juillet 1957
Le commissaire Duez n'est pas le premier venu. Né le 16 août 1905 à Leforest, dans le Pas-de-Calais, il était entré en juin 1929 au commissariat du Ve arrondissement comme gardien de la Paix, avant d'être nommé secrétaire de police en décembre 1940. Il fut arrêté par les Allemands le 17 avril 1941 et emprisonné durant deux mois au Cherche-Midi pour avoir rossé un collaborateur. Sa hiérarchie, pour faire bonne mesure, le suspendit de ses fonctions le 6 juin 1941, avant de le réintégrer le 21 juillet. Le 16 septembre 1944 il fut nommé commissaire du quartier du Gros Caillou, rue Amélie.
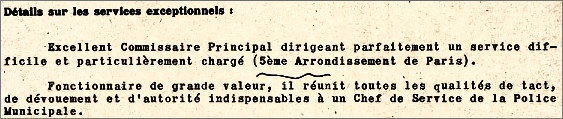
En octobre 1944 il occupa, durant quelques semaines, une charge peu commune, celle d'administrateur du camp de Drancy où étaient détenus les collaborateurs, notamment Sacha Guitry, dont le dossier lui fut confié le 8 octobre, et qu'il fit élargir trois semaines plus tard.
La présence du commissaire Duez aux Invalides, le 2 décembre 1945, tient donc au fait que l'attentat eut lieu dans un quartier dépendant du commissariat du Gros Caillou, mais il disparaît ensuite de l'enquête, puisqu'elle a été confiée à la Brigade Criminelle, ce qui n'a pas empêché Ducourthial d'avoir recours ensuite à ses conseils. Le commissaire divisionnaire Joseph Duez, fait chevalier de la Légion d'Honneur le 14 octobre 1957, prit sa retraite en 1963, et mourut le 10 mai 1969.
*
Lorsque l’inspecteur Ducourthial dépose son rapport d’enquête, le 25 janvier 1946, la veuve de l’éditeur vient tout juste d’être informée que Jeanne Loviton, gérante des Editions Domat-Montchrestien, a provoqué, en tant qu’« actionnaire majoritaire », une assemblée des actionnaires de la Société des Editions Denoël, rue Amélie.
Très vite, elle fait le lien entre la cession des parts de son mari et l’assassinat. Le 28 janvier 1946, elle dépose plainte contre Mme Loviton pour vol, escroquerie, abus de confiance, faux, usage de faux, et abus de blanc seing. Le 14 mai, elle se constitue partie civile sur l’instruction ouverte par le Parquet pour rechercher les causes de la mort de Robert Denoël.
La première affaire est confiée au juge Bourdon, la seconde au juge Gollety. La séparation des dossiers est jugée calamiteuse par la partie civile, qui pense que les deux sont liés et qui, durant quatre ans, va consacrer tous ses moyens et son énergie à le démontrer.
Un complément d’enquête est ordonné le 13 août 1946 par le juge Gollety, et c’est le même inspecteur-chef Ducourthial qui est chargé de cette nouvelle instruction, qui durera trois mois.
Une quarantaine de personnes seront interrogées, la plupart à propos des affaires qu’elles avaient nouées avec l’éditeur. Puisque la partie civile prétend que le crime est lié à des questions d’intérêt, Ducourthial va «indaguer » dans cette direction, sans plus revenir aux circonstances du meurtre.
On a le sentiment, en lisant son rapport du 15 novembre 1946, qu’il s’est surtout appliqué à se justifier face aux critiques de Mme Denoël et de son avocat.
Armand Rozelaar, qui avait la conviction qu’une troisième personne avait pris place dans la Peugeot, lui a reproché de ne pas avoir relevé les éventuelles traces de semelles à l’arrière du véhicule ? Il s’informe auprès de l’Office National Météorologique pour savoir s’il a plu ce soir-là : « Et quand bien même il aurait plu, peut-on relever des empreintes de pieds sur le tapis d’une voiture après le passage de quelqu’un, et à plus forte raison plusieurs heures après ? », écrit-il.
La voiture a été restituée sans examen à sa propriétaire ? « Pour quelle raison la voiture de Mme Loviton aurait-elle été saisie, alors que le meurtre s’est déroulé non pas à l’intérieur, mais à l’extérieur ? », réplique-t-il.
L’inspecteur néglige d’interroger Marion Delbo et ses invités, alors que Jeanne Loviton lui en a donné les moyens dès le premier soir. Il n’interroge plus le chauffeur de taxi Desprez ni le gardien Ré, qui se révéleront des témoins capitaux au cours de la troisième enquête.
En résumé, Ducourthial considère que les manœuvres visant à accaparer la succession de l’éditeur, dont parle sa veuve, sont consécutives à sa mort et ne constituent pas le mobile du crime. Il revient donc à sa première version : crime crapuleux, puisque « personne ne pouvait prévoir son passage boulevard des Invalides ce soir-là, comme personne ne pouvait prévoir la panne fortuite de la voiture ».
La position du corps
Le 3 décembre 1945, l'agent Testud déclare à la police qu'arrivant le premier sur les lieux de l'attentat, il a découvert un « homme, étendu sur le dos, parallèlement à la bordure du trottoir, avec la tête en direction de la station de métro 'Varenne'. »
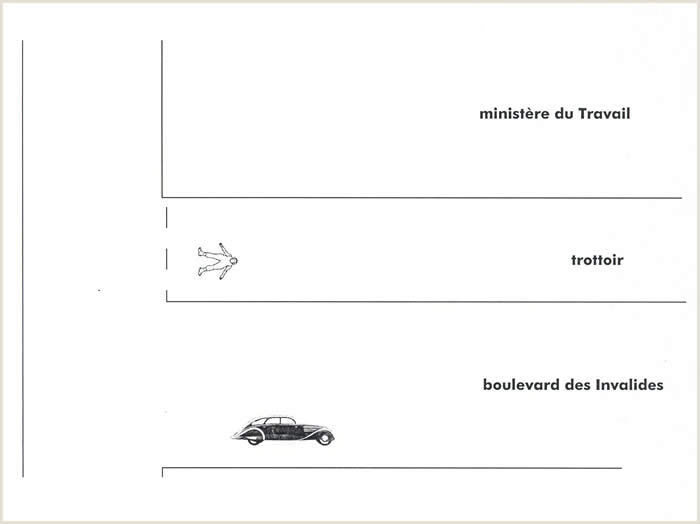
Dans son rapport du 25 janvier 1946, l'inspecteur Ducourthial ajoute à cette description que l'homme avait «les bras en croix ».
Dans la lettre qu'il a envoyée à la police, le lendemain de l'attentat, Roland Lévy ne décrit pas la position du corps de l'éditeur ; il écrit seulement qu'il a découvert sur le trottoir le corps d’un homme qui râlait.
Interrogé pour la première fois le 14 février 1950, Guillaume Hanoteau déclare à l'inspecteur Voges qu'il est arrivé sur les lieux en compagnie de Roland Lévy à l'angle du boulevard des Invalides et de la rue de Grenelle : «A notre gauche et sur le trottoir du boulevard des Invalides un homme gisait, étendu sur le dos, les pieds tournés vers la rue de Grenelle, la tête en direction de la bordure du trottoir et à environ 3 mètres de celle-ci. »
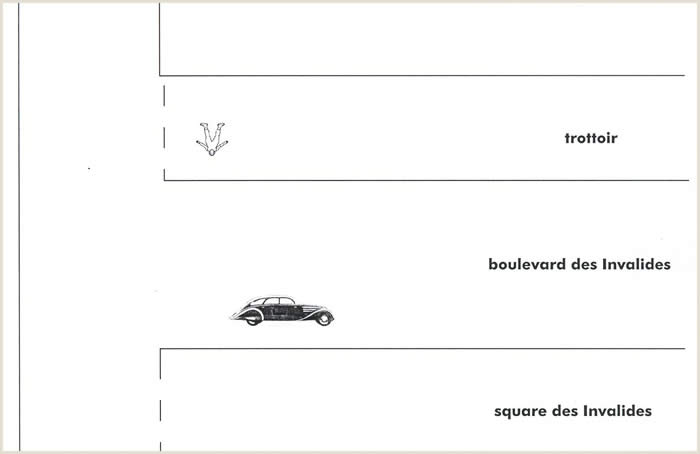
Le 28 avril 1950 Armand Rozelaar écrit au juge Gollety : « Faisant la description de la position du corps, M. Hanoteau, à l’encontre de tous les témoignages formels et tous rigoureusement conformes des agents, déclare que cet homme gisait sur le dos, les pieds tournés vers la rue de Grenelle, la tête en direction du trottoir. Vous pourrez vous reporter, Monsieur le Juge d’Instruction, aux déclarations des agents. C’est précisément le contraire, et l’homme était étendu la tête en direction de la rue de Grenelle, les trois témoins déclarant unanimement que la victime paraissait avoir poursuivi quelqu’un en direction de la rue de Grenelle. »
L'avocat remarque qu'au cours d'un nouvel interrogatoire, le 18 mars, Hanoteau a modifié légèrement sa description : « il dit que le corps était allongé légèrement en oblique, la tête en direction de la rue de Varenne et les pieds en direction du trottoir. »
On peut imaginer que Hanoteau, interrogé cinq ans après les faits, ait quelque mal à décrire exactement la position du corps de l'éditeur. Mais pourquoi, à un mois d'intervalle, change-t-il de version ?
C'est que cette position a son importance. Le 25 mai 1950 l'inspecteur Voges explique que « La position du corps de Denoël qui se trouvait précisément dans l’axe d’une diagonale formée par le point d’arrêt de la voiture et l’angle du trottoir de la rue de Grenelle, côté ministère du Travail, permet de laisser supposer, ainsi qu’il l’a déjà été indiqué, que Denoël pouvait fuir devant ses agresseurs dans cette direction lorsqu’il a été abattu ».
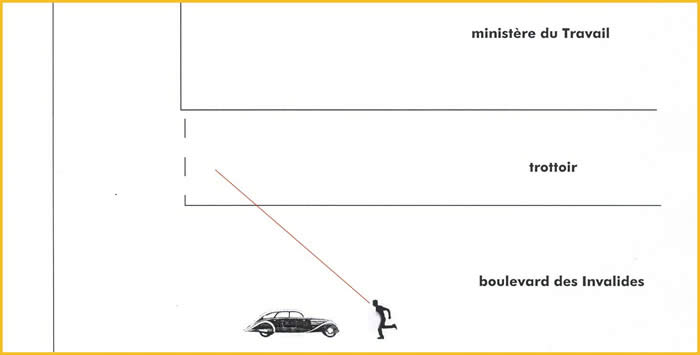
Fuir ou poursuivre quelqu'un qui, comme lui, se trouvait à côté de la voiture stationnée. Si la douille retrouvée le lendemain du drame à dix mètres en avant de la Peugeot est bien celle de la balle qui a frappé l'éditeur, sa trajectoire ne correspond pas avec le rapport d'expertise du professeur Piédelièvre, qui écrit :
« A la partie postérieure du thorax, 1/3 inférieur, côté gauche, un orifice de projectile (entrée) typique. Il est caractérisé par l’orifice proprement dit, avec collerette d’érosion. L’ensemble mesure environ un centimètre. Il n’y a pas de tatouage par grains de poudre. Un orifice de sortie du projectile se trouve en avant, sur la partie antérieure du thorax, à 7 centimètres au-dessous et très légèrement en dedans du mamelon droit. Il mesure près de 2 centimètres. [...] Le trajet a été d’arrière en avant, de gauche à droite et très légèrement de bas en haut. »
Le projectile a atteint Denoël sous l'omoplate gauche et est ressorti sous le sein droit : cette diagonale n'est pas conforme à la position qu'est censé occuper le tireur, devant la Peugeot. Si, comme le croit le policier, Denoël a quitté les parages de la voiture pour fuir ou pour poursuivre quelqu'un, la balle aurait dû pénétrer du côté droit et ressortir sous le sein gauche.
Dans son premier rapport l'inspecteur Ducourthial donne cette explication : « au moment où il s'enfuit, il se retourne certainement pour regarder ce qui se passe derrière lui, ce qui explique que la balle l'a atteint du côté gauche et non du côté droit, comme cela aurait été le cas s'il s'était enfui sans se retourner. »
Si l'éditeur s'est retourné, ce devait être en tournant la tête vers la droite, puisque son agresseur se trouve devant la voiture et qu'il court en diagonale vers la rue de Grenelle.
Pourquoi les inspecteurs pensent-ils que le coup de feu a été tiré à proximité du véhicule ? D'abord à cause de la description des lieux par Hanoteau qui déclare qu'après avoir traversé le boulevard pour examiner la voiture, il a vu qu' « un pneu était dégonflé et la malle arrière du coffre ouverte. Un espèce de tapis comme on en met à terre pour réparer les voitures se trouvait sur la chaussée. »
Elle est conforme à ce qu'a vu l'inspecteur Ducourthial vers 23 heures : « La roue avant droite était à plat, le coffre arrière était ouvert. Sur le trottoir se trouvaient le couvercle de la roue de secours, ainsi que le cric et la manivelle de cric qui avaient été rapportés auprès de la voiture par les gardiens de la paix. A l'avant du véhicule, on remarquait une toile et une genouillère en caoutchouc, ce qui paraissait indiquer que M. Denoël se disposait à changer la roue lorsqu'il a été agressé. »
Cela correspondait parfaitement au rapport balistique du professeur Sannié qui écrivait : « Il est probable que la victime était penchée au moment du coup de feu tiré dans le dos, et que le veston n’était pas boutonné, laissant flotter ses pans. »
Si Denoël était penché, veston déboutonné, c'est qu'il était occupé à changer la roue avant de la Peugeot. Et puisque le même rapport indiquait que le tir avait été effectué « à une distance égale ou supérieure à 50 centimètres », l'éditeur pouvait avoir été fusillé à moins de dix mètres par un agresseur surgi des fourrés du square. Touché par un projectile lourd tiré par surprise, comment l'éditeur aurait-il pu crier « au voleur » ?
D'autre part, si l'éditeur est tombé sur le dos, c'est à la suite de l'impact de la balle. Si, comme le croit Ducourthial, il avait reçu la balle alors qu'il se trouvait près de la voiture, et qu'il avait ensuite traversé le boulevard, chargé d'un cric et d'une manivelle, c'est face contre terre qu'il serait tombé.
On peut donc aussi imaginer que le coup de feu a été tiré sur le trottoir de gauche, là où fut découvert le corps de la victime, entouré du cric et de la manivelle. Denoël aurait pu interrompre son dépannage, traverser le boulevard, armé de ces instruments, en vue de poursuivre une discussion qui tournait mal.
Cela impliquait un tout autre scénario et la présence sur les lieux d'un troisième homme. On verra plus loin que la veuve de l'éditeur l'a envisagé.
Le minutage des événements tragiques de la soirée du dimanche 2 décembre 1945 a constitué un vrai casse-tête pour les enquêteurs en raison de l’imprécision des témoignages, mais tous étaient d’avis que c’est dans ce timing que résidait une des clefs de l’affaire.
Le parcours de 500 mètres qui sépare le square des Invalides du poste de police situé au n° 116 de la rue de Grenelle, fut le théâtre d’un nombre incalculable d’allées et venues que les enquêteurs tentèrent d’éclaircir. On s’accorde à dire qu’il faut cinq minutes pour les parcourir à pied.


Le commissariat de la rue de Grenelle
A quelle heure la Peugeot est-elle arrivée aux Invalides, à quel moment Jeanne Loviton a-t-elle quitté Denoël pour se rendre au commissariat, à quelle heure y est-elle parvenue, à quelle heure a éclaté le coup de feu... Autant de questions auxquelles il était difficile de répondre avec précision.
Le seul point de repère vérifiable était l’heure de sortie du car de police-secours, notée dans le registre de main courante du poste de police de la rue de Grenelle. Ce registre où sont consignés, heure par heure, les incidents de la journée, porte : 21 heures 22, corrigé en 21 heures 25.
C’est le procureur général Besson qui, dans son réquisitoire, eut l’heureuse idée d’en proposer un second : l’heure de la relève de la garde devant la porte du ministère du Travail, au n° 127 de la rue de Grenelle.
Le gardien de la paix Sannier, qui a pris son service à 19 h. 30, doit être relevé à 21 heures par la jeune recrue Yves Testud. Or, Testud est en retard et, après avoir un peu patienté, Sannier cesse sa faction « entre 20 heures 58 et 21 heures 02 » pour aller à la rencontre de son remplaçant.
Testud reconnaît qu’il a quitté le poste de police avec quelque retard. Le 3 décembre 1945, il déclare à l’inspecteur Ducourthial qu’il en est sorti « vers 21 h. 15 ». Dans sa déposition du 29 avril 1950, il corrige : « entre 21 heures 05 et 21 heures 10 ».
Le lendemain de l’attentat, alors que les événements tragiques sont encore bien présents dans sa mémoire, Testud déclare qu’une fois sorti : « A une vingtaine de mètres du poste, face à l’ancien ministère des P.T.T., j’ai rencontré une femme qui m’a demandé l’adresse du commissariat de police. [...] Je lui ai alors indiqué le poste central, et l’ai vue partir dans cette direction. Continuant mon chemin pour me rendre à mon point de service, j’ai rencontré mon collègue qui venait au devant de moi, à l’angle de la rue de Bourgogne et de la rue de Grenelle. Il m’a passé les consignes, puis s’est éloigné en direction du poste, tandis que je poursuivais mon chemin ».
En 1950, il ajoutera à l’intention de l’inspecteur Voges : « Il m’a passé les consignes et nous avons conversé pendant 2 ou 3 minutes. J’ai continué à me diriger vers le ministère du Travail ».
Sa déclaration est sans ambiguïté : Testud a rencontré Jeanne Loviton à vingt mètres du poste de police avant de croiser son collègue Sannier à la hauteur de la rue de Bourgogne.
Puisque les deux agents se croisent vers 21 h. 10, c’est que Jeanne Loviton a quitté Denoël et remonté la rue de Grenelle peu après 21 heures. Or, quel que soit le trottoir qu’elle a emprunté, elle n’a pu manquer de voir l’agent Sannier en faction devant la porte du ministère du Travail : pourquoi ne s’adresse-t-elle pas à lui ? Pourquoi attend-elle d’être en vue du poste de police pour interroger Testud à propos d’un taxi ? Sannier, interrogé le 24 février 1950, dit qu’il n’a pas vu Jeanne Loviton rue de Grenelle durant sa faction, ni après.
Mme Loviton pénètre dans le poste de police quelques instants après avoir croisé Testud : « Là, elle déclina son nom, présenta son certificat médical. Un des agents téléphona à une première station, sans pouvoir lui donner satisfaction. Il commenta cette carence, appela un second poste, et n’obtint un taxi qu’en s’adressant finalement au poste du Panthéon », écrit l’inspecteur Ducourthial dans son rapport du 11 novembre 1946.
Il doit être à ce moment un peu plus de 21 h. 15 : « Je me trouvais à l’intérieur de ce local depuis cinq minutes environ, lorsque j’ai entendu les agents de police parler d’envoyer un car de police-secours à l’angle de la rue de Grenelle et du boulevard des Invalides, où venait de se produire un attentat », déclare Mme Loviton aux policiers, la nuit même du meurtre.
Revenons à Testud qui, après avoir quitté Sannier, se dirige vers le ministère, sur le trottoir de gauche, et arrive en face du n° 123, c’est-à-dire à cinquante mètres du coin du boulevard des Invalides. C’est à cet endroit qu’il entend le coup de feu, « en même temps » qu’il aperçoit deux hommes qui sortent du ministère, et qui se dirigent ensuite en direction du boulevard : « Je me trouvais à environ 40 mètres d’eux », déclare-t-il.

Point rouge : le corps de Denoël - Point bleu : Hanoteau et Lévy - Point vert : l'agent Testud - Point noir : le poste de police
Dix mètres à peine séparent l’entrée du ministère du coin du boulevard. Puisque le corps de Denoël gît à cet endroit, les deux hommes le découvrent immédiatement : « Nous sommes retournés en direction de la rue de Grenelle où nous avons immédiatement prévenu un gardien de la paix qui est retourné avec nous sur les lieux du crime », déclare Roland Lévy, le lendemain.
Qu’a fait Testud dans l’intervalle ? « Je me suis moi-même porté dans cette direction d’où paraissait avoir été tiré le coup de feu. Comme j’arrivais devant la porte du ministère du Travail, les deux hommes que j’avais vus en sortir sont revenus vers moi, me déclarant qu’un homme venait d’être blessé à l’angle du boulevard des Invalides et de la rue de Grenelle. »
Le jeune gardien, pétrifié, n’a pu parcourir qu'une trentaine de mètres avant de rencontrer les deux hommes. En 1950, il dira même à l’inspecteur Voges : « Je suis allé sur la chaussée pour tenter de voir ce qui se passait. J’avais cru à ce moment avoir entendu l’éclatement d’un pneu [...] Je suis remonté sur le trottoir et j’ai continué ma route normalement. J’ai perdu de vue les deux hommes quand ils ont tourné boulevard des Invalides à gauche. Presque tout de suite je les ai vus revenir vers moi, marchant assez vite ».
Testud, le soir même de l’attentat, tente de masquer ses errements par des déclarations intempestives à propos du coup de feu qu’il situe au moment où les deux hommes sortaient du ministère. Considérant la proximité du boulevard, ces hommes auraient dû apercevoir le meurtrier, puisqu’ils surviennent à l’endroit même du crime quelques secondes plus tard.
Pour l’inspecteur Ducourthial, la version de Testud est plausible car elle confirme celle de Roland Lévy. Mais elle est contredite par la déclaration de Gustave Pavard, le concierge de l’immeuble du 142 bis, rue de Grenelle, dont la loge se trouve à quelques mètres du coin du boulevard, et qui est sorti aussitôt après le coup de feu : il aperçoit « plusieurs personnes rassemblées autour du corps d’un homme allongé sur le trottoir d’en face. »
Or Testud a déclaré : « Les deux seules personnes que j’ai vues à ce moment sur les lieux sont les deux hommes qui m’ont prévenu qu’un homme était blessé. » Qui sont donc les personnes aperçues par Pavard immédiatement après le coup de feu ?
Testud s’est ensuite rendu en compagnie de Lévy et Hanoteau sur les lieux de l’attentat, a appelé Police-Secours à la borne qui se trouve à l’angle de la rue de Varenne et du boulevard des Invalides, et attendu, en leur compagnie, l’arrivée du car de police, tandis que des badauds venus du Champ de Mars s’attroupaient autour de la victime.
Son appel a été reçu au poste de la rue de Grenelle à 21 h. 22, et le car de police-secours en est sorti à 21 h. 25. Le taxi réclamé par Jeanne Loviton est arrivé peu après : la main courante indique qu’il s’est présenté à 21 h. 30.
En dépit de quelques contradictions difficiles à expliquer, les policiers considèrent ce timing comme plausible, sinon satisfaisant. Armand Rozelaar lui-même ne le remet pas en cause durant quatre ans, occupé qu’il est à tenter de relier l’assassinat à des questions d’intérêt.
Le 1er mars 1950, le juge Gollety a procédé à une reconstitution et effectué en voiture le même parcours que Denoël, cinq ans plus tôt : le trajet a duré neuf minutes « en plein jour avec l’encombrement actuel des rues et deux arrêts à des carrefours ».
Si, comme le pense Armand Rozelaar, Denoël a quitté Auteuil vers 20 h. 30, il serait donc arrivé aux Invalides vers 20 h. 45, au plus tard - à moins qu’il ait embarqué quelqu’un dans la Peugeot durant son parcours insolite, ce qui expliquerait l’heure d’arrivée devant le square vers 21 heures.
L’avocat s’interroge alors sur le moment du départ de Jeanne Loviton. Puisque l’appel de police-secours a eu lieu à 21 h. 25 au plus tard, et qu’elle se trouvait au poste depuis cinq minutes environ, selon sa propre déclaration, elle n’a pu quitter Denoël à 21 h. 05, mais vers 21 h. 15. C’est aussi la conclusion de l’inspecteur Voges : « on peut fixer l’heure à laquelle Mme Loviton a quitté son ami vers 21 heures 10 au plus tôt ». Ainsi s’expliquerait l’absence de l’agent Sannier sur son parcours.
Que valent alors les déclarations de l’agent Testud ? Ce gardien a pris son service avec 10 minutes de retard, obligeant son collègue Sannier a quitter sa faction peu après 21 heures. Lorsqu’il a entendu le coup de feu, il se trouvait à cinquante mètres du boulevard des Invalides, et il a « continué sa route normalement », peut-être même est-il resté un moment sur place, avant de marcher, avec des semelles de plomb, en direction du boulevard. Quand il parvient enfin sur les lieux de l’attentat, il néglige de prendre l’identité des personnes présentes. Testud n’a cessé de commettre des fautes.
Dans la lettre qu'elle envoie le 10 juillet 1950 au président de la cour d'Appel, Cécile Denoël écrit que l'agent Testud « venait d’entrer en fonctions et qu’il était encore très jeune. Je me souviens parfaitement qu’il a déclaré devant M. Gollety que c’était la première fois qu’il se trouvait en présence d’un crime et que ceci l’avait complètement affolé. »
Quand a-t-il croisé Sannier ? Avant de rencontrer Jeanne Loviton. Quand a-t-il rencontré deux hommes venant du boulevard ? Après le coup de feu.
Me Rozelaar va s’appliquer à le démontrer, grâce au témoignage d’André Ré, le gardien du ministère, recueilli par les nouveaux enquêteurs. Selon lui, Roland Lévy est sorti du ministère vers 21 h. 10, et y est revenu « 7 ou 8 minutes plus tard », accompagné par Hanoteau. Lévy lui a annoncé qu’un meurtre venait d’être commis sur le boulevard.
Sa déclaration est confirmée par M. Le Guerne, le concierge du ministère, à qui Ré a annoncé, « vers 21 h. 15», l’attentat : « Il m’a dit l’avoir appris par deux membres du Cabinet qui étaient sortis du ministère et revenus quelques minutes après ». La version Testud selon laquelle les deux hommes étaient revenus du boulevard presque immédiatement paraît bien invraisemblable.
L’avocat s’interroge ensuite à propos de la découverte du corps de l’éditeur :
- Testud n’a vu sur les lieux que les deux hommes qui l’avaient prévenu de l’attentat.
- Le garde républicain Jean Gérard, de faction sur le boulevard, a aperçu « deux ombres » à l’angle du boulevard et de la rue de Grenelle. Il a vu ensuite Testud se diriger vers lui pour appeler du secours.
- Guillaume Hanoteau n’a vu personne près du corps, sauf le concierge Pavard qui sortait de son immeuble.
- Roland Lévy n’a vu personne sur les lieux ; il est retourné rue de Grenelle avec Hanoteau, et a prévenu Testud ; de retour sur le boulevard, « quelques personnes se trouvaient déjà rassemblées au tour du corps ».
- Le colonel L’Hermite, ouvrant aussitôt sa fenêtre du 6e étage, aperçoit « un rassemblement de plusieurs personnes » sur le trottoir.
- Gustave Pavard, le concierge du 142 bis, rue de Grenelle, est sorti aussitôt après le coup de feu, et a vu, à moins de dix mètres, « plusieurs personnes rassemblées autour d’un homme allongé sur le trottoir ».
Armand Rozelaar, qui s’est longtemps interrogé sur ce « rassemblement », en conclut, le 24 mars 1950 : « Si Denoël a été abattu par un coup de feu et qu’immédiatement après, tous les témoins sont d’accord pour dire qu’il ont aperçu quelques personnes sur le trottoir, mais qu’ils n’ont vu aucune de ces personnes prendre la fuite, c’est qu’évidemment, Denoël a été abattu par une de ces personnes. »
Dès le lendemain, au cours d’une confrontation entre Jeanne Loviton et Cécile Denoël dans le cabinet du juge d’instruction, il pose cette question : « Le témoin n’a-t-il rencontré personne entre le moment où il a quitté Robert Denoël et le moment où il a rencontré un agent rue de Grenelle en allant au commissariat ? ».
Jeanne Loviton répond : « J’affirme n’avoir rencontré personne, je m’explique : je n’ai adressé la parole à personne. Je ne puis pas vous dire qui j’ai croisé et je ne me souviens pas de ces détails. »
Rozelaar insiste : « Le témoin n’a-t-il pas croisé deux personnes ? » - Je n’en sais rien, répond-elle.
Le 26 mars 1950, dans une lettre au juge Gollety, l’avocat affirme que « ledit rassemblement devait normalement se composer de trois personnes : MM. Lévy et Hanoteau et Mme Loviton. »
Il développe ensuite une audacieuse théorie, en épinglant les déclarations contradictoires de Jeanne Loviton aux différents enquêteurs, notamment à propos de son départ du boulevard des Invalides.
Une première fois elle déclare qu’il portait son pardessus et s’apprêtait à ouvrir le coffre pour en tirer des outils, une autre fois elle le décrit aux prises avec ces outils, mais sans son pardessus. Pourquoi cette dernière image de Robert Denoël vivant, qui aurait dû se graver dans sa mémoire, change-t-elle sans cesse ? s’interroge l’avocat.
Pour lui, la réponse est claire : Jeanne Loviton ne peut le décrire précisément parce qu’il n’était nullement occupé à réparer la roue de la voiture, devant le square des Invalides, mais à discuter, voire à se disputer, et qu’elle s’est éloignée alors que cette discussion était sur le point de tourner mal - ou juste après.
Avec qui Denoël se querellait-il ? Le portier du ministère a, selon lui, fourni la réponse, en déclarant qu’à «21 heures 10 environ, je ne puis être plus précis, M. Roland Lévy, chef de cabinet, est sorti de son cabinet, je l’avais entendu marcher dans la cour du ministère et j’ai fait fonctionner l’ouverture de la porte pour lui permettre de sortir. [...] Environ 7 ou 8 minutes après, M. Roland Lévy a sonné à la porte d’entrée. Je lui ai ouvert. Il était accompagné d’un monsieur que je ne connaissais pas, de taille moyenne. M. Lévy m’a dit : " Ne vous dérangez pas, je vais chercher mes cigarettes. C’est un drôle de coin, votre quartier, il vient d’y avoir un attentat à l’angle du boulevard. " Je crois qu’il m’a parlé d’un homme qui était occupé à réparer sa voiture. Il a dit au monsieur qui l’accompagnait : " Ça doit être une histoire de bonne femme ". »
Hanoteau et Lévy rentrent donc dans le ministère après l’attentat et en parlent au portier, qui le rapporte peu après au concierge. Pourquoi Lévy ajoute-t-il qu’il doit s’agir d’une « histoire de bonne femme », puisqu’il n’y a plus de « bonne femme » sur le boulevard ?
Rozelaar entreprend alors de démontrer que la présence de ces deux hommes au ministère puis sur le boulevard, à cette heure tardive, n’est pas fortuite. C’est eux que Robert Denoël et Jeanne Loviton devaient rencontrer, probablement à propos de son procès devant la Commission d’épuration du Livre : « Rendez-vous avait certainement été pris pour 21 heures à l’angle du boulevard des Invalides, en face du ministère du Travail. »
Avocat à la Cour de Paris, Hanoteau a fait partie, comme Jeanne Loviton, du cabinet de Me Maurice Garçon. Il habite 13, rue de Verneuil : « Est-on allé le chercher chez lui ? C’est infiniment probable et cela expliquerait enfin l’invraisemblable crochet effectué par Denoël pour se rendre de la rue de l’Assomption à la rue de la Gaîté. »

Un trajet qui mène la voiture de Denoël de la rue de l'Assomption à la rue de Verneuil

La suite du trajet qui mène la voiture de Denoël de la rue de Verneuil au square des Invalides
Le rendez-vous a été pris avec un autre avocat à la Cour de Paris, ancien collaborateur de Raymond Rosenmark, l'avocat de Jeanne Loviton ; il est l'amant de Simone Penaud-Angelelli, l’avocate communiste de Robert Denoël et amie intime de Jeanne Loviton : Pierre Roland Lévy, nommé depuis quelques jours chef de Cabinet de Marius Patinaud, sous-secrétaire d’Etat communiste au ministère du Travail, où il occupe un bureau au rez-de-chaussée.
« Pierre Roland Lévy, qui était à cette heure tardive et un dimanche le seul membre du Cabinet présent au ministère, devait guetter de sa fenêtre donnant sur le boulevard des Invalides l’arrivée de la voiture », écrit Rozelaar.
Il en sort donc vers 21 heures 10 et rejoint les trois autres. Une discussion s’engage sur le trottoir entre Robert Denoël, Jeanne Loviton, Guillaume Hanoteau et Roland Lévy, « discussion dont il conviendra de déterminer les motifs exacts. Il est possible que Denoël ait ouvert le coffre à outils et en ait tiré le cric et la manivelle pour se défendre ou même, pour attaquer ses contradicteurs », mais il est possible aussi qu’à ce moment, il en ait tiré la mallette contenant des pièces d’or ou des devises, qu’il est allé chercher rue de l’Assomption, et qui représente le prix d’une transaction encore imprécise.
Est-ce que la dispute éclate en présence de Jeanne Loviton ou après son départ ? Rozelaar pense qu’après qu’un des hommes lui eût dérobé la mallette, il s’enfuit en direction de la rue de Grenelle, Denoël le poursuit avec les armes improvisées que sont le cric et sa manivelle, en criant « au voleur », l’autre lui tire dans le dos, puis crève un pneu de la voiture « soit d’un coup de canif, soit en tirant une balle (Jean Gérard croit en effet avoir entendu deux détonations) et l’on expédie Mme Loviton au commissariat de police pour y chercher un taxi, avec la thèse du pneu crevé accidentellement au moment où on se rendait au théâtre. »
Entre-temps, Jeanne Loviton s’est éclipsée, a rencontré Testud, puis est entrée au poste de police de la rue de Grenelle, tandis que Hanoteau et Lévy sont retournés au ministère :
« La station dans le bureau, sous prétexte d’y rechercher un paquet de cigarettes, dura quatre à cinq minutes. Exactement et au chronomètre, le temps qu’il faut pour aller à pied du 127 de la rue de Grenelle au poste de police. Puis ces messieurs sortent du ministère, tournent le coin, reviennent vers l’agent Testud et lui annoncent qu’un homme est là, râlant sur le trottoir.
Ont-ils suggéré à Testud que le coup de feu venait d’être tiré à l’instant, Testud croit-il l’avoir entendu, est-il de bonne foi, ou a-t-il menti pour essayer de couvrir la faute professionnelle qu’il avait personnellement commise ? Nous ne pouvons rien affirmer encore.
Le fait est là, brutal, absolu : M. Roland-Lévy, dans sa première déposition écrite, déclare que quand il est arrivé, diverses personnes se trouvaient déjà autour du corps. Comme personne n’est immédiatement allé sur les lieux, ces diverses personnes s’étaient rassemblées durant les quatre ou cinq minutes pendant lesquelles M. Roland-Lévy et M. Hanoteau se trouvaient à l’intérieur du ministère.
Quant à Mme Loviton, son alibi était parfait. Au moment où le coup de feu était tiré, au moment où deux honorables personnes, l’une appartenant à un Cabinet ministériel, l’autre avocat à la Cour, prévenaient eux-mêmes la Police du crime que l’on venait de commettre, Mme Loviton se trouvait au poste de police et ne pouvait donc pas savoir ce qui s’était passé. »
La démonstration d’Armand Rozelaar comportait des lacunes, faisait fi des témoignages de Jeanne Loviton et de l’agent Testud, mais présentait l’avantage d’expliquer la suite des événements.
En arrivant au poste de police, Jeanne Loviton redoutait une nouvelle tragique, puisqu’elle avait quitté les trois hommes alors qu’ils se querellaient ; c’est pourquoi, dit Rozelaar, elle répondit au juge Gollety qui l’interrogeait à propos de son attitude au poste, lorsqu’on avait annoncé l’attentat : « Immédiatement, j’ai compris et je me suis dit que Robert Denoël était en train de se battre avec quelqu’un ». Il pensait même qu’elle avait attendu cette annonce avant de réclamer un taxi, puisque celui de Desprez n’avait été enregistré qu’à 21 heures 30.
Eugène Desprez avait bien décrit son étrange comportement entre le poste de police et l’endroit de l’attentat : « Sur les lieux du crime se trouvaient notamment un gardien de la Paix et un monsieur en civil, nous avons parlé quelques instants et je me rappelle leur avoir dit qu’à mon avis cette dame s’attendait à ce qui s’était passé en raison de son attitude pendant le temps que je l’ai véhiculée dans mon taxi. En effet, j’ai eu l’impression qu’elle pensait être suivie, puisqu’elle regardait constamment en arrière. Quand nous sommes arrivés boulevard des Invalides elle est descendue, paraissant complètement affolée, de mon taxi. Elle s’est mise à crier tout de suite : ‘Ils me l’ont tué... Ils me l’ont tué’. »
Ce témoignage posait aussi d’autres questions. Puisque Jeanne Loviton avait compris que ce rendez-vous d’affaires avait mal tourné pour Denoël, pourquoi craignait-elle d’être suivie ? Ses interlocuteurs auraient-ils fait appel à des hommes de main ? Après avoir été complice passive, devenait-elle témoin gênant ?
Est-ce la théorie de Rozelaar qui allait perturber les avocats mis en cause, ou l’apparition du témoin inattendu qu’était André Ré ? Toujours est-il que l’un et l’autre allaient se contredire mutuellement dans le cabinet du magistrat instructeur.
Le 14 février 1950, Guillaume Hanoteau déclarait au juge Gollety : « J’ai dû arriver vers 8 heures 50 au ministère. Nous sommes restés quelques instants dans le cabinet de Roland Lévy puis nous avons décidé d’aller à la Chambre des Députés où il y avait une séance importante. Nous sommes sortis du ministère du Travail et sur le pas de la porte Roland Lévy s’est aperçu qu’il avait oublié je ne sais quoi. Il est remonté et je suis resté seul dans la rue. Au bout d’un temps indéterminé, j’ai entendu un coup de feu et un brouahara [sic].
A cet instant même, Roland Lévy sortait du ministère du Travail, nous avons couru en direction du coup de feu et nous sommes arrivés au coin du boulevard des Invalides et de la rue de Grenelle, et nous avons vu un corps étendu sur le trottoir. Roland Lévy s’est approché et il a dû dire : ‘Il est mal en point’. Roland-Lévy a appelé l’agent qui devait revenir prendre sa garde. »
Si Hanoteau était entré au ministère avant 21 heures, c’est le portier qui lui aurait ouvert la porte, et son nom aurait dû figurer dans le registre des entrées. Comme en témoignait le concierge du ministère : « la porte est toujours fermée le dimanche et l’ouverture est manœuvrée par un bouton électrique ». Il existait bien un moyen mécanique pour l’ouvrir de l’intérieur, mais connu seulement du personnel. Roland Lévy n’aurait donc pu y faire pénétrer Hanoteau à l’insu d’André Ré.
Et Hanoteau paraît ignorer qu'avant le portier Ré, un premier obstacle se serait trouvé sur sa route : le gardien de la paix Sannier, en faction devant la porte d'entrée entre 19 heures 30 et 21 heures.
Pour Armand Rozelaar, Hanoteau invente cette improbable visite à Roland Lévy pour justifier sa présence sur les lieux du meurtre, mais il est persuadé que l’avocat y est venu dans la voiture de Denoël.
D’autre part il a parlé d’assister avec Lévy à une « séance importante » à la Chambre des députés. Or, la séance du 2 décembre, qui n’avait rien d’exceptionnel, s’est clôturée à 21 heures.
Au cours d’une confrontation dans le cabinet du juge d’instruction, le 10 mai 1950, Cécile Denoël demande à Hanoteau comment il avait pu pénétrer au ministère et il répond laconiquement : « Le concierge m’a demandé où j’allais ».
Invité à situer le bureau de Lévy dans le ministère, il répond : « il devait se trouver donnant à droite en entrant, donnant sur le boulevard des Invalides. »
- Au rez-de-chaussée ? insiste-t-elle.
- Je n’en sais rien. Trois mois plus tôt, il avait déclaré être resté quelques instants dans ce même bureau.
Pressé d’expliquer les paroles prononcées par Roland Lévy au portier Ré, Hanoteau répond : « Il est très possible que Roland Lévy ait dit : ‘C’est une histoire de femme’ car il avait été surpris, ainsi que le brigadier, par la venue de la femme que j’ai su être Mme Loviton et qui s’est écriée ‘Qui a fait cela ? Qui a fait cela ?’ ».
Hanoteau situe ainsi leur entrée au ministère après l’arrivée de Jeanne Loviton sur les lieux de l’attentat, ce qui justifie la réflexion de Lévy. Le magistrat lui demande alors : « Etes-vous certain de ne pas être retourné au ministère du Travail après avoir vu le corps de M. Denoël ? », et Hanoteau, qui flaire le piège, répond : « Sans pouvoir être affirmatif, je ne le crois pas. »
Roland Lévy, interrogé le 11 mai 1950, déclare qu’il avait donné rendez-vous à son ami pour aller dîner avec lui. Et il ne se rappelait pas du tout être retourné à son bureau pour y chercher quelque chose qu’il y aurait oublié.
Mais il commet lui-même une erreur en déclarant qu’après la découverte du corps de l’éditeur, il était « retourné immédiatement au ministère donner l’ordre au concierge d’appeler Police-Secours », ce qui est contredit par le témoignage d’André Ré, et celui de l’agent Testud, qui était l’auteur de l’appel. Rozelaar pensait que cette déclaration était destinée à justifier sa rentrée au ministère et sa conversation avec le portier.
La position des deux avocats était devenue d’autant plus inconfortable que des fuites avaient eu lieu dans la presse et que plusieurs hebdomadaires avaient, dès le 30 avril, publié leurs noms et celui de Jeanne Loviton, en révélant que tous se connaissaient. La théorie du complot prenait corps.
C’est Jeanne Loviton qui réagit la première. Dès le 7 mai, elle avait déposé plainte pour diffamation contre trois organes de presse et, la semaine suivante, elle adressait au procureur général Besson un mémoire au ton péremptoire mais rédigé avec beaucoup d’habileté.
C’est ainsi qu’elle attribuait à un article à sensation paru le 30 avril dans Express-Dimanche, une nouvelle convocation dans les locaux de la police judiciaire, laissant entendre que la police était plus sensible à ce qui se disait dans la presse qu’à ce qui se trouvait réellement dans le dossier. Que lui voulait-on, au juste ?
« Faire avouer à Mme Loviton qu’elle connaissait MM. Roland Lévy et Hanoteau.
Même si Mme Loviton avait parfaitement connu MM. Roland Lévy et Hanoteau, est-ce que de ce fait l’instruction aurait fait un pas ?
La police suppose-t-elle, un instant, que M. Roland Lévy, actuellement membre du Conseil de la Magistrature, et M. Hanoteau, dans les loisirs que leur laissent leurs occupations, font métier de tueurs à gage ? »
Il était difficile de pousser plus loin la provocation. Elle y parvient pourtant :
« Dans les romans policiers - qui paraissent devenus le bréviaire de certains inspecteurs de police - sont suspectes toutes les personnes qui se trouvaient sur les lieux au moment du crime. » Hanoteau et Lévy s’y sont, certes, trouvés à un moment délicat mais, ajoute-t-elle : « Ils étaient encore là quand la police est arrivée, ce qui n’est pas, en général, considéré comme une preuve de culpabilité. »
Le 25 mai 1950, le commissaire Henri Mathieu faisait parvenir au juge Gollety les conclusions de son enquête. Elles n’étaient pas favorables à Jeanne Loviton, ni à Roland Lévy, ni à Guillaume Hanoteau. Sans en incriminer aucun, ses inspecteurs avaient épinglé toutes leurs divergences.
Et leur conclusion était que Robert Denoël « aurait pu trouver la mort à l’issue d’un rendez-vous consécutif à cet appel téléphonique, à la suite d’une longue discussion dont l’objet reste indéterminé, mais qui pourrait avoir eu pour objet la possession du dossier qu’il avait constitué en vue de sa comparution devant le Comité d’épuration du Livre ».
Certes, ils ajoutaient qu’il n’avait pu être établi que Mme Loviton pouvait être au courant de ce rendez-vous, et que la présence de Guillaume Hanoteau sur les lieux du crime était « due à un concours de circonstances extraordinaires », ce qui ne voulait pas dire grand-chose, mais il était désormais établi qu’il s’agissait d’un rendez-vous, et non d’une halte forcée à cet endroit en raison d’une panne fortuite.
Dès lors, que valaient les déclarations des uns et des autres ? Il appartenait au procureur général, Antonin Besson, d’en tirer la leçon. Il le fit le 1er juillet 1950 dans son réquisitoire définitif qui, apparemment, tenait compte de tous les éléments du dossier.
Il avait, à n'en pas douter, lu attentivement le rapport du commissaire Mathieu mais, à l'endroit où les policiers avaient développé l'hypothèse du rendez-vous qui se transforme en guet-apens, pour conclure que cette hypothèse leur paraissait la plus vraisemblable, le procureur avait noté : « Mais elle n’est appuyée sur aucun témoignage. Rien que des suppositions ! »
Besson n'a cependant pas éludé la question : « on ne saurait exclure la version envisagée par la Partie Civile selon laquelle Denoël aurait été exécuté au cours d’un règlement de comptes, soit que rendez-vous eût été donné à cet endroit à celui qui devait devenir son meurtrier, soit que le futur meurtrier eût pris place dans la voiture de la dame Loviton, soit que la voiture ait été suivie par une autre voiture d’où serait sorti l’individu chargé de tuer Denoël. Ces différentes hypothèses - qui impliqueraient que la dame Loviton connût le meurtrier, fût sa complice et ne se fût absentée que pour permettre l’assassinat et se créer un alibi - se heurtent toutes cependant à diverses objections ». Quelles objections ?
La première est que « la panne de l’auto - réelle et incontestable - était imprévisible à cet endroit ». Comment le procureur peut-il qualifier ainsi cette panne, alors que la Peugeot n'a pas été examinée ? Parce qu'elle a été remorquée jusqu'au poste de police de la rue de Grenelle à l'aide d’une voiture dépanneuse spéciale.
Le procureur perd de vue que le chauffeur de Jeanne Loviton n'a pas eu besoin d'une dépanneuse pour ramener le véhicule à Auteuil. Et il ne tient aucun compte des déclarations contradictoires qu'Abel Gorget a faites devant le juge Gollety, prétendant tout d'abord avoir lui-même réparé le pneu crevé, avant de reconnaître qu'il l'avait confié à un garage proche du domicile de Jeanne Loviton, où il n'était jamais allé le rechercher.
La seconde est apportée par le témoignage du colonel L'Hermite qui a entendu crier « au voleur » : « Si Denoël, en effet, menacé d’un pistolet, avait été en discussion d’affaires avec un antagoniste nécessairement connu de lui, il eût, peut-on penser, poussé d’autres cris ou d’autres exclamations ».
Si cet « antagoniste nécessairement connu de lui » a dérobé quelque chose d'important, l'objet même de la discussion, par exemple, quel autre cri aurait dû pousser Denoël, Besson ne le dit pas. D'autre part, un seul témoin a entendu cet appel au voleur, le colonel L'Hermite. Et l'honorable témoin âgé de 63 ans l'a entendu alors que sa fenêtre du 6e étage était fermée. Interrogé à nouveau quelques mois après le meurtre, et prié de confirmer sa première déclaration, le colonel L'Hermite « ne put d'ailleurs se montrer affirmatif en raison du doute semé dans son esprit par la question ».
Le concierge de son immeuble, Gustave Pavard, qui est plus proche que lui du lieu de l'attentat, n'a perçu que le bruit de la détonation suivi du cri de la victime. Le garde républicain Jean Gérard, en faction à cent mètres de là, n'a pas entendu d'appel au voleur. Dans leur déclaration, Roland Lévy et Guillaume Hanoteau, qui se trouvaient sur un trottoir près du ministère, à moins de vingt mètres du lieu de l'attentat, ne parlent, eux aussi, que de la détonation et du cri qui lui a succédé.
Quant à l'objet même de la discussion qui se serait déroulée sur le boulevard des Invalides : « Ce mémoire de défense n’ayant pas été retrouvé par la suite, il a été allégué que Denoël aurait pu être assassiné, soit pour l’empêcher de mettre en cause diverses personnalités, soit même pour pouvoir lui enlever ce dossier. Cette thèse ne s’appuie sur aucun des témoignages recueillis. En effet, ni la partie civile ni aucun des témoins entendus n’a pu désigner de groupe de personnalités ni de personnalité pour qui des accusations éventuelles de Denoël eussent pu être gênantes ».
Tous les journaux avaient, depuis décembre 1945, évoqué le dossier constitué par l'éditeur qui, écrivaient-ils, mettait en cause d'autres éditeurs. Antonin Besson ne les a sans doute pas lus. D'autre part, « un tel mémoire de défense est généralement dactylographié et il est loisible de penser que si l’original peut se trouver entre les mains de l’intéressé, des copies peuvent également avoir été remises à ses conseils ou à des tiers. Le vol d’un tel dossier eût, par conséquent, risqué de rester inopérant. »
L'objection est d'importance. Denoël avait certainement fait photographier son mémoire. Si Antonin Besson a lu les différents rapports de police - et il l'a fait puisque des éléments de chacun d'eux se retrouvent dans son réquisitoire - il n'a pu manquer de relever ce qu'avait écrit l'inspecteur Ducourthial dans celui du 15 novembre 1946 :
« Quant aux pièces constituant la défense de Monsieur Denoël devant la Commission d’Epuration du Livre, Mme Loviton dit qu’elles étaient entre les mains de son avocat (Me Joisson). Elle croit pouvoir affirmer qu’il est absolument faux que, pour sa défense, il avait fait le projet de mettre en cause d’autres éditeurs parisiens. »
Jeanne Loviton n'était pas seule à penser qu'une copie du mémoire se trouvait chez Me Joisson. Après avoir interrogé Albert Morys, Ducourthial écrit : « D’après ce qu’il a pu comprendre, [Denoël] devait l’avoir remis à Maître Joisson. Il l’avait également fait photographier en cas de perte ou de vol. Il ignore ce que sont devenus ces documents, et signale qu’il possédait des archives 39 Boulevard des Capucines, archives qui n’ont pas été retrouvées après son décès. »
Un peu plus loin, l'inspecteur conclut : « D’après ce dernier [Albert Morys], il l’aurait remis à son avocat, Me Joisson, après l’avoir fait photographier. Mme Loviton le dit également, sans parler de photocopie. D’autres témoins en avaient entendu parler, mais ils ne savent ce qu’il est devenu. Quant à Me Joisson, il se retranche derrière le secret professionnel. »
En effet, Ducourthial a bien tenté, sans succès, de récupérer ce mémoire : « Quant au dossier constitué par Monsieur Denoël en vue de sa comparution devant la Commission d’Epuration du Livre, dossier que Mme Loviton prétend se trouver entre les mains de Maître Joisson, avocat, domicilié 5 rue de Chaillot, nous mentionnons qu’aucune confirmation n’a pu être obtenue à ce sujet, Maître Joisson, consulté, ayant déclaré se retrancher derrière le secret professionnel et n’avoir rien à dire. »
Pourquoi le juge Gollety n'a-t-il pas prescrit une commission rogatoire pour obtenir de l'avocat Joisson un document aussi essentiel à l'instruction, comme il l'avait fait en janvier 1950 pour George Hagopian, l'homme d'affaires de Denoël ?
« Les perquisitions et saisies ne sont pas interdites chez un avocat, mais la police et le parquet ne peuvent y rechercher que ce qui peut constituer le corps même de l'acte coupable. Le juge d'instruction qui envisage d'opérer une perquisition chez un avocat prévient le procureur général et le bâtonnier de l'Ordre. Ce dernier assiste à la perquisition qui doit être faite par un magistrat, mais pas obligatoirement un juge d'instruction. Le juge examine le dossier de l'avocat pour rechercher s'il découvre le corps du délit et, le cas échéant, procède à la saisie.
Le bâtonnier est saisi de toutes réclamations de l'avocat soulevant le secret professionnel. Il doit s'opposer aux investigations qui compromettraient ses droits et, éventuellement, faite noter au procès-verbal sa protestation pour permettre à la juridiction compétente de déterminer si la pièce saisie était ou non couverte par le secret professionnel. En cas d'une saisie irrégulière, l'instruction sera nulle. »
Les dispositions du Code sont précises et il convient de ne pas y déroger sous peine de causer la nullité de cette saisie. On ne sache pas que Ferdinand Gollety se soit risqué à la moindre démarche chez Me Joisson.
Tout se passe au cours de cette longue enquête comme si le mémoire en défense de l'éditeur n'avait aucune importance, comme s'il ne contenait que des coupures extraites de la Bibliographie de la France, ainsi que l'a prétendu René Barjavel, c'est-à-dire des documents aisément consultables ailleurs.
L'inspecteur Voges lui-même, qui considère que ce dossier est lié directement à l'assassinat, paraît sans réaction lorsque le directeur commercial des Editions Denoël, Auguste Picq, lui dit : « Le dossier devant constituer la défense de M. Denoël a été vu par moi, dans le bureau de M. Tosi, à un moment où il le compulsait, après le décès de M. Denoël. »
Il ne réagit pas davantage quand Fernand Houbiers, cousin de Cécile Denoël, déclare : « Il m’a dit avoir préparé un dossier, pour la Commission d’Epuration du Livre, en vue d’assurer sa défense. Il m’a dit que s’il était inculpé, beaucoup d’autres éditeurs le seraient en même temps que lui car son dossier contenait des preuves. Il m’a affirmé avoir été menacé mais sans me donner de détails. »
En réalité, Voges est bridé dans son enquête. Mais son rapport livre tous les éléments dont il a pu prendre connaissance à propos de ce mémoire :
« Certains minimisent l’importance de ce dossier, disant que les ouvrages parus en faveur de la collaboration sous l’Occupation étaient connus non seulement du Comité d’Epuration mais de tous les milieux littéraires. Nous ne contesterons pas ce point, mais il convient de remarquer que si les responsables de la publication d’ouvrages autant ou plus compromettants que les siens avaient été absous, ou bien Denoël devait bénéficier de la même mesure de faveur, ou bien le cas de ceux-ci devait être révisé.
Les intentions de Denoël, dont il ne paraissait pas faire mystère, ont pu indisposer certains de ses confrères qui avaient escompté, peut-être, l’élimination dans la profession d’un concurrent dangereux et en éprouver un certain ressentiment.
D’ailleurs la question se pose de savoir pourquoi ce dossier soi-disant sans importance n’a jamais été retrouvé.
D’autres pièces sans grand intérêt ont été produites dans cette affaire. Sans doute en eût-il été de même du dossier en question s’il avait été jugé sans intérêt, car personne ne conteste son existence.
Il n’est pas interdit de penser que ce dossier, au contraire, peut être la cause indirecte de l’assassinat de Denoël.
Denoël paraissait en effet accorder une grande importance à ce dossier, si nous en jugeons d’après son attitude agressive au moment où il devait être appelé à se justifier devant le Comité d’épuration du Livre, et son attitude a pu inspirer des craintes dans le monde des éditeurs, ce qui nous permet de supposer que certaines personnes pouvaient avoir intérêt à s’emparer de son dossier, soit par la violence, soit en le monnayant.
Une ou plusieurs de ces personnes auraient pu, sous un prétexte quelconque, provoquer un rendez-vous, non pas pour l’abattre, mais uniquement dans le but de s’assurer de son dossier. »
Un dossier « noir »
Les conclusions de l'inspecteur Voges sont formelles : c'est le mémoire en défense de Robert Denoël destiné à une prochaine comparution devant la Commission nationale interprofessionnelle d’épuration qui est convoité, qui fait l'objet d'une âpre discussion sur le boulevard des Invalides, et qui cause finalement sa perte.
Ce mémoire n'était pas tout à fait complet puisque, le 3 décembre à midi, Auguste Picq devait remettre à Denoël une pétition du personnel de sa maison d'édition demandant sa réintégration [cf. Documents].
Or l'éditeur avait été avisé, dès le 8 novembre, qu'il aurait à comparaître devant la Commission nationale interprofessionnelle d’épuration, qui siégeait au n° 47 de la rue Dumont d’Urville, dans le XVIe arrondissement, et qu'il était prié de lui envoyer « dans les dix jours » un mémoire en défense.
Cette commission instituée le 16 octobre 1944 était chargée de prononcer des sanctions définitives après examen du dossier des éditeurs compromis. Qui était chargé de constituer ces dossiers ?
Le 2 février 1945, Pierre-Henri Teitgen, ministre de l'Information, avait signé un arrêt nommant une Commission consultative de l’épuration de l’édition « chargée de réunir et de transmettre au ministre de l'Information tous les renseignements de nature à motiver la citation devant la Commission nationale interprofessionnelle d'épuration des éditeurs coupables de l'un des actes énoncés aux paragraphes 2 et 3 de l'ordonnance du 16 octobre 1944 sur l'épuration dans les entreprises ».
Cette commission, qui allait siéger au n° 117 du boulevard Saint-Germain, était composée :
de l'éditeur Raymond Durand-Auzias, président ;
de Francisque Gay, Pierre Seghers et Vercors, éditeurs ;
de Henri Malherbe, écrivain ;
de Jean Martin, chef de service chez Larousse, représentant les cadres de l'édition ;
de M. Damarez, employé chez Plon, représentant les employés de l'édition ;
de René Riff, Frédéric Weil et M. Dufour, libraires.
Le 8 octobre 1946, Raymond Durand-Auzias déclarait à l'inspecteur Ducourthial que « sa » Commission avait transmis à la Commission nationale interprofessionnelle d’épuration, 47 rue Dumont d’Urville, les dossiers de tous les éditeurs compromis, en demandant des sanctions contre eux :
« Nous avons notamment transmis le dossier de Denoël et avons demandé la sanction la plus grave contre lui, c’est-à-dire l’exclusion définitive de la profession. Denoël a été invité à présenter un mémoire en défense en novembre et il devait comparaître devant la Commission en décembre.
Il n’y a pas trace de convocation le concernant dans les dossiers de la rue Dumont d’Urville mais je crois pouvoir affirmer que cette convocation devait être lancée peu de jours après la date à laquelle il a été assassiné.
Le Président Richard, ancien Conseiller à la Cour de Cassation était alors Commissaire du Gouvernement près de la Commission interprofessionnelle. C’est lui qui fixait les dates de convocation ; il pourrait éventuellement vous renseigner. »
On note en passant que Durand-Auzias, dont la Commission consultative siège boulevard Saint-Germain (VIe arrondissement), est en mesure de vérifier que le dossier de Denoël à la Commission d'épuration, rue Dumont d'Urville (XVIe arrondissement), ne comporte pas d'invitation à comparaître, mais que cette convocation lui aurait été envoyée peu de jours après le 2 décembre 1945.
M. Richard, commissaire du Gouvernement près de la Commission d'épuration, répondit à l'inspecteur Ducourthial qu'il « ne pensait pas avoir lancé de citation à comparaître, mais que les poursuites devaient être rapides. »
Ducourthial concluait : « En un mot, il n’apparaît pas que la date à laquelle M. Denoël devait comparaître devant cette commission ait été fixée. Mme Loviton parle cependant du 17 décembre. Est-ce qu’elle était renseignée en sous-main, à moins que M. Denoël l’ait été lui-même, ce n’est pas impossible. »
Il y avait de fortes chances, en effet, pour que Mme Loviton fût bien renseignée « en sous-main ». Si Denoël n'avait pas envoyé dans le délai fixé son mémoire en défense rue Dumont d'Urville, c'est qu'il savait que les comparutions suivaient généralement de quinze jours les citations, et qu'il disposait encore de quelques jours pour parfaire son dossier. Auguste Picq, toujours bien informé, avait déclaré à la police que Denoël aurait dû comparaître « au cours de la semaine qui a suivi son décès », soit entre le 3 et le 7 décembre 1945.
La Commission d'épuration aurait donc eu à se prononcer sur le cas de la Société des Editions Denoël au vu du rapport remis par la Commission consultative présidée par Raymond Durand-Auzias, et on sait que cet éditeur avait demandé la sanction la plus grave contre Denoël, c'est-à-dire l'exclusion définitive de la profession.
Né le 10 décembre 1889 à Corbeil, Raymond Durand-Auzias était, comme Jeanne Loviton, éditeur d'ouvrages de droit. Il dirigeait, avec Robert Pichon, la Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, une très ancienne maison d'édition remontant à 1904 et établie au n° 20 de la rue Soufflot, près de la Sorbonne.
A la déclaration de guerre, il était trésorier du Cercle de la librairie et du Syndicat des éditeurs. En décembre 1940 et en janvier 1941, il fut nommé par le Tribunal de commerce [dont il avait été président de chambre] administrateur provisoire de plusieurs maisons d'édition juives telles que Ferenczi, Nathan, Gedalge, Cluny.
Sa maison d'édition n'avait pas eu trop à souffrir des différentes listes d'interdiction puisque deux titres seulement furent mis à l'index, ce qui permit au journal France libre, dans un article titré : « Le Syndicat de l’Edition a servi l’ennemi », d'écrire le 22 septembre 1944 à propos de ses trois dirigeants, dont le trésorier Durand-Auzias : « Il est vrai que tous trois représentent au sein du syndicat qui a fait tant de mal à la librairie française pendant la guerre, des firmes ne publiant que des ouvrages scientifiques ou de jurisprudence qui ne risquaient pas de figurer sur les listes Otto. »
En décembre 1944, Durand-Auzias fait partie des membres fondateurs du groupement « Pour le Livre », un groupe d’éditeurs « restés dignes pendant l’Occupation » qui se proposent de vérifier la déontologie du métier. Ces « chevaliers blancs » furent présents dans la plupart des comités d’épuration ultérieurs.
Le 2 février 1945, Raymond Durand-Auzias est nommé président de la Commission consultative de l’épuration de l’édition. Dès le 6 mars, il envoie au ministre de l'Information une lettre dans laquelle il regrette que l’on ne puisse traiter l’édition comme n’importe quel commerce, et que l’ordonnance du 16 octobre 1944 sur l’épuration dans les entreprises ne prévoie pas que certains noms de firmes trop compromises puissent être changés : « il serait aussi préjudiciable, pour le prestige français, de voir subsister certains noms de firmes comme " Editions Denoël " que de laisser par exemple subsister le nom de certains journaux comme Gringoire ou Le Pilori, même avec une direction nouvelle ».
Comparer les Editions Denoël, dont le catalogue est riche de plus de 700 titres, à des officines de délation comme Au Pilori montre à suffisance que Raymond Durand-Auzias, éditeur de livres de droit, a quelques comptes personnels à régler avec son confrère Robert Denoël, éditeur de livres de littérature.
Sachant que, dans le même courrier, il a proposé au ministre deux séries de mesures :
- Pour les éditeurs : blâme - interdiction temporaire d’exercer la profession - interdiction définitive
- Pour les maisons d’édition : placement sous administration provisoire avec possibilité pour l’administrateur de changer le nom de l’entreprise et de la vendre en s’assurant qu’elle ne soit pas rachetée par un prête-nom de l’ancien propriétaire
et qu'il a demandé la sanction la plus grave pour son confrère belge, la situation de Robert Denoël n'était guère enviable au début du mois de décembre 1945.
J'avais, en 1980, interrogé Jeanne Loviton à propos de cette surprenante animosité. Elle s'était contentée de répondre qu'un « pacte de non-agression » avait été passé avec son confrère Durand-Auzias « au nom de la vieille amitié qui l'avait lié à son père, Fernand Loviton ». Que valait un tel pacte puisque la Commission présidée par Raymond Durand-Auzias n'avait qu'un avis consultatif ?
Mme Loviton était parfaitement informée : en avril 1945, la Commission consultative de l'épuration de l'Edition avait obtenu d'être représentée, lors de la comparution d'un éditeur devant la Commission nationale interprofessionnelle d’épuration, par son président Durand-Auzias et deux de ses membres, « chargés d'observer les débats et, le cas échéant, d'aider la Commission à soutenir son point de vue devant le tribunal. »
Que se serait-il passé le 17 décembre 1945 si Denoël avait comparu devant cette Commission d'épuration où l'on prononçait des condamnations qui n'étaient pas toujours de principe ?
Le 17 mai 1945, elle avait prononcé un blâme sans publicité contre Fernand Sorlot, alors que la Commission consultative réclamait son exclusion à vie. Le 3 décembre 1945, elle avait simplement interdit à Gilbert Baudinière de conserver un poste à responsabilité dans l'édition - et Baudinière avait fait appel.
Le 21 décembre 1945, la Commission consultative de l'épuration de l'Edition, écœurée par tant d'indulgence, donnait en bloc, sa démission. Est-ce à dire que si Denoël était passé à son heure devant cette Commisssion d'épuration, il aurait bénéficié d'une décision de classement ?
En quoi l'affaire Denoël de juillet 1945 différait-elle de l'affaire Denoël de décembre 1945, ou d'avril 1948 ? La ligne de défense fut « la même que lors du procès de Robert Denoël », écrit Fouché. De fait, les livres qui furent reprochés à Robert Denoël en avril 1948 étaient les mêmes qu'en juillet 1945.
En réalité, il n'y eut jamais qu'une affaire Denoël, qui s'étala sur cinq ans - cinq années durant lesquelles les gouvernements, et les rapports de force, se modifièrent. Raymond Durand-Auzias est mort le 3 juin 1970.
Revenons au dossier constitué par Robert Denoël. Tous les éditeurs incriminés étaient invités à produire un mémoire en défense. Ce qu'ils y mettaient concernait leur activité durant l'Occupation : c'est de cela seulement qu'ils avaient à répondre, pas des publications de leurs confrères.
Pourquoi Denoël aurait-il fait exception à cette règle ? En quoi des livres publiés par d'autres l'auraient-ils mis hors de cause ?
Dès le 4 décembre 1945, Libération écrit que l'éditeur avait, « paraît-il, affirmé qu'il ferait des révélations mettant en cause d'autres éditeurs. A-t-on voulu l'empêcher de parler ? »
Le 17 janvier 1950, Paul Bodin publie dans Carrefour un article sur l'affaire Denoël qui vient de rebondir en raison de la constitution de partie civile de la veuve de l'éditeur. Il évoque un « dossier noir constitué par Denoël, dont on parlait dans tout Paris et qui mettait en cause d’autres éditeurs. L’un d’entre eux aurait eu recours à une police politique renommée pour abattre un témoin gênant ».
Edmond Buchet, l'un des directeurs des Editions Corrêa, écrit dans son journal, le 3 décembre 1945 : « Ce qu'il y a de troublant, c'est que Denoël se trouvait à la veille de passer devant un tribunal qui l'aurait probablement blanchi car il avait multiplié les démarches, et que, d'autre part, il avait menacé d'ouvrir un dossier qu'il avait constitué à propos d'un de nos plus grands confrères. »
Voilà un dossier dont personne ne connaît le contenu, mais dont tout Paris parle, et qui met en cause d'autres éditeurs, dont l'un aurait décidé de réduire au silence un confrère trop bavard. Il n'est pas question de leurs publications - qu'on peut vérifier dans Bibliographie de la France - mais de leurs activités durant l'Occupation.
Quel pouvait être l'objet du marché que Denoël s'apprêtait à conclure avec deux avocats dont l'un était communiste, et l'autre résistant ? S'agissait-il de payer pour sortir indemne d'un procès qui s'annonçait mal ? Ou bien l'éditeur devait-il marchander une partie du contenu de son mémoire en défense ?
Denoël apportait-il de l'argent (or ou devises étrangères : la monnaie serait dévaluée le lendemain) ou des documents extraits de son mémoire et qui concernaient certaines personnalités ? Etant donné qu'il avait confié une copie de son dossier à Me Joisson, son avocat, ces documents dupliqués n'auraient pas eu grande valeur.
On peut penser que c'est son argent qu'on lui a dérobé aux Invalides - sauf celui qu'il serrait dans un portefeuille retrouvé intact - puis, dans un deuxième temps, son dossier, resté dans sa garçonnière ou chez Jeanne Loviton.
Deux témoins controversés
Dès le 4 décembre 1945 Ce Soir signale la présence sur les lieux de l’attentat de « deux employés qui sortaient du ministère du Travail tout proche et qui ont découvert le corps ».
Ces deux « employés » ne seront plus évoqués dans la presse avant le 3 avril 1950, lorsque Georges Gherra révèle dans France-Soir l’existence d’un document rédigé par le gardien de nuit du ministère du Travail à propos de deux personnes dont la présence dans le bâtiment, avant et après le crime, lui avait paru insolite.
Le 30 avril c’est Roger Darbois qui, dans un article à sensation, publie leurs noms dans l’hebdomadaire Express-Dimanche : Pierre Roland Lévy, « magistrat de carrière, aujourd’hui membre du Conseil supérieur de la Magistrature et qui à l’époque avait un bureau au ministère du Travail » et son ami Guillaume Hanoteau, « qui fut jadis avocat ».
La partie civile, écrit Darbois, a relevé un fait : c’est que ces deux témoins apparaissant comme accidentels connaissaient l’éditeur et sa maîtresse. Guillaume Hanoteau et Jeanne Loviton ont fait partie, avant la guerre, du même cabinet d’avocats, celui de Me Maurice Garçon.
En fait, Hanoteau a tenu, à partir de mars 1934, le même rôle que Jeanne Loviton auprès de Maurice Garçon :

Journal des débats politiques et littéraires, 21 octobre 1934
« Or, les dépositions des deux témoins ne font aucune mention qu’ils aient reconnu l’éditeur, pas plus qu’ils aient reconnu Mme Loviton, qu’ils rencontrèrent sur le trottoir du ministère ».
Quelques jours plus tard Jeanne Loviton porte plainte contre l’hebdomadaire et lui réclame des dommages-intérêts exorbitants, ce qui incite désormais le journaliste à la prudence. C’est à peu près tout ce que les lecteurs de l’époque ont pu apprendre à propos de ces singuliers témoins.
Le 6 juillet, le juge Gollety prononce un nouveau non-lieu dans l’assassinat de l’éditeur, non-lieu confirmé trois semaines plus tard par la cour d’Appel de Paris. La presse fera désormais le silence sur l’affaire.
L’examen du dossier montre que les noms de Lévy et Hanoteau sont apparus très tôt. L’inspecteur Ducourthial a interrogé le gardien du ministère quelques heures après l’attentat et André Ré lui a parlé de la présence de Roland Lévy au ministère, à l’heure du crime, en compagnie d’un ami qu’il ne connaît pas.
Lévy a refusé de parler aux policiers mais il a envoyé, le 3 décembre 1945, une lettre au commissaire Pinault dans laquelle il donne sa version des faits, en signalant la présence d’un ami dont il ne donne pas le nom. Lévy ne sera jamais entendu par la police mais sera interrogé le 11 mai 1950 par le juge Gollety. Le 27 mai il envoie un droit de réponse à l’hebdomadaire Express-Dimanche qui l’avait mis en cause dans l’article à sensation paru le 30 avril. Ce sont les seules manifestations publiques de ce magistrat communiste.
Le nom de Guillaume Hanoteau est cité dès le 3 décembre 1945 au matin par son ami Flavien Monod : c’est lui qui annonce la nouvelle de l’attentat à son père, Maximilien Vox.
Et Vox le nomme à son tour devant Cécile Denoël, à qui il va présenter ses condoléances le lendemain : « C'est lui qui m’annonça que Me Hanoteau, alors avocat à la Cour, s’était trouvé un des premiers sur les lieux du crime avec M. Roland Lévy, directeur du Cabinet du ministre du Travail, et que Me Hanoteau était un ami de son fils Flavien Monod ; c’était par ce dernier qu’il avait appris ce qui s’était passé », écrit Cécile au juge Gollety, le 8 janvier 1950.
Au cours d’une confrontation avec la partie civile dans le bureau du juge Gollety, le 10 mai 1950, Guillaume Hanoteau déclare : « Me Rozelaar m’a téléphoné une semaine après le crime et je lui ai donné des détails qu’il ne connaissait pas. »
Armand Rozelaar avait en effet contacté directement Hanoteau : « Il existe un autre témoin que je vous demande de bien vouloir entendre. Il s’agit de M. Hanoteau, avocat à la Cour de Paris, demeurant 13 rue de Verneuil. Ce dernier témoin vous donnera quelques éclaircissements qui pourraient être extrêmement importants pour la suite de votre instruction », écrit l’avocat au juge Gollety, le 21 mai 1946.
Ainsi, dès le début de l’enquête, quatre personnes au moins connaissent le nom du second témoin direct de l’assassinat de l’éditeur : Cécile Denoël, Armand Rozelaar, Maximilien Vox, Flavien Monod.

Guillaume Hanoteau en 1980
Apparemment la police l’ignore puisque, dans le premier rapport qu’il dépose le 25 janvier 1946, l’inspecteur Ducourthial, qui cite la lettre envoyée le 3 décembre 1945 par Roland Lévy, écrit : « Nous n’avons pas jugé utile d’entendre l’ami de M. Roland Lévy dont ce dernier n’a d’ailleurs pas cru [devoir] nous communiquer le nom et l’adresse. »
Ce n’est que lorsque Mme Denoël se porte partie civile, le 23 mai 1946, que le nom de Hanoteau apparaît dans le courrier de son avocat au juge d’instruction, lequel en informe les enquêteurs. Or, au terme de sa seconde enquête, l’inspecteur Ducourthial écrit le 15 novembre 1946 :
« Nous n’avons également pu recueillir la déclaration de M. Hanoteau, avocat à la Cour, demeurant 13 rue de Verneuil à Paris. Il est l’ami de M. Lévy Roland, chef de cabinet de Monsieur le ministre du Travail, lequel n’a pas jugé utile de nous donner son nom lorsque nous l’avons consulté le lendemain du drame.
Touché par téléphone le 9 octobre 1946, M. Hanoteau a fait connaître à l’Inspecteur principal adjoint Ducourthial qu’il ne savait rien de plus de ce qui nous avait été dit par M. Roland Lévy, en acceptant néanmoins de venir faire sa déposition.
Rendez-vous fut pris mais il ne vint pas. A la suite d’une visite que lui rendit plus tard l’inspecteur Tifa, il promit de nous faire parvenir ses déclarations par lettre, lettre que nous n’avons jamais reçue. »
Ducourthial sait certainement que Guillaume Hanoteau a fait partie de la Résistance, mais paraît ignorer qu’il a été rayé de l’Ordre du barreau de Paris en décembre 1945. Pourquoi a-t-il autant d’égards pour ce témoin capital qui ne paraît pas pressé de témoigner, et pourquoi clôture-t-il son enquête sans l’avoir entendu ?
Hanoteau, à qui Cécile Denoël reprochera, devant le juge Gollety, son peu d’empressement à aider la police, en lui demandant pourquoi Roland Lévy n’a pas jugé utile de citer son nom dans sa lettre du 3 décembre 1945, répondra simplement : « Il a eu tort. En tous les cas, en ce qui me concerne, je n’ai jamais caché cette affaire. »
Le 21 décembre 1949, Armand Rozelaar remet au procureur de la République un mémoire contenant de nouveaux éléments susceptibles de faire rouvrir l’enquête sur le meurtre de l’éditeur et, une semaine plus tard, le Parquet ordonne la reprise de l’instruction.
Mais l’avocat, en concentrant ses attaques sur des questions d’intérêt, va amener la police à indaguer en priorité dans cette direction, au détriment de l’enquête sur le meurtre proprement dit. Ce n’est que plus tard - un peu trop tard -, quand il reviendra sur les circonstances de l’attentat, que de nouvelles pistes apparaîtront.
L’équipe du commissaire Henri Mathieu, qui reprend l’enquête le 16 janvier 1950, interroge Hanoteau le 14 février et le 18 mars ; le 10 mai il est confronté à Cécile Denoël dans le cabinet du juge d’instruction Gollety.
Il convient de suivre ses déclarations ligne à ligne pour les comparer avec celles des autres témoins interrogés peu après par la police ou par le juge d’instruction : André Ré, M. Le Guerne, Yves Testud, et Roland Lévy.
« Le 2 décembre 1945, vers 21 heures, je sortais du ministère du Travail, rue de Grenelle, en compagnie de M. Roland Lévy, chef du cabinet du dit ministère. »
Roland Lévy avait écrit : « Hier 2 décembre 1945, vers 21 h 15, je sortais accompagné d’un ami, du ministère du Travail ».
Les heures ne concordent pas mais les deux hommes déclarent qu’ils sont sortis ensemble du ministère. Or André Ré, qui a débuté sa garde à 19 heures, a pu constater que Lévy se trouvait au ministère dès 20 heures 30 et qu’il était seul dans son bureau, puisqu’il s’y est rendu pour fermer les volets.
Hanoteau aurait-il pu y pénétrer ensuite ? C’est ce qu’il déclare le 10 mai : « J’ai dû arriver vers 8 heures 50 au ministère. Nous sommes restés quelques instants dans le cabinet de Roland Lévy puis nous avons décidé d’aller à la Chambre des Députés où il y avait une séance importante. »
M. Le Guerne, le concierge du ministère, est formel : « La porte d’entrée du ministère est toujours fermée le dimanche et l’ouverture est manœuvrée par un bouton électrique. Quand quelqu’un sonne, on ouvre la porte et on le laisse pénétrer s’il est connu. »
André Ré, on le verra plus loin, ne connaît pas Hanoteau. Aurait-il pu entrer en se recommandant de Roland Lévy ? Peut-être, mais son nom aurait alors dû figurer sur le registre des entrées qui, dans ce ministère dirigé depuis quelques jours à peine par des communistes, était rigoureusement tenu.
Dans le cabinet du juge Gollety, la partie civile lui pose la question : « La porte du ministère était-elle ouverte ou fermée ? » Il répond : « Elle devait être fermée.» On lui demande alors comment il a pu entrer, et il dit : « Le concierge m’a demandé où j’allais », ce qui suppose qu’il était déjà à l’intérieur.
Comme il avait assuré précédemment qu’il s’était rendu à trois reprises au ministère pour voir son ami Lévy, la partie civile insiste pour qu’il situe son bureau, et il déclare : « Le bureau de Roland Lévy devait se trouver donnant à droite en entrant, donnant sur le boulevard des Invalides », ce qui est exact, mais quand on lui demande de préciser si c’est au rez-de-chaussée, il reconnaît qu’il n’en sait rien.
C’est donc le portier qui aurait dû le lui indiquer ou l’y mener, or il n’a aucun souvenir de ce visiteur puisque, lorsque Roland Lévy rentre un peu plus tard au ministère, accompagné de Hanoteau, Ré parle « d’un monsieur que je ne connaissais pas ».
Le témoignage d’André Ré, qui était garçon de bureau et assurait le service du concierge ce soir-là, est-il entièrement fiable ? Pas sur ce point précis puisqu'il déclare qu’à 21 heures 10 environ, Lévy est sorti du ministère : « Je ne me souviens plus très bien s’il était accompagné de quelqu’un mais mes souvenirs ne sont plus très précis à ce sujet. »
Ces témoignages tardifs manquent tous de précision. Malgré ce qu’en a dit Le Guerne, et bien que Hanoteau soit incapable d’expliquer comment il y est entré, les enquêteurs peuvent penser qu'il est bien sorti du ministère en compagnie de Lévy, puisque c’est ce que l’agent Testud déclarait avoir vu.
Mais la suite va vite faire problème car Hanoteau déclare, le 10 mai, au juge Gollety : « Nous sommes sortis du ministère du Travail et sur le pas de la porte Roland Lévy s’est aperçu qu’il avait oublié je ne sais quoi. Il est remonté et je suis resté seul dans la rue. Au bout d’un temps indéterminé, j’ai entendu un coup de feu et un brouahara [sic]. A cet instant même, Roland Lévy sortait du ministère du Travail, nous avons couru en direction du coup de feu ».
La déclaration qu’il a faite aux enquêteurs, deux mois plus tôt, était assez proche : « Alors que nous venions de franchir la porte, M. Lévy s’est aperçu qu’il avait oublié un dossier. Il est remonté et j’ai parcouru en l’attendant environ une quinzaine de mètres en direction de la rue de Bourgogne. A ce moment, j’ai entendu un coup de feu que j’ai situé comme provenant de l’angle du boulevard des Invalides et de la rue de Grenelle. J’ai rebroussé chemin immédiatement pour aller me rendre compte et, en repassant devant le ministère du Travail, j’ai rencontré M. Roland Lévy qui en ressortait. Je ne puis dire si M. Lévy a entendu le coup de feu ou si je lui en ai fait part, mais il m’a accompagné. »
Ce n’est pas ce qu’avait écrit Roland Lévy le lendemain du meurtre, ni ce qu’avait déclaré l’agent Testud : selon eux, c’est alors que les deux hommes sortaient du ministère qu’un coup de feu avait éclaté, et qu’ils avaient couru en direction du boulevard.
On notera que Roland Lévy écrit que le coup de feu « provenait de la direction du boulevard des Invalides », alors que Hanoteau, lui, déclare qu’il provenait « de l’angle du boulevard des Invalides et de la rue de Grenelle. » Et on saluera l'intrépidité des deux avocats qui, alors que l'agent Testud reste pétrifié sur son trottoir, se précipitent, un soir où il brouillasse, en direction d'un endroit désert où vient d'éclater un coup de feu.
Pourquoi Hanoteau invente-t-il cette pseudo-rentrée de Lévy au ministère ? Armand Rozelaar pense que c’est pour accorder son récit à celui d’André Ré, mais elle ne peut en aucun cas être confondue avec le retour des deux hommes, que Ré situe un peu plus tard : « Environ 7 ou 8 minutes après, M. Roland Lévy a sonné à la porte d’entrée. Je lui ai ouvert. Il était accompagné d’un monsieur que je ne connaissais pas, de taille moyenne. M. Lévy m’a dit : “ Ne vous dérangez pas, je vais chercher mes cigarettes. C’est un drôle de coin, votre quartier, il vient d’y avoir un attentat à l’angle du boulevard. ” »
Si le témoignage de Ré est imprécis sur certains points, il ne l’est pas quant aux paroles prononcées par Lévy, qui sont confirmées par Le Guerne : « Vers 21 heures 15, Mr Ré m’a fait connaître qu’un attentat venait d’être commis [...] Il m’a dit l’avoir appris par deux membres du Cabinet qui étaient sortis du ministère et revenus quelques minutes après. »
Quand Lévy et Hanoteau se font ouvrir la porte du ministère par André Ré, l’attentat a donc déjà eu lieu, mais à quel moment y entrent-ils ? Le gardien rapporte les paroles prononcées alors par Lévy : « Je crois qu’il m’a parlé d’un homme qui était occupé à réparer sa voiture. Il a dit au monsieur qui l’accompagnait : “ Ça doit être une histoire de bonne femme ”. »
Si les deux témoins parlent d’une voiture accidentée et d’une « bonne femme », ce ne devrait être qu’après l’arrivée de Jeanne Loviton sur les lieux de l’attentat. Or, son taxi ne l’y a déposée que vers 21 heures 35, après quoi « nous en avons discuté avec le brigadier. Le car de police est parti, et nous avons discuté, je crois, avec le concierge du ministère du Travail», dit Hanoteau.
Il situe donc leur retour au ministère et la discussion avec le concierge beaucoup plus tard que le faisaient Ré et Le Guerne, qui parlaient de 21 heures 15. Les enquêteurs peuvent alors penser que les gardiens du ministère, interrogés cinq ans après les faits, n’ont plus de la chronologie des événements qu’une idée approximative.
Mais le 30 avril Express-Dimanche a publié un article à sensation qui mettait en cause Jeanne Loviton, Hanoteau et Lévy, et ce dernier a cru bon d’envoyer, le 27 mai, un droit de réponse à l’hebdomadaire dans lequel il écrit qu’après avoir découvert le corps de l’éditeur, il est « retourné immédiatement au ministère donner l’ordre au concierge d’appeler Police-Secours. »
Il est avéré que l’agent Testud était l’auteur de l’appel à partir de la borne téléphonique située sur le boulevard des Invalides. Pourquoi Roland Lévy éprouvait-il le besoin de justifier ainsi son retour au ministère ?
Dans son rapport du 25 mai 1950 l’inspecteur Voges a épinglé ces contradictions : « Nous signalons malgré tout que M. Hanoteau maintient sa déclaration en ce qui concerne le retour de M. Lévy au ministère qu’il situe, répétons-le, avant le coup de feu, se trouvant en contradiction avec le gardien de nuit Ré, tout en admettant qu’après le départ de police-secours, en quittant les lieux, il est possible que M. Lévy soit retourné à son cabinet, ajoutant qu’il avait le vague souvenir d’une conversation avec le portier. »
Hanoteau commettait à son tour une bévue en laissant entendre que Lévy était peut-être retourné, seul, au ministère, puisque Ré déclarait : « Ils sont rentrés tous les deux dans la cour du ministère. J’ai refermé la porte d’entrée. J’ai proposé à M. Lévy de l’accompagner à son bureau avec une lampe pour lui permettre de traverser la cour. Il m’a répondu que ce n’était pas la peine. Je ne me souviens plus si le monsieur qui l’accompagnait l’a suivi jusqu’à son bureau mais je puis affirmer que ce dernier était bien rentré dans le ministère. M. Lévy est resté absent pendant 4 ou 5 minutes. Je lui ai ouvert la porte à nouveau, ainsi qu’à son compagnon. »
Pour couronner le tout, Hanoteau déclarait que Roland Lévy et lui avaient décidé, vers 21 heures, « d’aller à la Chambre des Députés où il y avait une séance importante », et il s’avérait que cette séance très ordinaire s’était terminée... à 21 heures. Quant à Lévy, il expliquait leur rendez-vous par l’envie d’aller dîner ensemble.
Ces contradictions ne furent sanctionnées que par une remarque, sans conséquence, de l’inspecteur Voges à la fin de son rapport : « la présence de M. Hanoteau à proximité des lieux, le soir et à l’heure du drame, est due à un concours de circonstances extraordinaires. »
Le Procureur de la République, dans son réquisitoire définitif du 1er juillet 1950, fit beaucoup mieux : « Ainsi donc et bien qu’il eût pu adopter cette même version des faits s’il était coupable, Hanoteau dont la bonne foi ne paraît pas douteuse est en contradiction avec les précédents témoins sur les circonstances dans lesquelles il perçut le bruit de la détonation. Aucun élément de l’information ne permet de suspecter son attitude. »
Lorsqu’il rédige son texte, Antonin Besson sait que Guillaume Hanoteau a, en décembre 1945, été radié à l’unanimité du Barreau de Paris, et il sait certainement pour quelles raisons.
Il n’ignore pas non plus que Roland Lévy est en difficultés dans son propre parti, qui n’est plus au pouvoir. A aucun moment il ne paraît se demander ce qu'il faisait à cette heure tardive, un dimanche soir, dans un ministère désert.
Il a le pouvoir de réclamer au juge Gollety un complément d’enquête, comme le lui demande la partie civile. Au lieu de quoi, il dit qu’il n’y a pas lieu à poursuivre. Et le juge Gollety, suivi par la Cour d’appel, lui emboîte le pas : le non-lieu définitif est prononcé.
*
Cécile Denoël et son avocat, qui ont beaucoup travaillé sur cette enquête, n'avaient pas épuisé toutes leurs cartouches. Quels étaient les éléments avancés par la partie civile, et qui ont été écartés par la Cour ?
Armand Rozelaar a relevé, avec raison, qu’un rassemblement avait été observé par plusieurs témoins autour du corps de la victime, mais à des moments différents.
Le garde républicain Jean Gérard, qui se trouvait en faction dans les jardins des Invalides, et qui est sorti immédiatement après le coup de feu, a aperçu deux ombres à l’angle du boulevard des Invalides et de la rue de Grenelle, puis il a vu un gardien de la paix [Yves Testud] venir dans sa direction et ensuite téléphoner à l’avertisseur « Police-Secours » qui se trouvait devant sa guérite.
Gustave Pavard, le concierge du 142 bis, rue de Grenelle, a entendu une détonation suivie d’un cri, et il est sorti immédiatement : il a vu, à moins de dix mètres, plusieurs personnes rassemblées autour du corps d’un homme allongé sur le trottoir d’en face.
Le colonel L’Hermite, qui habite un appartement du sixième étage dans le même immeuble, a entendu un appel « au voleur » (il est le seul) suivi d’un coup de feu : il s’est penché immédiatement et a aperçu un rassemblement à l’endroit où gisait le corps de la victime.
Dans son rapport, l’inspecteur Voges écrit : « Une chose est assez surprenante, c’est que le colonel L’Hermite et sa femme aient pu voir aussi rapidement un rassemblement. Sur ce point, alors qu’apparemment M. Lévy et son ami Hanoteau, premiers témoins qui aient découvert la victime, ne semblent avoir vu à leur arrivée personne autour du corps, ni dans le voisinage, et que ce n’est que lorsqu’ils sont revenus sur les lieux, accompagnés de l’agent Testud, dit M. Lévy, que plusieurs personnes se trouvaient autour de la victime. »
Hanoteau avait décrit, lui aussi, le 10 mai 1950, une scène déserte : « nous sommes arrivés au coin du boulevard des Invalides et de la rue de Grenelle, et nous avons vu un corps étendu sur le trottoir. Roland Lévy s’est approché et il a dû dire : “ Il est mal en point ”. Roland-Lévy a appelé l’agent qui devait revenir prendre sa garde. » Ce n’est qu’ensuite que « des gens sont arrivés de l’esplanade des Invalides et un concierge est sorti d’une maison située rue de Grenelle, juste en face du lieu du crime. »
Le 14 février 1950 il avait, dans sa première déclaration à l’inspecteur Voges, distribué autrement les rôles : «Arrivés tous deux à l’angle du boulevard des Invalides et de la rue de Grenelle, nous avons vu un homme sortir d’un immeuble situé à droite dans la rue de Grenelle. Cet homme devait être le concierge. A notre gauche et sur le trottoir du boulevard des Invalides un homme gisait, étendu sur le dos [...] Encore à ce moment nous n’étions que trois : M. Lévy, le concierge et moi-même. [...] Presqu’aussitôt, c’est-à-dire environ 30 secondes plus tard, deux ou trois personnes sont arrivées et se sont jointes à nous. Elles venaient de l’esplanade des Invalides. Je crois qu’il y avait deux hommes et une femme. Un gardien de la paix est venu ensuite. »
Apparemment, ces témoignages sont discordants et pourtant ils décrivent tous un attroupement autour de la victime. Armand Rozelaar se demande alors s’ils décrivent bien le même rassemblement et il compare les différentes déclarations.
Roland Lévy et Guillaume Hanoteau découvrent le corps d’un homme gisant seul sur le boulevard. Le second voit surgir presqu’aussitôt le concierge du 148 bis rue de Grenelle, Gustave Pavard. A ce moment, dit Hanoteau, ils ne sont que trois : Lévy, Pavard et lui-même. L’agent Testud n’est donc pas encore sur les lieux : c’est eux qui vont ensuite l’appeler rue de Grenelle.
Pavard déclare qu’il aperçoit plusieurs personnes rassemblées autour d’un corps allongé. Il ne donne pas leur nombre, et il ne dit pas qu’il s’est joint à elles. Ce n’est que dans sa seconde déclaration qu’il dit avoir traversé ensuite la rue de Grenelle pour se mêler aux badauds qui entouraient le corps de l’éditeur.
Yves Testud explique que Lévy et Hanoteau l’ont appelé alors qu’il se trouvait devant la porte du ministère, et qu’il s’est rendu avec eux sur le boulevard où il a découvert un homme étendu, seul. Il s’est alors dirigé vers la borne « Police-Secours » située à l’angle de la rue de Varenne et du boulevard des Invalides, tandis que les deux hommes gardaient le corps.
Le garde républicain Jean Gérard, de faction à cent mètres, sur le trottoir de droite, côté Invalides, aperçoit deux ombres à l’angle du boulevard des Invalides et de la rue de Grenelle, puis le gardien Testud qui se dirige vers lui, sur le trottoir de gauche, pour appeler du secours à l’avertisseur « Police-Secours ».
Le colonel l’Hermite, qui habite un appartement au 6e étage de l’immeuble de Pavard, 142 bis rue de Grenelle, entend un coup de feu, ouvre aussitôt sa fenêtre et aperçoit plusieurs personnes à l’angle du boulevard et de la rue de Grenelle.
Ces cinq témoins décrivent tous des lieux déserts d’où ils n’ont vu personne s’enfuir. Tous avaient un champ de vision dégagé et l’endroit était bien éclairé.
Me Rozelaar en conclut qu’il a dû se produire deux attroupements à des moments bien distincts, et que le second, qui comportait un plus grand nombre de personnes, ne peut être confondu avec celui que décrivent les cinq témoins ci-dessus.
En effet, après 21 heures 30, on trouve sur les lieux de l'attentat :
* Le car de police-secours qui emmène cinq hommes
* Yves Testud, le gardien de la paix
* Jeanne Loviton
* Le chauffeur de taxi Desprez
* Le concierge Gustave Pavard
* Roland Lévy et Guillaume Hanoteau
* Un nombre indéterminé de badauds
Guillaume Hanoteau avait déclaré, à propos de ces badauds survenus rapidement sur les lieux : « deux ou trois personnes sont arrivées et se sont jointes à nous. Elles venaient de l’esplanade des Invalides. Je crois qu’il y avait deux hommes et une femme. »
Et, parmi elles, un « homme coiffé d’un chapeau sombre, qui a déclaré qu’il avait entendu crier " au voleur " avant le coup de feu », selon Roland Lévy.
Quinze personnes rassemblées autour de la victime, c’était bien le nombre avancé par Gustave Pavard dans sa déclaration de 1950. Il ne pouvait donc s’agir des « quelques personnes » présentes auprès du corps immédiatement après le coup de feu dont ce même Pavard avait parlé en janvier 1946.
Dans une lettre adressée le 24 mars 1950 au juge Gollety, Me Rozelaar en arrivait à cette conclusion : « Si Denoël a été abattu par un coup de feu et qu’immédiatement après, tous les témoins sont d’accord pour dire qu’il ont aperçu quelques personnes sur le trottoir, mais qu’ils n’ont vu aucune de ces personnes prendre la fuite, c’est qu’évidemment, Denoël a été abattu par une de ces personnes. »
L'accusation tombe comme un couperet. A partir de ce moment l'avocat, qui ne perd pas pour autant de vue le mobile d'intérêt, va s'appliquer, durant deux mois, à étayer sa démonstration.
Il en revient donc à ce « premier » attroupement, « qui devait normalement se composer de trois personnes : MM. Lévy et Hanoteau et Mme Loviton » :
« On crève le pneu soit d’un coup de canif, soit en tirant une balle (Gérard croit en effet avoir entendu deux détonations) et l’on expédie Mme Loviton au Commissariat de police pour y chercher un taxi, avec la thèse du pneu crevé accidentellement au moment où on se rendait au théâtre. [...]
Mr Ré constate que 8 minutes environ après son premier départ, M. Pierre Roland-Lévy revient au ministère accompagné d’un ami et, chose curieuse, il sait à ce moment-là, non seulement qu’un homme est étendu râlant sur le trottoir, boulevard des Invalides, mais que cet homme était en train de réparer une voiture, et qu’il s’agit sans doute d’une " histoire de bonne femme ".
Puis M. Roland-Lévy monte dans son bureau avec ou sans Hanoteau. Peu importe. Mr Ré est formel, les deux hommes sont entrés ensemble dans le ministère, ils y sont restés ensemble et ils en sont sortis ensemble.
La station dans le bureau, sous prétexte d’y rechercher un paquet de cigarettes, dura quatre à cinq minutes. Exactement et au chronomètre, le temps qu’il faut pour aller à pied du 127 de la rue de Grenelle au poste de police.
Puis ces messieurs sortent du ministère, tournent le coin, reviennent vers l’agent Testud et lui annoncent qu’un homme est là, râlant sur le trottoir.
Ont-ils suggéré à Testud que le coup de feu venait d’être tiré à l’instant, Testud croit-il l’avoir entendu, est-il de bonne foi, ou a-t-il menti pour essayer de couvrir la faute professionnelle qu’il avait personnellement commise ? Nous ne pouvons rien affirmer encore.
Le fait est là, brutal, absolu : M. Roland-Lévy, dans sa première déposition écrite, déclare que quand il est arrivé, diverses personnes se trouvaient déjà autour du corps. Comme personne n’est immédiatement allé sur les lieux, ces diverses personnes s’étaient rassemblées durant les quatre ou cinq minutes pendant lesquelles M. Roland-Lévy et M. Hanoteau se trouvaient à l’intérieur du ministère.
Quant à Mme Loviton, son alibi était parfait. Au moment où le coup de feu était tiré, au moment où deux honorables personnes, l’une appartenant à un Cabinet ministériel, l’autre avocat à la Cour, prévenaient eux-mêmes la Police du crime que l’on venait de commettre, Mme Loviton se trouvait au poste de police et ne pouvait donc pas savoir ce qui s’était passé. »
Le scénario imaginé par Armand Rozelaar se heurtait au témoignage incertain de l’agent Testud mais recoupait ceux de Ré, de Le Guerne, du colonel L’Hermite et du garde républicain Jean Gérard.
Il mettait surtout en cause trois personnes : Jeanne Loviton, Guillaume Hanoteau et Roland Lévy, les seules personnes qui, à ses yeux, se soient trouvés sur les lieux avant et après le crime.
Pour cela il lui fallait découvrir le lien qui les unissait car, lorsque Jeanne Loviton descendit de son taxi, vers 21 heures 35, les deux autres affirment ne pas l’avoir reconnue. Et ce lien était, selon lui, le cabinet de Me Maurice Garçon :
* Guillaume Hanoteau avait déclaré qu’en 1942, il avait rencontré à de nombreuses reprises M. Pierre Roland Lévy chez Me Maurice Garçon.
* Me Maurice Garçon ayant été le « patron » de Mme Loviton puis de M. Hanoteau, il est vraisemblable qu’il se sont retrouvés, ne fût-ce que par hasard, par son intermédiaire.
* Au cours de sa confrontation avec Cécile Denoël, le 10 mai 1950, Hanoteau, à qui l’on demande s’il connaissait Robert Denoël, déclare « Je crois avoir aperçu Denoël une fois chez Maître Maurice Garçon. »
* Au cours de la même confrontation, quand on lui demande s’il connaissait « fort bien » Jeanne Loviton, Hanoteau répond : « Je l’ai rencontrée quatre fois dans ma vie. En 1934 au restaurant du Vert Galant, alors que Maurice Garçon était candidat au Conseil de l’Ordre ; et il avait réuni tous ses collaborateurs et anciens collaborateurs. »

Maurice Garçon [1889-1967]
Tous les protagonistes se sont donc trouvés à un moment ou un autre dans le cabinet de Maurice Garçon, particulièrement Jeanne Loviton qui fut sa secrétaire ; et l'avocat fut l'un de ses témoins à son mariage avec Pierre Frondaie, en 1927.
Un deuxième avocat permet de les relier les uns aux autres : Me Raymond Rosenmark, l’avocat communiste de Jeanne Loviton, dont Roland Lévy fut le collaborateur avant la guerre.
Un troisième avocat assure le même lien : Simone Penaud-Angelelli, amie intime de Jeanne Loviton, avocate de Robert Denoël devant la cour de Justice et dans son affaire de divorce, et amie de cœur de Roland Lévy.
D'autre part plusieurs intimes de Jeanne Loviton, tels que Maurice Garçon, Roland Lévy, Raymond Rosenmark et Yvonne Dornès, appartiennent à la franc-maçonnerie.
Après avoir reconstitué un tel « panel », Armand Rozelaar a pu croire que la vérité était proche, mais il écrit tout cela au juge d'instruction en avril 1950, moins d’un mois avant que la police judiciaire dépose son rapport.
Le 28 avril 1950 a lieu une seconde confrontation entre Cécile Denoël et Jeanne Loviton. Me Rozelaar saisit l'occasion pour demander à cette dernière si elle est bien sûre de n'avoir reconnu personne sur les lieux de l'attentat : « Je l’affirme expressément. Je pense que vous faites allusion à M. Hanoteau, que je ne connais pas personnellement, que j’ai peut-être eu l’occasion de voir cinq minutes autrefois chez Me Maurice Garçon, et qui n’a d’ailleurs jamais lui-même pris la peine de me prévenir qu’il avait vu le corps de Robert Denoël ? », répond-elle.
Puisque Mme Loviton se dérobe, l'avocat se dit qu'il aura plus de chance avec Guillaume Hanoteau qui doit, le 10 mai 1950, être confronté avec Cécile Denoël. Spontanément, Hanoteau déclare : « un taxi est arrivé de la rue de Grenelle, une femme en est descendue, elle avait des lunettes, et le lendemain j’ai appris qu’il s’agissait de Mme Loviton, que je n’avais pas reconnue, il y avait 7 ans que je ne l’avais pas vue. »
L'avocat lui demande s'il connaissait Denoël : « Je crois avoir aperçu Denoël une fois chez Maître Maurice Garçon. Et encore, je n’en suis pas sûr. Je ne l’avais pas reconnu sur les lieux du drame ».
- Mais vous connaissiez fort bien Mme Loviton ?
- Je pense bien ! Je l’ai rencontrée quatre fois dans ma vie. En 1934 au restaurant du Vert Galant, alors que Maurice Garçon était candidat au Conseil de l’Ordre ; et il avait réuni tous ses collaborateurs et anciens collaborateurs. Je l’ai rencontrée dans les mêmes circonstances en 1935, et je l’ai revue une ou deux fois, depuis. Et je l’ai revue pour la dernière à un dîner chez Jacques Mourier en 1938.
L'avocat s'emporte alors : « Le témoin se souvient avec précision des rencontres qu’il a eues avec Mme Loviton, et lorsqu’elle descend seule d’un taxi et qu’un crime a été commis, il ne la reconnaît pas ! » Hanoteau se borne à répéter qu'il ne l'avait pas revue depuis sept ans.
Me Rozelaar insiste : « Il était de notoriété publique que Mme Loviton était la maîtresse de Denoël. »
Guillaume Hanoteau : « Je ne le savais pas. Je l’ai appris par les journaux, le lendemain matin. »
Quelques jours plus tard, Jeanne Loviton est à nouveau interrogée par la police, et ce dernier interrogatoire lui paraît si insupportable qu'elle s'en plaint directement, le 15 mai, au procureur général Besson, dans un mémoire rédigé à la troisième personne :
« Quel a été l’objet des interrogatoires des inspecteurs de police ? Faire avouer à Mme Loviton qu’elle connaissait MM. Roland Lévy et Hanoteau.
Même si Mme Loviton avait parfaitement connu MM. Roland Lévy et Hanoteau, est-ce que de ce fait l’instruction aurait fait un pas ?
La police suppose-t-elle, un instant, que M. Roland Lévy, actuellement membre du Conseil de la Magistrature, et M. Hanoteau, dans les loisirs que leur laissent leurs occupations, font métier de tueurs à gages ?
Dans les romans policiers - qui paraissent devenus le bréviaire de certains inspecteurs de police - sont suspectes toutes les personnes qui se trouvaient sur les lieux au moment du crime. Mais, en l’espèce, MM. Roland Lévy et Hanoteau ne s’y trouvaient pas, et sont soupçonnés, parce qu’il sont arrivés auprès du corps du malheureux Robert Denoël, immédiatement après le crime, attirés - semble-t-il - par le bruit du coup de feu. Ils étaient encore là quand la police est arrivée, ce qui n’est pas, en général, considéré comme une preuve de culpabilité. »
Le 25 mai, le commissaire Mathieu remet son rapport au procureur général : il est objectif, et ses enquêteurs n’ont pas manqué de relever les divergences entre les témoignages des trois personnes suspectes désignées par Me Rozelaar, mais ils n’ont pas établi de lien formel entre elles et la victime.
Le 1er juillet 1950 c’est au tour du procureur de la République, Antonin Besson, de prononcer son réquisitoire définitif. Lui non plus n’établit pas ce lien.
Il conclut qu'il n'y a pas à poursuivre et, dès le 6 juillet, le juge Gollety prononce un nouveau non-lieu. Cécile Denoël se pourvoit une nouvelle fois en appel.
Quatre jours plus tard elle adresse un ultime courrier au président de la cour d’Appel de Paris. Armand Rozelaar a certainement supervisé cette lettre pathétique mais que pouvait-il faire d’autre à ce moment ? La partie était déjà perdue.
Cécile Denoël y jette, pêle-mêle :
* des accusations difficiles à étayer : « Les enquêteurs auraient pu également apprendre que Mme Loviton passe, à juste titre, pour avoir, durant l’Occupation, fait un trafic d’or considérable »,
* des révélations curieuses à propos de sa rivale : « N’a-t-elle pas été jusqu’à produire certaines lettres qui lui furent adressées par mon propre frère, prouvant ainsi avec une impudeur dont je vous laisse juge, que peu de jours après l’assassinat de Robert Denoël, elle entretenait des relations disons, suivies, avec son beau-frère ? »,
* des informations intéressantes à propos de son mari : « Il est exact que c’est depuis le début de l’Occupation que Robert Denoël connut une certaine prospérité [...] c’est surtout depuis l’arrivée d’Andermann dans la Société des Editions Denoël que cette entreprise devint prospère et florissante »,
* des attaques intempestives contre la magistrature : « Je n’en veux pour preuves que les interventions multiples faites auprès de vous les Magistrats (j’aimerais que l’on voulût bien me contredire), qu’ils appartiennent au Tribunal de Commerce, au Tribunal Civil ou à la Cour d’Appel »,
* des déclarations contre des personnalités politiques en place : « Je n’en veux pour preuves, et il suffira de reprendre la sténotypie de la plaidoirie de Me Rosenmark, avocat de Mme Loviton, devant la 3e Chambre de la Cour d’Appel au mois d’octobre de l’année dernière, que les propos tenus par cet avocat qui déclara avec fierté et en audience publique, que si, en définitive, l’administrateur provisoire, que le Ministre de la Production Industrielle avait imposé à la Société des Editions Denoël, avait été remercié, ç’avait été grâce à l’intervention d’une dame qu’il désigna clairement, en précisant qu’elle était la femme d’un ancien professeur d’histoire, devenu par la suite Président du Conseil »,
* des compliments à l’adresse des derniers enquêteurs tout en déplorant « que les policiers se soient trouvés devant un mur, à partir du moment où il s’est agi de pousser dans leurs derniers retranchements certains témoins, et surtout lorsqu’il s’est agi d’en entendre un, M. Pierre Roland-Lévy, membre du Conseil supérieur de la Magistrature, puisque aussi bien les policiers n’avaient pas le droit de l’interroger »,
* des reproches à l’adresse du juge Gollety qui « n’a jamais confronté les témoins les uns avec les autres, et que le jour où il s’est agi de faire une reconstitution du crime, l’honorable magistrat intructeur n’a pas convoqué la partie civile et s’est borné, à la suite d’une promenade en automobile qui l’a amené de la rue de l’Assomption à l’Esplanade des Invalides, à interroger Mme Loviton. Cette dernière a donné des circonstances du crime une nouvelle version aussi fausse d’ailleurs que les précédentes »,
* des accusations de partialité à charge du procureur Besson : « constatation pour le moins curieuse, les témoins qui ont jeté sur cette affaire un jour nouveau, et qui ont apporté à la nouvelle enquête des éléments parfois très troublants, ont été systématiquement écartés par Monsieur le Procureur de la République au cours de la rédaction de son réquisitoire définitif »,
* de nouvelles informations à propos des deux « témoins des Invalides », qui méritent d'être reproduites :
Roland Lévy : « comme par hasard, en ce soir du 2 décembre 1945, qui était un dimanche, on trouve réunis à cet endroit désert, Me Hanoteau qui connaissait fort bien Mme Loviton, Mme Loviton, M. Pierre Roland-Lévy, également avocat et, depuis quelques jours, nommé chef de cabinet de M. Croizat, ministre du Travail. On n’a pas recherché quelles étaient, dans ce même milieu, les relations personnelles de M. Pierre Roland-Lévy.
Je crois savoir qu’il était à l’époque lié d’une amitié très vive avec Mlle Simone Penaud-Angelelli, et je crois savoir également (il sera facile de le vérifier) qu’il était avant la guerre le collaborateur de Me Rosenmark. Il ne peut s’agir là, évidemment, que de coïncidences, mais je ne peux pas ne pas les indiquer.
Il eût été indispensable, quelle que soit l’importance des fonctions occupées par M. Pierre Roland-Lévy actuellement, de faire aussi une enquête sur sa vie privée et sur ses relations.
On aurait peut-être alors appris, qu’affilié au Parti Communiste, M. Pierre Roland-Lévy avait été délégué par ce parti au Conseil supérieur de la Magistrature mais, qu’ayant été exclu du Parti Communiste au cours de l’hiver 1949-1950 et mis en demeure de donner sa démission, il s’était néanmoins maintenu dans ses fonctions.
On aurait appris que M. Pierre Roland-Lévy est, pour la troisième fois, si je ne m’abuse, en instance de divorce. Je n’ai pas à m’immiscer dans la vie privée de M. Pierre Roland-Lévy, mais il y a là tout de même, un élément d’ordre moral qu’il convient de ne pas négliger. Je crois savoir également que du vivant du père de M. Pierre Roland-Lévy, celui-ci n’était pas en accord avec son fils et qu’il adressait à ce dernier des reproches violents.
En un mot, ce qui est grave dans cette affaire, c’est que l’on ait adopté vis-à-vis de M. Pierre Roland-Lévy, des égards dus beaucoup plus à ses fonctions qu’à sa personne.
Mais si M. Pierre Roland-Lévy est indigne des fonctions qu’il occupe, ce n’est pas la fonction qui est atteinte, c’est l’homme, et je ne puis concevoir qu’en raison de la fonction, on puisse ménager l’homme. »
Guillaume Hanoteau, à propos duquel le procureur et les enquêteurs n’ont rien trouvé à redire quant à sa présence insolite sur les lieux du crime : « Il est tout de même, quelle que soit la bonne foi dont Monsieur le Procureur de la République veut bien honorer M. Hanoteau, exact de dire que, deux jours après le crime, M. Hanoteau était jugé par défaut par le Conseil de l’Ordre des Avocats et qu’il fut alors radié à l’unanimité.
Je n’ai pas à connaître les motifs de cette radiation, mais elle est de notoriété publique et par conséquent, elle permet de penser que M. Hanoteau n’est pas un personnage tellement intéressant. »
Je n'ai pu connaître le motif de cette radiation. Interrogé en 2006, l'archiviste de l'Ordre a répondu que Guillaume Hanoteau avait, en décembre 1945, été « retiré du tableau, mais pour des raisons professionnelles sans rapport avec la Deuxième Guerre mondiale ».
* enfin, de nouvelles pistes possibles à partir d’une reconstitution qu’elle a elle-même effectuée « puisque le magistrat instructeur m’avait écartée de celle qu’il avait lui-même accomplie » :
« J’ai constaté que le bureau de M. Pierre Roland-Lévy se trouvait à l’intérieur du ministère, au rez-de-chaussée, dans le corps de bâtiment donnant sur le jardin.
A proximité de la fenêtre de ce bureau, un grand mur haut d’enviton 2 mètres 50, longe le boulevard des Invalides et, à deux pas de la fenêtre de ce bureau, une petite porte s’ouvre dans ce mur et donne sur ce boulevard.
Je suppose que c’est par cette petite porte que l’assassin est rentré dans le ministère et a pu s’y mettre à l’abri, tandis que la police faisait ses premières constatations. Puis, au cours de la nuit, tout étant rentré dans le calme, il lui fut très facile d’en ressortir.
Je constate avec regret qu’aucune investigation quelconque n’a été faite du côté de cette petite porte et que l’on n’a même pas recherché où se trouvait habituellement la clé et comment on pouvait en faire usage. »
Cécile Denoël termine ce plaidoyer chaotique par de nouvelles demandes d’audition :
- Marion Delbo qui est un témoin capital, puisque c’est grâce à elle que Denoël et Jeanne Loviton se sont connus et que c’est chez elle qu’ils ont passé ensemble leur dernière journée,
- Henri Jeanson, son mari, puisque chacun sait que « M. Henri Jeanson, qui collabore avec M. Galtier-Boissière à la rédaction du Dictionnaire des contemporains, est parfaitement informé sur tout ce qui se passe à Paris, dans le monde de la politique, de la littérature et des arts »,
- M. Glodek, qui est le beau-père de M. Pierre Roland-Lévy : « Par lui, on pourra peut-être obtenir certains renseignements sur l’activité de M. Pierre Roland-Lévy à l’époque du crime et sur les conditions dans lesquelles il fréquentait à cette même époque, un certain nombre de personnes mêlées à cette affaire. »
Cécile écrit encore qu’elle a déclaré au juge Gollety que « le rapport de police était une base de départ sur laquelle on pourrait commencer enfin une information, aboutissant à la découverte de la vérité. Il m’a été répondu par une ordonnance de non-lieu. Les arguments mis en avant par Monsieur le Procureur de la République ne sont pas convaincants. »
Espérait-elle vraiment, et Armand Rozelaar avec elle, que la cour d’Appel de Paris ordonnerait une nouvelle enquête, à partir des éléments qu’elle apportait ?
Le 28 juillet 1950, l’enquête sur la mort de Robert Denoël était définitivement enterrée.
Le ministère du Travail
A la lecture de ce qui précède, le ministère du Travail, dont les bâtiments occupent l’angle de la rue de Grenelle (n° 127) et du boulevard des Invalides (n° 11), pourrait apparaître comme une forteresse inquiétante, une sorte de « château d'If » au pied duquel fut retrouvé le corps sans vie de Robert Denoël.


Le ministère du Travail côté rue de Grenelle, et côté boulevard des Invalides
Le site est pourtant des plus aimables : l'immeuble fut construit entre 1770 et 1776 par Mathurin Cherpitel, à la demande du comte du Châtelet-Losmont, d’où le nom d’hôtel du Châtelet, qui lui est resté. Entre 1849 et 1905, il fut occupé par l'archevêché de Paris avant d'être affecté au ministère du Travail à la suite de la séparation de l’église et de l’état.
C'était, en 1906, le ministère le plus modeste de la République, avec 530 agents répartis à différentes adresses, sous la direction de René Viviani [1862-1925], premier ministre du Travail.
Sous l'Etat français, des lois promulguées en 1940 et 1941 écartent des emplois publics les fonctionnaires nés d'un père non français, les franc-maçons et les juifs. Le ministère du Travail sera l'un des moins touchés avec 75 agents relevés de leurs fonctions, grâce notamment à son ministre « synarchiste », René Belin [1898-1977].
Au Pilori ne s'y trompe pas qui écrit : « Le ministère du Travail est, à n'en pas douter, l'administration la plus enjuivée et la plus maçonnique de toutes ! » avant d'exiger de son successeur, Hubert Lagardelle [1874-1958], qu'il nettoie « cette écurie d'Augias ».
Le nouveau ministre s'opposera efficacement à l'entrée des partis collaborationnistes dans son administration mais ne pourra échapper à l'engrenage de la collaboration avec l'instauration, en 1943, du Service du Travail Obligatoire (STO), lequel sera, à partir de novembre 1943, du ressort de Jean Bichelonne [1904-1944], puis de Marcel Déat [1894-1955].
Nommé ministre du Travail en mars 1944, Déat pratique une tout autre politique que ses prédécesseurs : deux mois après sa nomination, le ministère est devenu un bastion retranché de la collaboration, protégé en permanence par une trentaine de miliciens armés. Il est vrai qu'à plusieurs reprises, des résistants s'y sont introduits pour détruire les fichiers du STO.
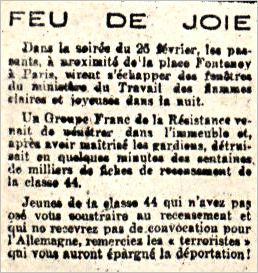
Combat, n° 55, mars 1944
Le 22 août 1944, des administrateurs provisoires nommés par Alger et protégés par un détachement de FFI, investissent un ministère quasi désert. C'est Adrien Tixier [1893-1946] qui, durant deux semaines, assurera les fonctions de ministre du Travail.
Le 10 septembre, le général de Gaulle confie le ministère du Travail à Alexandre Parodi [1901-1979], qui fut délégué général du Comité de la libération nationale. Ses services, à la tête desquels il a nommé des hommes de confiance qui se sont distingués dans la Résistance, occuperont l'hôtel du Châtelet jusqu'au 21 novembre 1945.
Au ministère, l'heure est à la reconstruction mais aussi à l'épuration : « L'administration connut, dans les semaines qui suivirent la Libération et jusqu'au printemps 1945, d'intenses mouvements de personnel qui, pour les anciens, avaient le caractère d'un retour à la normale, d'une remise en ordre. On assistait à des retrouvailles, mais aussi surtout à des règlements de comptes ; il y avait des noms qu'il était préférable de ne pas prononcer. »
Une Commission d'épuration, présidée par l'ancien ministre Adolphe Landry, a été créée le 27 septembre 1944, au ministère du Travail. Si les postes les plus élevés de l'administration sont pratiquement tous renouvelés, les rédacteurs, inspecteurs du travail, contractuels et auxiliaires, restent souvent en place. Sur 523 dossiers ouverts début 1946, 341 feront l'objet de condamnations.
L'administration doit, c'est impérieux, faire face au retour massif des prisonniers de guerre et des déportés : elle manque de fonctionnaires et pratique donc une épuration sélective.
Lors des élections du 21 octobre 1945, la gauche socialiste et communiste obtient la majorité absolue. Le général de Gaulle, réélu président du Gouvernement provisoire le 13 novembre, accorde trois portefeuilles ministériels importants à des communistes.
Celui du Travail échoit à Ambroise Croizat [1901-1956], dont les services occupent l'hôtel du Châtelet à partir du 23 novembre 1945.
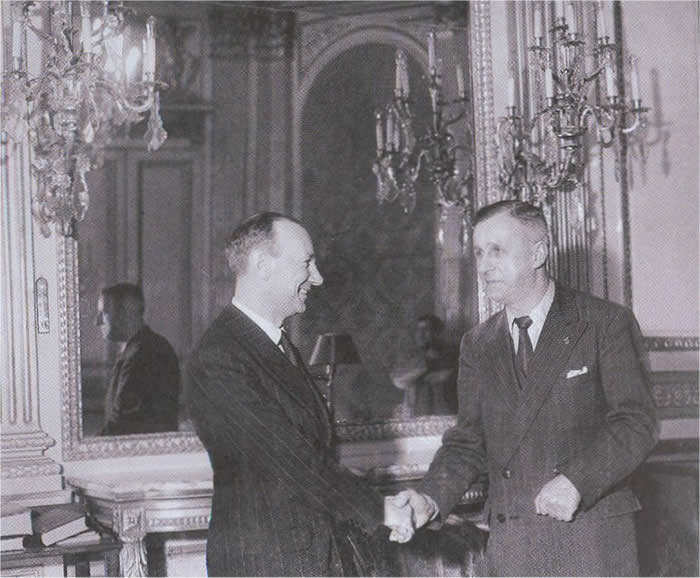
Passation de pouvoirs Parodi - Croizat, 23 novembre 1945 (© Lapi-Viollet)
Né le 28 janvier 1901, ce métallurgiste savoyard a adhéré à la CGT à l'âge de quinze ans, puis au PCF deux ans plus tard. Député communiste de la Seine de 1936 à 1940, il a été arrêté le 7 octobre 1939 pour son appartenance au PC et transféré en Algérie. Libéré en 1943, il est devenu membre de l'Assemblée consultative d'Alger.
On s'accorde à reconnaître qu'Ambroise Croizat, bien accueilli dans l'opinion publique comme dans son administration, et qui est resté ministre du Travail dans les gouvernements qui se sont succédé jusqu'en mai 1947, c'est-à-dire jusqu'au départ des communistes, a fait du bon travail en appliquant la plupart des grandes ordonnances promulguées par Alexandre Parodi concernant les comités d'entreprise, la Sécurité sociale, l'Office national d'immigration, la réglementation en matières d'accidents de travail, l'Ecole nationale d'administration.
Ses services ont investi le ministère le vendredi 23 novembre 1945, soit dix jours avant l'assassinat de Robert Denoël. Parmi ceux-ci, Pierre Roland Lévy [1908-1990], avocat au Barreau de Paris rentré de captivité quelques semaines plus tôt.
La lettre qu'il envoie à la police le 2 décembre 1945 est signée « Roland Lévy, chef de Cabinet au ministère du Travail », sans autre précision, ce qui implique qu'il possède un bureau et un appartement de fonction dans les bâtiments du ministère.
Or, au cours d’une confrontation dans le cabinet du juge Gollety, le 10 mai 1950, Cécile Denoël demanda à Guillaume Hanoteau s’il avait souvent rendu visite à Roland Lévy au ministère du Travail, et Hanoteau répondit :
« A cette même époque, j’ai dû aller le voir trois fois. Une première fois, je suis allé voir Vialar ; une seconde fois, sans pouvoir être affirmatif, je suis allé voir Roland Lévy, et il m’avait fait visiter l’appartement affecté au chef du cabinet du ministère du Travail. J’ai revu Vialar une autre fois, puis Roland Lévy encore une fois au sous-secrétariat du ministère du Travail. »
Voilà un visiteur assidu puisque, entre le 23 novembre et le 2 décembre 1945, il se serait rendu au ministère du Travail à trois reprises en cinq jours ouvrables ! Et aucun portier ne le connaît... Examinons cette déclaration qui date de cinq ans après les faits.
Hanoteau dit qu’il y a rencontré deux fois Paul Vialar, écrivain, résistant, et ami de Robert Denoël. Vialar n’est pas communiste : le bureau qu'il a occupé au ministère du Travail date probablement de l’époque Parodi.
Il y a vu Lévy à deux reprises dont une fois « au sous-secrétariat du ministère du Travail ». Le siège du sous-secrétariat d’Etat se trouvait place de Fontenoy. Roland Lévy fut en effet directeur de Cabinet de Marius Patinaud, lequel n’y fut en place qu’entre le 26 janvier et le 24 juin 1946.
Hanoteau répond donc avec habileté en entremêlant des visites effectuées à trois époques distinctes, mais il s’avère qu’il n’a pu rencontrer Lévy qu’une seule fois au ministère du Travail. C’est la raison pour laquelle il se trouve embarrassé quand on lui demande de situer son bureau dans le bâtiment, surtout si, comme il le dit, Lévy ne lui a montré que son appartement de fonction, qui se trouve sans doute dans le bâtiment principal.
Sur le plan ci-dessous, le bureau occupé par Roland Lévy se trouvait dans l'aile droite de l'immeuble, à proximité des jardins, avec plusieurs fenêtres ouvrant sur le boulevard des Invalides.
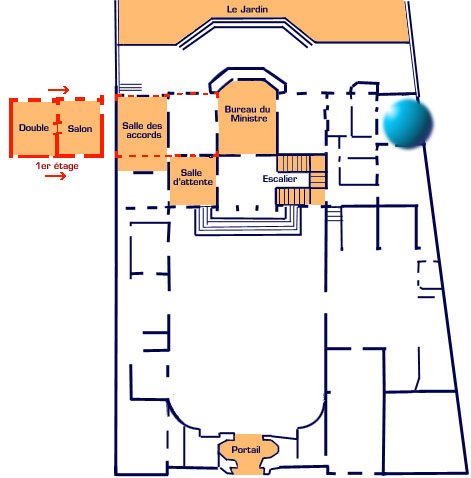
Pour y accéder, il fallait passer par le portail principal, gardé en permanence par un policier en armes, qui se trouve au n° 127 de la rue de Grenelle. Une fois le portail franchi, on se trouvait dans une cour monumentale avec, de part et d'autre, deux ailes basses. Celle de gauche abritait la conciergerie, d'où on actionnait à distance l'ouverture et la fermeture de la porte.

Les bâtiments latéraux de droite, prolongés par un mur haut de deux mètres cinquante derrière lequel s'étendent de superbes jardins, donnent sur le boulevard des Invalides ; ils étaient occupés par les bureaux des fonctionnaires, dont celui de Roland Lévy.

Cécile Denoël a eu la curiosité de se rendre sur place : « J’ai constaté que le bureau de M. Pierre Roland-Lévy se trouvait à l’intérieur du ministère, au rez-de-chaussée, dans le corps de bâtiment donnant sur le jardin. A proximité de la fenêtre de ce bureau, un grand mur haut d’enviton 2 mètres 50, longe le boulevard des Invalides et, à deux pas de la fenêtre de ce bureau, une petite porte s’ouvre dans ce mur et donne sur ce boulevard. »
Elle échafaude ensuite une théorie audacieuse : « Je suppose que c’est par cette petite porte que l’assassin est rentré dans le ministère et a pu s’y mettre à l’abri, tandis que la police faisait ses premières constatations. Puis, au cours de la nuit, tout étant rentré dans le calme, il lui fut très facile d’en ressortir. Je constate avec regret qu’aucune investigation quelconque n’a été faite du côté de cette petite porte et que l’on n’a même pas recherché où se trouvait habituellement la clé et comment on pouvait en faire usage. »
Puisque Roland Lévy et Guillaume Hanoteau sont rentrés au ministère par le portail principal, rue de Grenelle, et que la police se refuse à les mettre en cause, c'est donc qu'un troisième homme a tiré sur son mari puis s'est éclipsé rapidement par la porte qui donne accès au jardin du ministère, dont on lui avait fourni la clef.
Partie civile, Cécile Denoël a eu accès aux différents rapports de police et elle a observé que les enquêteurs avaient privilégié le tir à distance, c'est-à-dire à partir des abords de la voiture stationnée en bordure du square, ce qui permettait au tireur de se réfugier rapidement dans ses fourrés : « Aucun témoin n’a vu personne s’enfuir dans n’importe quelle direction, ce qui nous incline à penser qu’ils ont pu se cacher immédiatement après le "coup" en escaladant les grilles du square des Invalides qui se trouvaient à cinq ou six mètres de la voiture », écrivait l'inspecteur Ducourthial, le 25 janvier 1946.
Arrivé sur les lieux avec son équipe vers 23 heures, soit deux heures après l'attentat, Ducourthial avait fait chou blanc : « Nous avons bien, personnellement, effectué des recherches dans ce square au cours de la nuit du 2 au 3 décembre, mais lors de notre intervention, il est indéniable qu’un malfaiteur aurait eu largement le loisir de disparaître entre-temps. »
Disparaître dans quelle direction ? « Nous n’éloignons pas non plus la possibilité d’une agression commise par un soldat américain, d’autant plus que l’arme est un pistolet de marque américaine, et que des militaires de l’armée américaine, notamment des noirs, stationnaient avec leurs camions dans le parc aménagé sur l’esplanade des Invalides. »
Voilà l'origine de l'invraisemblable version servie aux journalistes le soir même de l'attentat par le commissaire Duez, et relayée durant des années par les journaux, qui y ajoutèrent le qualificatif de « déserteur ».
Faisant table rase des rapports Ducourthial qui situent le coup de feu sur le trottoir de droite du boulevard, Cécile Denoël et Armand Rozelaar, attentifs aux déclarations de Guillaume Hanoteau qui, en mars 1950, avait déclaré aux enquêteurs : « j’ai entendu un coup de feu que j’ai situé comme provenant de l’angle du boulevard des Invalides et de la rue de Grenelle », portent désormais leur attention sur le trottoir de gauche, là où fut retrouvé le corps de Robert Denoël.
Ils ne croient pas que l'éditeur, blessé à mort, ait pu parcourir, chargé d'un cric et d'une manivelle, les 25 mètres qui séparaient sa voiture du trottoir d'en face. Denoël a été abattu à l'endroit même où il fut retrouvé, et son assassin n'a pu trouver refuge que dans le jardin du ministère, voisin de quelques dizaines de mètres et accessible par cette petite porte dont, seuls, certains fonctionnaires du ministère détenaient la clef.

Façade arrière du ministère du Travail, côté jardins (© J.-P. Somme)
Cette hypothèse de dernière minute allait faire long feu mais elle avait eu le mérite d'être exposée au juge d'instruction Gollety par Armand Rozelaar, puis, plus explicitement, le 10 juillet 1950, par Cécile Denoël au président de la Chambre des mises en accusation de la cour d'Appel de Paris, avant que n'intervienne un non-lieu définitif.
Elle n'a jamais été examinée par la police qui, le 25 mai 1950, avait déposé son dernier rapport, ni par le procureur général Besson, dont le réquisitoire définitif date du 1er juillet 1950.
Que faut-il penser des soupçons portés par Cécile Denoël à l'encontre de Maurice Percheron, qui habitait rue Las-Cases, à moins de 500 mètres du ministère du Travail ?
Dès le 21 mai 1946, Armand Rozelaar écrivait au juge Gollety que Cécile Denoël avait, durant la nuit tragique du 2 au 3 décembre 1945, tenté vainement de l'appeler au téléphone.
Percheron s'en expliqua ensuite devant les enquêteurs : « Le soir du drame, c’est-à-dire la nuit du 2 au 3 décembre 1945, je suis resté chez moi ; j’ai joué aux cartes l’après-midi chez mon cousin M. Jacques Trefouel, 205 rue de Vaugirard à Paris. Je suis rentré chez moi pour dîner et je ne suis pas ressorti. Si, au cours de la nuit, je n’ai pas répondu aux appels téléphoniques qui ont pu m’être adressés par Mme Denoël, c’est qu’on ne m’a pas appelé ou que je n’ai pas entendu. Je ne me souviens pas que mon appareil ait été en dérangement à cette époque. »
L'affaire était curieuse, en effet, concernant un docteur en médecine qui devait avoir l'habitude d'appels téléphoniques nocturnes. Cécile affirmait l'avoir appelé durant toute la nuit à son domicile. Maurice Percheron n'avait pas d'alibi. Où avait-il passé la nuit du 2 au 3 décembre 1945 ?
La question n'aurait peut-être pas été posée si Percheron n'avait, dès le lendemain de l'assassinat de l'éditeur, multiplié les démarches intempestives [cf. Notices biographiques]. Et Cécile avait sans doute gardé à l'esprit cette étrange déclaration de Maximilien Vox, le 4 décembre 1945, relative à un ami médecin des hôpitaux de Paris qui aurait accompagné, la veille au soir, le couple Denoël-Loviton aux Invalides.
Armand Rozelaar, qui avait noté son comportement insolite, n'hésitait pas à écrire, le 24 mars 1950, au juge Gollety : « Comme d’autre part, le Docteur Percheron n’était vraisemblablement pas à son domicile pendant la nuit du crime, qu’il ne put être atteint au téléphone qu’à partir de 7 heures du matin, et qu’il a fait auprès de l’agent d’affaires Hagopian des démarches pour le moins singulières, on peut se demander le rôle exact qu’il a pu jouer à l’occasion du drame lui-même. »
Il n'avait pas non plus laissé une très bonne impression aux enquêteurs du commissaire Mathieu qui, dans leur rapport final du 25 mai 1950, écrivaient : « Quant au docteur Percheron, il semblerait qu’il y ait lieu de faire quelques réserves sur la sincérité de ses déclarations. En tout cas les démarches qu’il semble avoir entreprises auprès d’Hagopian après le crime, en vue de s’emparer de cessions de parts dans les Editions de la Tour le laisse supposer. »
Mais ils nuançaient leur jugement : « Pour nous, cette question complexe d’intérêts enchevêtrés est uniquement une conséquence du crime et non la cause ou une des causes. »
En résumé, Armand Rozelaar et Cécile Denoël avaient imaginé le scénario suivant : Robert Denoël et Jeanne Loviton, accompagnés de Guillaume Hanoteau et de Maurice Percheron, avaient garé leur voiture devant le ministère du Travail pour y rencontrer Roland Lévy. Une discussion s'était engagée sur le boulevard des Invalides entre ces cinq personnes, et avait mal tourné.
Denoël aurait été abattu à l'angle du boulevard des Invalides et de la rue de Grenelle ; ensuite Maurice Percheron se serait réfugié dans les jardins du ministère, tandis que Jeanne Loviton, Roland Lévy et Guillaume Hanoteau gagnaient la rue de Grenelle, la première pour se rendre au poste de police, les deux autres pour rentrer au ministère du Travail. C'était un scénario assez complexe qui supposait un complot préalable et l'absence de tout témoin.
Le G.I. noir déserteur
J'ai cru longtemps que les témoins de cette époque qui attribuaient, sans examen, le meurtre de l'éditeur à des déserteurs noirs américains, sous le prétexte que des G.I. stationnaient avec leurs camions sur l'esplanade des Invalides, ce dimanche 2 décembre 1945, avaient quelques obscures raisons d'évacuer d'autres pistes.
Or c'est le commissaire du quartier du Gros-Caillou, M. Duez, qui, le premier, avait proposé cette version aux journalistes, dès le soir de l'attentat : on parlait alors dans la presse de « dix à quinze attentats, chaque jour, dans ce secteur devenu malsain aux honnêtes gens ».
Le 3 décembre 1945, les amis et parents de Denoël s'étaient rencontrés à l'hôpital Necker, où Maurice Percheron, raconte Cécile Denoël, avait « crié à la cantonade qu’il s’agissait indubitablement d’un crime crapuleux commis par un nègre américain ».
Paul Vialar avait la même opinion. Dans le texte qu'il m'avait envoyé en 1980, il écrivait : « Il fut tué - dans le dos - par une balle de Colt. Cette arme est américaine et, à l'époque, au cours de l'enquête de police que je pus suivre, beaucoup de déserteurs de l'armée américaine quittaient le front, venaient à Paris et là, aussitôt accueillis dans ce qu'on nomme « le milieu », ils y faisaient, pour commencer, une fête qui durait jusqu'à leur dernier dollar. Le milieu continuait à les prendre en charge puis, quelque temps plus tard, faisaient comprendre au déserteur que sa situation de parasite ne pouvait durer toujours et qu'il lui fallait faire quelque chose : un « coup », pour rester avec eux. Alors le G.I. déserteur tentait sa chance, tuait pour voler. C'est la quasi-certitude que j'ai emportée de l'enquête et, à mes yeux, il n'est pas d'autre version plausible. »
Percheron et Vialar, amis intimes de Robert Denoël et qui avaient eu à répondre aux questions des enquêteurs, ne s'étaient donc pas forgé cette opinion en lisant la presse du lendemain, mais en bavardant avec des policiers qui avaient la conviction que cette agression pouvait être due à des G.I. américains déserteurs d'origine africaine.
Dans son premier rapport daté du 25 janvier 1946, l'inspecteur Ducourthial n'écartait pas « la possibilité d'une agression commise par un soldat américain, d'autant plus que l'arme est un pistolet de marque américaine, et que des militaires de l'armée américaine, notamment des noirs, stationnaient avec leurs camions dans le parc aménagé sur l'esplanade des Invalides. » Ce soldat noir disparaît de son second rapport du 15 novembre 1946, et n'apparaît pas du tout dans la troisième enquête du commissaire Mathieu, qui dépose son rapport le 25 mai 1950.
C'est pourtant en 1950, lors de la relance de l'enquête, que les journaux rappellent la présence de G.I. sur l'esplanade des Invalides.
Le 13 janvier, L'Aube écrit : « Crime crapuleux, avait-on dit. Denoël a été tué par un nègre américain en état d'ivresse. On n'a jamais retrouvé ce nègre. Et d'ailleurs on ne semblait guère avoir fait beaucoup d'efforts pour le rechercher. »
Dans L'Express-Dimanche du 30 avril, Roger Darbois écrit : « Très vite, on conclut au classement de l’affaire en mettant l’assassinat sur le compte d’un rôdeur, en l’espèce un noir américain, dont on put sans peine à cette époque où Paris était plein de troupes alliées, attester le passage dans les environs à l’heure approximative du crime. »
A l'origine, l'attribution à un « nègre américain » de l'agression mortelle de l'éditeur est donc due à la police parisienne, mais il s'est trouvé au moins un journal pour soulever la question dans ses colonnes. Le 8 décembre 1945 France-soir lance une campagne : « Halte au crime ! » Le journaliste Paul Bringuier s'adresse directement au préfet de police, Charles Luizet : « Les gens de Paris voudraient savoir s’ils pourront sortir le soir. Je veux dire sortir le soir avec une chance de rentrer chez eux sains et saufs. A Montmartre, à la Bastille, il n’y a pas de nuit sans fusillade, batailles rangées entre bandes rivales, sans passants couchés par des balles perdues. On assaille des boutiques en plein jour, on assassine dans le quartier des ministères. » (je souligne).
« Le mal, écrit-il, n'est particulier ni à Paris ni à la France. Il est d'abord d'époque. C'est la maladie classique d'après les guerres, en même temps que les typhus, les pestes et les grippes espagnoles. Un virus sort des charniers pour décimer les survivants, un autre subsiste dans les cervelles les plus faibles des soldats désarmés. On ne se guérit pas si facilement de la fièvre de l'action violente, ni même du goût de tuer. »
Il en vient alors aux déserteurs américains : « Paris a un gang qui lui est spécial. Les Américains. Qu’on ne se trompe pas. Le G.I. régulier, enrégimenté, sauf quand il se bagarre après boire, est sage. Les exemples d’attentats commis par des soldats américains en situation militaire régulière sont presque inexistants.
Pratiquement, tous les escarpes en blouson kaki sont des déserteurs. Iils sont quelques centaines, pour ne pas dire quelques milliers dans Paris. Certes la Military Police est bien équipée pour les poursuivre, mais ses hommes sont gênés dans une ville étrangère, isolés au milieu d’une population qui ne les comprend pas. »
Quant à la police parisienne, « avec ses vieux vélos, la défense de prendre un taxi, l’impossibilité d’entrer dans un bar ou un restaurant cher pour y suivre un suspect, la hantise de ne pas téléphoner pour ne pas dépasser son misérable crédit de frais, elle a la faculté de poursuivre en métro les gangsters motorisés. »
Le 11 décembre c'est Henry Pignolet qui prend le relai, et le premier exemple qu'il donne montre que c'est bien l'attentat du 2 décembre qui a déclenché la campagne du journal :
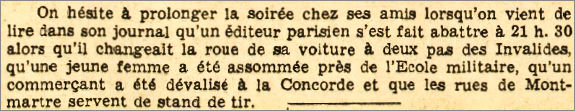
« En trois mois (mai, juin et juillet), il y a eu 45 assassinats entre le crépuscule et l’aurore. Depuis deux ans, il ne s’est passé qu’une seule nuit pour laquelle on n’enregistre aucune agression nocturne dans la capitale. C’est la nuit du 5 au 6 décembre 1945 ».
On vend, écrit-il, des revolvers 2 000 francs au marché noir. Que risquent les auteurs de ces agressions à main armée ? Une amende ou trois mois de prison avec sursis pour port d’arme prohibée, quelques mois pour agression à main armée.
« Les criminels d'aujourd'hui, nous déclarait hier un haut fonctionnaire de la police, ne sont pas des professionnels. On les arrête assez facilement. Le crime est brutal. Il faudrait que la répression soit brutale et rapide. »
Le haut fonctionnaire interrogé n'est autre que le commissaire Lucien Pinault, patron de la Brigade Criminelle, celui-là même qui est chargé de l'enquête sur l'assassinat de Robert Denoël :
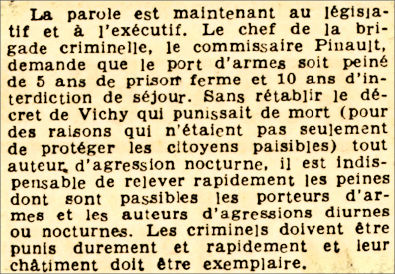
Le journal clôture sa campagne le 27 décembre, avec l'annonce d'une nouvelle qui se veut rassurante :
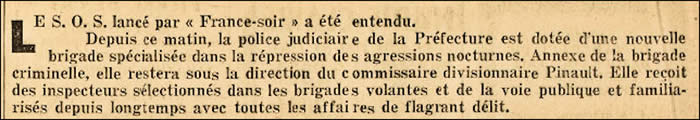
Malheureusement pour l'affaire qui nous occupe, l'arrivée de cette nouvelle brigade n'eut aucune incidence sur la résolution de l'assassinat de l'éditeur, mais elle avait eu le mérite de désigner au public et aux autorités les auteurs d'attentats nocturnes, qu'ils appartinssent à la pègre parisienne, ou à l'armée américaine.
C'est un sujet qui reste aujourd'hui encore peu connu. Dès le 14 juin 1944, une semaine après le débarquement allié, un G.I. noir viole une jeune femme près de Sainte-Mère-l'Eglise. Pour le seul mois de juin, en Normandie, 175 soldats américains seront accusés de viols ; 3 500 meurtres, viols, pillages et exactions diverses seront portés au compte des libérateurs, entre juin 1944 et juin 1945, et 85 % des condamnations prononcées par des tribunaux américains d'exception concernent des soldats noirs, lesquels ne constituent pourtant que 10 % des effectifs engagés. On estime à dix mille [« The Lost Division »] le nombre de G.I. déserteurs sur le territoire français en 1944 et 1945.

Life, 12 mars 1945
La presse américaine n'a pas éludé cette épineuse question. Le 12 mars 1945 Life consacrait un article sans complaisance aux exactions américaines sur le territoire français. La journaliste Mary Welsh estimait alors à deux mille le nombre de « crimes majeurs » commis par des G.I. depuis juin 1944 mais estimait que les lourdes sanctions prises récemment par les tribunaux militaires américains avaient rendu plus prudents les délinquants.
La plupart de ces délits se retrouvent dans tous les pays occupés : trafics de denrées alimentaires, cigarettes, essence, c'est-à-dire le marché noir. L'article de Mary Welsh, qui se veut objectif, ne prend en compte que les délits qui ont causé des pertes substantielles à l'état américain (estimées alors à quelque 218 000 dollars) mais ignore absolument leur impact sur l'économie française.
Quant à la peine de mort appliquée désormais aux déserteurs, elle avait rendu très dangereux ces desperados qui vendaient désormais chèrement leur peau et n'hésitaient plus à faire le coup de feu avec la police. Néanmoins le nombre de 18 000 déserteurs avancé par la presse française était, selon la journaliste, inexact.
Les services du général Milton Reckord [1879-1975], responsable de l'armée américaine en France, auxquels elle s'est adressée, n'ont pu lui fournir de chiffre plus précis mais, de toutes façons, « le taux de criminalité cette année n'est pas extraordinairement élevé. » On ignore à partir de quel taux la criminalité de soldats américains en pays libéré doit être considéré comme « élevé ».
En novembre 2013 a paru, aux Editions du Léopard Démasqué, Le Père Denoël est-il une ordure ? L'auteur a pris la peine de tout lire à propos de l'assassinat de l'éditeur et, sous le couvert d'un roman « historico-déconnant », il propose une version inédite de la mort brutale de Robert Denoël, qui mérite réflexion.
Robert Denoël, Jeanne Loviton et Guillaume Hanoteau se trouvaient dans la Peugeot, qui s'est rangée le long du square des Invalides. Roland Lévy les y a rejoints et s'est installé sur le siège arrière de la voiture. La discussion a mal tourné. Celui qui se trouvait derrière le chauffeur a saisi son Colt 45 et tiré à travers le dossier du siège.
La suite est une mise en scène : on a disposé le couvercle de la roue de secours, la toile et la genouillère devant la roue avant de la voiture pour faire croire à une réparation. Le corps de l'éditeur a été emporté sur le trottoir d'en face, avec le cric et sa manivelle à portée de main. L'important était d'éviter que l'attention se porte sur la voiture, où Jeanne Loviton s'était efforcée de colmater sommairement la trace du projectile. Elle s'est rendue ensuite au commissariat, tandis qu'on tirait une balle dans le pneu avant de la Peugeot. C'est ce second coup de feu qu'ont entendu les témoins.
Gordon Zola, considérant la trajectoire de la balle [elle a été tirée « d’arrière en avant, de gauche à droite et très légèrement de bas en haut »], ajoute que le tireur devait être gaucher.
L'auteur compare la scène de l'attentat au Mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux, mais en extérieurs : tous les protagonistes sont connus, aucun ne s'est enfui : l'assassin est donc parmi eux.
Un tel scénario s'adapte parfaitement aux éléments connus de l'enquête. Le premier coup de feu, tiré à l'intérieur de la voiture, n'aurait pas été perçu aux alentours. Il était donc possible de transporter le corps de l'éditeur [90 kilos, tout de même, plus le poids du mort] à vingt-cinq mètres de là et de tout mettre en scène avant la seconde détonation.
A l'appui de cette version, on peut rattacher les témoignages de moniteurs de tir de la police parisienne [2014] qui, tous, répondent catégoriquement que la puissance d'une telle arme devait logiquement projeter la victime face contre terre. Si on la retrouve sur le dos, c'est qu'elle s'est retournée durant sa chute, ou qu'elle n'est pas morte sur le coup et s'est retournée alors qu'elle était au sol, ou qu'elle a été retournée.
