Textes et interviews
1926
Janvier
✪ Compte rendu signé Robert Marin paru dans la rubrique « Chronique des livres » de Liège-Universitaire du 22 janvier, où il occupe la page 3, colonne a-e.
Le livre de Pierre Girard est paru en 1925 chez Simon Kra, aux Editions du Sagittaire, dans la « Collection de la Revue Européenne ».
La traduction française du livre de Miguel de Unamuno [1864-1936], due à Francis de Miomandre [1880-1959], est parue en 1925 aux Editions du Sagittaire.
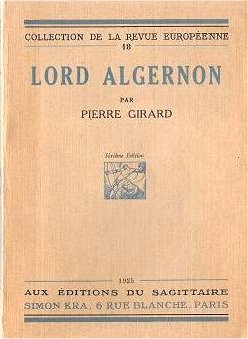
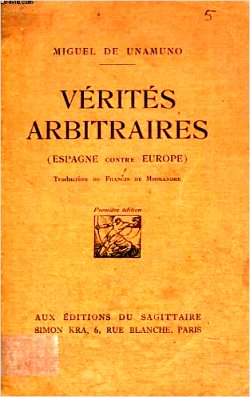
« Lord Algernon par Pierre Girard - Vérités arbitraires par Miguel de Unamuno »
J’ai un ami que la lecture du premier livre de Pierre Girard a tout à fait ensorcelé. Ce garçon est étudiant en médecine. Il aimait mieux son canoë, les jeunes filles les fleurs, son chien, que tous les livres de la terre. Il méprisait surtout ceux qu’il appelait avec une nuance d’effroi « les modernes ». Le voilà, comme disent les Anglais, tombé en amour avec Barbara, avec June, avec Betsy. Cette passion dévorante n’exclut pas le désintéressement; chaque fois que mon ami adore une jeune fille, il lui donne un exemplaire de « June, Philippe et l’Amiral ». Et il s’en va, certain de sa reconnaissance, sinon de son amour. Aujourd’hui, en Belgique, au moins vingt jeunes visages entourés de cheveux noirs, vingt jeunes regards couleur de ciel - il n’aime que les brunes aux yeux bleus - rêvent à Pierre Girard, au son de sa voix, à la marque de ses cigarettes...
Le cher garçon ne s’en tient pas là. Il faut que ses amis deviennent, à leur tour, les heureuses victimes de sa passion. Un jour qu’il fait beau - Pierre Girard et le soleil s’entendent bien - il les prend par la manche, les mène chez lui, de force leur lit une page, deux pages du livre et le ferme. Il n’a plus alors qu’à les accompagner chez le libraire. Le commis, qui n’attend plus la commande, court chercher le volume à couleur grise de la collection de la Revue Européenne et, sans l’envelopper (il sait qu’ils en commenceront la lecture dans la rue) le leur tend avec un sourire délicieux.
J’ignore ce que mon ami pense de « Lord Algernon », mais il m’a envoyé le télégramme suivant : « Ai trouvé Algernon édition originale. Vie est belle ». Puissé-je le rencontrer le jour qu’il découvrira un autographe de son Baruch !
Pour parler de Pierre Girard comme il convient, il faudrait un vocabulaire tout neuf, qui respire la fraîcheur, l’innocence ; il faudrait parler sa langue. Les paresseux citent Jean Giraudoux, évoquent les ombres d’Alfred de Musset ou de Gérard de Nerval et se tiennent pour satisfaits. Ce n’est pas qu’il importe de relever des procédés ou des méthodes de composition : je goûte médiocrement cet appareil didactique. Mais l’œuvre de Pierre Girard montre une personnalité assez singulière pour qu’il soit inutile de lui chercher des parrains. J’admire chez l’auteur de « June, Philippe et l’Amiral » une jeunesse qui ne chôme jamais, une fantaisie proche des larmes autant que du rire et qui s’arrête à ces dangereuses frontières pour nous contenir dans une zone que baigne la plus douce malice. Il semble que ses livres ignorent la peine, que ces pages soient naturellement gracieuses, qu’un dieu bienveillant les accorde à leur auteur comme le sourire aux jeunes filles, comme la joie aux enfants.
Il est des critiques qui s’affligent de ce ton aisé, de l’allégresse de ce tour d’esprit. Comme j’estime Pierre Girard de manquer de cette gravité qu’on lui souhaite ! De pouvoir être tendre en parlant des roses ou des nuages, de chercher dans la vie ce qui heurte le moins, ce qui nous trompe le plus sûrement, d’aimer les poètes, l’Odyssée (dans la traduction de M. Bérard) comme Madame de Noailles, Shelley comme Paul Valéry et de nous l’apprendre de cette manière.
En écrivant « Lord Algernon », il a, sans doute, fait effort pour se libérer d’une partie de sa grâce : heureusement, il n’est parvenu qu’à lui joindre une assurance, une sorte de fermeté qui la rend plus durable. Si le détail offre moins de surprise, l’allure générale du récit gagne en décision, en unité - Devant un tel bonheur, devant une réussite où l’intelligence et ce qu’il y a en nous d’aptitudes à la poésie se trouvent si gentiment satisfaits, je ne chercherai pas plus longtemps les sources de mon plaisir, je ne veux retenir que sa qualité. Algernon, cette mystérieuse Anne qu’il enlève, et Emmeline elle-même peuvent tendre les mains aux personnages de «June». Leur charme n’est pas moindre, mais peut-être atteint-il en nous des régions plus profondes.
*
Pierre Girard aime tant ses amis que lorsqu’il écrit un roman il ne peut se défendre d’y mêler quelque détail de leur vie. Vous saurez bientôt que Francis de Miomandre envoie des lettres roses à l’auteur de « Lord Algernon ». Il est donc naturel qu’il serve d’intermédiaire entre celui-ci et Miguel de Unamuno dont il vient de traduire d’une manière très vivante les « Vérités arbitraires ».
L’espace m’est si avarement mesuré que je ne pourrai que vous signaler ce recueil d’essais du grand écrivain espagnol. Miguel de Unamuno est aujourd’hui universellement célèbre et non pas seulement à cause de son exil. Plusieurs de ses œuvres ont été traduites en français. Dans l’introduction qu’il écrivit aux « Trois Nouvelles exemplaires », Valery Larbaud dont on ne louera jamais assez le goût et l’intelligence qu’il dépense à nous faire connaître le meilleur des littératures étrangères, Valery Larbaud disait qu’en Miguel de Unamuno on rencontre «un esprit d’humaniste et d’érudit explorateur passionné d’une dizaine de littératures, un penseur, un moraliste, un poète et un dramaturge qui a su créer des formes et des types littéraires capables de durer et de vivre aussi longtemps que la langue dans laquelle il s’est exprimé ».
Dans les « Vérités arbitraires », Miguel de Unamuno étudie la situation de l’Espagne dans l’Europe d’aujourd’hui. Il parle de la civilisation et de la culture, de la patrie et de l’armée aussi bien que de la foi ou de l’orgueil. Jamais il n’est inégal à son sujet : cet érudit aborde les plus vieux problèmes, oubliant les solutions qui en ont été données; il déteste l’expression et la pensée toutes faites. Il poursuit le réel d’un amour effréné, découvre des choses la face la plus éloignée, nous met le nez dessus et nous laisse incapables d’autres mouvements que d’adhésion.
Robert Marin
✪ Compte rendu signé Robert Marin paru dans la rubrique « Chronique des livres » de Liège-Universitaire du 29 janvier, où il occupe la page 3, colonne a-e. Denoël y proclame qu’il tient Aragon « pour le premier écrivain de ce temps ». Le roman de Pierre Drieu la Rochelle [1893-1945] est paru en 1925 aux Editions de la Nouvelle Revue Française.
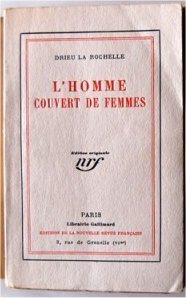
« L’Homme couvert de femmes par Pierre Drieu la Rochelle »
Quand Pierre Drieu la Rochelle a publié « La Valise vide », il a tout à coup fait germer l’attention de ceux que l’anodin ne contente plus. Cette courte nouvelle a connu une fortune égale à celle que rencontrait, trois ans plus tôt, « Le Bon Apôtre » de Philippe Soupault. Elle servir de départ à des discussions, elle fut un point de repère, un signal.
C’est qu’en dehors de ses visées sociales, qu’on pouvait tenir pour parfaitement négligeables, cette nouvelle apportait un élément neuf : une façon volontaire de bondir pour retomber, mille traits hostiles dont la réunion composait un portrait et cette langue hargneuse, d’une forte densité, avec des élans cassés et des retraites, à l’image du récit. Tout cela comportait un ensemble de défauts et de qualités d’un tel rang que l’œuvre existait, originale, dans l’espace et la durée. Que l’auteur eût voulu faire le tableau de « la misère sexuelle de ce temps » ou autre chose, cela nous importait peu. Nous l’avions vu s’imposer des règles et les suivre, davantage, créer un homme qui nous hante encore aujourd’hui. « Plainte contre inconnu », recueil de nouvelles qui contenait « La Valise vide », pouvait être apprécié d’un point de vue littéraire.
Faut-il voir ici ce goût de la sincérité que Drieu dénonçait lui-même ou ce mépris de la « littérature » commun à certains des écrivains du lendemain de la guerre ? L’Homme couvert de femmes est un ouvrage hétéroclite qui participe de la « fiction », c’est le mot de Drieu, et de l’essai moral ou psychologique. Le propre de ce livre me semble l’emportement. Disons - les vieilles images comme les vieilles femmes sont parfois secourables - disons que Drieu a bien tracé un lit à son livre, mais trop fort, trop nombreux, ce fleuve crève les barrières et son farouche élan couvre la campagne. Comme l’homme et le cataclysme ici se confondent, il ne faut pas trop nous lamenter si l’un ne sut pas dominer cet autre qui entraîne avec soi de si magnifiques beautés.
Cependant, l’ambiguïté de ce livre est faite pour irriter et peut-être est-ce elle qui retient notre enthousiasme. La première partie offre l’aspect d’un roman où des personnages sont contraints à vivre de la seule vie sexuelle. Le premier apparaît, Gilles, l’homme que les femmes vont couvrir : lui existe, et existera jusqu’au bout, malgré quelques défaillances sur lesquelles je reviendrai. Et les femmes surgissent, que l’auteur a voulues précaires ; elles sont un instant volumineuses, avec des chairs, des formes, un embryon d’âme, puis elles fuient, immatérielles, elles disparaissent, leur rôle joué de décevoir Gilles. Une seul, Finette, demeure plus présente : elle agit, elle aime, elle souffre. Méprisée par l’auteur presqu’autant que par Gilles, combien de temps se défendra-t-elle contre le cercueil ? La seconde partie tue tous nos espoirs et, violemment, nous impose une âpre compensation. L’intrigue, ou ce qu’il faut bien appeler de ce nom, si fortement conçue au début, s’affaisse, n’est plus qu’une ligne, si ténue que nous nous étonnons de ses sursauts. Il n’y a plus qu’une méditation forcenée, quelques faibles gestes et le silence.
Peut-être Drieu a-t-il voulu concentrer la lumière sur Gilles comme autrefois sur Gonzague ? Peut-être les personnages sont-ils plantés comme les parties d’un décor où seul Gilles agira ? Ici encore Drieu trompe notre attente. Gilles apparaît tantôt comme un produit pur de l’intelligence, une entité, pareils à ces personnages si secs qu’Ernest Hello introduisait dans ses « Contes extraordinaires » ; tantôt d’autres pages le rapprochent de nous, le font homme et Drieu sent si bien la dualité de cette nature, qu’il ne peut plus considérer son personnage comme extérieur à lui et que le récit continue à la première personne. Ces deux visages ne peuvent correspondre, jamais leurs contours ne se joindront exactement. Et l’on voudrait nous satisfaire de ce désaccord.
Drieu la Rochelle et Louis Aragon, à qui le livre est dédié, sont peut-être les écrivains que je distingue le plus nettement de la foule. Bien que je tienne Aragon pour le premier écrivain de ce temps (ces formules sont idiotes), le ton dont il use est tel que devant sa moindre page, une note, une image, n’importe quoi qui vient de lui, j’oublie toute littérature. Drieu atteint parfois aussi, et avec quelle brutalité, au plus profond de moi-même : seule son indécision pourrait m’écarter de sa route.
Ce lyrique est terriblement dénué de charme, sa parole ignore la flatterie, l’image naît sous sa plume avec un air de sauvage dureté. Mais cette attitude ou ce naturel lui permet toutes les hardiesses : il partage maintenant avec Aragon le privilège de pouvoir dire tout. Dans « L’Homme couvert de femmes », il a tenté les plus dangereuses expériences et en est sorti les mains nettes. On m’excusera de ne pas entrer ici dans des considérations morales : ce domaine ne m’est pas encore familier. Pour Drieu l’univers est soumis à des lois qu’il ne pourrait déterminer. Il les sent dans une exprimable confusion et tout ce qu’il dit en porte la marque obscure. Mais, à chaque instant, au milieu de sa déroute, une phrase, une page éclate comme une fusée, et désigne crûment le centre de la nuit.
Pourquoi Drieu la Rochelle s’obstine-t-il à juger ? Pourquoi veut-il s’asseoir au moment que sa passion lui ordonne une marche impitoyable ? L’analyse, au lieu qu’elle l’apaise, ne fait que l’exciter au déchaînement qui emporte tout.
Robert Marin
Livres reçus :
Raboliot par Maurice Genevoix. Histoire de braconnier et de gendarmes. Description de la Sologne. Prix Goncourt (Bernard Grasset).
Le Bachelier sans vergogne par Albert Marchon. Aimable récit d’un vagabondage dans la campagne française. Jolies anecdotes (Bernard Grasset).
Février
✪ Compte rendu signé Robert Marin paru dans la rubrique « Chronique des livres » de Liège-Universitaire du 12 février, où il occupe la page 3, colonne a-e. Le roman de Jean Giraudoux [1882-1944] a été publié en 1926 chez Grasset dans la collection « Les Cahiers Verts ».
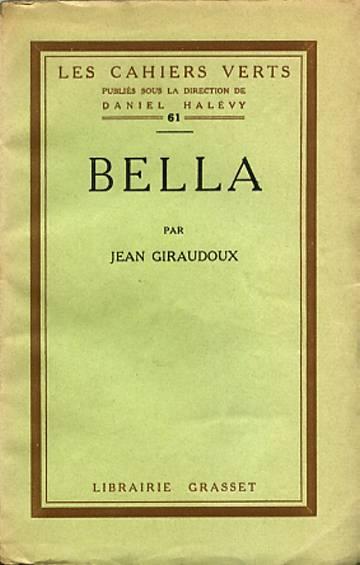
« Bella par Jean Giraudoux »
Les livres de M. Jean Giraudoux n’ont pas encore rencontré toute l’estime ou toute l’admiration que réclame leur qualité. Parmi les critiques, s’il en est qui louent ces ouvrages, il s’en trouve pour leur refuser l’attention, pour les ignorer d’une façon si obstinée qu’elle irrite. D’autres déclarent sa manière d’écrire contraire au goût français, obscure, voire incompréhensible ; un critique, qui par ailleurs montra quelque intelligence, ne craignit pas de nommer M. Giraudoux le plus mauvais écrivain d’aujourd’hui.
Cependant, si l’on en juge par l’influence qu’il exerce depuis son premier livre publié en 1911, il faut reconnaître que l’enrichissement poétique fourni par cet esprit si délié ne s’est pas produit comme une excroissance tôt résorbée sur ce beau corps qu’est la littérature française, mais qu’il en a gagné le sang, qu’il en a rajeuni la matière vivante. Tous ceux qui, au lieu de partir à la découverte des vrais talents, semblent institués pour soutenir la gloire de quelques écrivains amis de la foule, s’accordent à dénier à l’auteur d’« Adorable Clio » la clarté des idées, la limpidité du discours. Ils lui reprochent de ne pas écrire comme Voltaire - Le parallèle est un exercice bien agréable et que M. Jean Giraudoux nous conseille dans son dernier livre. Je me suis diverti à en établir un entre lui et Voltaire, et j’ai été fort étonné de la ressemblance de ces deux esprits apparemment si éloignés. Essayez. Je tiens que M. Giraudoux est une des intelligences les plus lucides, les plus froidement clairvoyantes d’aujourd’hui.
Il ne diffère des écrivains lumineux, d’Anatole France par exemple, que par l’abondance des idées et des sentiments. Dans la complexité de son univers, il se joue avec l’allégresse du poisson dans les millions de gouttes d’eau qui composent le lieu de ses ébats. Ne vous en prenez qu’à votre paresse, à votre manque d’éducation, si vous n’approchez pas son agilité. Il vous suffit de regarder ses mouvements et d’en jouir : qui vous parle de les imiter ?
L’univers de M. Jean Giraudoux est relié mille fois au vôtre, au mien ; M. Jean Giraudoux, ou je m’étonnerais, ne croit pas à l’absolu. Pour lui, rien n’existe en soi, tout se meut, se transforme, agit selon des influences qu’il appartient au poète de déceler. Pour lui, les hommes ne sont pas seuls à vivre en société ; les innombrables objets de la nature ont entre eux d’intimes relations, et les hommes et la nature. Vous saviez cela mais d’une manière vague, comme vous savez que Henri II vécut au seizième siècle, mais vous ignorez la date de sa naissance et celle de sa mort. Jean Giraudoux connaît tous les rapports des choses entre elles et d’elles à nous. S’il se tait, c’est qu’il a chargé de ce devoir, un personnage atteint de la douce manie didactique. Evidemment, cette science que M. Giraudoux possède, il ne faut pas attendre qu’il la livre tout entière. Il en donnera ce que lui permettront les hasards d’un roman, d’un récit. Mais déjà c’est assez pour comprendre la sagacité, l’exquise souplesse de cet esprit qui recréa le monde selon des lois nouvelles. Vous apercevrez que ces lois ne régissent pas grossièrement mais qu’elles prévoient le détail et jusqu’au plus petit.
Que ne peut-on pas comparer dans le ciel !, écrit-il. De chacun de ses meubles, de chacun de ses gestes, de chacun des jeux de lumière du jour ou des lampes, il sentait maintenant qu’il lui eût suffi d’un peu d’intelligence et d’un peu d’invention pour dégager et délivrer un génie scintillant.
Cette invention, dont parle M. Giraudoux, il se fait qu’il en est admirablement doué. Il n’est que d’ouvrir un de ses livres au hasard pour être aussitôt saisi par la nouveauté des images que l’on y rencontre.
La comparaison, l’image, la métaphore, l’allégorie même, sont les figures dont il use le plus volontiers. Elle lui appartient en propre cette manière - combien de fois imitée - d’allier la fantaisie et la réalité. En changeant un peu les termes de sa phrase, nous pouvons nous écrier avec un de ses héros : « Qu’il est consolant de vivre, si le monde réel se coud ainsi à un monde imaginaire ! »
Tous ces rapports que M. Jean Giraudoux révèle à nos yeux, nous plaisent par leur imprévu, par leur profondeur, par leur nombre. Plus ces relations offrent d’inattendu, plus elles nous charment, plus lointaines sont leurs racines et plus elles nous émeuvent, et leur abondance suscite en nous l’émerveillement des belles moissons. Mais qu’une de ces qualités vienne à manquer et aussitôt notre plaisir faiblit. Nous avons eu ainsi des livres ou des récits parfaits comme « America America », « La Nuit de Châteauroux » ou encore « Suzanne et le Pacifique » et d’autres qui nous déçurent par une économie plus grande, par une façon trop brève de nous indiquer le mécanisme des choses.
Bella vient de paraître. C’est une œuvre admirable, d’une harmonie et d’une richesse égales dans la construction et dans le détail. Jamais, je crois, M. Jean Giraudoux n’avait atteint une telle ampleur et ensemble une telle aisance dans ses démarches.
Le thème d’un roman compte peu pour lui ; il a choisi cette fois un sujet qui inspira ou aida Shakespeare, des vaudevillistes, des auteurs de mélodrames et de romans-feuilletons. Bella, ce n’est rien moins que «Roméo et Juliette» porté dans le monde politique de nos jours. J’ajouterai que le dénouement y est moins tragique : seule, Bella meurt.
Le conflit dont on sent la menace à travers tout le livre n’y occupe qu’une petite place matérielle. Avant tout, l’auteur a tracé une série de portraits, une série de tableaux. Jamais il ne se résoudrait à faire entrer un nouveau personnage sans nous apprendre son caractère, ses habitudes, ses goûts. Il le décrit minutieusement, mais avec quel charme, par rapport à l’univers dans lequel il vit, par rapport aussi aux personnages qui l’entourent. Le récit, amorcé dès les premières pages, chemine à une allure très lente. Ne nous en plaignons pas, car ces portraits successifs sont d’une beauté entièrement originale, à chaque pas notre attention trouve sa plus jolie récompense. Imaginez un immense jeu de puzzle découpé avec un raffinement de complication qu’ignoraient ceux qui amusèrent notre enfance. Pour plus de difficulté, mêlez-y plusieurs autres puzzles étrangers à la figure qu’il va falloir construire. Regardez maintenant M. Jean Giraudoux. Sa sûreté tient du prodige. Jamais, il ne saisira un fragment inutile. Il semble partir au hasard, mais chaque fois, il trouve je joint et peu à peu, le portrait grandit devant nous, se développe, vit.
La vie de ces portraits, comme d’ailleurs celle du récit, ignore les mouvements trop rapides. L’action leur est moins aisée que la grâce. Chacun des personnages, une fois défini, s’affirme dans une sorte de stabilité dont on les dérangerait difficilement. Ils vivent mais à la façon de ces chefs-d’œuvre dans un cadre. Est-ce dire que les personnages de M. Jean Giraudoux sont moins émouvants, moins vrais que d’autres ? Non pas. Cet homme, si intelligent et si cultivé soit-il, est loin d’être insensible, et son train uniforme, ses images qui vont trois par trois ou deux par deux, sagement la main dans la main, n’empêchent point son cœur de battre et ce battement s’entend, gagne le nôtre.
Robert Marin
✪ Compte rendu signé Robert Marin paru dans la rubrique « Chronique des livres » de Liège-Universitaire du 19 février, où il occupe la page 3, colonne a-e. Cette édition en deux volumes du poème de Gogol [1809-1852] traduite par Henri Mongault a été publiée en 1925 par les Editions Bossard.
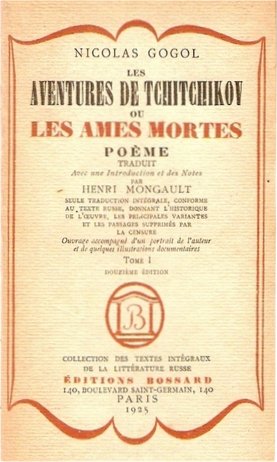
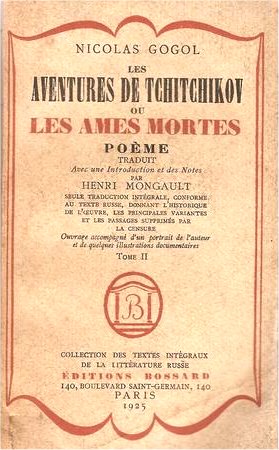
« Les Aventures de Tchitchikov ou Les Ames mortes, de Nicolas Gogol »
C’est presqu’un truisme de dire que les œuvres de génie, vraies pour toutes les époques, se présentent à chaque génération avec la force de la nouveauté. Il éclate, par exemple, que la critique d’aujourd’hui goûte Stendhal d’une manière fort différente de celle de Balzac ou de Paul Bourget. Et l’on peut être assuré que nos petits neveux y découvriront des éléments que nous avons négligé. Cela qui est vrai pour un livre qui touche le public, sans que personne l’ait mutilé ou trahi, l’est bien davantage quand il s’agit d’un ouvrage traduit. Et singulièrement de la littérature russe.
Il faut lire le « Roman russe » de Voguë pour se rendre compte de la méfiance observée, il y a quelque trente ans, dans tous les milieux de langue française à l’égard d’œuvres reconnues aujourd’hui comme habitée par le génie. Sous le prétexte du caractère trop opposé à l’esprit latin des livres de Gogol, de Tolstoï ou de Dostoïevski, des traducteurs peu scrupuleux ne craignirent pas d’en présenter des éditions fortement écourtées. Et comme, en fait, l’usage de la langue russe est restreint, bien peu d’Occidentaux ont pu jusqu’aujourd’hui définir exactement la valeur de ses chefs-d’œuvre.
Depuis la guerre, le roman français, ou ce qu’on appelle ainsi, évolue avec une belle rapidité. Il n’est pas douteux qu’il subisse l’influence des Anglais et des Russes qui, seuls, nous ont donné des romans, c’est-à-dire des œuvres de longue haleine où de multiples personnages de caractères différents se heurtent et se combattent. En France, nous aurons beau chercher, nous ne trouverons que trois œuvres dignes du titre : « La Cousine Bette », « Le Rouge et le Noir » et « L’Education sentimentale ». Tout le reste de la production romanesque n’est que monographies, études psychologiques fragmentées, analyses brèves ou anecdotes. Après l’armistice, nous avons eu l’incroyable révélation de l’œuvre de Proust ; il y a quelques jours à peine, André Gide a publié Les Faux-Monnayeurs, tentative très brillante dont je parlerai bientôt, et l’on voit des écrivains comme Roger Martin du Gard et Marcel Arland, s’orienter avec des fortunes diverses du même côté.
Je note cela en passant, parce que j’y vois un corollaire de l’intérêt extraordinaire que suscite actuellement la littérature russe. Il n’est guère de grandes maisons d’édition qui n’aient dans leurs collections quelque œuvre de Gorki, de Tolstoï, de Tchekov ou de Dostoïevski. Il appartenait à la Maison Bossard de publier une « Collection des textes intégraux de la Littérature russe », que je ne saurais assez louer. Son effort qui dure déjà depuis plusieurs années a porté aussi bien sur des ouvrages d’auteurs contemporains comme Bounine, Kouprine, ou Fédor Sologoub, dont MM. Pernot et Stahl nous ont traduit une sorte de chef-d’œuvre intitulé : « Le Démon mesquin », que sur des œuvres incomplètement rendues en français jusqu’ici, comme par exemple « Les Frères Karamazov » ou « Les Ames mortes ».
Des « Ames mortes », nous ne connaissions qu’une édition très abrégée, tout à fait insuffisante. M. Henri Mongault nous donne enfin la traduction souhaitée. Il l’a accompagnée d’une introduction historique et critique dont tous les amateurs d’histoire littéraire apprécient vivement l’opportunité. Quant aux notes dont l’ouvrage est suivi, elles forment, en quelque façon, un tableau très complet de la vie russe à laquelle Gogol fait, sans cesse, allusion dans son « Poème ». C’est en dire l’agrément et l’utilité. Ainsi l’œuvre maîtresse de Gogol nous est restituée, peut-on dire, avec la saveur de l’original. Nous en saisissons parfaitement le mouvement et ce curieux mélange de lyrisme et d’observation. Elle est trop vaste pour que je puisse, dans le cadre limité de cette note, faire autre chose que la signaler. Comme le fait très justement remarquer M. Mongault, on peut considérer cette œuvre que la mort vint interrompre, « comme la peinture du régime patriarcal russe à son déclin, de ce régime que rongent la canaillerie des fonctionnaires, la sottise des hobereaux et la paresse de leur valetaille ». On peut aussi dire que c’est « le poème de la platitude, de la bassesse humaines ».
« La faculté maîtresse de Gogol - il le reconnaît dans une lettre - c’est de donner à la vulgarité un relief si puissant que les plus infimes détails sautent tout de suite aux yeux ». Il importe aussi de ne pas négliger le caractère moral que Gogol a voulu donner à son œuvre : sans entrer dans le détail, nous pouvons dire que, possédé de l’amour de la Russie, l’auteur des « Ames mortes » a rêvé de créer des types exemplaires de l’homme russe.
Quand j’aurai ajouté que l’œuvre de Gogol est douée d’une vie intense ; que l’on y rencontre des personnages dont le caractère étudié avec une minutie déconcertante atteint aisément l’universel ; que l’auteur y emploie sans fautes une science du comique, un humour auxquels je ne connais pas d’équivalents dans d’autres littératures ; qu’au surplus on la sent toute baignée dans l’esprit d’amour, l’esprit proprement chrétien, qui fait l’auteur s’incliner sans aversion vers tous les hommes quels qu’ils soient, - j’en aurai dit assez pour que la belle traduction que nous en offre M. Mongault suscite votre intérêt et, bientôt, votre admiration.
Robert Marin
Livres reçus :
Dostoïevski. Les Possédés. Traduction de M. Jean Chuzeville. J’en parlerai prochainement.
Pirandello. On tourne (Editions du Sagittaire). Roman assez curiment composé. La vie n’y manque pas mais des « idéologies » par trop nombreuses en arrêtent à chaque instant l’essor. Ce livre est comme un tissu rayé irrégulièrement : au premier regard cela amuse mais, bientôt, quelle fatigue !
✪ Compte rendu signé Robert Marin paru dans la rubrique « Chronique des livres » de Liège-Universitaire du 26 février, où il occupe la page 3, colonne a-e. Le roman d’André Gide [1869-1951] est paru aux Editions de la Nouvelle Revue Française. Denoël lui consacre deux chroniques, pour l’éreinter [cf. celle du 5 mars].
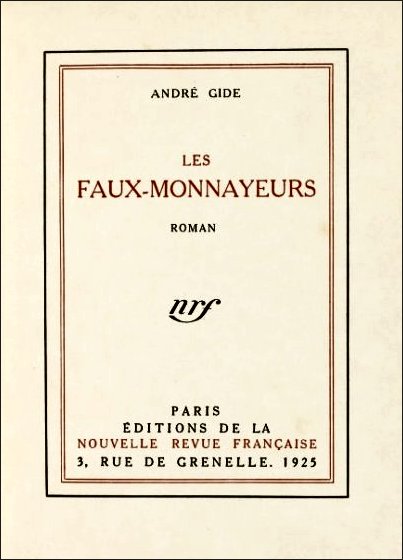
« Les Faux-Monnayeurs par André Gide [1] »
En dépit des embûches que ce livre tend à la critique et au lecteur, en dépit surtout de la confusion qu’un effort soutenu veut ici créer, je crois qu’il est aisé de discerner le rang de ces Faux-Monnayeurs que nous étions quelques uns à attendre avec plus que de la curiosité. Sans doute, il est tôt pour en parler. Nous manquons de recul. L’œuvre profite encore d’une nouveauté dont je ne sais pas si elle est uniquement formelle : cependant les points de comparaison qu’elle nous commande en grande instance, m’apparaissent si nettement définis que malgré les brumes dont s’entoure l’objet à comparer, une longue ignorance n’est pas possible de son poids et de son volume, non plus que l’erreur au sujet de sa situation. Pour le détail, Les Faux-Monnayeurs révèlent un grand nombre d’ambitions dont le degré varie. Comment n’en pas négliger ? On ne trouvera pas ici une étude, mais des notes, des indications sommaires ; je m’en excuse.
Dans son feuilleton des « Nouvelles Littéraires », M. Edmond Jaloux a réussi à dire l’essentiel de cette œuvre dont la complexité calculée ne laisse pas d’embarrasser. Au cours de cet article, où s’exercent une intelligence déliée et une sympathie que rien n’abat, M. Jaloux détermine avec la plus grande clarté le dessein de l’auteur des « Caves du Vatican ». L’admiration, que suscite la beauté de l’effort, lui enlève, me semble-t-il, un peu de sa perspicacité quand il s’agit de préciser le résultat atteint par cet effort même. Lorsque M. Charles du Bos loua chez Marcel Proust le « courage de l’esprit », nous étions à notre aise, car nous savions quelle magnifique récompense cette vertu avait trouvée. Force nous est de constater qu’il en va autrement ici. Quelles que soient les différences entre « La Cousine Bette » et « Phèdre » par exemple, on pourra toujours, sans ridicule, rapprocher ces deux œuvres ; mais qui voudrait - autrement que pour signaler une influence superficielle - parler de Dostoïevski, à propos des « Faux-Monnayeurs » ?
Laissons les Russes. Voyons chez les Anglais : ce ne sera certes pas l’œuvre de Dickens qui nous permettra le rapprochement. Meredith ? Elliot ? Non plus. Hardy, peut-être, ou Conrad ? Pas encore. Quoique M. Gide ait emprunté divers procédés à ces auteurs, il ne semble pas nécessaire de conclure à l’identité de valeur de son livre et d’œuvres comme « Lord Jim » ou « Jude l’Obscur ». En Angleterre, il n’y a vraiment qu’avec Daniel de Foë, celui qui écrivit « Lady Roxana » que l’on puisse tenter une comparaison : encore la supériorité ne restera-t-elle pas au Français. Demeurons en France, et ne cherchons pas trop haut. Ce livre, qui ne voudrait ressembler à rien, rend un son pareil à celui que rend l’œuvre de M. Roger Martin du Gard, « Les Thibault ». Sans doute, le livre de M. Gide diffère par la conception; on y voit un autre goût de la nouveauté, une autre ampleur et une richesse plus grande mais, à l’examen, ces qualités n’apparaissent pas assez développées pour interdire le rapprochement. Et d’un autre point de vue, c’est aux romans érotiques du dix-huitième siècle qu’il faut comparer cette œuvre où l’abondance des événements empêche la profondeur.
M. Gide a, au sujet du roman, les meilleures idées : il en expose plusieurs dans « Les Faux-Monnayeurs », il en exprima déjà un certain nombre dans ses livres de critique et, singulièrement, dans son «Dostoïevski». Il nous prouve aujourd’hui la difficulté de leur application et, quant à son chef, l’impossibilité. Quand il faudrait du génie, M. Gide nous offre son talent. Jusqu’à présent cet esprit, qui a fait agir plus qu’il n’a agi, possédait le sentiment exact de ses limites. Jamais, il n’avait tenté de les dépasser. Aussi lui devions-nous des récits parfaits, dont «La Porte étroite» demeurera comme le chef-d’œuvre. M. Gide juge sévèrement ses œuvres passées. « Les livres que j’ai écrits jusqu’à présent, dit Edouard, le héros principal des « Faux-Monnayeurs », me paraissent comparables à ces bassins des jardins publics d’un contour précis, parfait peut-être, mais où l’eau captive est sans vie. A présent, je la veux laisser couler selon sa pente, tantôt rapide et tantôt lente, en des lacis que je me refuse à prévoir ». Pour continuer cette allégorie, je dirai, sans ironie, que M. Gide endigue à plusieurs reprises cette eau sans force et que, lorsqu’il la laisse couler, ses flots trop limpides ne montrent que l’aridité du sol qu’elle recouvre. En voici des exemples.
Et d’abord la conception du livre. « J’invente, dit Edouard, un personnage de romancier, que je pose en figure centrale ; et le sujet du livre, si vous voulez, c’est précisément la lutte entre ce que lui offre la réalité et ce que, lui, prétend en faire. » Ce que M. Gide raconte, est pour Edouard comme la vie, comme la réalité. Edouard a, de croire à l’existence de ces personnages et de ces événements, des raisons dont la principale me paraît être la volonté de M. Gide. L’idée était ingénieuse, pour renforcer la crédibilité ou mieux, l’authenticité de sa parole, de confier au personnage principal le soin de l’interpréter. Pierre Louys, en publiant ses « Chansons de Bilitis », ne les présenta-t-il pas comme traduites du grec ? Et les notes critiques dont l’ouvrage était enrichi, ne serait-ce pas elles qui facilitèrent l’admiration du lecteur ? Malheureusement, nous ne découvrons pas dans le récit que fait M. Gide des motifs d’excitation aussi puissants que ceux qu’Edouard y recueille à chaque instant. M. Gide n’a pu se détacher d’Edouard : malgré les travers dont il afflige ce héros, nous voyons trop comme il lui ressemble. La réalité qui arrive à Edouard comme la simple réalité nous parvient à nous comme une réalité déformée. Il nous paraît inutile que le personnage principal ou l’auteur s’applique encore à l’interpréter puisque, déjà, il le fit. Cette critique, d’ailleurs, sollicite la nôtre. Elle l’obtient, mais qui ne porte plus sur cette réalité mais bien sur la façon dont on veut nous l’imposer. Et pour finir, nous ne verrons dans cette conception, qu’une habileté, le plus souvent impuissante à entamer notre froideur.
C’est aussi que les faits qui nous racontés n’atteignent, pour la plupart, qu’une valeur d’anecdote. Et, pourtant, quels efforts M. Gide ne fait-il pas pour leur insuffler une vie profonde ! Encore une fois, le défaut ne gît pas dans la forme. L’auteur des « Faux-Monnayeurs » sait conter et, ce qui est bien plus difficile, styliser ses personnages et son récit. Bien que le dialogue reflète un peu trop fidèlement la réalité, il s’en écarte assez pour prendre parfois un ton d’humanité, qui saisit. Comment, alors, M. Gide ne parvient-il pas à rendre un événement dans sa complexité ou, tout au moins, dans une partie de celle-ci ? Besoin de simplification, goût de la ligne pure ou, peut-être, attitude « a priori ».
Des exigences typographiques me forcent d’arrêter ces notes ici. Je les compléterai la semaine prochaine. Mais que l’on n’aille pas conclure du ton de ces lignes que « Les Faux-Monnayeurs » ne commandent pas le plus grand intérêt. Les indications qu’ils contiennent ne seront pas perdues. Et en dehors de cela, ce livre vaut par des intentions morales : il me sera agréable de les signaler.
Robert Marin
Mars
✪ Compte rendu signé Robert Marin paru dans la rubrique « Chronique des livres » de Liège-Universitaire du 5 mars, où il occupe la page 3, colonnes a-e.
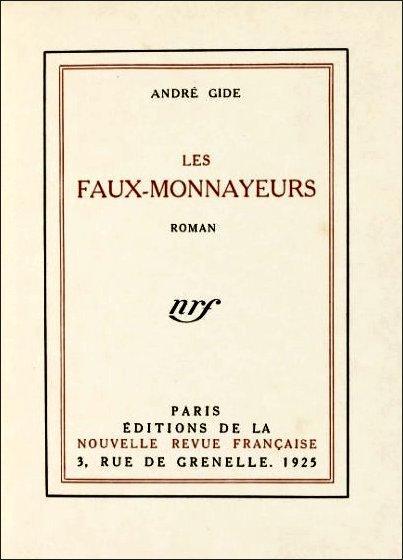
« Les Faux-Monnayeurs par André Gide [2] »
Je me demandais, la semaine dernière, en terminant ma chronique au sujet des « Faux-Monnayeurs », comment il se fait que la plupart des événements qui composent la trame de ce roman, s’y paraissent rapporter d’aussi grêle façon, comment ils se présentent à nous, si pauvres de résonnance, de mystère et pour tout dire, de signification. Aucun des actes de Bernard, d’Olivier ou d’Edouard, ne conduit à cette émotion que les gestes de «L’Immoraliste » ou d’« Isabelle » ne manquaient pas à déclencher. A plusieurs reprises, au cours de son dernier livre, M. André Gide assure le lecteur de l’excellence de ses intentions. Il le prévient qu’il se soumet à ce qu’il faut bien appeler « l’inspiration », qu’il abandonne sa personnalité, qu’il se veut oublier devant les acteurs du drame dont il se fait le narrateur. Le lecteur aurait peut-être aimé de comprendre cela sans avertissement. Quoi qu’il en soit, devant l’œuvre accomplie, il se voit contraint de dire que M. Gide n’a pas tenu sa promesse ou qu’il l’a tenue avec trop peu de générosité pour qu’on lui en marque de la reconnaissance. Ou bien l’auteur des «Faux-Monnayeurs» n’a pas su, malgré son désir, vaincre son goût le plus habituel ; ou, simplement, ce qu’il a trouvé au fond de lui-même, cela que le « démon » lui a accordé était par trop maigre. Je crois que le vice de cette œuvre tient à ces deux causes.
M. André Gide s’est-il soumis, comme il se le proposait et comme il le devait, à ce hasard qui, par ailleurs, lui a été si favorable ? Au lieu du naturel, de l’aisance que l’on voudrait y trouver, on remarque, tout au long de cette œuvre, l’artifice le plus étudié. Pas la moindre confiance en soi, mais un besoin de critique qui n’a de cesse que tout ne soit détruit ou en voie de mort. Jamais les lecteurs d’André Gide, pourtant accoutumés à ses préparations, à cet art savant des moindres effets, n’auront été sollicités avec autant d’insistance.
Que ces précautions aient pour objet de s’insuffler l’intérêt ou l’enthousiasme, ou l’indignation, elles provoquent, toutes, l’agacement. Et ce souci constant de l’effet, par cela seul qu’il est visible, suspend le cours d’une vie déjà précaire. M. André Gide use souvent des procédés de la comédie italienne (Ces coïncidences qui paraissent invraisemblables quand on en lit le récit et qui pourtant sont fréquentes). Je ne le lui reproche pas. Est-ce que les conversations surprises par l’auteur d’A la recherche du temps perdu nous gênent le moins du monde ? Il nous gêne de voir que M. Gide adopte ces procédés, non parce qu’en effet ce sont eux qui se présentent les premiers à l’esprit, mais, parce qu’en les choisissant, on pourra se targuer de sincérité ou de parfaite docilité à l’inspiration. Cette ruse et mille autres ne m’arrêteraient qu’un instant si je découvrais d’autre part des motifs d’admiration.
Quand M. Gide raconte les divers épisodes de son roman, il ne les réduit pas à la dimension convenable, il les ampute. Il accomplit sur la réalité des coupes, mais toujours au même endroit et toujours dans le même sens. Comme cet acte se répète avec une régularité en quelque sorte nécessaire, on en arrive à une impression d’uniformité. Une nouvelle convention se crée, mais si odieuse, si pénible qu’on se prend à regretter celles des autres romanciers. Lisez d’affilée trois cents pages de Faublas ou des Liaisons dangereuses, je serais bien étonné si elles ne vous jetaient pas dans la même fatigue que trois cents pages des « Faux-Monnayeurs ». Cette curiosité qui ne s’adresse qu’à un côté de l’individu, immobilisera l’écrivain dès qu’elle manquera d’aliment. Et ainsi s’expliquent ces lignes où s’étale l’affectation la plus outrée : « Passavant... autant n’en point parler, n’est-ce pas ? Rien n’est à la fois plus néfaste et plus applaudi que les hommes de son espèce, sinon pourtant les femmes semblables à Lady Griffith. Dans les premiers temps, je l’avoue, celle-ci m’imposait assez. Mais j’ai vite fait de reconnaître mon erreur. De tels personnages sont taillés dans une étoffe sans épaisseur. L’Amérique en exporte beaucoup... etc. » Je voudrais bien savoir comment les défenseurs des « Faux-Monnayeurs », s’il s’en trouve, feront pour expliquer cette attitude. Comment admettre qu’un écrivain introduise consciemment dans son œuvre des personnages dénués de vie. Notez que je ne parle pas ici des autres personnages comme « Laura Douviers» dont le caractère et les gestes sont aussi fort conventionnels. Je ne connais pas une seule grande œuvre où un personnage soit présenté de la sorte. Pour les créateurs, il n’y a pas d’hommes tout faits, ce sont eux qui les font.
Je me trompe peut-être. J’ai trop d’admiration pour certains livres de M. André Gide pour ne pas vouloir l’étendre à une œuvre qu’il doit considérer comme capitale. « En art, il n’y a pas de problèmes - dont l’œuvre d’art ne soit la suffisante solution », écrivait-il jadis. Je ne peux me défendre de croire que tous les problèmes posés par « Les Faux-Monnayeurs » attendent encore une solution. Ce qui fait le plus grand intérêt de cet ouvrage, c’est une étude, beaucoup plus abstraite que l’on ne pourrait le penser au premier abord, de l’adolescence et de ce qui la compose. Comme le disait M. Edmond Jaloux : « Cette mauvaise ivresse, ce cynisme, ces grands élans, ces beautés, ces défaillances, ce désir de jouer avec la vie, ce besoin de s’affranchir de tous les liens, tout cela M. André Gide l’a étudié de la manière la plus subtile et la plus vaste. »
Et j’ajouterai que M. Gide a noté, bien subtilement aussi, cet équivoque attrait et invincible que les tout jeunes gens exercent sur un homme mûr. Mais qui ne voit le caractère accessoire de tout cela ?
Robert Marin
✪ Compte rendu signé Robert Marin paru dans Liège-Universitaire du 14 mars, où il occupe la page 1, colonne b-c.
Peintre de paysages né à Liège, Guillaume Detilleux [Liège 1886 - Bruxelles 1961] n’appartient à aucune école. On a qualifié sa peinture de « décharnée » et de « squelettique » : ses compositions offrent la particularité de montrer des paysages dépouillés de toutes leurs contingences : heure, temps, saison, atmosphère. On ne voit pas, chez cet artiste, ce qui a attiré Denoël, qui aime les peintures robustes et pleines de santé d’un Mambour, par exemple - sauf l’originalité.
« Guillaume Detilleux »
C’est un métier, paraît-il, que de parler de peinture. Il y faut un vocabulaire technique, un ton d’oracle et toutes sortes de façons compliquées dont je n’ai pas l’habitude. Ne craignez pas que je vous découpe un tableau en plans, en volumes et en éclairages. Je laisse à d’autres ces exercices. C’est une tâche différente qui me sollicite et bien plus belle : il s’agit pour moi de désigner un talent, de le montrer sous sa face la plus vraie et de vous inviter à l’admiration qui me possède.
En art, quel que soit le procédé employé, je réclame de l’artiste qu’il me montre du neuf et que cela vive. A quoi bon s’encombrer de cadavres ou d’avortons ? La peinture, surtout, exige une vue particulière, une domination spéciale de l’artiste, sans laquelle son œuvre ne sort pas du néant.
Guillaume Detilleux vient de faire sa première exposition au Cercle des Beaux-Arts. Que ses toiles révèlent un métier étonnant, une aisance à peindre qui confond les plus avisés, cela ne me regarde pas. Mais, si par leur secours, je pénètre dans un monde qui, auparavant, n’existait pas pour moi, si elles éveillent au plus profond de moi-même des échos que j’ignorais, une seule attitude m’est permise : celle de l’admiration. Soyez assurés que je ne m’en priverai pas.
Guillaume Detilleux ne s’inspire de personne, sauf de lui-même. Il écoute son instinct le plus secret, celui-là qui est le plus difficile à entendre, recouvert des feuilles mortes, de la pourriture de la convention. Il faut voir comme il se refuse à la facilité, comme il s’interdit tout clin d’œil à un monde déjà décrit. Il travaille avec un courage, beau en lui-même, mais plus beau encore par ses résultats : chacune de ses toiles est le fragment d’un univers, tout plein de mystère, mais où il y a place pour la vie. Chacune nous apporte, petite ou grande, une surprise comme la lumière au sortir d’une cave. D’abord, nous écarquillons les yeux, mais ce n’est pas longtemps: cette présence nous devient familière et déclenche notre joie la plus pure. A quoi cela est dû, je n’en sais rien. Je me garderai de diminuer mon plaisir en l’analysant. Je ne vous décrirai pas les tableaux de Guillaume Detilleux, je ne tenterai même pas de les évoquer. Les mots n’ont rien à faire ici, que de vous décider. Si vous avez des yeux, allez voir.
Robert Marin
✪ Comptes rendus signés Robert Marin parus dans la rubrique « Chronique des livres » de Liège-Universitaire du 14 mars, où il occupe la page 3, colonne a-e.
Le livre de Delteil [1894-1978] est paru chez Albert Messein dans la collection « La Phalange ».
Celui de Fernand Divoire [1883-1951] a été publié en 1925 par Simon Kra aux Editions du Sagittaire dans la collection « Les Cahiers nouveaux ». Le livre auquel fait allusion Denoël est Introduction à l’étude de la stratégie littéraire, paru en 1912 chez Sansot : c’est un recueil satirique qui recense toutes les recettes pour triompher dans la vie littéraire.
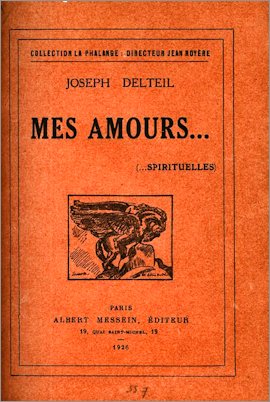
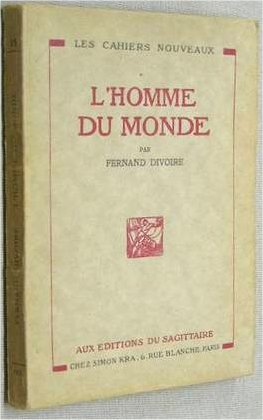
« Mes Amours... spirituelles par Joseph Delteil -
L’Homme du monde par Fernand Divoire »
Dans son enfance, Joseph Delteil a beaucoup joué, et à toutes sortes de jeux, avec la langue française. Cela se passait au soleil dans un décor d’arbres et d’herbe. La chaleur aidant, bien des recoins se révèlent, bien des replis secrets se dévoilent. Maintenant qu’il la possède, cette langue française, ses anciennes familiarités le servent magnifiquement à lui faire dire ce qu’il veut, à lui faire avouer les hontes les plus cachées ; cela sans ruse, sans circonlocution. Il lui suffit de parler avec l’accent de la joie. Il lui suffit d’user de ce ton dru, de ces propositions absolues. Nous reconnaissons son «style», je ne dis pas son écriture, à vingt mètres.
Ce qui distingue Joseph Delteil de ses contemporains, à part sa langue à forte saveur campagnarde, c’est, je crois, le goût de la vie, et surtout le goût du grand. Il s’avance bardé de partis pris et il donne à droite et à gauche de forts coups de poing à l’intelligence, à l’esprit du boulevard, aux esthètes. Un instinct l’écarte de tout ce qui ne jaillit pas, de tout produit de pur artifice. Son encre pâlit, quand elle rencontre le mesquin. Il n’est à l’aise que dans les vastes sujets ou les espaces largement balayés d’air. Les poumons, pour respirer, réclament le ciel et les étoiles. Ajoutez à cela un optimisme solidement fondé, un rire puissant, qui met toutes ses dents à l’air et son cœur. En voilà assez pour aimer Delteil et tout ce qu’il écrit.
Lisez Mes Amours... spirituelles. Ce n’est pas un grand livre, c’est un recueil d’articles, de contes, de vers, mais vous le goûterez, et très vivement, à cause de sa franchise, de sa verdeur et de la poésie qu’il capte à chaque instant. Il contient des notes sur Pierre Mac Orlan, Max Jacob, le peintre Delaunay, Philippe Soupault, Jacques Rivière, un plan du Xe arrondissement (une merveille), le « Discours aux oiseaux » par St-François d’Assise et des films et un chapitre inédit de ce livre extraordinaire : Sur le fleuve Amour. Et pour vous séduire plus sûrement, je vous ferai lire cette page sur Max Jacob : [suit un long extrait du livre].
Cette page, que j’ai dû mutiler, n’est-ce pas qu’elle suscite une image merveilleusement vraie du poète du «Cornet à dés » et du « Laboratoire central » ? « Mes Amours... spirituelles » contiennent, comme celle-là, plusieurs raisons de plaire.
*
Il y a des années que je connais le nom de M. Fernand Divoire. Au hasard des jeunes revues, j’ai lu quelques uns de ses beaux et curieux poèmes. Comme tout le monde, je sais qu’il écrivit un traité fameux de «Stratégie littéraire». Je n’ai jamais pu me procurer ce traité non plus que les autres livres de M. Divoire. Je le regrette d’autant plus que la lecture de « L’Homme du monde » m’a ravi. C’est un petit livre mais tout pénétré de la poésie la plus authentique. L’auteur y a mis une préface fort courte : « C’est de la prose », sans doute à l’usage du critique qui s’empresse de crier à l’erreur ou, s’il n’est pas poli, au mensonge. Non que les notes, les petits tableaux, les réflexions plus que malicieuses qui composent ce recueil, soient des vers ou relèvent du genre «prose poétique ». Le mystère de cette réussite est plus difficile à trouver qu’un premier contact ne pourrait le faire croire. On ne s’en tirera pas avec une vague classification.
Les seuls miracles dont nous jouissons aujourd’hui, nous les devons aux poètes. Ouvrons les yeux. Devant nous, ils créent la vie, ou ils la ressuscitent. Parfois, il leur faut de longues incantations. A M. Divoire il suffit souvent de quelques mots, de quelques phrases. La poésie, il l’appelle du ton le plus simple. S’il la sollicite, c’est par des mots familiers, des gestes que ne dépare aucun tragique extérieur. Mais sa voix connaît des sonorités si humaines, tant de grâce, en dépit des brusqueries, enveloppe sa parole que la poésie ne résiste pas, qu’elle caresse de sa présence comme une lumière, ce livre où l’auteur considère quelques uns des plus rares spectacles du monde. Si je vous donnais le nom de ces spectacles, vous seriez étonnés. En effet, leur rareté ne provient que de la mauvaise attente qu’on leur accorde généralement. Il faut, pour que rien de leur vertu ne nous échappe, tout le zèle, toute la persévérance, toute la présence d’esprit du poète. M. Divoire a bien raison d’écrire après avoir évoqué de la plus vivante façon la figure d’un autre poète :
« Et pourtant...
Cendrars, j’ai aussi un genre de forêt, et un genre de croix du sud, et un genre d’espace.
En attendant. »
Suivez M. Divoire dans son « monde », vous en reviendrez, le cœur battant, l’esprit bellement ému et tout prêt à la reconnaissance.
Robert Marin
✪ Compte rendu signé Robert Marin paru dans la rubrique « Chronique des livres » de Liège-Universitaire du 19 mars, où il occupe la page 3, colonne a-e.
L’édition étudiée est celle de Jean Chuzeville parue en 1925 chez Bossard dans la « Collection des textes intégraux de la littérature russe ».
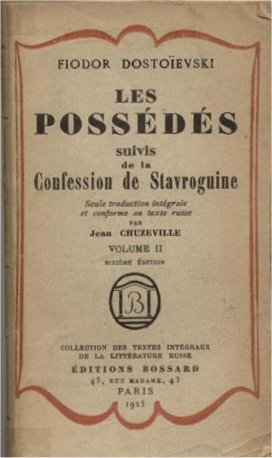
« Les Possédés suivis de La Confession de Stavroguine par Féodor Dostoïevski »
J’ai déjà eu l’occasion de signaler ici [cf. l’article du 19 février], à propos des Ames mortes notamment, les excellentes traductions que la maison Bossard nous offre dans sa « Collection des textes intégraux de la Littérature russe ». Cette initiative est d’autant plus intéressante que nous lui devons la révélation de plusieurs œuvres d’un très grand intérêt et, par ailleurs, la restitution des textes que des éditeurs peu scrupuleux n’avait pas craint de mutiler. Grâce à M. Mongault nous connaissons complètement Les Frères Karamazov ; M. Jean Chuzeville nous apporte aujourd’hui Les Possédés.
Parmi les grands romans de Dostoïevski, L’idiot, Les Frères Karamazov et Crime et châtiment, Les Possédés tiennent une place très spéciale, non pas par la composition générale qui, me semble-t-il, y est moins achevée, non plus par le détails des innombrables personnages que l’on y rencontre. En effet, il règne dans Les Possédés comme une sorte de confusion - peu gênante d’ailleurs à la lecture - qui tient et au souci que l’auteur apporte à la préparation de chaque événement, et à la complexité de l’action principale. Nous ne trouvons pas dans Les Possédés, cette progression magnifique, cette montée lente vers un conflit supérieur si pas unique, qui éclate avec violence dans les autres romans de Dostoïevski.
Nous assistons à une série de conflits, individuellement amenés de la manière la plus dramatique, mais dont la résolution fragmentaire nous arrête aux dépens du reste de l’action. Dans la construction des personnages même, tous doués d’une vie étonnante d’ailleurs, mais qui n’est pas toujours poussée au degré extrême d’intensité comme dans Les Frères Karamazov, il semble qu’il y ait aussi une sorte de ralentissement à l’activité créatrice. Sauf Stavroguine qui peut prendre place à côté des grandes figures de Dostoïevski, comme Raskolnikof, ou le Prince Mirichkine, il semble que les autres caractères, pour puissants qu’ils soient, n’obtiennent pas (toujours d’un point de vue technique), cette inexprimable plénitude, cette richesse d’être qui confond. Tout ceci demanderait pour être justifié, de longs développements : ainsi faite, la remarque peut paraître inexacte. Mais il ne faut pas oublier que le génie est ici comparé à lui-même : quelle que soit l’immense valeur des Possédés pris en eux-mêmes (ce livre seul égale un homme aux plus grands), si on les place à côté des autres œuvres de maîtrise, il faut bien dire qu’ils pâlissent un peu.
Mais une fois ces considérations techniques terminées, il éclate que dans aucun de ses romans, Dostoïevski n’a réussi à créer une atmosphère aussi violente, aussi tendue. On sait que ce livre présente la peinture de deux sortes de conflits, conflits d’ordre familial, et conflit d’ordre social. Mais, ce qui fait le fond du livre, ce qui lui donne toute sa résonnance et toute son ampleur, c’est la pensée profonde qui l’anime. C’est ici que Dostoïevski a le plus clairement exprimé ce que l’on peut appeler sa « philosophie », et cela de la manière la plus vivante et la plus dramatique. S’il fait exposer ses idées par un Chatov ou un Kirilov, ne croyez pas que ces personnages se transforment, comme souvent dans le roman français, en rhéteurs soucieux de composer des discours parfaitement logiques et parfaitement inutiles.
La pensée que Dostoïevski ordonne à ses personnages de traduire, il l’a incorporée à leur vie, à leurs passions, à leurs vices ; et leurs paroles deviennent en quelque sorte nécessaires à l’explosion du drame. Si un Chatov ne raisonnait pas comme il le fait, si Kirilov ne nous donnait pas théorie de « L’homme-Dieu », il est incontestable que la valeur de ces deux personnages en serait diminuée et, par suite, la force des épisodes où ils tiennent la première place. Quelle est donc la pensée que nourrit cet épouvantable tableau, à quel ordre obéissent donc les convulsions qui peuplent ce roman des gestes de la fureur et du désespoir ? C’est la théorie la plus chère à Dostoïevski et qui apparaît à des degrés divers dans tous ses livres, à commencer par Crime et châtiment, comme le dit parfaitement M. Boris de Schloezer.
Dostoïevski avait bien autre chose à faire qu’à peindre les révolutionnaires ou à éclairer les mystères de «l’âme russe » : c’est sa propre existence qui était en jeu et l’existence de Dieu et celle de toutes les valeurs vitales et métaphysiques qui, à ses yeux, tombaient si Dieu n’était pas. Toute la question pour lui est de savoir si l’homme peut vivre sans Dieu, et Les Possédés ne sont en somme qu’un acte d’accusation contre le Diable, contre cet esprit de néant que Dostoïevski sentait en lui, qui le tentait et que jamais il ne parvint à vaincre... Dostoïevski veut démontrer (à soi-même plus encore qu’à nous) que, détaché de Dieu, l’homme aboutit au crime, à la folie, à la mort, et s’il poursuit les révolutionnaires russes de sa haine, c’est qu’ils incarnent pour lui ce désir de l’homme de s’organiser sans Dieu, c’est-à-dire contre Dieu.
C’est peut-être dans le personnage de Stavroguine, figure hallucinante et terrible, que Dostoïevski a poussé le plus loin la mise en œuvre de sa théorie. Nous le voyons encore mieux maintenant qu’à la suite des «Possédés» nous pouvons lire l’horrible « Confession de Stavroguine ».
Remercions M. Jean Chuzeville (1) de nous avoir donné une traduction aussi claire, aussi vivante de cette œuvre gigantesque.
Robert Marin
(1) Notre plaisir serait plus complet encore si une courte notice (comme on l’a fait dans la même collection pour d’autres œuvres) indiquait la situation exacte du livre dans l’œuvre du romancier, précédait la traduction.
Avril
✪ Compte rendu des Faux-Monnayeurs d'André Gide, roman publié en 1925 par les Editions de la N.R.F. Texte signé Robert Marin paru dans Sélection, 5e année, n° 7, du 15 avril 1926, aux pages 156-158.
Cette critique a ceci d'inattendu qu'elle a déjà paru sous la plume de Robert Marin dans Liège-Universitaire des 26 février et 5 mars. Denoël éreinte toujours le roman de Gide, mais en d'autres termes, plus vifs et convaincants que dans l'article précédent.
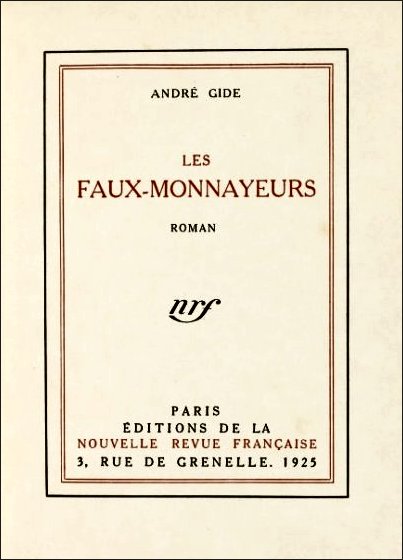
Cette œuvre naît à peine et la voilà qui gagne les régions de la mort. Chacun tendait vers elle des mains prêtes à étreindre et chacun les a laissé tomber.
Rien ne nous retient ici que le spectacle d'un effort immense et vain. La grandeur de la peine nous rend moins supportable encore le vide qu'elle a circonscrit. Faudra-t-il que, comme tous, nous nous rabattions sur l'accidentel de ce livre, l'aisance, l'audace, une probité que l'on a pu méconnaître ou même sur la réussite de certaines pages ? Triste proie pour l'admiration que ces intentions clairement exprimées et clairement trahies. Et comment louer des qualités que, par ailleurs, nous connaissions bien employées. On comprend le ton funèbre de la critique à l'égard de ce livre, cet accent du regret dont la sympathie la mieux armée ne peut se défendre.
« Les livres que j'ai écrits jusqu'à présent, dit Edouard, le héros principal des Faux-Monnayeurs, me paraissent comparables à ces bassins des jardins publics d'un contour précis, parfait peut-être, mais où l'eau captive est sans vie. A présent, je la veux laisser couler selon sa pente, tantôt rapide et tantôt lente, en des lacis que je me refuse à prévoir ». Pour que l'attitude annoncée de la sorte trouve sa justification, il faut que l'auteur soit assez fort pour y demeurer fidèle et en outre qu'il se sache possesseur d'une infinie variété de richesses. Ces richesses, il doit pouvoir les exprimer d'un seul élan, se gardant d'influer sur leur cours. Or il semble que M. Gide ait ouvert les portes à son goût le plus habituel, qu'il n'ait fait que rendre plus allègre la démarche d'une pensée déjà connue. On doute même s'il n'a pas empêché l'éparpillement de cette pensée, s'il a su se garder de lui imposer la direction unique qu'il faut bien lui reconnaître. La profondeur est réduite à l'extrême. La vie se répand, c'est vrai, mais pas si loin que le regard n'en saisisse en un instant l'étendue. L'eau du bassin a un volume, une couleur, un poids ; celle-ci qui devrait fuir plus loin que l'horizon, humecte à peine un aride enclos.
Ce défaut apparaît si crûment et les exemples en sont si nombreux qu'il devient évident que M. Gide en a méprisé les méfaits. Encore nous devait-il compensation. Mais où la trouver ?
« J'invente, dit Edouard, un personnage de romancier, que je pose en figure centrale ; et le sujet du livre, si vous voulez, c'est précisément la lutte entre ce que lui offre la réalité et ce que, lui, prétend en faire ». Ce que M. Gide conte est donc, pour Edouard, comme la vie, comme la réalité. Edouard a, de croire à l'existence de ces personnages et de ces événements, des raisons dont la principale me paraît être la volonté de M. Gide. L'idée était ingénieuse pour établir l'authenticité de sa parole, de confier au personnage principal le soin de son commentaire. Malheureusement, nous ne découvrons pas dans les récits que nous fait M. Gide des motifs d'excitation aussi puissants que ceux qu'Edouard y recueille. M. Gide n'a pu se détacher d'Edouard : malgré les travers dont il afflige son héros, nous sentons trop comme il lui ressemble. La réalité qui arrive à Edouard sous des traits purs, nous parvient à nous comme une réalité déformée. Il nous paraît inutile que le personnage principal ou l'auteur s'applique encore à l'interpréter, puisque déjà il le fit. Cette critique, d'ailleurs, provoque la nôtre. Elle l'obtient, qui ne porte plus sur cette réalité mais bien sur la façon dont on veut nous l'imposer. Et pour finir, nous ne verrons dans cette conception, qu'une habileté, le plus souvent impuissante à entamer notre froideur.
Qui, malgré tout, se voudrait sensible à cette réalité, il ne donnerait qu'un assentiment précaire. En effet, quand M. Gide raconte les divers épisodes de son roman, il ne les réduit pas aux dimensions convenables, il les ampute. Il accomplit des coupes sur la réalité, mais toujours au même endroit et toujours dans le même sens. Comme cet acte se répète avec une régularité en quelque sorte nécessaire, il produit une uniformité invraisemblable. Une curiosité qui ne s'adresse qu'à un côté de l'individu immobilise rapidement l'écrivain, faute de nourriture. De là ce dédain pour certains personnages, dont on regrette qu'il vienne si tard. A côté de la convention qu'il crée, M. Gide admet celles de ses prédécesseurs, quant à l'idée tout au moins qu'il veut suggérer de ses héros. La stylisation est ici poussée au point que l'on se demande pourquoi M. Gide n'a pas appelé Olivier et Bernard « les Adolescents » par exemple, Passavant « le mondain cynique », Laura Douviers « l'amoureuse délaissée » etc... Tout le monde a constaté le manque de vie particulière de chacun de ces êtres : leurs gestes n'émeuvent guère plus qu'une succession de signes algébriques.
La manière même dont les événements se pressent et, si nombreux, se soudent pour former un courant sans force, je ne suis pas à l'aise pour la louer. Quelle que soit l'agilité de l'auteur, son élégance, ou, si l'on veut, sa grâce, on a l'impression, en dépout ou à cause de toutes ses prudences, que le calcul le plus méthodique y présida. Je cherche la part de Dieu ou du démon ; je ne trouve que le visage de M. Gide, sous un aspect peu inquiétant.
La leçon morale qui se dégage des « Faux-Monnayeurs », les théories artistiques d'Edouard, le progrès « dans la connaissance du cœur humain », tout cela ne nous satisfait pas. Notre admiration demande un étai plus robuste. D'ailleurs, si M. Gide avait voulu nous intéresser au seul jeu des idées, il eût composé quelque traité d'éthique. Mais à quoi bon recommencer Corydon ?
Robert Marin
✪ Compte rendu de Les Poilus, roman de Joseph Delteil [1894-1978] publié en 1925 chez Bernard Grasset. Texte signé Robert Marin paru dans Sélection, 5e année, n° 7, du 15 avril 1926, aux pages 158-159.
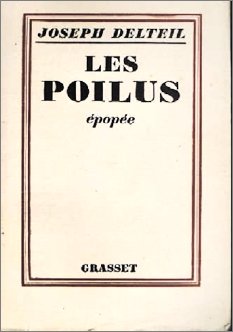
On se rappelle la déclaration de Joseph Delteil : « Pourquoi j'ai écrit « Les Poilus » ? Eh ! tout simplement parce que je me suis cru le seul à pouvoir les écrire. » Il ne semblait pas téméraire d'approuver cette assurance au moment qu'elle se manifesta. Quelques fragments publiés dans les revues annonçaient une œuvre sonore mais bien nourrie, une « épopée » où les mots de 1926 trouvaient naturellement l'accent héroïque. Le livre lui-même déçoit. On y chercherait en vain l'ample mouvement de Jeanne d'Arc. La réussite de quelques pages apparaît comme un phénomène isolé. Tout au long de quatorze chapitres, la négligence et la hâte - il faut bien le dire - étalent leurs méfaits.
Jusqu'à sa Jeanne d'Arc, Delteil avait cultivé d'un soin égal ses qualités et ses défauts. Puis il relâcha sa surveillance et tout le monde s'accorda à louer un beau livre. Aujourd'hui il semble qu'il ait fait adroitement son propre pastiche, qu'il veuille nous faire assister à l'exploitation (exclusive de toute découverte) des procédés, des habitudes « littéraires » de l'écrivain qu'il était il y a quelques mois. Je suis forcé d'user de ces mots pour caractériser un livre dont plusieurs pages me prouvent, en effet, que Delteil était « le seul » à pouvoir l'écrire. L'attitude du narrateur choque d'ailleurs autant que la forme du récit. Loin de moi l'idée de lui reprocher un patriotisme de music-hall, et un sentimentalisme à la manque. Le ton du livre est libre : s'il l'avait réussi sur ce ton-là, c'eût été un motif de gloire supplémentaire. Ce qui n'est pas supportable, c'est l'absence d'unité, ce sont ces mouvements contradictoires. Tantôt il considère la guerre de haut (la guerre vue en l'an 3000), tantôt de tout près, au point qu'il ne franchit pas la réalité visible pour tout le monde. Ces Poilus, ils ont été écrits par un seul homme, mais, dirait-on, à différentes périodes de sa vie. Des pauvretés inimaginables voisinent des pages solides, telles que nous les souhaitons. Manque d'acharnement, Delteil n'a pas bougé d'un pas. Une plus grande exigence vis-à-vis de soi-même nous aurait valu un chef-d'œuvre.
Robert Marin
✪ Compte rendu de La Maison des trois fiancées, un roman d'Emile Zavie [1884-1943] publié en 1925 aux Editions de la N.R.F. Texte signé Robert Marin paru dans Sélection, 5e année, n° 7, du 15 avril 1926, à la page 162.
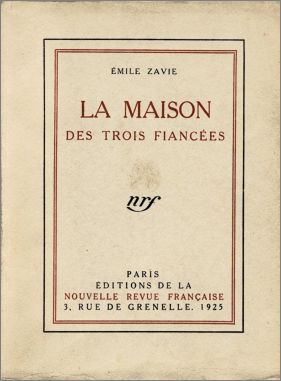
Le ton des premières pages, paisible, contraire à toute emphase, à toute manœuvre mélodramatique, nous avertit déjà que, dans ce livre, les événements, pour exceptionnels qu'ils soient, se réduiront au rôle subalterne. Ils ne serviront qu'à acheminer doucement des êtres humains vers la vie et à les y maintenir. La narration se fie à une chronologie minutieuse ; le style ignore la recherche comme la vulgarité (l'auteur sait que l'éclat n'est pas le plus sûr indice de la richesse) ; si je note encore un humour qui n'appuie pas, j'aurai dit l'extérieur de ce roman. Un personnage est jeté à l'improviste parmi des gens qu'il ignore. Il arrive dans un état parfait d'impartialité : différents phénomènes bien connus le conduisent plutôt vers ceux-ci que vers ceux-là. Les « Trois Fiancées » sortent de l'ombre à la faveur de surprises sentimentales. Les mouvements du personnage central, ses hésitations dues, - étrangeté en ce temps sexuel - au seul trouble du cœur, jettent sur elles une lumière insuffisante. Xénia, Wanda et Nate, toutes trois admirables, si différentes entre elles et pourtant sœurs, portent dans leurs yeux tout le tragique de la terre. Elles possèdent chacune un pouvoir d'attraction - pas nécessairement le charme slave - qui est évoqué d'une manière impossible à définir. Cent traits, cent gestes d'importance inégale sont ici rapportés d'un même accent, mais si bien que ces trois femmes vivent d'une vie à nulle autre pareille. C'est la beauté de l'œuvre de Zavie, que sans jamais s'arrêter à l'analyse, il soit parvenu à bâtir ainsi trois caractères qui nous retiennent et nous émeuvent. Evidemment, les autres ont été un peu négligés. Non pas le personnage central, acteur du drame et spectateur à la fois, dont la position ambiguë ne cesse pas d'intéresser, mais les comparses. Peut-être l'auteur a-t-il voulu les reléguer aux postes inférieurs ; est-ce pour cela qu'il les laisse grignoter par la convention ? - Cela seul entame notre plaisir.
Peu d'écrivains joignent au don, si peu répandu, de conter, la faculté de reculer les bornes de l'anecdote. Pour nourrir d'éléments durables un roman à péripéties, il faut autre chose que la main du bon ouvrier. On a vu des habiles s'essouffler à cette tâche. Le plus simplement du monde, M. Emile Zavie vient de réussir, malgré le pittoresque du sujet, à faire de « La Maison des trois fiancées » un roman où l'aventure immédiate n'est pas seule à nous attacher.
Robert Marin
✪ Compte rendu du Voyage sentimental de Victor Chklovski [1893-1984] publié en 1926 aux Editions du Sagittaire. Texte signé Robert Marin paru dans Sélection, 5e année, n° 7, du 15 avril 1926, à la page 168.
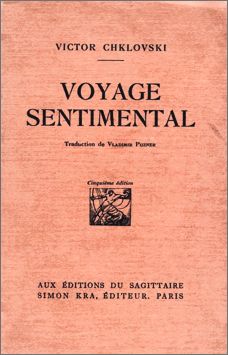
Voilà un livre écrit en mépris de la littérature et dont la force est terrible. Un moteur lâché et qui tourne sans arrêt. Malgré les ratés, la fumée et le bruit, il accomplit sa besogne.
Qu'on cherche dans ce « Voyage sentimental » des satisfactions d'ordre historique, la véritable odeur des révolutions ou des anecdotes, on en reviendra les mains pleines. Chklovski raconte sans art, sans souci de l'effet, dans un énergique désordre. Il vit la minute présente et ne s'embarrasse pas de sa culture, de la portée de ses paroles. Il relate l'horrible sans points d'exclamation comme il dresserait un inventaire : l'expression, toutefois, est dure, osseuse et elle cogne. Et parfois Chklovski se permet l'ironie, il s'y jette comme souvent l'homme devant une très grande souffrance.
Bien plus que les tableaux qu'il nous trace, c'est lui qui nous passionne. Nous laissons passer les révolutionnaires, les Turcs, les Arméniens, les comités de soldats, mais nous nous attachons à celui qui les a vus. Chklovski se montre, peut-être malgré lui, à chaque page de son livre. Il s'y trouve sans défense, comme dans le sommeil. Qu'importe le sang répandu, cette énergie égarée et la vermine que ces pages ne peuvent oublier ? La passion, l'amour de la vie prend au sein du monotone malheur un accent qui secoue. Rien de tel que des cadavres çà et là pour rendre les vivants plus alertes.
Robert Marin
✪ Nouvelle signée Robert Marin parue dans les numéros du 15 avril [p. 89-106] et du 15 mai [p. 275-292] de la revue littéraire bruxelloise Sélection.
Elle avait été remarquée, écrit Denoël en avril 1926, par Léon Pierre-Quint qui voulait la publier dans la collection « Les Cahiers Nouveaux » qu'il dirigeait aux Editions du Sagittaire.

Cette longue nouvelle est dédiée à Jacques Collet [1900-1959], un ami bruxellois dont il parle dans une lettre du 6 novembre 1927 à Victor Moremans : « Mon ami Collet qui vient de se marier a passé 15 jours chez moi avec sa femme. »
Le texte est en partie autobiographique mais, si Albert/Robert est aisément identifiable, Beïle, la Juive, qui est rousse aux yeux verts, comme Cécile Brusson, ne paraît pas lui emprunter d'autres caractéristiques. Denoël la décrit déjà trois mois plus tôt dans « Portrait » où, comme ici, elle appelle ou personnifie la mort .
Le héros de cette histoire est, en réalité, le père du narrateur, que Robert Denoël fait mourir accidentellement, et qui est le déclencheur du récit.
Un Homme de circonstances
Pour Jacques Collet.
Nouvelle.
I.
Le front bas, comme il sied au cortège des morts.
Joséphin Soulary (1815-1891).
A peine débarqué, Albert endossa la douleur que sa famille lui tendait comme un pardessus. L'oncle Emile donnait enfin sa démission de parent-le-plus-proche-de-la-victime ; son ventre redevint souple, sa barbe noire coulait avec une nouvelle abondance. Il conduisit Albert à la chambre où le cadavre régnait sur deux ombres agenouillées et le lui confia.
La surprise n'avait pas atteint à son point mort : le feutre des voix s'usait à peine. Ce n'est que le lendemain que l'antichambre retentit du murmure poli des salles de concert. Des habitudes venaient d'être imposées dont le provisoire exagérait la difficulté. Albert n'apportait que son ignorance et sa fainéante imagination. La Tante Julie, qui usait d'un face-à-main dès dix heures du matin, le secourut. Grâce à cette collectionneuse d'attitudes, il arriva à s'acquitter des premiers gestes. Et; dans la suite, revêtu de son uniforme d'orphelin, il fit l'exercice honnêtement, sans que personne l'engueulât.
Le temps était froid, qui lui permettait de grelotter quand s'embarrassait une conversation à sens unique. Impuissant à en varier le thème fondamental, il s'essayait aux fioritures. Aux femmes, il distribuait des détails sur l'accident et leur abandonnait le soin d'y coller de vieilles étiquettes salies. Certaines tiraient de leur œil une larme comme une crasse et d'autres, les mâchoires oscillantes, embrassaient sur les joues leurs vivants. Il les accompagnait jusqu'au palier où il inclinait vers leurs fourrures une dernière reconnaissance. Sa recette augmentait d'une représentation à l'autre. L'oncle Emile qui le jugeait en homme officiel ne cachait pas son estime: il parcourait le salon, en proie à des hochements de tête et à des soubresauts de vieille automobile. Albert en vint à s'admirer, lauréat de la douleur, distançant tous les concurrents de la famille. Devant une psyché il s'adressa des hommages : ses yeux de tuberculeux, sa peau maigre que rehaussait le poil et, offert à la vitrine de son visage, ce grand deuil.
Aux messieurs - entre hommes, n'est-ce pas ? - il parla d'heure marquée. Il bâtissait des sentences avec des décombres de philosophes. Un jurisconsulte, qui avait du rhumatisme dans le bras, cita Sénèque. Brutalement, il lui renvoya Montaigne ; écrasé, le vieillard rampa jusqu'à la porte.
Quand il redoutait quelqu'un, il disait : « Voulez-vous le voir ? » Et il montrait le cadavre comme une rareté. Tous filaient la tête plus haute, ce nouveau répit dans la poche.
A l'heure du dîner, Albert déposa une partie de ses armes. Il s'assit à côté de sa mère. Elle ne disait rien mais il détesta ses joues enflammées et son mouchoir. En face de lui son très jeune frère menaçait de croire à la considération qu'on lui témoignait. De la nourriture naquit sur les assiettes, tout à coup les verres furent pleins de vin rouge. D'où viendrait la première plaisanterie ? Un souvenir d'enfance de l'oncle ouvrit la porte aux sourires. La gaieté passa la tête. Mais la tante toussa.
Ils se mirent à composer une image du mort ; chacun fournissait une couleur, un trait. Elle fut flatteuse comme pour un jubilé, comme si, devant une coupe de champagne, il avait pu remercier d'un geste de la main et promettre une augmentation de traitement. Quand on s'aperçut que l'on parlait à l'imparfait, la douleur générale se raffermit. Albert se taisait : il se demandait pourquoi le mot « condoléance » s'emploie le plus souvent au pluriel.
*
Il sortit du sommeil comme d'un bain de boue et se hâta vers la douche. Tandis qu'il se frictionnait, les souvenirs, un à un, se rabattaient sur sa liberté. Il raccourcit ses gestes, épargna ses mouvements. Le courrier du matin lui livra un vocabulaire dont la richesse ne suffisait pas à une évasion. Aussi répondit-il au curé qui lui présentait ses consolations et secours tarifés : « Oui, oui, certainement, ne voulez-vous pas voir ma mère ? ».
Il déterrait de son cerveau des formes de pistils, de sépales et les principaux types de la famille des composées, quand il vit l'oncle retrouver le tic de se gratter une rainure du front. L'atmosphère devait perdre en densité. La Tante balança sa tête expérimentée et offrit de la force sous l'espèce d'une vieille liqueur. La cuisinière cassa quelque chose dans sa cuisine. Une heure s'affaissa lentement comme un terrain. Les dernières cellules du cadavre perdirent la vie.
Tout le monde rebondit lorsque des spécialistes clouèrent la bière. Le bruit des marteaux, si lancinant, rouvrait la souffrance dans les crânes. Il partagea cette sensation, la perçut vulgaire et sentit une amertume dégoûtante couler le long de son corps jusqu'à ses pieds.
L'ordonnateur de la cérémonie remplissait pompeusement son rôle et sa tunique. Albert s'étonna de l'entendre prononcer des phrases usuelles au lieu de vers de Victor Hugo. Pour la première fois de sa vie, il se trouva dans la rue, la tête découverte il est vrai, entre un vieillard et un homme mûr. Les saluts de la foule comme le chant ignoble des prêtres le stupéfiaient. Il crut saisir la solitude à l'église. Le cri rugueux des orgues, projeté contre les voûtes, retombait sur les dalles comme du plâtras ; des grappes de cierges, heurtées au passage, frémirent. Il s'y attacha pendant un quart d'heure, et à la mimique de l'officiant, aux fumées d'encens, aux dimensions du catafalque. Toujours plus lourds à ses épaules, il sentait ses parents, l'assistance curieuse, avec l'interdiction de tourner la tête. Des envies extravagantes (Foutez donc tous le camp ! Si on dansait !) se résolurent en un malaise. Il connut le poids de ses intestins et leur situation dans l'économie de son corps.
C'est alors que le Dies Irae s'avança à l'allure des processions. D'habitude la vertu de ce chant gagnait au plus lointain de lui-même de chaudes impressions endormies, d'un baiser au front les réveillait vertes. Elles ouvrirent un œil, étirèrent une paresse de cent ans ; une exigence de bachelier (la portée exacte du mot favilla ?) les repoussa net dans la lourdeur.
Il s'appliqua de nouveau. « Mon père est mort », murmura-t-il dans sa poitrine. Ce fil trop épais manqua l'aiguille. Il rusa : « Mon père n'est plus ». Refoulé jusqu'à un professeur de cinquième qui donnait des exemples d'euphémisme, il perdit courage et s'assit. Le cimetière, les deux discours, les pelletées de terre, les « merci monsieur, merci cher ami », le déjeuner encore au milieu de parents inconnus et décorés, s'entassèrent lentement, comblèrent trois heures. La maison avait hâte de reprendre sa coutume. Hors les vêtements des convives, une odeur et la disposition trop minutieuse des bibelots sur la cheminée, les services d'un tapissier et de la servante avaient effacé l'événement. Albert vit poindre sa fuite.
On parla d'affaires en retard, de retour. Malgré les instances de la Tante Julie, la mère d'Albert voulut retourner chez elle au début de l'après-midi. Albert allégua des notes à prendre - il venait rarement à Paris - pour repartir par le train du soir. Sa mère se résigna. Sur les dernières larmes dédiées à un mort qui n'avait jamais existé, on se sépara.
II.
Le printemps inquiet paraît à l'horizon.
Alfred de Musset.
Il les quitta. Il croyait les avoir abandonnés. Il se sentit rafraîchi, neuf, avec des aptitudes énormes. Il consacra les débuts de sa liberté à une marche saccadée. L'air lui tapotait le visage : il fut heureux pendant trois minutes.
Il arriva sur un boulevard où le moment suscitait des combats. L'ombre gonflait peu à peu son domaine. Des odeurs de toute provenance se fondirent sous le vent en un alliage épais. Aux façades, violemment sautèrent des lumières, qui y demeuraient accrochées, et dans le ciel et sur les trottoirs. Des pans de clarté croulèrent pour se redresser au milieu d'une rumeur de grande ville que les claquesons et les tremblements de terre nés des autobus désarticulaient. Un rythme qu'il n'aurait pu prévoir asservit son pas. Des visages coupés au ras de la nuit, soudain rouges, puis violets ou de cuivre, avec des yeux miroitants, invitent ses regards et partent. Avides, d'autres gagnent un instant la place froide, se bousculent, s'égaillent sur un grognement de troupeau.
Il n'osa agripper ce factice, ce renouvellement inexorable et vain de la rue : heurts, tourbillons, apparences sitôt touchées, sitôt défaites où la solitude gardait son poids. Mais il pouvait acheter les chrysanthèmes mal peignés que lui réserve cette devanture - il lui décerne un faible regard - refuser du feu à l'ouvrier - Je vous en prie, Monsieur - tâter les seins à la fille là-bas qui parle à une copine, se jeter dans l'alcool ou dans une maison de prostitution. Sa liberté n'était pas d'un usage rudimentaire. Il refusa, il refusa encore et chacun de ses refus en même temps qu'il fortifiait son espoir de gain, le rapprochait de la pauvreté, le ramenait sûrement à sa prison.
Il continua d'avancer. Il arrivait à l'extrême de la fatigue. Il vit ses parents le regarder de leurs yeux mal cuits d'où les larmes suintaient. Menacé par cette horde, il courait se réfugier dans un café, se distraire par l'estomac, parler au garçon, mais il rencontra Belhommet. Il connaissait le maniement de cet ami dont il suffisait de toucher un point pour que son énergie jaillît en gerbes et bouillonnements d'un contact agréable. Il s'élança vers lui comme un suppliant. Que cet être vivant lui communiquât sa vie, sa vie étrangère si pure ! Il lui posa une question anxieuse. Belhommet était disponible. Ce garçon précis et luisant comme un gobelet de nickel riait de plaisir et, déjà, précipitait dans le vide des gestes trop longs. Les trois heures qui le séparaient d'une femme allaient mourir sans se faire remarquer. Il se saisit d'Albert, le mena au café, choisit deux places et des boissons.
Puis soudain, très embêté :
- Tu es en deuil ?
- De mon père.
- Oh !
Mais Albert le prévint d'une phrase nette. Un instant surpris, Belhommet laissa choir comme un râtelier une banalité inopportune, la ravala en rougissant et repartit. En avant. Il se mit à parler seul. Généreux, il jeta son univers à la tête d'Albert comme un quartier de viande. Et, venant au détail, il fit surgir sa maîtresse, la planta toute remuante entre les verres, la lui donna. C'était une femme saine comme une vachère et fine avec laquelle il se battait tous les jours. Pour la présenter, il usa de comparaisons et d'images d'un modèle vulgaire, mais sa voix les accompagnait si précisément qu'elles rendaient un son efficace. Les mots sortaient tout nus de sa bouche et leur vigueur bâtissait des édifices solides. Il allait, il allait, toujours plus dur, plus net, proie d'une vitesse régulièrement accrue, comme un piston. La possession, l'attente, les rires, la colère se heurtaient sur son visage. Albert acquit en peu de temps une âme de spectateur, réduite à quelques témoignages, à des sentiments de collectivité. Quand la course de Belhommet aboutit au premier silence, il ressentit une gêne d'entr'acte. Il accepta une cigarette à bout de paille ; son visage se chargea de politesse ; pour lui, il avait déjà quitté le café. Il relisait le télégramme : « Viens. Ton père grièvement... ». Sa mère exprimait sa peine en signes atroces. Il la secoua comme une mèche de cheveux. Après une courte honte, déférence à l'Albert mécanique qu'il traînait partout, il ouvrit la porte à une femme nue. Elle accomplissait chacun de ses innombrables gestes. Elle parlait très vite en prononçant toutes les syllabes et sa bouche menue était si ronde qu'elle semblait siffler. Elle se couche. Elle n'est plus qu'une femme envahie par le plaisir. Ses seins détachables, eût-il dit, si tendre est leur contour, si mûres leurs couleurs, s'alanguissent, se relèvent au vent de sa poitrine. Sa gorge rit, quelle est cette fontaine ?, et de chauds éventails de plumes poussent l'air au long de ses hanches endormies.
Belhommet la creva. En quelques coups de crayon il dessina sur une réclame une coupe d'embryon de canard qui lui avait été présentée à son dernier examen. Il aurait voulu teinter le noyau des cellules au bleu de méthylène : il suppléa l'absence de ce colorant par l'encre de son stylo. Le résultat fut étrange et décoratif. Belhommet expliqua que son amie du mois précédent lui avait brodé un coussin d'après ce modèle. Et comme Albert exprimait de la curiosité :
- Viens chez moi, fit-il, je te le montrerai.
Albert abdiqua encore une fois et de bonne grâce. Ils sautèrent dans un taxi et en quelques minutes arrivèrent chez Belhommet. Son bureau, qui lui servait aussi de chambre à coucher, était tendu de toile grise comme les murs d'une salle d'exposition : en guise de tableaux il avait accroché çà et là des pièces de soie qui brillaient. Rien ne rappelait la double destination de cette chambre : le lit, grâce à un mécanisme, se rabattait dans un placard, une commode basse remplaçait la table de nuit et le lavabo s'abritait à l'intérieur d'une sorte de coffre-fort. Belhommet fit admirer cet aménagement. Il n'oublia pas de signaler qu'un curieux vase chinois, acheté Boulevard Richard-Lenoir, lui servait de pot de chambre. La trivialité de ce détail les fit rire. Il montra alors le coussin et une main d'homme qu'il avait volée à l'amphithéâtre pour la disséquer à loisir. Elle baignait dans un pot à tabac rempli d'alcool. Belhommet la retira au moyen d'une pince et en indiqua les muscles superficiels. Albert se blessa au doigt en maniant un bistouri. Il y avait sur une table un encrier plein de teinture d'iode qui servit à désinfecter la petite plaie. - Ils burent du thé qu'ils préparèrent eux-mêmes. Ils fumèrent. Ils tisonnèrent des souvenirs de lycée. Ils ébranlèrent de gros traités pourvus de planches coloriées et de statistiques où des jeunes filles en costume de bain servaient de signets. Ils s'amusaient. Cependant, vers six heures, Albert se rappela que Belhommet avait un rendez-vous et il se leva. Belhommet, attristé de cette séparation, lui offrit un livre de poèmes en édition de luxe dont il possédait par distraction deux exemplaires. Croyant avoir perdu le premier alors qu'il l'avait oublié chez un ami, il avait pu en acheter un autre. Cet ami, un vieillard qui ne lisait plus et très obligeant, avait fait reporter le livre chez lui quelques jours après. Malgré cette explication, Albert hésitait à prendre le cadeau. Il s'entendit injurier en anglais, et fort sèchement. Il accepta avec émotion et partit.
*
Au sortir de chez Belhommet, il avait oublié son passé immédiat. Sa force d'accueil augmentait : s'il n'avait pas déjà récupéré l'aisance de ses mouvements et cette foi dans la générosité du hasard qui enrichissait sa vie quotidienne, l'extérieur des choses l'affligeait moins. La rencontre de la juive fût à cet instant demeurée stérile, mais non la présence d'une ancienne amie. Tout en usant de faux-fuyants, il s'avouait prêt à la consommation de plaisirs indéterminés. Provisoirement, il entra chez un coiffeur dont la vitrine le séduisait.
Passé l'antichambre, il se trouva dans une pièce lumineuse où des boiseries de teinte pâle, des glaces paisibles et un tapis doux à la marche composaient un décor favorable. Un jeune homme vêtu de blanc glissait dans la tiède atmosphère, les bras chargés d'objets bizarres en nickel, et ses yeux étaient pareils à la mélancolie des antilopes. Albert abandonna son pardessus que le patron de l'endroit recueillit en grande douceur. Un fauteuil lui fut tendu. Il s'assit plein de la nonchalance des bêtes à longs poils. Une vague de linge frais atteignit son cou, où elle séjourna, et la senteur du savon entoura ses oreilles. Un homme mûr se leva, dodu, printanier, digne d'amour. Dans une glace des ciseaux voletaient en bourdonnant autour d'une tête espagnole. Le garçon attaché au service d'Albert, portait une barbe qui appelait doucement l'adjectif « fleurie ». Les rasoirs s'élançaient sur les joues comme des traîneaux et leur sillage était rose. Au bout de quelques minutes, Albert vit son désir accompli. Un scrupule le retint de sortir. Heureusement le coiffeur lui suggérait d'autres plaisirs ; il se laissa imposer un massage facial.
Albert ignorait tout de cette opération mais, depuis des années, désirait la subir. Dans un silence délicat le garçon prépara des appareils étincelants munis de fils électriques, des flacons, un système de brosses. Albert songeait au noir de son costume qu'il avait aperçu dans un miroir quand il sentit appliquer sur sa figure une serviette qui venait d'être brûlante. Le coiffeur la retira bientôt et de ses doigts longs, doux comme la laine, enduisit d'une pâte le visage docile qui s'offrait. Il se prit à le malaxer avec une mansuétude inexprimable. Puis il usa d'un instrument mystérieux, qui approchait la peau sur un frémissement d'éventail, une pudeur d'oiseau, pour, soudain décidé, niveler tout accident. Une paix d'après-midi d'été où la chaleur et le frais se rejoignent, descendit le corps d'Albert, gagna des articulations lointaines, passait souriante sur ses côtes, flattait ses bras, lui chatouilla l'oreille. Il connut une joie d'ivresse quand une lamelle de caoutchouc pénétra sa chair, la pinça, la tritura, la couvrit de brutalités voluptueuses.
Aux intervalles du sortilège, le garçon se penchait à son oreille et furtivement lui soufflait des interprétations. Albert, tout pétri d'essences rares et d'urbanité, approuvait son langage optimiste, imité des prospectus. Après une dernière familiarité de la main du coiffeur, il sourit à son visage devenu lisse, régulier, d'une fraîcheur végétale et si heureusement sensible que le moindre choc l'affectait d'allégresse. Il se leva, paya une somme minime à la caissière dont les yeux sourirent naturellement pour la première fois de la journée et sortit, escorté de la gratitude du garçon auquel il avait donné un pourboire digne d'éloges. A peine dans la rue, il s'aperçut que l'heure de son départ était proche. Il entra n'importe où et mangea n'importe quoi, à la hâte. Puis, il courut vers la gare.
Derrière un pilier, il surprit l'oncle Émile en train de sangloter d'une manière affreuse, dans sa barbe déployée comme une serviette.
III.
Je plains l'homme qui peut voyager de Dan à
Bersabée et s'écrier : Tout est stérile.
Sterne.
Quand vers minuit, le cœur barbouillé de remords indigestes, Albert rentra dans sa chambre, il s'étonna de se découvrir une âpre curiosité du lendemain. La tendresse minable de sa mère à qui il venait de dire bonsoir, avait ranimé sa pitié. Mais la Juive, il n'avait pas compris son nom, le retenait davantage, et les moindres accidents de ce retour, où son père écrasé par une automobile intervenait étrangement. Albert s'irrita et se félicita tour à tour d'une stabilité trop vite retrouvée. Les conventions sursautaient et lui représentaient le mélodrame de l'orphelin blasphémant une mémoire encore chaude. Il se frappait la poitrine, puis il se raillait de cette soumission passagère. Pour finir, il glorifia son appétit. Il repassa ce trajet de deux heures, en lui infligeant des déformations. Dès son entrée dans la gare, il avait redouté la solitude et son climat funeste. Pour y parer, il s'était muni de livres, de journaux. Bagage insuffisant. Il eut peur. Il souffrit.
Comme il était de quelques minutes en avance, il se promena le long du convoi et, en jetant des coups d'œil dans les compartiments, s'aperçut qu'il cherchait une femme seule. Il recula, la conscience moite, puis il se soumit en aveugle à ce désir dont il connaissait la réalisation impossible au moment qu'il la concevait. N'importe. Il voulait rencontrer une femme, une femme quelconque, celle-là qui passe seule, vêtue de vert, non, elle est accompagnée, une autre, vous qui parlez par la portière, ou cette troisième, celle qui voudra. De grâce, un visage où se reposer, une barrière à ouvrir, une clôture à abattre et, soudain, deux bras qui se referment, une bouche qui trouve son chemin... En hâte, il longea de nouveau le convoi, retournant d'un regard chaque compartiment; mais ces masques étaient trop simples ou bien, déjà, trois hommes entouraient ce corsage. Et il avait dû s'asseoir en face de coussins vides en invoquant le fatalisme qui le secourait en de telles déceptions.
Il ouvrit ses journaux, coupa les premières pages d'un roman et s'arrêta pour louer les circonstances qui lui épargnaient une conduite indécente. Une vieille femme et un enfant entrèrent, qui s'établirent dans le coin opposé. Il y eut un moment qu'il entendit vivre la gare comprimée dans sa cage de vitres et de fer. Les autres figurants étaient alors arrivés en bon ordre par le couloir, mais précédés de grands éclats de voix. Au passage, Albert les évalua. Le plus gros d'entre ces hommes était aussi le plus bruyant : son enveloppe le trahissait bassement. II le considéra avec partialité. Rien à espérer de ce ventre qui dévale à pic sur des cuisses courtes ; ni de ces bajoues roses, ni de ce col de porcelaine, vulgarité cossue, si pénétrée de son importance qu'elle tue toute curiosité.
Le train eut un grognement intestinal, souffla, s'étira et partit.
Une femme passa dans le couloir. Le gros homme s'empressa : « Par ici, Mademoiselle, cria-t-il, il y a encore une place ». Elle jeta un regard distrait à son interlocuteur, elle hésitait, Albert la fixa et d'un coup (du moins il l'avait cru) la tira dans le compartiment. La dernière place vaquait à côté de lui. La femme posa dans le filet une mallette de cuir et s'assit. Deux centimètres d'air le séparaient d'elle. Une rumeur d'estime courut.
Elle s'était assise maladroitement, trop en avant, le buste penché et elle serrait les genoux.
A partir de ce moment, les souvenirs d'Albert se refusaient à une discipline. Ils accouraient en troupes et de toutes parts, impatients d'occuper la première place. Il se rappela cependant l'intense plaisir, la satisfaction du salaire enfin touché, qu'il avait ressentie à voir entrer la femme. Il se rappelait aussi les différentes humiliations qu'il avait subies, mais il les dédaignait pour n'en garder que le résultat seul digne de mémoire. A grands renforts d'épaules et de gosier le gros homme avait lancé des gravelures et ses compagnons riaient de tous leurs boyaux chatouillés. Cette complicité ne suffisait pas à l'humeur du pachyderme : il réclamait une adhésion universelle. Il se mit à plaisanter les voyageurs, guettant sous les paupières de chacun des témoignages d'approbation. Ils se gardèrent de les lui refuser. Albert, renfrogné au début, avait souri, et, de plus en plus lâche, avait ri ; aussi fut-il moqué comme les autres.
La femme était jeune, une jeune fille, et l'esthétique de son costume l'apparentait aux modistes du dixième arrondissement. Mais elle n'était pas maquillée : elle semblait ignorer la ruse. Elle demeurait sans mouvement, les yeux attachés à sa mallette, - absente.
Albert lui cherchait un état-civil, des motifs de voyage. L'existence immédiate de cette femme, la réalité de son corps et de ses vêtements, sa jambe d'un type courant mais qui n'écartait pas le mystère, l'aspect que son visage offrait à tous avec indifférence comme une vitrine ses objets morts, tout cela arrêtait Albert et le passionnait bien plus que les déductions qu'il en aurait pu tirer. Il la regardait à la dérobée, non pour découvrir des pistes neuves où s'élancer, mais afin d'accommoder sa vue à cet être dont le voisinage lui était promis pour une durée minimum de deux heures. Elle se déganta. Ses doigts longs comme ceux des squelettes, avec des ongles à l'état naturel, rappelaient la teinte médiocre de son visage. Ses yeux saillaient, mal enfoncés. Elle cachait son corps dans un tailleur gris, neuf, mais de façon commune, des bas crème, des souliers d'étoffe noirs. Une écharpe bigarrée liait son cou à sa poitrine, un chapeau cloche engloutissait la moitié de sa tête.
Le gros homme offrit des cigarettes. Albert dut accepter après des refus grotesques. Il se proposa d'en offrir à son tour : allant à sa poche, il sentit son étui vide. Il rougit. Le gros homme s'excusa soudain et, tout en ratissant sa moustache, présenta le paquet à la jeune femme. Elle fit non de la tête. Il insista. Elle refusa à nouveau sans mot dire mais tendit un sourire que personne n'aurait pu prévoir. Albert en avait été enchanté. Il révélait à ses yeux une singulière faculté d'adaptation au bonheur. Ce n'était ni le sourire commercial, ni le sourire de dédain ou de complaisance. Un geste aussi peu espéré expliquait plutôt l'aise d'une enfant qui émerge d'un demi-sommeil pour remercier la sollicitude de son entourage.
Cependant, la jeune femme n'avait pas encore parlé : ses dents étaient régulières, un peu jaunes.
Malgré le dépit qu'il éprouvait, le gros homme entama son panégyrique. Il lui brassait de gigantesques éloges que sapait une gauloiserie de réserviste. Albert inspecta encore sa voisine comme s'il avait dû faire son portrait : ses lèvres, dressées à cet exercice, s'étiraient en un nouveau sourire, qui parut presque bête parce que les yeux et l'esprit ne suivaient pas. (Mais, quelles sont ces prunelles comme des vitres, pas si sombres qu'Albert ne voie, un instant, l'inquiétude y cogner de la tête ?) Le train roulait très vite, scandait les conversations à coups précipités. Les mots isolés gagnaient de l'importance : comme dans les télégrammes on doutait de les comprendre. La fumée des cigarettes bouillonnait, puis étalait un voile mou sur des visages de flamme. L'enfant dormait, le nez dans les jupes de la vieille. Albert sentit que la température atteignait vingt degrés centigrades. Brusquement la mince paroi de ses vêtements céda et la chaleur de la jeune femme rencontra la sienne : du point de contact dérivait un paisible courant qui reflua sur tous ses membres. Au lieu de lui dispenser le bien-être, cette chaleur étrangère décuple la sienne et le fait souffrir. Son sang alerté bondit en désordre, toute sa chair, frappée jusqu'aux orteils, crie d'un immense attrait. Le voilà lâché, et il hurle, ce besoin d'étreinte ; il la reconnaît cette avidité de forcené qui lui brûlait les mains dès son premier tripotage de petite fille dans le jardin paternel. La bête a faim. Qu'on la nourrisse !... Mais que veut-il trouver au creux de ce corps? Quoi, une fragile retraite à forcer, quelques tièdes secrets à toucher du doigt, ses humeurs épanchées et il serait satisfait ! Est-ce donc cela qui le courbe vers cette femme sans beauté ?
- Puisque vous ne voulez pas de mes cigarettes, dit le gros homme, je vous offrirai des galettes fines. Je les rapportais à ma femme ; une de plus, une de moins, foutre ! Vous n'en aurez pas, vous autres.
La jeune femme demeura sans répondre, le paquet sous le nez. Indifférence, mépris, stupidité ? elle ne faisait pas un geste. Le gros homme répéta son offre. Un voyageur aux joues bleues l'appuya. Albert s'amusait de leur insuccès. Elle se tourna vers lui et d'un visage qui disait la confiance, lui demanda conseil. Il obéit au premier sentiment venu et lui souffla : « Acceptez, je vous en prie ». Elle prit la galette, la paya d'un hochement de tête et se mit à manger, vivace comme une jeune bête. Ses yeux étaient verdâtres, couleur d'eaux mortes, qu'une marée imprévue ranima. Elle semblait libre de son apathie, prête à entrer dans la vie commune. De son coin la vieille lui envoyait des indulgences. Albert ne bougeait plus, ramassé sur lui-même, figé dans une zone de bonheur comme le poisson au soleil. Le gros homme secouait ses mentons, donnait du coude dans ses voisins, déployait un grand orgueil. Il s'enhardit même à poser la patte sur les genoux de la jeune femme. Inutile de crier « A bas ! » puisqu'elle ne proteste pas. Elle admet cette impudence comme le froid, comme la fatigue, comme la nuit qui fuit derrière les vitres, toutes ses étoiles au front.
- Alors, Mademoiselle, vous allez à...
Le plaisantin nomma la ville qu'Albert habitait. La jeune femme fit un signe affirmatif.
- Vous êtes étrangère?
Elle répondit de la même façon.
- Anglaise ? Non ? Belge ? Polonaise ?
A ce dernier mot, elle fit non, précipitamment, comme indignée et dit :
- Rousse.
Puis elle se tut.
Sa voix n'offrait aucune aspérité mais elle en avait fait un trop bref usage pour qu'Albert pût l'apprécier plus avant. Le mot qu'elle avait prononcé levait le rideau sur un spectacle de fusillade, de viols et d'incendie. Albert ferma les yeux et la revêtit mentalement d'une destinée orientale. Elle en devint plus attractive encore. Pourtant ses pommettes lisses, enduites d'une mince couche de lumière, ses paupières, sa bouche étiolée, et son buste, que balançaient les hasardes de la vitesse, semblaient réunis pour une vie dénuée d'accidents. Il ne relevait aucune empreinte de révolution, aucun passage de cataclysme sur ces jambes, ce corps naïf, mais des traces de repas à prix fixe, de semaine anglaise, les émotions connues dans les cinémas de quartier, les joies de la banlieue les dimanches de beau temps... Le gros homme parlait de la fraternité des peuples, de sentiments internationaux. Les auditeurs attendaient l'application de ses principes.
Albert profita de la distraction générale, avança le pied et, en grande crainte d'échec, toucha le soulier d'étoffe. La réponse instantanée exauça si pleinement son attente la plus secrète qu'ébahi, il faillit ne pas la goûter. Un pied vorace pressait le sien, lui assénait des témoignages de tendresse. Et au premier cahot le contact s'accrut d'une jambe de chair et de chaleur.
Leurs yeux se heurtèrent. Les siens se mouillaient, mais en dépit de son émotion, il regarda le sang courir sous la peau de la jeune fille, du front jusqu'au cou ; ses pupilles prodiguer une lumière si dure qu'il la supportait mal ; son nez éprouver de minuscules convulsions dont pâtirent bientôt ses lèvres gonflées à bloc. Cette ardeur qu'elle déclarait ingénument mais sans impudence comme sans grossièreté, la transformait mieux que n'eût fait l'abandon de son vêtement pour la tenue convenable à une poitrine prospère, à des bras qui respirent le bonheur, à des lignes courbes, à tout cela qu'Albert croyait réclamé par un désir naissant. La violence de l'appel ne le choquait pas mais bien l'appétit qui se révélait tout à coup, dents à l'air. Tout satisfait qu'il fût de la victoire reçue, il se dépitait d'avoir été si long à la décider. Il se sentait tenu de l'attribuer à des accidents dont il n'avait jamais été maître. A tout hasard et avec une grande gaucherie il se félicita d'avoir passé par les mains du coiffeur. Dès cet instant il sut que cette fille serait sa maîtresse, mais il ignorait l'époque de cet événement, sa durée, ses conditions. Il aurait fallu la connaître davantage, aussi reporta-t-il l'assouvissement de son envie à un avenir éloigné. Il pensait d'ailleurs d'une façon très fragmentée, voisine de l'incohérence. Ses idéee se bousculaient : la rapidité du train et de cette aventure le rendait stupide. Il imaginait Belhommet écoutant le récit de son histoire, la vie russe de la jeune femme qui, soudain, cédait la place au gros homme réduit à la peau et aux os par la jalousie. Mais des instances toujours plus pressantes le ramenaient sans cesse au centre de la joie. Il jouissait de son succès comme si la jeune femme avait appartenu au gros homme, comme s'il la lui avait volée. A titre de compensation, il voulut rire aux plaisanteries que ce personnage continuait à décharger avec une lourdeur obstinée de ruminant. L'amour que la jeune femme inspirait, formait le fonds de son discours. Albert constata que dans le développement de ce thème l'orateur usait tour à tour de l'hyperbole, du parallèle et de la litote. A cette découverte, il rit sans contrainte. Pour elle, elle paraissait comprendre ces phrases qui, toutes, atteignaient ses oreilles. Du moins, enfoncée dans le velours, elle riait sans bruit, en fronçant le nez, comme les lapins mangent. La lumière attaqua son visage de biais, fouilla une fossette, révéla une malice d'enfant.
Cependant, les compagnons du gros homme accumulaient les exclamations, les cris de la gorge et du ventre et composaient un vacarme égal à la nuit par la sécurité qu'il donnait. Albert saisit le bras de sa voisine au niveau du biceps et le pressa hypocritement. ll osa même lui chatouiller le creux de la main à l'instant que le bruit parvenait à sa cime. Le voyageur aux joues bleues subissait une quinte, les autres le bourraient de conseils et de tapes. Le gros homme montrant Albert déclara dans un hoquet :
- Monsieur revient sans doute d'un enterrement, mais il pourra dire qu'il n'aura jamais autant ri qu'aujourd'hui.
Cette sentence, rendue au milieu du respect, s'achevait à peine qu'une volée de cris l'accueillait. L'homme aux joues bleues se frappait la tête contre le capitonnage, un petit vieux à lunettes carrées manqua être désarçonné par un galop trop rapide, tandis que son vis-à-vis exprimait à coups de poing sa sympathie pour l'orateur. La vieille femme n'existait plus, elle regardait par la portière. Albert enrageait comme un que l'on interrompait dans le sommeil, mais sans rien laisser entendre de sa situation, il avait témoigné la joie jusqu'au moment où la vitesse du train s'anémia, se confondit avec son élan et mourut.
Une ville, tapie dans l'ombre, guettait la volonté des voyageurs, leur suscitait des images de plaisir en même temps que des journaux et des sandwiches. La vieille et l'enfant descendirent. Le compartiment soudain refroidi parut amputé. Le vieux aux lunettes carrées se dirigea vers le coin libre et s'accota. Avant que le train repartît Albert avait réfléchi à certaines suites de l'accident de son père : un procès ou d'interminables discussions avec la compagnie d'assurance. Le gros homme ouvrit son veston, écarta les jambes et se prit la tête entre les mains. L'espace plus grand dont chacun profitait avait supprimé une partie de l'intimité : il fallut plusieurs minutes de trajet pour relever la conversation. La jeune femme n'avait pas quitté son poste, elle envoyait à Albert des regards en éclaireurs, qui ne rapportaient rien que les preuves d'une grande timidité. Par une lâcheté qu'il nommait pudeur, Albert n'osait parler à sa voisine, il se bornait aux expressions rudimentaires de sa jambe et de son pied.
Enfin le gros homme sortit. Albert trouva encore des prétextes pour retarder l'essor des paroles. Elle n'y tint plus. Plusieurs sentiments excessifs travaillaient son corps, qui, tout entier tendu, se dirigeait vers celui d'Albert immobile. Et tout à coup, dans une angoisse qu'elle s'efforçait de cacher :
- Vous de C... , dit-elle à mi-voix.
Albert, stupéfait et irrité de cette audace, pensa se montrer dur, opposer la froideur, peut-être même la grossièreté à cette avance. Plus simplement, comme le temps le pressait, il adopta son langage et répondit :
- Moi de C...
Elle fut si contente de cette réponse qu'elle exécuta le plus rapidement possible tous les gestes de sa reconnaissance : un clin d'oeil, une pression de main, un sourire et un hochement de tête. Déjà une magnifique avidité la forçait de dire :
- Quoi vous faire ce soir ?
- Moi, rentrer maison.
Ses yeux regagnèrent la nuit, son visage si net se lézarda et le sang qui se retira de ses joues les laissa déçues comme des nuages sans soleil. Elle repartit brusquement :
- Vous venir demain quatre heures dans oune cinéma ?
- Moi pas pouvoir, moi deuil.
De ces mots, elle comprit qu'ils exprimaient un refus dont le motif lui échappa. L'obstacle nouveau qui s'élevait entre elle et son désir, la mit en colère. Elle se frappa rageusement le genou et d'un air de méchanceté demanda:
- Quoi deuil ? Moi pas comprendre.
- Perdu parent... Vous pas compris ?... Vous venir demain quatre heures dans oune café ?...
Elle accepta sur le ton de l'enthousiasme. Sans souci des voyageurs, qui, d'ailleurs, sommeillaient, elle pressa les mains d'Albert, les caressa, avec de grands transports. Il lui indiqua la situation de ce café proche de la gare. Tandis qu'il donnait cette explication, malgré lui, il pensait pour la première fois à la mort de son père. Il se représentait l'accident et ses détails : un choc ; une poitrine qui craque, la bouche s'ouvre pour un cri, c'est un sang baveux qui en sort. A cette image il avait éprouvé une souffrance bizarre, un tiraillement de ses muscles qu'il oublia vite car la jeune femme lui demandait son nom. Elle le trouva admirable et le répéta en variant ses intonations. Elle regardait Albert comme pour voir si ce nom s'adaptait bien à sa personne, puis, convaincue, elle dit :
- Beau, Albert... Beau, Albert... Moi appeler...
Elle prononça les syllabes de son propre nom. II n'en perçut qu'un assemblage de gutturales et de chuintantes, pénible à se figurer... Il l'interrogea. A mesure qu'elle parlait, il découvrait de nouvelles raisons de la croire Juive, mais il négligea de s'informer de ce détail.
Elle lui apprit qu'elle avait habité Paris pendant six mois. Elle venait d'arriver à C... où son frère était établi avec sa famille. Elle devait chercher du travail et c'est pour cela qu'elle s'était rendue le matin même à Paris. Du genre de travail qu'elle cherchait, elle ne dit mot. Ses paroles manquaient de clarté, la pauvreté de son vocabulaire et un débit rapide aggravaient la confusion de son discours. Albert, trop sensible aux attouchements dont elle le favorisait, la comprenait peu. Mais elle le passionnait comme une arme chargée.
La rentrée du gros homme mit un terme à leur dialogue. Albert choisit un air distrait, la Juive lui décernait des regards comme des flammes ; personne ne s'y trompa. Le gros homme considéra les jeunes gens en silence. Puis il montra Albert du doigt et dans une amertume d'homme trop mûr, dit :
- C'est moi qui ai chauffé le four, c'est lui qui y mettra cuire son pain.
Albert s'abstint de protester. La Juive poussa une sorte de grognement joyeux. Comme on approchait de C..., le gros homme avait encore dit :
- Je vous invite tous à prendre un verre au buffet de la gare.
Albert doutait s'il allait accepter. Il se rappela à temps qu'il ne possédait plus que quelques pièces de monnaie ; il refusa.
La Juive ne disait ni oui, ni non. Il n'éprouva aucune inquiétude.
Sa vie, ses gestes, quels qu'ils fussent, ne lui importaient plus jusqu'au lendemain à quatre heures. Eût-il pu d'ailleurs rendre la politesse au gros homme qu'il aurait préféré revenir directement chez lui. Dès que le train fut en gare, il s'esquiva après de vagues excuses. Il avait serré la main du gros homme pour serrer celle de la juive.
Il s'était enfui par une rue immense où des réverbères frissonnaient. Il hâtait sa marcher et se répétait qu'il valait mieux ne pas découcher ce soir-là. Sa mère pourrait s'en affecter outre mesure.
Quant à son père, il l'avait oublié.
IV.
La mère d'Albert agit peu sur les sentiments de son fils, jusqu'au matin qui suivit son retour. Elle y avait collaboré pour sa part modeste, une rose dans la tapisserie, une ligne dans le décor où Albert traînait une indifférence douloureuse de ne pas s'ignorer. Cette femme souffrait jusque dans ses profondeurs mais depuis trop longtemps elle tend l'échine à l'artifice, qui la plie, l'étire et la façonne à son gré pour que l'exaltation casse sa souplesse. Tous ses gestes sont soumis au système métrique ; aucun ne jaillit, aucun n'éclate. Après de lentes réflexions, des comparaisons dont le détail échappe, elle s'est pétri un modèle de dignité dont elle ne s'écartera jamais. Sa voix connaît les modulations adaptées aux exigences de la vie, son rire se maintient dans une ellipse inextensible, ses fureurs elles-mêmes, le centimètre les gouverne et sa tristesse, pour vive qu'elle soit, a trouvé l'expression qui ne changera plus. Albert savait cela de longue date mais, buté à l'aspect des choses, il n'avait pas voulu voir au-delà d'un mouchoir humecté de larmes décentes, au-delà de ces bras que le désespoir tordait avec soin.
Il s'en était irrité.
Il s'en irrita bien davantage pendant les heures qu'il usa avant son rendez-vous. Par surcroît, la cousine âgée, qui était venue aider aux premières tristesses du veuvage, l'encombrait de ses apitoiements. A chaque instant, elle lui lançait gracieusement dans les jambes quelque pouilleux échantillon de sa pitié - qu'il ramassait avec des marques de gratitude. Cependant la colère lui battait le sang et l'amenait à vouloir une action prompte, comme de casser plusieurs objets ou de posséder une femme. Mais s'il pensait à la Juive, à son appétit femelle, et à la rapacité qu'elle cachait sous d'humbles replis, il pensait aussi, et avec quel dégoût, à sa propre lenteur. En dépit d'une brutalité naturelle, Albert se croyait un fond de douceur qu'il aimait de faire valoir surtout aux yeux des femmes. Il avait fini, à force de se copier soi-même, par estimer la possession une démarche importante qu'il faut préparer longuement, avec un courage sans cesse reconstruit, comme un examen. Excepté des étapes au bordel, il ignorait les aventures rapides. Mais alors, cet hôtel dont un ami lui avait donné l'adresse ? Cet hôtel si proche du café, lieu de son rendez-vous ? Il tenta, car il avait envers lui-même de douteuses pudeurs, de s'expliquer l'illogisme. En fait, il sentait qu'il voulait, - ne fût-ce qu'à titre de protestation - coucher le soir même avec la Juive; et d'autre part le terme de son désir dépassait, prétendait-il, un apaisement d'usage. Il a une maîtresse, femme moelleusement installée pour quelques années encore dans la trentaine et dont les exigences sexuelles ne chôment pas. Elle lui a écrit « pour le consoler. » Une telle niaiserie studieuse foisonnait dans sa lettre qu'il y avait aussitôt répondu par des remerciements gonflés de larmes. Il avait terminé son mot, en prévenant la destinataire que, vu les circonstances, il ne la rencontrerait de plusieurs semaines.
Au rappel de ce geste, Albert ajoutait l'absence de motifs à poursuivre en d'autres corps les plaisirs qu'il venait de détester. Docile à une autre superstition, Albert assurait volontiers à l'heure des traits d'esprit, que la possession aide à surprendre les plus petits secrets des femmes. II voulait connaître celle-ci, il la croyait trop différente des cadavres le long de quoi il vivait, pour ne pas espérer un secours inouï. Son imagination travaillait avec aisance à fabriquer de cette voyageuse à la peau muette, au corps mille fois vu, un être qui par hasard aurait une âme. D'ailleurs sous les sévices familiaux son héroïsme poussait comme une maison. Albert relégua sa paresse et, dans un grand zèle, se condamna à la possession immédiate de la Juive. Il coucherait avec, pour en finir. Il lui arracherait sa robe, et non pas seulement celle d'étoffe. Il lui ôterait la peau, il la viderait, cette fille, comme une volaille, mais il saurait ce qu'elle a dans le ventre.
Comme d'autres pour se donner de la colère, Albert crie faux pour se rendre de la décision. Il en aggloméra assez pour être sûr d'une victoire que par prudence il se mit à calculer. Il réfléchit même aux moyens de n'être pas surpris avec une femme dans la rue. Car ce garçon qui voyait les conventions rivées aux épaules d'autrui, ne parvenait pas quant à lui, à les secouer définitivement. Scrupuleux comme un chimiste, il avait au moment du déjeuner prévu tous les événements de son après-midi, hors l'essentiel. A table, il dut prendre la place de son père ; il montra à s'y asseoir la dignité qui convenait à un jeune homme promu au grade de maître de maison par de dures circonstances. Il se trouva du naturel.
Avant de partir, il reçut la visite d'un vieillard qui avait guidé l'enfance de son père. Cet homme paraissait égaré par la mort qu'il venait d'apprendre. Pour s'en convaincre il voulait parler aux personnes qui avaient le mieux connu le défunt. Il parlait lentement, ses yeux de victime agrippés à ceux de son interlocuteur, dans l'attente d'une clémence immédiate. Albert n'avait rien à lui offrir. Les plus frais souvenirs de ce malheureux dataient d'un autre âge : il aurait fallu fouiller des tombeaux, remuer on ne sait quelle pourriture pour découvrir des détails bons à le satisfaire. Albert ne lui fournissait que des mots sans résonance, sans odeur substantielle ; le vieillard partit sur sa gêne accrue.
Albert sortit aussitôt. Bien éloigné d'imaginer que la Juive pourrait ne pas venir, il craignait de la faire attendre. Une seconde, il pensa lui acheter des fleurs ou des bonbons, mais le temps lui manquait de ces gestes accessoires et désintéressés. Il arriva au rendez-vous, l'haleine courte, mais en même temps qu'elle. Il la reconnut sans peine et, la prenant par la main, l'entraîna vers le fond du café. Après quelques paroles préliminaires, il l'assit sur la banquette, très près de lui, et se dépêcha de l'examiner.
*
Elle portait le même costume que la veille et le même air d'oiseau mouillé. Mais au travers des éléments disséminés qui composaient son apparence la plus immédiate, il était aisé de discerner, comme des algues sous l'eau, les signes de la joie et de la reconnaissance. Un peu plus d'attention, et Albert, à ce moment trop épris de lui-même pour se montrer sensible à des subtilités, aurait reconnu dans ces prunelles au point extrême de dilatation, dans ce gonflement de la gorge, dans ces mains plus agiles comme un orgueil de victoire, voire une sorte de fatuité. Après qu'il eût commandé du café - elle l'aimait - il se mit à parler. Son embarras commença à cette minute même. Il devait user d'un langage direct, nettoyé de toute nuance, encore n'était-il pas sûr d'être compris. Il voulut s'en tenir aux remarques essentielles. Incertain des manœuvres utiles à toucher cette femme dont il ignorait les points de contact avec l'humanité, il louvoyait. Il l'assura du contentement qu'il éprouvait à la voir. Elle répondit en se servant gauchement de ses mots, puis ils se pressèrent les mains avec un grand plaisir. Il l'interrogea sur sa soirée de la veille. Elle raconta, - et de nouveau elle appelait ses doigts, ses yeux et tout son corps au secours de sa parole - que le gros homme l'avait invitée à souper. Albert ouvrit l'oreille. Après ce souper elle était retournée chez son beau-frère. Toute la matinée, elle avait dormi. L'après-midi, elle s'était rendue chez la couturière qui devait l'employer. (Cette couturière, quelle invraisemblance !) Elle se hâterait d'entreprendre son travail, car l'argent lui manquait et son beau-frère avait juré très haut de ne plus l'héberger.
Toute cette histoire qu'elle délivrait à grand renfort d'infinitifs présents et de pronoms à l'accusatif, arrivait peu à peu à une vie gluante de mensonge. Elle obtenait de l'auditeur des sensations de cake-walk : elle l'attirait, puis le repoussait, ou bien, par une jolie complication, les deux mouvements éclataient ensemble. Il ne restait plus à Albert qu'à s'accrocher à la première barre de cuivre venue, la pitié par exemple, ou, qui sait ? la crainte... La crainte de quoi?... Cette Juive à tout prendre c'est... Oui, mais si... Instantanément, Albert commanda des petits gâteaux et pria sa précaire campagne de se nourrir sans retard. Elle n'avait pas faim mais pour tuer le moindre dissentiment - cette fille, la soumission même - elle se mit à mâcher. Tandis qu'elle s'occupait, il crut nécessaire de lui redemander son nom : la pâtisserie et des difficultés linguistiques ne permirent que des bredouillements inférieurs au silence. Il tenta alors de lui faire épeler ce patronyme rebelle à l'expression et sous sa dictée de l'écrire. Ses efforts inspiraient la pitié. La juive prit dans sa sacoche un petit carnet d'identité tout neuf et, habituée aux voix rudes de la police et de la douane, le lui tendit sans hésitation. A la première page, sous une blême photographie, il lut des indications d'état-civil. La Juive s'appelait Beïle Awrischuvska ; elle était mariée, d'origine polonaise, âgée de vingt-trois ans.
- Trois ans de plus que moi, dit Albert.
Une sympathique rougeur suivit cette preuve de spontanéité, qui fit Beïle montrer la partie aimable de sa mâchoire.
- Mais, reprit Albert qui voulait se venger, vous avez dit hier que vous étiez Russe?
Elle ne se déconcerta pas.
- Polonais' dit-elle, Polonais' ! beaucoup assassiner en France, pas bonne pour dire aux gens, alors moi dire Rousse.
Elle riait à la façon des contrebandiers. Albert sourit comme un humide nageur à des gens vêtus. Il ne savait à quel sentiment se vouer. Mille images lui travaillaient le cerveau, mille désirs en pointe fouillaient son cœur et ses reins, une curiosité d'épiderme et d'esprit, une soudaine abondance de vie et imparfaite autour de quoi s'enroulait, draperie toujours visible, la crainte de rencontrer un parent ou un ami. Il avait choisi ce café parce qu'il n'y était jamais allé, persuadé que les gens qu'il connaissait, ne pouvaient, non plus, s'y rendre. Et la Juive, Beïle, a beau être là, si palpable, avec cette joie tapie au coin d'une lèvre qui rayonne, avec la souplesse de ses bras et tout l'inconnu du monde, Albert épie la porte. La crainte d'une arrivée inopportune n'est pas seule à le retarder : une sournoise paresse le rend mou à l'idée de mettre son projet en actes. Dès qu'il s'en aperçut, il se fit honte, puis muni d'un sérieux dégoût de lui-même, il s'efforça. D'instinct, il reprit la route suivie la veille : le pied qu'il effleura, des doigts déjà un peu chauds et si longs, un bras dont il eut soudain la main pleine. Naturellement, ils parlaient beaucoup tous les deux. Beïle accordait des détails biographiques encadrés de petits sourires d'ironie : elle se moquait soi-même. Mais tout d'un coup, tandis qu'il lui empaumait le genou, - irritant contact sous le glacis de la soie - son regard mollit comme une brise, ses lèvres tremblèrent et une grande détresse affamée déjeta son corps. Elle continua de parler, mais de sa bouche gonflée les mots s'évadaient à grand' peine. Albert cessa de la questionner. Il est incapable d'entendre. De nouveau le désir déferle comme une rivière en crue, dévore tout le paysage, sauf la peur du ridicule et une courbature, sommets inaccessibles. Plus rien n'existe bientôt qu'une trouble force, impatiente de se perdre. Albert jette un coup d'œil autour de lui - l'ombre commence à sourdre des murs - il lance comme une corde son bras aux reins de la jeune femme. Il l'attire et la baise aux lèvres molles, si tendrement humides. Aussitôt après ce contact, ils connurent en même temps et dans une précise clarté, lui, qu'il fallait supprimer les transitions, elle, que son règne était venu. Il n'eut aucune peine à supposer des regards indiscrets au garçon, à feindre la gêne, à réclamer d'urgence l'intimité d'un autre local. Au mot d'hôtel qui apparut très tôt, quoique prononcé sur un ton de langueur, Beïle rougit brutalement. « La honte est ici sans emploi », se dit Albert. Comme Beïle lui percutait la cuisse d'un index replié, il mit la joie à l'origine de ses nerveuses actions. Lui-même, il trépignait dans son corps plus lourd ; certain d'arriver, il mourait d'empressement et de vanité. Mais il fallait aviser au détail, avertir Beïle des manœuvres nécessaires. Ils ne pouvaient sortir ensemble du café ; il la précéderait dans la rue ; elle n'aurait qu'à pénétrer à sa suite dans l'hôtel. Elle consentait - que n'eût-elle pas consenti ? - sans témoigner le moindre heurt. Il eut la faiblesse de commenter ces manœuvres et même d'en donner les motifs. Tâche inutile et dont le côté pénible surgit aussitôt, car malgré ses maigres sourcils froncés à l'extrême, malgré l'effort de ses maxillaires tendus, Beïle ne comprenait pas. Albert s'obstina : il répétait ses paroles, se contraignant à une articulation puissante. Il fut obligé, à défaut de mots plus convenables, d'en prononcer de discordants comme « Père kapout, vous comprendre » pour ruiner la résistance d'un cerveau étranger.
Quelques minutes plus tard, à la suite de compromissions avec un garçon d'hôtel, ils purent profiter d'une chambre mal faite pour les images moelleuses. Albert déplora en esprit l'absence de confort, non pour sa partenaire mais pour lui. Il se tourna vers elle qui attendait, les bras disponibles. En deux pas il la rejoignit, l'appliqua contre son corps et avec force l'embrassa. Elle roucoulait et de longs remous dévastaient sa poitrine. Ils se séparèrent à grand' peine au bout d'un temps inappréciable. Sans mot dire, mais si lasse, elle enleva son chapeau et la première partie de son costume. Elle apparut dans une blouse versicolore ; un chignon diffus lui pendait à la nuque. Elle se rapprocha à dégoût, semblait-il. Il lui prit doucement la tête entre les mains. La merveille, alors, ce fut sous un vêtement de cheveux ce visage enfin nu et pareil par ses aspérités à la sale nuit que tourmentent les traits de la lune et l'aboiement des chiens et la bourrasque. Il pleure ou il a du rire plein les dents, on ne sait dans cette ombre, mais il est là, offert avec son grossier relief, prêt aux crispations. La bouche hagarde et toute luisante de sang, cette mâchoire qui oscille et les yeux, quelle détresse les a donc convoqués parmi la vulgarité de ce décor ?
Beïle - elle est maintenant lente comme l'ennui et silencieuse - Beïle s'allonge sur un canapé, elle étend sa fatigue et ses paupières tombent sur ses yeux, lourdement, pour narguer le plaisir qui frappe à toutes les portes. Albert se couche près d'elle, saisi d'angoisse ; à la faveur du silence son haleine retentit. Il reconnaît sous la robe un froid métal, démasque un sein et une odeur touffue. Elle, un bras pendant, se laisse harceler par des mains affairées, par une bouche, par tout un grand corps qui gronde. Elle gît, sans vie que d'un souffle qui altère et rétablit tour à tour l'ordre de sa poitrine. Mais elle revient au monde, elle gémit pour reconnaître sa voix, d'une main qui hésite elle dissipe la buée du sommeil ; son bras rencontre un visage, le repousse avec douceur. Albert craint de l'avoir froissée par sa hâte, non, elle ne veut que se mettre nue, mais seule. Elle appuie de pesants regards sur un soulier comme si son pied l'avait suivi sous le fauteuil. Elle quitte sa robe à remords, comme elle détacherait une peau morte. Pour lui, il se refuse au mystère. Il va, il vient dans la chambre, il s'efforce à la gaieté. Parfois il interrompt ses mouvements pour embrasser sa partenaire dans le cou, lui flatter la hanche, l'assurer d'un désir ferme et qui comporte la joie. Beïle ne se montre pas hostile à ce jeu, bientôt ses dents brillent et ses bras deviennent plus rapides. La voilà prête dans son linge. Elle se dresse contre Albert, lui aspire les lèvres, puis se détachant d'une saccade, elle court vers un lit glacial.
A peine l'a-t-il rejointe qu'ils s'étreignent grelottants. Il part à la découverte du corps inconnu et sa main avide rencontre sur des os la peau huileuse des cadavres. Chair sans richesse, trop abîmée pour les services qu'elle a pu rendre, mais qu'importe un ventre sans ampleur, la sécheresse de ces bras, cette hanche creuse à y fourrer la main, qu'importe un chétif détail si une flamme brûle ici et se tord ! La fureur tient ce corps, une avidité sauvage et qui ne connaît pas le repos. Prompt à l'appel, l'autre s'élance, et ces deux misères s'unissent, un instant, au milieu du halètement des poitrines et des jointures qui craquent.
Albert sentit bientôt toute l'imperfection de son plaisir, mais ne s'avoua pas déçu. Tout ceci n'était qu'un prologue. Avec de la chance, il aurait pu s'y faire prendre : un demi-échec n'autorisait que l'indifférence. Beïle était comblée, mais distrait, il s'en apercevait à peine. Il la laissa grogner, user peu à peu la violence de ses nerfs en quelques dures étreintes qui n'avaient désormais aucune prise sur lui. Puis fidèle à ses prétentions de courtoisie, il l'entoura d'égards, si bien que lorsqu'elle remonta des abîmes elle murmura à voix exténuée :
- Manières françaises... Juifs faire l'amour, un, deux, trois et fini... Et elle prit les mains d'Albert et les baisa à plusieurs reprises. Il fut aussi heureux de ce témoignage de reconnaissance que de la remarque ethnologique qui l'avait précédé : quel tact à rompre le silence !
- Mais, reprit-il aisément, pourquoi dire que je ne suis pas Juif. Je le suis peut-être...
Elle n'en voulait rien croire. Les Juifs étaient reconnaissables à la mâchoire et aux yeux : Albert n'entrait pas dans la catégorie. Comme, par jeu, il insistait, elle se prit à douter de sa science et curieuse de s'instruire sûrement, insinua sa main sous le drap. Il bondit aussitôt en arrière, elle en resta ahurie et rougissante. Elle se remit cependant à l'entendre éclater de rire ... Elle se rapprocha et, toute gonflée de tendresse, entama la louange de son amant. En dépit de la gêne qu'il éprouvait à de tels propos, Albert l'écoutait avec une bizarre curiosité vanter ses yeux, ses bras et la force de son étreinte. Emportée par un souci d'exactitude elle allait, toujours sur un ton chantant, à des détails si particuliers que les joues lui en brûlèrent. Il préféra l'interrompre.
- Tu aimes de faire l'amour, lui demanda-t-il.
Il n'avait pas l'habitude d'adresser cette franchise aux femmes : par méfiance peut-être, il usait de périphrases. Mais Beïle, dénuée d'embarras, l'amenait à la simplicité. Elle répondit oui d'un air de gourmandise et sans plus attendre décrivit le modèle des amants. Il ne pouvait dépasser la trentaine ; elle le voulait plutôt grand que petit, avec des dents personnelles, un bon appétit, et du sang sous la peau. Le costume, les façons, la condition sociale, elle s'en moquait. Elle réformait les hommes à l'âge de trente ans ; s'ils montraient de la soumission, elle les admettait aux services auxiliaires : règlements de factures, invitations au théâtre, fleurs. Ainsi en avait-elle agi avec le gros homme du train. Ils avaient soupé seuls dans un restaurant de nuit où l'on mangeait bien. Tous les autres les avaient quittés au sortir de la gare. (Pourquoi elle avait tu ce dernier détail d'abord ? Erreur ou émotion, elle n'en savait rien.) Au dessert le gros homme s'était décidé à avouer les motifs de sa munificence : on les entendit avec un dédain adouci de politesse. C'est alors qu'il avait commandé du champagne dans l'espoir que cet expédient le servirait. Beïle riait encore du vieux visage tout dérangé par le désir et la boisson. Que n'avait-il compris ce rire, définition des rapports possibles entre deux épidermes nommément désigné ! Il s'était fâché jusqu'à évoquer, le malheureux, la richesse en femmes de sa ville ; mieux, il avait comparé la beauté des indigènes à celle de son invitée. A ce point, le haussement d'épaules lui-même était superfétatoire. Le silence, parlez-moi du silence, quand pour le ponctuer un poing rouge fracasse une coupe de champagne ! Après quoi, honte parmi les morceaux de verre et l'empressement d'un maître d'hôtel, excuses, désespoir. «Tu aimes mieux le petit jeune homme du train n'est-ce pas ? - Oui. » Enfin, comme fiche de consolation, une magnanimité qui sonne faux : « Je ne t'en veux pas. Si un jour tu as besoin de quelque chose, viens me trouver, je t'aiderai. » - La carte de visite entre dans la sacoche, la sacoche sous le bras et bonsoir.
Beïle avait conté cette anecdote de l'accent de la candeur ; elle n'y attachait d'autre importance qu'exemplaire. Elle entendait d'ailleurs défendre sa théorie de la déchéance des hommes plus que trentenaires par l'argument «a contrario ». En effet, la chair fraîche, une fois qu'elle en avait conçu le goût, il n'était rien que Beïle ne fit pour y mordre.
La veille, au moment de monter dans le train, elle ne pensait pas aux bras d'homme ; une fatigue d'origine obscure l'accaparait. Elle ne songeait qu'à la chaleur du repos, elle inventait l'engourdissement que lui ménagerait bientôt le creux des coussins. Il fallut la vue d'Albert avec sa figure de vingt ans et la jeunesse de ses muscles imaginables par delà les étoffes, pour remettre en mouvement un désir pris de sommeil. Beïle fut subitement assise à côté du garçon devenu nécessaire. Elle tremblait un peu qu'il ne s'échappât. Elle voulait le rencontrer dans un lit, elle voulait, et au plus tôt, connaître sa force et sa sueur, car il est doux de se sentir liée à un corps robuste et dans le délire de crier des insultes. Autour de ses hanches un brouillard naissait, fomenté par le regard des voyageurs. Quand Albert y joignit le sien, elle ne douta plus du succès. Délai ne signifia jamais échec : elle s'était trompée d'un jour, soit, mais maintenant sa volonté peut se détendre, satisfaite.
Ce renversement de rôles, prestement exécuté au son d'un rire cruel, blessa Albert. Ce fut une douleur vive et atroce. Il détesta cette femme. Incapable de la battre, il voulut la faire souffrir d'une autre façon. Il refusait d'admettre son triomphe quand tout et ses souvenirs trop précis lui en soulignaient l'éclat. Il essaya des dénégations qui ne mordaient pas. La vanité d'une défense lui apparut si crûment qu'il se rabattit sur les plus basses mesures. Il retira son bras humilié de dessous le dos de la Juive et en grande rudesse la rappela aux bienfaits de l'eau courante. - Il faut qu'il n'ait rien compris à Beïle. Alors qu'il croit l'écraser par ces évocations vulgaires, elle rebondit soudain, le corps traversé d'un sentiment qui stupéfie. Elle tombe à bras affolés sur la poitrine de son amant. La détresse des naufrages crispe ses mains, convulse sa bouche, cependant que sa voix partie des entrailles hèle le secours qui fuit et hurle : « Je veux un enfant de toi !... Je veux un enfant de toi ! »
Tant de forces se rassemblent dans cet accent, c'est une voix si lointaine qui retentit et tout à coup si proche qu'Albert accourt du bout de sa haine, oublieux de tout sinon d'une angoisse pareille. Il tend les mains à cette triste chair, elle s'agrippe sauvagement et les voilà noués dans une étreinte, jusqu'à l'écoeurement, jusqu'à ce goût fade dans la bouche de sang et de mort... De nouveau un vide les sépare que Beïle va combler de ses paroles. Ce cri qu'elle poussa, ce désir qu'elle vient d'avouer, bien qu'il ne soit pas réciproque, a flatté Albert mieux que le discours le plus avisé. Il incline à l'indulgence, il a oublié son rôle subalterne. Beïle prompte aux rêves comme à l'action, accouche d'un fils. Elle respire le contentement grave des maternités ; il ne lui reste plus qu'à décider du système d'éducation. Le mieux sera de retourner en Pologne où cet enfant grandira dans les prairies parmi les arbres et les bestiaux. Par la suite, elle le conduira à Varsovie, au « gymnase » quelle connaît. C'est là qu'il acquerra une démarche d'athlète et ce regard hardi qui rafle au passage le cœur des femmes.
Toutefois, sur un sourire d'Albert, Beïle arrêta son discours et se leva. Il resta seul en proie à la chaleur maintenant répandue dans la chambre et à l'odeur de deux corps. Il s'étira pour la méditation d'usage. Loin de se sentir diminué, il souffre de ne pas extraire de sa poitrine ce qui y pèse, ce qui étouffe de ne pouvoir s'exprimer. Une forêt serait secourable où soudain sonneraient de grands cris, ou encore une plage vaste que peupleraient les gestes multiples de la joie ou de la fureur. La chambre s'offre avec des bruits d'eau, les relents d'une sale volupté, une vanité qui se plaint de ses blessures et à l'horizon, sur une tenture, un nuage pareil à un remords. Albert se découvre nu. Il ne peut s'attacher à ce spectacle. Il se lève, exécute plusieurs gestes. Beïle revient au lit. Il voit dans la lumière son corps dont quelques vestiges rappellent qu'il fut fait pour la joie des yeux. Il veut l'examiner de près, contempler ses limites. Sous ce regard qui la jauge, Beïle sent naître sa pudeur : elle se met à l'abri des draps. Il les arrache. Elle croise les bras sur sa poitrine, elle se recroqueville afin de laisser la plus petite surface à l'inquisition; mais cette défense n'empêche pas le gris de sa peau d'affleurer, une chair malmenée de montrer ses haillons. Albert ne se lasse pas de cette vue : il la souhaite plus précise.
Il écarte les bras comme des branches importunes ; il développe le corps contracté qui apparaît dans la honte. Elle parle alors, elle explique son état par l'agitation de sa vie, par l'impossibilité de trouver le repos. Albert la presse de questions. Elle raconte son histoire avec une complaisance pareille à la fierté. Elle déroule un tapis usé, plein de marques honteuses et parfois une fleur vivante comme au premier jour éclate des plus riches couleurs. Elle use de cinquante mots ; ses mines sont si parlantes qu'elles reculent les bornes de son vocabulaire. L'imagination d'Albert travaille : il bourre de chair des personnages qui lui paraissent squelettiques, il bâtit le décor, supplée à la pauvreté des sentiments.
Voilà le père de Beïle : il sort de son comptoir, ses doigts traînent dans une barbe d'astrakan, une lévite est flanquée sur ses épaules comme sur une tringle ; ses yeux ont les reflets mortels du zinc. La mère est une femme tout en viande blanche, avec des fesses énormes et des mamelles qui pèsent. A eux deux, ils vendent des bonnets de fourrure, des bottes moisies, les dernières nouveautés de Paris, des chemises américaines, et les bijoux de la tsarine. Les clients ne manquent pas, ni les poux, ni les enfants. Les fenêtres sont jaunâtres et donnent une lumière grise. Le vent transporte une odeur de bouleau éventré, de goudron et de basse friture. Parfois on se bat, le père glapit et lance des coups de poing durs comme le fer, tandis que la mère s'écroule dans sa graisse. Les enfants se cachent derrière la friperie. Un jour Beïle a treize ans. Elle plaignait ses frères, elle méprisait surtout celui qui la suivait et dont elle partageait le lit : elle aurait craché sur ses bras de rachitique. Par contre la sœur aînée était une belle femme. Les soirs de beau temps elles s'asseyaient à deux sur le pas de leur porte. Les gars se promenaient dans les rues, la bouche pleine d'interpellations malicieuses. « Belle fille, criaient-ils farauds, est-ce aujourd'hui que tu couches avec moi ? ». Elles tiraient la langue et répondaient : « Pas encore pour mille roubles I » Elles riaient alors et par leur bouche ouverte on voyait leur œsophage - L'amour a mordu le village, on en parle sous toutes les lampes, dans tous les lits et les hommes se font plus rares que l'or. Beïle devient nubile au milieu de chuchotements obscènes. Des vieillards clignent de l'œil. Parfois entre deux portes l'audace d'un gamin : une bouche mange la sienne. Une giffle claque, le garçon s'enfuit abandonnant dans le corps de Beïle un chaud brouillard.
Ce récit court vite et refuse toute relâche. Albert voudrait nommer ses impressions, les soupeser, à peine a-t-il le temps de grossir d'un faux pittoresque les spectacles évoqués. Déjà le mécanicien Ivan' se montre, construit à la manière des monuments. Il remue des bras vastes comme des annexes et dans sa figure fraîchement peinte de vermillon deux yeux sont plantés qui dispensent la lumière. Les femmes plient sous sa poigne, mais si fières de plier ! Le mécanicien Ivan' veut épouser Beïle. Qu'il s'adresse à l'autorité figurée ici par la lévite et la barbe d'astrakan ! L'autorité consent à céder sa fille aînée : en cas de mort de celle-ci le veuf pourra épouser Beïle, si pendant l'intervalle elle ne s'est pas mariée. La loi est la loi. Ivan' s'y soumet et Beïle referme ses bras sur le vide. L'hiver survient : la femme de Kamenschikoff en meurt. Malgré ses petits yeux et sa figure rose de cochon Kamenschikoff souffre de son lit à moitié vide. La timidité ravage sa barbe déplumée, pas assez qu'il ne demande la main de Beïle. Événement inespéré : Kamenschikoff vend sa boutique, s'associe au père de Beïle. On agrandit la maison, on bâtit une chambre pour les nouveaux époux.
Beïle hait son esclavage, elle ne tolère ni l'haleine de son mari ni le voisinage de ses mains. Elle pense au mécanicien Ivan' dont les joues sont si rouges ; elle envie la fécondité de sa sœur. Aux tentatives de Kamenschikoff elle oppose une hargne indestructible ; l'autre retire la patte et rentre dans son trou sur des grognements pareils à des soupirs. La mère énorme s'inquiète cependant; elle rappelle sa fille au devoir des femmes. Chaque matin, Kamenschikoff descendu, elle visite le lit conjugal dans l'espoir d'y relever les traces d'un hymen consommé. Mais comme dit Beïle : « Moi dire à mère à moi . lui pas vouloir, lui rien demander. Et lui honteux, rien oser dire. »
Beïle atteignit au passage le moins honorable de sa vie, ses mots se raréfiaient, elle se serait tue volontiers. Albert n'était pas revenu de l'étonnement de ce récit que la curiosité le jetait dans de nouvelles questions. Il interrogea en désordre comme un examinateur ahuri de la science de l'élève. Beile mentit par instinct de conservation : elle ne voulait pas endommager la figure qu'elle avait construite pour Albert, et lui, c'était celle-là justement qu'il voulait supprimer. Il mettait par instants une grande âpreté dans la poursuite. Il arrachait les mensonges lambeau par lambeau ; acculée, Beïle avouait. Un peu plus de patience, il aurait tenu la vérité. Mais il s'embarrassait du dégoût, des sursauts de son éducation et de ses habitudes. Si, par exemple, il apprenait que Beïle ne se fera pas couturière mais serveuse de café, son amour propre souffrait. Plus que cela, malgré le caractère risible qu'il veut lui attribuer, la sensation du sacrilège, du geste à portée fatale se mêlait à un malaise pesant pour composer l'état le moins supportable.
Beïle qui retrouve son aplomb l'en distraira quelques instants encore. Elle raconte comment le goût de l'aventure souffla sur le village et en arracha les gens mal posés. Son frète aîné partit, Kamenschikoff le suivit de près. Ils s'en allaient à Munich faire du commerce. Beïle seule, les femmes de village la moquent et sa mère exprime des sentences plus pénibles que les rires. Au bout de trois mois l'épouse rebutée empila son linge dans une valise, rassembla toute la monnaie disponible et partit pour Munich. Kamenschikoff avait déjà gagné Dusseldorf. Beïle arriva une nuit dans cette dernière ville ; à grand' peine elle trouva l'hôtel de son mari. Il l'avait quitté depuis trois jours. Il fallut reprendre le train pour Leipzig. L'argent de Beïle s'évadait : la faim et cette solitude persistante renforcèrent sa rage. Quand elle se fut nourrie de pain dans un square, elle utilisa sa dernière ressource, elle rendit visite au rabbin. Ému de la foi qu'elle témoignait cet homme lui donna quelque argent et lui promit une place. Beïle affirme qu'elle entra quelques jours plus tard, en qualité d'infirmière, dans un hôpital.
Un jeune médecin désirable... Le jeune médecin s'affaisse. Albert le lâche pour une autre image. Debout devant une cheminée d'usine, un homme montre une figure chargée de violence. Son regard est levé, il fixe ardemment quelque chose qui n'a pas place dans l'air. La mode a changé la coupe de ce visage, la forme de ces vêtements ; le geste demeure et les traits pareils à ceux qu'Albert regarde dans les miroirs. L'attitude réfléchie par cette jaune photographie dénonce une passion dont Albert, né trop tard, n'a jamais saisi que les vestiges. Comment retrouver cet homme qui est son père et son vrai visage, l'équilibre de ses vices et de ses vertus ?... Travail si ardu à entreprendre qu'il s'en laisse déjà détourner. Il rejoint le jeune médecin au moment que ce timide grimpe à un magnolia en fleurs. Beïle se trouvait à la jointure de deux branches, elle balançait les jambes au dessus de la terre... Elle voulut se sauver, le pied lui manqua, on la releva une jambe cassée. C'est ainsi que le jeune médecin vint prendre de ses nouvelles le soir dans sa chambre et qu'elle le posséda.
Aussitôt guérie, elle toucha son salaire et partit pour Sarrebrück où son mari lui avait donné rendez-vous. Elle descendit de wagon vers deux heures du matin. Le quai était désert, le vent soufflait, une lampe à arc refoulait la nuit. Vers trois heures, Kamenschikoff, flanqué d'un ami, sortit de l'ombre. Après de secs compliments, ils prièrent Beïle de se rendre avec eux dans une salle de danse où une grande fête se donnait. Depuis son accident Beïle redoute la danse et ce soir, rendue de fatigue, pénétrée de la crasse du voyage, elle attend de sombrer dans le sommeil. Albert ignore ce qui s'est passé dans la salle de danse, pourquoi Beïle s'empara d'un couteau et se jeta sur son mari. Il apprend qu'un garçon l'arrêta à grands cris. L'orchestre cassa net, une rumeur démantibula l'atmosphère de la salle : Kamenschikoff, Beïle et l'ami se trouvèrent vite dans la rue.
Albert abandonne de nouveau Beïle et cette fois volontairement. Il tente d'arrêter la figure de son père fuyante, insaisissable. Ses manies, c'est par là qu'il l'attrapera. Elles affluent : la foi aux médisances ; l'orgueil des succès scolaires ; le souci de la correction traduit par le vêtement, le son de la voix ; l'estime qu'il accordait aux gens, calculée au poids de leurs titres universitaires ; ce goût de vaincre si poussé qu'une défaite au whist... Mais que Beïle devient obsédante ! Il est impossible de s'arracher à cette fille. Son corps s'obstine à vivre dans un voisinage immédiat ; ses flancs sont chauds ; ils battent, de quelle bestiale manière ! Elle remue et elle parle, elle parle. Albert ne la questionne plus, il feint l'indifférence ; elle continue sur la vitesse acquise. Il sent dans une inexprimable confusion que cette femme a pris trop de place dans ces deux jours ; qu'elle ne lui apportera plus que dégoût de lui-même. Il la pousserait du pied, il la jetterait bas du lit... La cadence d'un souffle, ce regard humain qui choque chez les bêtes, et Albert se penche, il voudrait aimer... Il écoute encore un épisode. Beïle s'était installée à Metz dans un petit appartement que son mari avait meublé. A cause de trafics obscurs et fructueux à la frontière, Kamenschikoff s'absentait souvent. Au départ il laissait à Beïle l'argent nécessaire. Un jour il négligea cette formalité. Beïle vendit meubles, vêtements, linge, tout ce qui était vendable et partit pour Besançon. Son frère, croyait-elle, s'y exerçait à la liquidation de marchandises américaines. A Besançon pas de frère, mais, pendant 15 jours, un jeune sergent d'infanterie...
Cette fois, c'est fini. L'attention qu'Albert donnait à Beïle s'effondre au profit d'une obscure souffrance. Il s'éloigne à grande vitesse dans une direction inconnue. Cette ignorance l'agace, ajoute à sa nervosité. Quant à Beïle, ses côtés haïssables s'affalent dans l'ombre : son corps se désagrège, retourne au ventre de sa mère. Seule sa voix persiste, qui conte les vices d'un architecte parisien. Puis cette voix adopte les formes de la mendicité pour offrir un durable amour, à l'instant même qu'Albert doute de l'opportunité de sa présence dans un lit aussi hasardeux. (Quelle douceur qu'une chambre parfaitement silencieuse, parfaitement vide de femme où l'immobilité des livres et des meubles compose le calme !) - Pourquoi ne pas user des moyens traditionnels? Albert proposa une entrevue ultérieure mais dans des conditions si ridicules - Beïle n'a qu'à lui écrire poste restante - qu'elle comprit. A peine lui sut-il gré de la parfaite aisance qu'elle témoigna à l'audition de cette fin de non-recevoir. Il a épuisé cette femme qui prétendait le vaincre. Qu'elle retourne à sa vie, qu'elle s'en aille de sa chair ! Qu'elle emporte les traces de sa venue, matière à souvenirs, rebut désormais secourable au seul cas d'amertume !
Maintenant que Beïle a repris un aspect décoratif, Albert se trouve seul en face de lui-même. Il gémit de plus en plus. La chambre tourne autour de sa tête, lui présente ses murs bêtement tapissés, un tableau champêtre et cent portraits de son père : son père riant au bord de la mer, son père qui parle à des ingénieurs, son père assis dans un fauteuil, son père qui dit une plaisanterie d'un air fin. Ces portraits s'emboîtent les uns dans les autres. Une immense affiche du péril vénérien les recouvre à l'improviste, puis tout cela s'amalgame, et s'écoule en longs ruisseaux d'argile. Un orgue de Barbarie dégaine une chanson russe. Des serpents poussent, des fils gluants à travers les bras d'Albert, un grand peuple d'images combat dans sa tête... Albert est soudain debout dans la chambre. Et il se hâte.
Ils se sont rhabillés. Ils descendent l'escalier. Beïle fait durer chacun de ses pas. Une fois de plus, le spectacle est terminé quand elle commence à y trouver de l'agrément. Les autres s'empressent de partir, elle voudrait demeurer. Elle perd cet homme qui aida à son plaisir, à sa vie : il s'en va d'elle, grandi, plus désirable.
Les voilà sur le seuil. Rapidement il enlève son chapeau, tend la main. Elle ne se retient pas de l'embrasser encore...
*
Une fois dans la rue, Albert se mit à marcher rapidement et sans tourner la tête. Il se croyait aux portes d'un événement douloureux dont rien ne lui faisait soupçonner l'essentiel. Il portait en lui-même un mal dont il ignorait les formes qu'il allait prendre. Il voulait se trouver chez soi dans le local de ses habitudes pour lui donner la vie. La Juive avait disparu, son rôle joué de le stimuler, de lui indiquer la fenêtre de l'horizon nouveau. Qu'il fasse jour, il verra. Il marche si vite qu'au passage il heurte les gens. Il s'excuse et repart...
Chez lui pour se séparer de tout vestige, il procède à de grandes ablutions. Puis il se met à table. Il mange beaucoup et de bon appétit, machinalement. Sa mère l'interroge, la cousine lui raconte une anecdote. Il leur répond, sourit quand il le faut, s'incline avec opportunité. Il ignore d'ailleurs ce qu'il fait. Après le dîner son frère lui demande la traduction d'un texte latin. Il la lui donne, il y ajoute même un commentaire grammatical. Enfin il se retire dans sa chambre.
Il va, il vient, prend un livre puis un autre. Il fume des cigarettes qu'il n'achève pas, il recule sa chaise, l'avance. Il se lève pour regarder un tableau. Il se rassied, se déchausse. Il n’a pas sommeil, il ne peut pas se coucher. Il pense à la Juive. Il admire que toute sa vie soit orientée par l'amour ou tout au moins par ses plus grossiers simulacres... Des mots qui évoquaient les manifestations de ce sentiment, niais ou bas, qu'importe, Beïle tirait comme d'un geste un ample plaisir. Elle les prononçait avec précaution, frottant le pouce contre l'index, l'air de compter de l'argent. Elle en mastiquait la sonorité et, une fois partis, elle les suivait dans l'air du regard qui remercie... Cela défendra-t-il cette fille contre le cercueil ?
Albert se promène dans la chambre. Il réfléchit. Il s'arrête, distrait. Une image affleure soudain dans sa conscience, un grand craquement, une déchirure et la lumière qui éblouit. Son corps devient inexprimablement léger. D'un coup Albert tombe, les jambes fauchées, sur un divan et le nez dans les coussins, il murmure comme on gémit : « Ah ! le pauvre type ! le pauvre type ! »
Pour la première fois depuis cinq jours, il sent que son père est mort. Il trouve enfin des larmes pour le pleurer.
Robert Marin
✪ Article signé Robert Marin paru dans la rubrique « Chronique des livres » de Liège-Universitaire du 23 avril, où il occupe la page 3, colonne a-e.
Le livre de Hubert Dubois a été publié en avril 1926 par les Editions Sélection. Tiré à 150 exemplaires et illustré de quatre dessins d’Auguste Mambour, ce recueil pour bibliophiles ne pouvait avoir une grande audience : si Denoël lui consacre ce bel article, c’est par amitié pour l’auteur et l’illustrateur, Liégeois comme lui.


Auguste Mambour [1896-1968] et Hubert Dubois [1903-1965] en 1926 - Illustration de Mambour pour le livre de Dubois
« Pour atteindre à la mort, poème de Hubert Dubois
avec 4 dessins d’Auguste Mambour »
Rien de plus malaisé que d'essayer, à l'aide d'une prose raisonnée et raisonneuse, de suggérer le sentiment profond, la vie invisible comme le vent, qui parcourt un poème et l'anime. Déjà ardu quand il s'applique à une œuvre d'allure classique, cet exercice devient presque impossible en présence d'un poème nourri tout entier d'éléments sensibles. Je crois que la critique ne peut pas se payer de mots, j'entends qu'elle doit renier l'approximation, que son rôle est de montrer du doigt, d'indiquer avec le moins d'écart possible les centres de vie et de beauté. Elle doit renoncer aux jeux combinés de l'imagination et de la sensibilité, les abandonner avec des regards d'envie, au poète qui seul peut s'y prêter. Son domaine est la précision, la netteté. Ses procédés habituels la servent mal ici.
L'analyse, si utile dans l'examen d'un roman où le jeu des caractères, la progression de l'atmosphère, le ton général sont autant de points de repère, l'analyse devant un poème est pareille à un couteau ébréché. Isoler des éléments qui n'acquièrent leur valeur que par la situation, c'est risquer d'en endommager la portée, de provoquer de détestables déchirures. Il reste deux attitudes : ou bien traiter le poème d'une façon technique, s'astreindre à une besogne de grammairien ou de linguiste, s'acharner à la découverte des procédés particuliers au poète (rythmique, métrique, etc...) ou bien s'en tenir à des considérations morales au sujet des sentiments exprimés. Ce petit préambule était, je crois, nécessaire à préciser ma position en face du beau poème qu'Hubert Dubois nous donne aujourd'hui.
On connaissait Hubert Dubois par le recueil qu'il publia en 1924, Baptême des tropiques. Ce petit livre avait bien des raisons de. plaire, qu'il garde d'ailleurs. Son charme fait de verdeur et d'une allégresse qui bondit et rebondit, sûre de ses mouvements, son charme demeure vivace et nous touche encore aujourd'hui (1). Plus même que les qualités éparses dans chacune des pièces du volume, j'admirais combien ce début d'un jeune poète révélait d'équilibre. Hubert Dubois négligeait les préliminaires d’usage : sans passer par les fautes de goût, le clinquant, la mièvrerie ou la grandiloquence, il nous révélait un tempérament de poète prouvé par mille traits et, chose plus vraie encore, un sens exact de. ses limites.
C'est à peine si dans tout le recueil, que je viens de relire, je trouve deux passages un peu gâtés par ces mots que nous légua le symbolisme : mouvance, luminosité. Mais, pour tout dire, après ce plaisir vif et brûlant que donnait Baptême des tropiques, je me sentais indécis, enclin à imaginer l'aboutissement d'une telle fantaisie et si heureuse, ou tout au moins à douter qu'elle reculât grandement ses bornes. Dans les deux cas nous aurions rencontré un poète mais qui n’eût enchanté que la face la moins grande de notre inquiétude.
Voilà une crainte que nous pouvons déposer. Ce qu'il me plaît de distinguer dans cette nouvelle œuvre, c'est une plus vaste ardeur, c'est un besoin presque tragique d'élévation que la nature non plus que 1'expression ne trahissent. Après avoir évoqué des spectacles fragmentaires, avec une émotion que le sourire entourait souvent, Hubert Dubois a éprouvé la nécessité de confronter les richesses que lui donne le détail des jours, d'en extraire la force et le drame secrets. [suit un extrait du livre].
Et, tout naturellement, le poète trouve l’accent de la grandeur pour nous inviter à sa suite au grave et merveilleux voyage qu’il entreprend « pour atteindre à la mort ». - Hubert Dubois n’a pas négligé la leçon d’Arthur Rimbaud. A la médiocrité la fréquentation du génie ne sert de rien, si ce n’est à encourager des illusions, mais là où se trouve le talent elle agit comme un révélateur. Si l’auteur de « Baptême des tropiques » aime Rimbaud, Max Jacob, Aragon, Valéry ou Tristan Tzara, ce n’est pas au point agaçant d’écrire ou même de sentir comme eux. On peut lui trouver un air de famille mais avec des traits caractéristiques : on n’a garde de lui reprocher le manque de personnalité. Sa manière d’accueillir le monde extérieur et de traduire ses sentiments les plus subtils autant que la science du rythme et de la résonance des mots lui assurent d’emblée le rang de créateur. Son pouvoir d’images étonne et charme.
Hubert Dubois « met des images » avec une discrétion, un souci d’harmonie qui est proprement admirable. Il ne considère certes pas le poème comme une devanture de bijoutiers mais plutôt, me semble-t-il, comme un tissu mouvant dont la richesse tient à la trame plus peut-être qu’au lit. Les images dont chacune suscite l’insaisissable qui recréent ennobli le mouvement même de la vie dans ce qu’elle a de mystérieux ; elles ne retardent pas le déroulement du poème, elles y aident au contraire par une continuité, une cohésion dont nous n’apercevons jamais le point de soudure. Elles laissent retentir dans son ampleur une voix humaine, une détresse dont l’accent excite notre plainte identique. D’un seul élan nous gagnons les hauteurs où l’air circule et surpris par dévorante audace, nous n’avons plus de paroles que d’admiration.
Le seul reproche que je ferai au poème d’Hubert Dubois - et encore ne sera-ce que par un scrupule poussé à l’extrême - est d’ordre technique. Sans doute, le mouvement jaillit dès les premières strophes, enfle, grandit, et nous mène avec une magnifique assurance à son achèvement, mais je regrette de le devoir à un procédé dont la répétition m’a gêné lors d’une troisième lecture. L’allure du poème n’aurait pas souffert d’une variété plus grande, d’un refus net à l’imitation de soi-même. Problème secondaire il est vrai, tout de métier, mais dont la solution eût ajouté à la qualité de notre plaisir.
Quatre merveilleux dessins d’Auguste Mambour accompagnent plutôt qu’ils n’illustrent « Pour atteindre à la mort ». Ils emportent notre admiration par une manière unique d’aller au cœur des choses. Comme le poème, ils joignent la force et la gravité la mieux fondée à cette grâce que l’on ne peut désigner, qui se joue avec pureté de l’inexprimable. Ces dessins ne s’attachent au réel que pour en cueillir la vie secrète et nous l’offrir nue dans sa vérité première.
Robert Marin
(1) Remarque que l’on peut malaisément faire à propos de la première œuvre d’un écrivain et, singulièrement, d’un premier recueil de vers.
✪ Article non signé figurant en première page du n° 1 et seul paru de Péliklan, « Organe de dégonflement à soupapes satiriques, humoristiques et illustrées » paru à l’occasion d’un salon de peinture à Liège.
Ce journal bi-mensuel a été créé par des représentants de la jeune peinture liégeoise comme Auguste Mambour et Edgard Scauflaire, et quelques littérateurs comme Hubert Dubois et Robert Denoël. L’éditeur Pierre Aelberts [1899-1983], qui l’avait réimprimé en 1975, assurait que le texte ci-dessous, qui figure en première page, était dû à Denoël.
Le titre du journal, expliquait Aelberts, avait été forgé à partir du nom d'un café pour étudiants, « Le Pélican », qui se trouvait au centre-ville, non loin de l'université. En effet, le Café du Pélican, où Alexis Curvers et le groupe des Cahiers Mosans tenaient leurs quartiers, était situé au 114 de la rue de la Cathédrale, et son propriétaire s'appelait H. Coninx. Curvers s'en est souvenu après la guerre lorsqu'il écrivit Tempo di Roma.
Dans les écrits publiés que l’on a de lui, le jeune Denoël ne nous a pas habitués à ce ton «carabin» mais peut-être, à la veille de gagner Paris, fait-il un ultime pied-de-nez aux bourgeois d’une ville qu’il ne supporte plus. Je le publie donc avec les réserves d’usage.

« Souhaits de bienvenue »
Approche, vil bourgeois, passe-toi trois fois la main sur le ventre en signe de soumission et écoute :
Nous avons pour toi un mépris dont la hauteur ne se peut exprimer, tu ne serviras ici qu’à des usages domestiques : paillasson, gratte-semelle, torchon.
Malgré la haine que nous vouons à ta graisse, à l’épaisseur de tes digestions, et en général à l’ignominie des basses fonctions dont tu es capable, nous t’appelons ici. Pourquoi ?
Nous ne prétendons pas jeter une lueur ni même un reflet d’intelligence dans des cerveaux qui, manifestement, ont été créés pour d’autres usages.
Les plus bas instincts nous guident ici. Ce n’est pas à ta femme que nous en voulons, ni à tes enfants, nous savons qu’il est pour toi des choses plus chères. C’est ton portefeuille, ta montre, en un mot, c’est ton argent que nous voulons.
Pour l’obtenir, nous ne reculerons devant rien. Nous chatouillerons en toi les plus ignobles penchants, nous connaissons ton goût pour la médisance et ces paroles inavouables dont ta solitude se réjouit.
Par une perversion que les spécialistes comprennent mal, tu te mêles souvent, au sortir du comptoir ou du bureau, de parler avec des sourires complices de ce qui, pour toi, représente la Beauté. Tu éprouves des joies viscérales à fréquenter ceux que tu crois être des artistes.
Ton cœur se gonfle et tes yeux se remplissent d’eau à l’idée d’orner ta salle à manger du paysage que tu souillas de ta présence ou du portrait des rejetons engendrés de tes génitoires amorphes.
Nous te parlerons ici, sur le ton de la sympathie, de ceux-là qui ont su atteindre aux cîmes de la considération.
Nous te dirons avec douceur tout ce qui peut augmenter encore l’estime que tu as vouée à ces escrimeurs de l’Art. Aventures louches, détails intimes, chiffres de revenus, espoirs inavoués, tout ce qui peut susciter la satisfaction de tes vices moyens.
Nous savons que nous possédons ainsi le plus sûr moyen de t’avoir à notre service. Chaque quinzaine, tu te rueras chez les marchands et tu y trouveras la pâture souhaitée par tes goûts immondes.
Et nous, avec l’assurance que donne l’argent bien acquis, nous irons au Péliklan, et nous y boirons, aux frais de ta munificence forcée, les consommations qui déchaînent l’allégresse.