Petit retour sur mes pas
Mes recherches sur Robert Denoël sont bien antérieures au site Internet que j'ai ouvert en mai 2005. Trente ans plus tôt j'avais déjà publié des « petits papiers » à son sujet, aujourd'hui éparpillés et oubliés.
Ce n'étaient que prémices assez maladroites mais certains d'entre eux méritent peut-être d'être conservés (surtout pour moi). Ils montrent combien fut difficile la connaissance d'un dossier frileusement défendu par ses proches et par les autorités françaises. Des polémiques ont jalonné ce parcours, dès l'origine. Un parfum assez particulier, auquel je n'étais pas sensible, émane de ce dossier. On me l'a rappelé autant de fois que nécessaire. Mais je suis assez têtu, voire obtus, devant les ukases. Je dirais même qu'ils m'aiguillonnent.
Pourtant, j'avais abandonné mes recherches en 1982. Je me heurtais alors à des fins de non-recevoir, surtout du côté des dépôts d'archives. Il fallut la parution, en 2002, du livre de Louise Staman pour tout relancer. Les Archives de la Seine avaient entretemps, sans le dire, permis l'accès à la plupart de leurs dossiers.
J'ai réuni ici les articles qui me paraissent dignes d'intérêt, malgré les erreurs dont ils sont parsemés. Marc Laudelout fut mon plus fervent « éditeur » : son Bulletin célinien accueillit tous mes pensums. Certes Denoël était le premier éditeur de Céline, et le meilleur sans doute, mais il avait publié bien d'autres écrivains, qui ne passionnaient pas forcément ses lecteurs. Il eut le mérite de consacrer quatre numéros à mon héros malheureux, à une époque où l'on s'en désintéressait complètement.
Est-ce à dire qu'on se passionne à présent pour lui ? Certes non. Mais quatre ou cinq volumes parus entre 2002 et 2013 ont rappelé son nom et je vérifie, grâce aux courriels que me vaut ce site, que des lecteurs restent attentifs à son histoire.
J'ai joint à ce récapitulatif les articles parus ailleurs que sur mon site depuis 2005.
*
1987

© Le premier volume de la série « Tout Céline » fut publié par la BLFC en avril 1981. Les quatre suivants sont parus à l'adresse de ma librairie liégeoise. C'était un instrument de référence essentiellement bibliographique, auquel des textes de fond sont venus s'adjoindre. Le quatrième, tiré à 150 exemplaires, parut en mars 1987. Il contenait un article consacré à L'Ecole des cadavres.
L'Ecole des cadavres et la censure
Châtions, châtions, nos expressions !
[Les Beaux Draps]
Bagatelles pour un massacre fut bien accueilli par la presse et par le public : après la guerre, les Editions Denoël faisaient état de ventes dépassant les 100 000 exemplaires. L'Ecole des cadavres, qui avait bénéficié d'un premier tirage supérieur [25 000], totalisa 37 669 ventes. On a expliqué l'insuccès de ce pamphlet par sa date de parution. Prôner une alliance militaire avec l'Allemagne, deux mois après Munich, était d'une incongruité totale. Dans sa préface à la réédition de 1942, Céline lui-même rappelait l'attitude de la presse : « pas une ligne, la pétoche totale, le désaveu absolu ».
Il convient d'y ajouter plusieurs éléments commerciaux dont on a minimisé l'importance. Mis en vente le 24 novembre 1938, le livre fait l'objet d'une plainte de la part du journaliste Léon Treich, dont Céline a cité le nom à la page 122, et la presse s'en fait l'écho dès le 7 janvier 1939.
L'auteur soumet alors à l'avocat André Saudemont ce projet d'erratum : « M. Léon Treich nous fait connaître par huissier : 1° qu'il n'a jamais appartenu au P.S.F. ; 2° qu'il n'est pas juif ; 3° qu'il appartient à une famille de catholiques pratiquants [...] Nous regrettons que cette rectification n'ait pas été demandée à " La France enchaînée " dont nous avons reproduit exactement le texte. » (1)
Céline avait utilisé un autre journal pour rendre compte de l'inauguration d'un dispensaire dans la région parisienne, au cours de laquelle plusieurs médecins - « tous juifs » - avaient pris la parole. L'un d'eux, le docteur Pierre Rouquès, n'était pas juif et L'Humanité ne l'avait pas écrit dans son édition du 5 novembre 1938 ; il porta plainte pour « diffamation, injures publiques et complicité » en vertu du décret-loi Marchandeau, dit « Loi sur les habitants », visant à protéger les minorités raciales, et promulgué le 21 avril 1939.
Ce décret n'avait pas d'effet rétroactif et ne s'appliquait qu'à la presse, les commentateurs l'ont assez souligné. Pourtant Céline en soumet le texte à son avocat avec ce commentaire : « il me semble qu'il signifie le retrait de Bagatelle et de L'Ecole sous peine d'immédiates poursuites qui ne sauraient nous surprendre. Denoël songe à expédier ces livres en Belgique et à les faire vendre là-bas. Est-ce possible et sans risques légalement ? » (2)
On ignore toujours ce qui détermina l'éditeur, commerçant avisé, à retirer les deux pamphlets de la vente à un moment aussi critique pour sa maison (3). Robert Brasillach, dont le journal avait commenté ironiquement cette décision, reçut de Céline l'explication suivante : « Simultanément en plusieurs endroits la police dès le décret a sommé les libraires de retirer Bagatelle et L'Ecole [...] Nous avons enlevé nos deux ouvrages avec Denoël sur l'avis formel de Saudemont notre avocat » (4).
Toujours est-il que le 4 mai 1939, les Messageries Hachette avertissaient les libraires que ces deux livres étaient interdits de vente et que les exemplaires en stock devaient leur être retournés (5).
La première audience du procès Rouquès eut lieu le 8 mai et l'affaire fut jugée le 21 juin : le tribunal correctionnel de Paris condamnait Céline et son éditeur à 2 000 francs de dommages et intérêts et ordonnait la suppression du passage incriminé sous astreinte de 200 francs par jour de retard. La commercialisation de L'Ecole des cadavres avec un texte intégral avait donc duré moins de six mois.
A partir de septembre 1939 (6), Bagatelles et L'Ecole furent remis en vente avec des fortunes diverses : la drôle de guerre, l'exode, la fermeture des Editions Denoël (mai à octobre 1940), furent autant d'éléments défavorables à une diffusion efficace. Les exemplaires de L'Ecole étaient amputés de trois feuillets et portaient, collé sur le feuillet de garde, le papillon reproduit ci-après :

Cet avertissement laissait le lecteur sur sa faim : qui était concerné par les pages arrachées au volume ? La page 302 mentionnait Rouquès et avait donc été supprimée en raison du jugement rendu le 21 juin. La page 122 portait le nom de Léon Treich et cette auto-censure explique pourquoi le journaliste avait retiré sa plainte (7).
La page 17, elle, contenait une lettre scatologique d'un lecteur juif intitulée : « A Céline le dégueulasse » et sans doute Denoël avait-il jugé prudent de la supprimer aussi : il avait été beaucoup question, au cours de l'été 1939, d'une loi qui réprimerait les atteintes aux bonnes mœurs dans la presse et dans les livres (8), et le risque était bien réel, s'il faut en croire Céline : « J'ai failli aussi écoper d'un outrage aux mœurs, toujours pour L'Ecole » (9).
A ces conditions de vente assez catastrophiques, il faut ajouter une réticence certaine d'Hachette à diffuser le livre, ce qui amena Robert Denoël à en confier des exemplaires à des officines politiquement très marquées : les bureaux du journal Au Pilori, de la revue La Bataille maçonnique, du « Centre de documentation et de propagande » dirigé par Henri-Robert Petit, du « Rassemblement antijuif » de Darquier de Pellepoix, etc.
Les premières restrictions sur les attributions de papier et l'interdiction de réimprimer les ouvrages épuisés (mai 1941) l'obligèrent à « rafraîchir » ses invendus au moyen d'une nouvelle couverture datée 1941, munie de cette bande-annonce : « Les Juifs me regretteront... Edouard Drumont / Ouvrage interdit par le gouvernement Daladier » (10). Ces exemplaires n'étaient probablement pas nombreux puisqu'en octobre 1941, ni L'Ecole ni Bagatelles n'étaient en vente à l'Exposition « Le Juif et la France » au Palais Berlitz (11).
Ce qui est sûr, c'est que L'Ecole des cadavres était vendue caviardée : comment expliquer autrement l'indication « Texte intégral » imprimée sur la couverture des rééditions d'octobre 1941 et de 1942 de Bagatelles pour un massacre ? Cet avertissement s'adresse au lecteur qui ne trouve sur le marché qu'une édition censurée de L'Ecole.
Curieuse censure, d'ailleurs, qui n'est pas la même dans tous les exemplaires (12) : la seule constante est l'absence du feuillet 17-18. Considérons l'édition « définitive », celle d'octobre 1942, parue avec une préface inédite et 14 photographies : le nom de Treich y est rétabli ; celui de Rouquès a disparu mais Céline le mentionne nommément dans sa préface.

« A Céline le dégueulasse » : éditions de 1938 et de 1942
En revanche, la lettre « A Céline le dégueulasse » est écourtée de 25 lignes : c'est que cette fameuse « loi sur les bonnes mœurs » dont le projet remontait à l'été 1939 avait bel et bien votée deux ans plus tard par le gouvernement de Vichy ! On trouvera dans Les Beaux Draps (13) les mots indignés qu'inspirait à Céline la promulgation de ces « décrets de pudeur », à l'origine desquels se trouvait, selon lui, « la maîtresse richissime d'un de nos présidents du Conseil » (14).
Ainsi, après Mort à crédit, la véritable censure dont fut victime L'Ecole des cadavres avait pour cause : l'obscénité.
Notes
1. Autographe proposé en septembre 1974 dans le catalogue n° 393 de la Librairie Simonson, à Bruxelles.
2. Lettre à André Saudemont, [avril ou mai 1939], fac-similée dans l'Album Céline de la Pléiade, p. 158.
3. Dès le départ, en décembre 1936, de Bernard Steele, principal bailleur de l'entreprise, les Editions Denoël connaîtront d'importantes difficultés de trésorerie qui ne s'aplaniront vraiment qu'en juillet 1941, lors de l'association de Robert Denoël avec l'éditeur berlinois Wilhelm Andermann. En mai 1939 Céline, qui force toujours un peu la note, n'hésite pas à écrire à son sujet : « Denoël en mauvaise foi et faillite, qui ne me paye plus » [lettre à Evelyne Pollet].
4. Lettre à Robert Brasillach, [début juin 1939], en réponse à un écho polémique paru dans Je suis partout du 26 mai 1939 sous la signature de « Midas ».
5. « L'éditeur dit qu'une circulaire a été envoyée à tous les libraires de France, " les priant de retourner ces ouvrages à l'éditeur ". Il serait curieux de savoir si, après cela, il restera beaucoup d'invendus à " retourner " ! » [Le Mémorial, 10 mai 1939].
6. Cete date est avancée par Dauphin et Fouché [39A1], qui renvoient à notre Tout Céline 1, pp. 29-30, où nous décrivions un exemplaire amputé de 3 feuillets, remis en vente après le procès du 21 juin 1939, sans autre date. Celle de septembre 1939 est plausible et nous l'adoptons.
7. La correspondance de Céline mentionne deux procès contre L'Ecole jusqu'en juin 1939. Sans doute n'avait-il pas reproduit aussi « exactement » qu'il le dit l'article de La France enchaînée.
8. Voir à ce sujet : « Pour les Messieurs seulement. Une lettre de L.-F. Céline sur " La défense des bonnes mœurs », dans : Le Merle, 14 juillet 1939.
9. Lettre à Evelyne Pollet, [2 juin 1939], dans : Cahiers Céline 5, p. 206.
10. Le prix initial de 30 F est maintenu en raison du blocage des prix, datant du 2 septembre 1939, l'éditeur devant justifier d'une partie au moins inédite du volume pour augmenter son prix de vente.
11. Le Capitaine Sézille, à qui Céline s'était plaint de cette carence, affirmait n'avoir pu se procurer ces deux livres chez l'éditeur, alors qu'il disposait d'un « grand nombre de Beaux draps et de Mea culpa » [cf. sa lettre du 24 octobre 1941 dans : Gibault, Céline 2, pp. 286-287]. On note aussi que le 14 février 1941, Céline demande à son éditeur six exemplaires de tous ses ouvrages, sans mentionner Bagatelles et L'Ecole.
12. Quarante exemplaires recensés (par moi) présentant les caractéristiques suivantes :
A. Couverture 1938, papillon, 3 ff. arrachés : 23
B. Couverture 1938, papillon, ff. 17-18 et 301-302 arrachés : 5
C. Couverture 1938, sans papillon, ff. 17-18 et 301-302 arrachés : 3
D. Couverture 1938, sans papillon, 3 ff. arrachés : 6
E. Couverture 1941, papillon, 3 ff. arrachés : 2
F. Couverture 1941, papillon, texte intégral : 1
13. Aux pages 9 et 155-158.
14. Les Beaux Draps; p. 9. Cette personne que Céline nomme « Madame de Broussol, née Plumier » s'appelait en fait Madame Brunschvicq [Au Pilori, n° 65, 2 octobre 1941]
1989
![]()

En mars 1989 Marc Laudelout consacre l'intégralité de son 79e Bulletin célinien à Robert Denoël, à l'occasion de la parution du 12e numéro de sa collection « Céliniana », qui contient la publication d'un texte de Denoël consacré à Céline datant de 1941 et resté inédit.
Ce numéro spécial comporte une interview de l'éditeur parue dans l'hebdomadaire bruxellois Voilà du 27 novembre 1942, des souvenirs de Victor Moremans recueillis par Bernard Gheur et publiés dans La Meuse du 6 mars 1973, et un texte de Denoël sur Céline paru dans Le Cahier jaune de novembre 1941. Ma contribution se limite à une Chronologie assez sommaire qu'on trouve aux pages 15-23. Il était inutile de la reproduire : celle qu'on trouve sur ce site est moins fautive.
1995
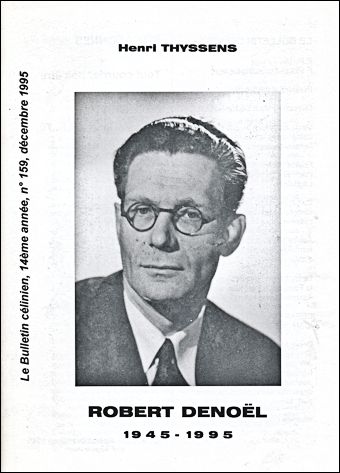
© En décembre 1995 Marc Laudelout a consacré un deuxième numéro spécial du Bulletin célinien à l'éditeur : il contient un texte de 35 pages que j'ai rédigé pour commémorer le cinquantenaire de sa mort. A ma connaissance il n'y eut aucun autre hommage à sa mémoire dans la presse.
Un Cinquantenaire oublié
Mort à crédit ?
Mais vous l’êtes, cher ami.
[Lettre de Céline à Denoël, 1933]
Le 2 décembre 1945 un éditeur belge a été assassiné à Paris. Cinquante ans plus tard, on ne sait toujours pas qui l’a tué, ni pourquoi, mais la question n’a jamais laissé personne indifférent car il s’agissait de l’éditeur de Louis-Ferdinand Céline. Si l’écrivain était resté à Montmartre, nul doute qu’il eût subi le même sort et tout le monde aurait compris pourquoi. Son éditeur n’avait pas les mêmes craintes, qui n’avait fait que commercialiser des idées qui n’étaient pas forcément les siennes, mais enfin il se cachait. Jamais il n’eut la tentation de chercher refuge en Belgique. Depuis près de vingt ans, sa vie était à Paris et il choisit crânement de s’y battre jusqu’au bout.
Robert Lucien Marie Denoël, qui répétait volontiers que la littérature aurait sa peau, n’a sans doute jamais imaginé qu’il tiendrait un jour le rôle de la victime dans un roman policier. Aucun autre éditeur n’a été abattu à la Libération, et c’est pourquoi une phrase de Céline, écrite quinze jours après cette mort suspecte, a permis les commentaires les plus lyriques depuis trente ans : « Il me semble que j’ai laissé en France un double qu’on écorche à plaisir » (1). Ces interprétations littéraires n’ont jamais mené nulle part parce que le destin de cet homme n’appartient pas à la littérature. En 1935 Denoël a résumé d’une jolie phrase toute sa carrière éditoriale: « Un jour j’écrirai la complainte des échéances difficiles » (2).
Il aimait passionnément la littérature, au point d’écrire lui-même quelques contes et nouvelles assez bénins dans les journaux et revues belges, au début des années vingt. Georges Poulet, qui l’a connu à cette époque, résume ainsi le sentiment général : « La médiocrité apparente de Denoël cachait des qualités que nous n’avions pas mais qui n’en étaient pas moins importantes, la hardiesse, l’esprit d’entreprise, surtout une grande vigueur physique et morale, quelque chose enfin qui nous donnait vaguement le sentiment qu’il avait de l’avenir » (3).
Un avenir qui était à Paris, Denoël l’avait pressenti très tôt mais il se fiait plutôt à son flair pour découvrir de quoi il serait fait. Fin 1926 il s’y établit et fut quelque temps commis dans la librairie de son compatriote George Houyoux, rue Sainte-Anne, qui envisageait l’édition d’ouvrages de luxe, une idée que Denoël reprendra à son compte deux ans plus tard. Ensuite il s’improvisa vendeur à la Galerie Champigny où l’on exposait les peintres de l’Ecole du Pré St-Gervais, dont faisaient partie Eugène Dabit et Béatrice Appia.
Quand Champigny ferme sa galerie, l'année suivante, Denoël se tourne vers le commerce d’antiquités et brocante. Au 60 de l’avenue de La Bourdonnais sommeillait une boutique appartenant à leur amie Anne-Marie Blanche ; en deux mois Denoël la transforme en librairie, puis en maison d’édition. Les Trois Magots publient leur premier livre en juillet 1928 : c’est une édition à tirage limité. A ce moment Denoël n’envisage pas de publier autre chose, et ce choix étonne car le marché du livre de luxe, tel qu’il a fonctionné depuis la fin de la guerre, est sur le point de disparaître. D’ailleurs il n’en publiera que trois, avant de trouver la bonne voie avec le roman qu'Eugène Dabit lui a proposé et qui obtiendra le premier Prix populiste.
Certes Dabit le quittera pour Gallimard mais le succès de L’Hôtel du Nord va lui apporter beaucoup plus : un vrai commanditaire, américain et riche de la fortune de sa mère. En avril 1930 est constituée la Société des Editions Denoël et Steele, au capital de 300 000 francs. Bernard Steele en fournit la moitié en numéraire, Denoël l'autre moitié en marchandises, matériel, clientèle. Pendant deux ans ils vont publier des petits romans de débutants, des livres pour enfants, une collection d’ouvrages de psychanalyse, sans grands profits, jusqu’à ce qu’arrive le livre qu’attend tout éditeur, celui qui lance définitivement sa maison.
Pour publier le gros roman de Céline il a fallu injecter 65 000 F de plus dans l’affaire, mais cette somme sera récupérée au centuple car Voyage au bout de la nuit obtient le prix Renaudot, et les tirages succèdent aux tirages. L’avènement du Front populaire met fin à l’euphorie. L’édition littéraire se porte mal, Denoël joue alors la carte politique et publie « communistes et royalistes avec plaisir et sans aucune sorte de cynisme » (4), tout en se gardant du moindre engagement personnel sauf quand il s’agit des pamphlets publiés par Céline à partir de 1937.
Ce programme et les nouveaux investissements qu’il réclame ne rencontrent plus l’assentiment de son associé, qui trouve que la maison s’éloigne de ses objectifs prioritaires. En fait, elle ne s’en est approchée qu’au début de leur association. Le rêve de Bernard Steele était de publier des traductions d’auteurs américains et anglais. Denoël lui a fait ce plaisir jusqu’en 1933, ensuite il n’en a plus été question. D’autre part le frileux américain ne supporte plus les exigences éditoriales de Céline, « un paranoïaque qui hurlait, portait des accusations tout à fait fausses sur les uns et les autres. Parfois il avait des attitudes extravagantes », dira-t-il plus tard (5).
Le départ de Steele est un coup très dur dont Denoël ne se remettra jamais tout à fait. En janvier 1939 il publie un catalogue anniversaire qui annonce que sa société d’édition, « SARL au capital de 365 000 F, est sur le point de se tranformer en SA, avec une forte augmentation de capital ». Cet appel de fonds ne sera entendu que deux ans plus tard, mais l’argent viendra d’Allemagne.
Est-ce en raison de sa nationalité belge, malgré une activité éditoriale « entièrement consacrée à servir la cause des alliés et de la France » (6), il s’estime brimé durant la « drôle de guerre » par certains ministères qui détournent ou surveillent son courrier, et lui retirent sa carte de circulation.
Le 14 juin 1940, les Allemands sont à Paris. Deux maisons d’édition sont, bien avant les autres, fermées à cause de leurs publications hostiles à l’Allemagne : Denoël et Sorlot. Chez Denoël, 41 titres et sa revue patriotique Notre Combat seront pilonnés. Cela représente plus de 200 000 volumes et brochures, pour une valeur de 1 728 214 F, soit près du tiers de son stock (7). Auguste Picq, le comptable de la maison, m’a confié qu’une partie de ces titres figurant sur la liste Otto avait pu être mis à l’abri ; on pénétrait sans difficulté au 19 rue Amélie par le magasin voisin ayant appartenu à Robert Beauzemont. Cela n’enlève pas grand-chose au préjudice, puisque ces ouvrages sont restés interdits de vente durant toute l’Occupation.
Denoël a pu rouvrir sa maison le 15 octobre, mais dans quel état : « Toute l’activité d’autrefois a disparu. Les quelques personnes qui travaillent font des inventaires, chiffrent, établissent le montant de la catastrophe. Je négocie en vue d’obtenir des capitaux. » (8).
Dans un premier temps il se contentera de remettre en vente le reste de son fonds et de publier quatre titres favorables à l’Occupant. Pour cela il crée (9) avec une amie, Pauline Bagnarro, qui a publié chez lui sous le pseudonyme de de Kéan, une nouvelle société d’édition : Les Nouvelles Editions Françaises, qui vont mettre en vente la collection « Les Juifs en France », abandonnée après le quatrième volume, et surtout Les Beaux Draps.
Dans sa maison il est conduit à publier au cours de l’année 1941 quatre ouvrages collaborationnistes dont un seul lui sera reproché en 1945 : les Discours d’Hitler. Ce titre lui a-t-il été imposé, l’a-t-il choisi ? Un de ses proches estime qu' « étant devenu l’éditeur du Führer, on devint un peu moins exigeant avec lui qu’avec ses confrères ». Il est sûr que ce choix n’est pas innocent, même si Denoël a aussi publié avant guerre des écrits de Mussolini, de Staline et de Roosevelt.
Tous les éditeurs ont dû, à un moment ou à un autre, publier des ouvrages conseillés ou simplement favorables s’ils voulaient obtenir du papier pour continuer leur activité. Mais en 1942 Denoël va rééditer les œuvres antisémites de Céline et surtout, publier Les Décombres de Lucien Rebatet, qui sera le plus grand succès de l’Occupation. Ces livres lui seront comptés trois ans plus tard bien plus lourdement que les autres titres : « On me reproche certains livres à succès et mon succès tout court », écrira-t-il en 1944 à Jean Rogissart (10).
*
On lui a surtout reproché d’avoir accepté une participation financière allemande dans sa société d’édition. Comment en est-il arrivé là ? Lors du départ de Steele en décembre 1936, Denoël a racheté ses parts et celles de sa mère, en a cédé deux à son frère Pierre, et trois à Max Dorian, l’attaché de presse. Il possède alors 725 parts sur 730 dans sa société, laquelle est à peu près exsangue. A partir de décembre 1940 il multiplie les démarches pour obtenir un prêt d’un million de francs auprès du Crédit National, proposant en garantie son stock évalué à plus de cinq millions, sans succès. L’éditeur Henri Gautier, administrateur de l’Imprimerie Crété de Corbeil (l’un de ses imprimeurs) lui présente en juin 1941 un éditeur d’art berlinois, Wilhelm Andermann, qui cherche à s’associer avec un éditeur français. Le contrat est signé un mois plus tard. Denoël cède 360 parts à Andermann pour 180 000 francs, en conservant donc 365. L’éditeur allemand lui consent un prêt de deux millions, remboursable en cinq ans, dont 800 000 francs sont destinés à apurer les dettes de la société.
Malheureusement ce contrat a été conclu en dehors de l’Office des changes et Denoël se trouve en effraction avec la législation française. Convoqué au ministère des Finances, il explique qu’il a dû faire appel à des capitaux étrangers faute d’en avoir trouvé en France, mais qu’il n’en a pas averti le Comité d’organisation du livre parce que « d’origine belge, il n’est pas en très bons termes avec ses confrères » (11). Ceci est confirmé dans la note transmise en février 1942 au ministre des Finances par le directeur des Finances extérieures et des changes, « qui reconnaît qu’il est exact que la situation financière de la maison Denoël et la personnalité de son gérant devaient créer des difficultés au renflouement de la maison par des capitaux français, et confirme que le Crédit National a refusé un prêt après un avis défavorable du secrétaire général à l’Information » (11).
Si l’Etat refuse de reconnaître le contrat avec Andermann, la maison Denoël n’est plus viable ; or, poursuit le directeur des Changes, il craint des incidents avec les autorités allemandes car Denoël, qui a édité les discours d’Hitler, « est certainement appuyé par elles ; d’autre part Andermann a de puissants appuis à Berlin ». Le secrétaire général à l’Information, Paul Marion, donne son accord pour qu’une plainte soit déposée contre « ce personnage » (12). La crainte de voir les autorités d’Occupation intervenir dans une affaire dont l’un des protagonistes est allemand est-elle déterminante ? Toujours est-il que c’est Pierre Laval lui-même qui décide de suspendre les poursuites.
En novembre 1942, l’éditeur est reçu au ministère des Finances où il demande que la transaction soit autorisée officiellement. Mais si aucune poursuite n’a été engagée, la plainte n’a pas été retirée : on attend de nouvelles instructions... En juin 1943 Denoël se dit prêt à rompre avec Andermann pour qu’on retire la plainte. Il lui est répondu que l’éditeur berlinois doit lui rétrocéder ses parts. Andermann demande alors l’appui des autorités allemandes et la solution retenue est celle-ci : la cession de parts est autorisée, à charge pour Denoël de verser une amende de 100.000 F et de rembourser immédiatement Andermann de la moitié du prêt, augmentée des intérêts, soit 1.165.000 francs ; le solde devra être payé dans les deux ans. L’éditeur s’exécute en décembre 1943. L’autre moitié ne sera jamais remboursée.
Beaucoup de temps a donc été perdu en palabres et c’est Robert Denoël qui a finalement été pénalisé. Mais dans l’intervalle il a profité du prêt allemand et procédé, en février 1943, à une augmentation du capital de sa société, à laquelle participe Andermann. Le capital a été porté à 1 500 000 F, Denoël possédant 1515 parts, Andermann 1480, Dorian 3 et Pierre Denoël 2. Les sommes dues par les deux principaux actionnaires ont été compensées avec les sommes dont ils étaient créanciers de la société. Les actions achetées par Andermann ne lui seront jamais livrées, on ignore pourquoi, mais cela permettra leur mise sous séquestre à la Libération. L’argent de l’éditeur allemand aura aussi permis à Denoël d’échapper à l’étranglement systématique de son diffuseur Hachette, dont il pourra dénoncer le contrat d’exclusivité dès le 1er janvier 1943.
Au cours de cette année 1943 Denoël a publié quatre ouvrages de propagande et deux traductions de l’allemand : aucun ne lui sera reproché à la Libération.Il a aussi fait paraître Le Cheval blanc d’Elsa Triolet, et celui-là lui sera porté en compte par certains comme un exemple manifeste de duplicité.
*
La fin de la guerre est en vue, et les menaces d’épuration se précisent. Depuis décembre 1943, les revues du Comité National des Ecrivains, clandestines ou non, ont mis en garde les écrivains et éditeurs collaborateurs : Denoël figure sur toutes leurs listes noires. Aussi entreprend-il très tôt de mettre à l’abri la plupart de ses biens.
Le 16 mai 1944, il cède ses parts dans la société des N.E.F. à Maurice Bruyneel, qui en devient le gérant ; l’adresse de la société devient provisoirement celle du domicile de Bruyneel, 5 rue Pigalle (13). Le second associé est Maurice Percheron, un auteur Denoël. Le 14 novembre le nom de la société des N.E.F. est changé en Editions de la Tour et son siège transféré au 162 Boulevard Magenta (14).
Le 9 juin 1944, il revend pour 500 000 F la Librairie des Trois Magots à deux hommes d'affaires parisiens, les frères Elie et Georges Alban (15).
Le 5 octobre 1944, il cède le bail de son appartement, rue de Buenos-Ayres, à Maurice Bruyneel puis lui « vend » tous les meubles et objets mobiliers qui s’y trouvent (16).
Le 15 février 1945, Denoël sollicite l’agrément de l’Administration des Domaines (détentrice des parts d’Andermann) pour une éventuelle cession de ses parts dans la Société des Editions Denoël. L’administration lui fait savoir qu’elle n’usera pas de son droit de préemption prévu aux statuts.
A la suite de menaces écrites et téléphonées, il quitte son appartement le 18 août 1944. Durant une quinzaine de jours il trouve refuge chez des amis, place Boïeldieu. Ensuite il loue, au nom de Jeanne Loviton, une garçonnière située au premier étage du 39 boulevard des Capucines. Sa femme s’installe chez Maurice Bruyneel, rue Pigalle, et confie leur appartement à Madeleine et Paul Vialar. Avec l’aide d’Auguste Picq, il a entreposé une partie des archives des Editions Denoël dans sa garçonnière et au siège des Editions Domat-Montchrestien, rue Saint-Jacques, tandis que sa bibliothèque personnelle est confiée à Maurice Percheron, qui habite rue Las-Cases. Durant plusieurs mois Denoël va mener une vie discrète. Il couche dans sa garçonnière ou à Auteuil, chez Jeanne Loviton.
Combien d’éditeurs compromis ont-ils été arrêtés après la Libération ? Une demi-douzaine entre septembre 1944 et mai 1945, et ils sont tous sortis de prison après quelques semaines. A ma connaissance aucun n’a subi de violences corporelles.
Le 9 septembre, le Syndicat des Editeurs exclut six de ses membres: Denoël n’en fait pas partie (17), décision que Carrefour commente ainsi : « Denoël, qui doit à sa nationalité de n’être pas exclu du syndicat des éditeurs, va-t-il au lieu de s’asseoir entre deux chaises, se prélasser dans un fauteuil ? » Quinze jours plus tard le Groupement corporatif du livre l’exclut avec trois autres éditeurs, mais cet organisme présidé par Gilbert Baudinière, collaborateur notoire, est contesté. Le 26 septembre 1944 la Direction de l’Edition et de la Librairie transmet à la justice une liste de neuf éditeurs « qu’il y a lieu d’arrêter pour leur activité anti-nationale », et Denoël est de ceux-là.
Le 6 février 1945, suite aux attaques de la presse il s’est présenté spontanément devant un juge d’instruction, qui l’inculpe deux semaines plus tard pour intelligence avec l’ennemi, mais le laisse en liberté.
A partir du 7 mars vont se succéder les procès d’éditeurs devant la Cour de Justice. René Debresse s’en tire ce jour-là avec un non-lieu. Fernand Sorlot, l’un des plus compromis, se voit infliger un simple blâme.
*
Le 13 juillet, c’est le tour de Robert Denoël. On lui reproche douze livres « pro-allemands » et la cession de ses parts à Andermann. Les ouvrages les plus compromettants sont les quatre titres publiés par les Nouvelles Editions Françaises ; il dit avoir arrêté la collection « Les Juifs en France » début 1941, lorsqu’il a appris les mesures prises contre les juifs. Le Commissaire du gouvernement ne retient finalement que l’infraction aux changes ; or Denoël a déjà été condamné pour cela. Le classement de la procédure est prononcé. Les témoignages en sa faveur ont été nombreux. Jeanne Loviton prétend lui avoir apporté celui d’Aragon, et surtout l’appui décisif de son ami Raymond Durand-Auzias, président de la commission d’épuration (18).
Sa société reste poursuivie par la Commission d’épuration du livre ; le procès devrait avoir lieu le 8 décembre 1945. Début août, Denoël écrit à un écrivain de sa maison : « J’ai gagné la partie, il ne me reste plus qu’à régler le montant des enjeux, ce sera l’affaire de quelques mois et je reprendrai mon travail avec la certitude qu’il sera fécond » (19).
Au cours des mois suivants des condamnations plus sévères vont être prononcées. Jacques Bernard (Mercure de France) par exemple, est condamné le 16 juillet à cinq ans de réclusion, à l’indignité nationale et à la confiscation de ses biens. Le même jour Jean d’Agraives (Editions Colbert) est condamné à huit mois de prison et à cinq ans d’indignité nationale. Mais en novembre, des décisions de classement assez inattendues sont prononcées en faveur de Jean Renard et de l’Artisan du livre. Le 3 décembre, Gilbert Baudinière est interdit d’édition et, le 19, Jean de La Hire (spoliateur des Editions Férenczi) est exclu de la profession. Deux poids, plusieurs mesures.
Rien ne permet d’affirmer que Denoël aurait été lourdement condamné, mais il est vrai que d’autres éditeurs importants comme Flammarion, Gallimard ou Plon, ayant bénéficié de décisions de classement, et la presse issue de la Résistance s’en étant émue, il fallait faire des exemples. Quatre maisons sont considérées comme particulièrement compromises : la sienne, Grasset, Sorlot et Baudinière. Leurs procès n’auront lieu que bien plus tard, quand les passions se seront apaisées. Baudinière sera acquitté le 7 janvier 1949 ; Sorlot sera condamné à vingt ans d’indignité nationale et à la confiscation de ses biens jusqu’à concurrence de deux millions ; Grasset, après de multiples atermoiements, sera condamné à la confiscation en 1948, mais amnistié en 1953. Il paraît avoir joué le rôle du bouc émissaire de l’édition.
Si Denoël avait vécu, aurait-ce été lui ? Personnellement, je crois que oui. Sa nationalité belge a toujours joué en sa défaveur, et la prise de participation allemande ne pouvait que l’accabler. Il importe peu que la Société des Editions Denoël ait finalement été acquittée, le 30 avril 1948 : son nouveau propriétaire avait alors de puissants appuis politiques. En disparaissant la veille de son procès, Denoël nous a de toute façon privés d’une décision de justice qui aurait pu changer le visage de l’édition parisienne après la guerre.
*
Robert Denoël et Jeanne Loviton ont passé une partie du dimanche 2 décembre 1945 à « La Tour de Nézant », la propriété de Marion Delbo à Saint-Brice-la-Forêt, dans le Val d’Oise, en compagnie de trois autres invités : le journaliste Claude Rostand, un gouverneur de colonies et sa femme, M. et Mme Baron. Ils ont quitté St-Brice à 18 heures, déposé à Neuilly le couple Baron, et regagné le domicile de Mme Loviton à Auteuil. « Entre 20 heures et 20 heures 30 » le couple quitte la rue de l’Assomption « pour se rendre à Montparnasse, au théâtre d’Agnès Capri » .
A 21 heures 10, Denoël range sa voiture boulevard des Invalides ; un pneu a éclaté. Mme Loviton se rend au commissariat le plus proche pour demander un taxi, tandis qu’il s’apprête à réparer. A 21 heures 30 Police-Secours découvre l’éditeur râlant sur le trottoir, à quelques pas de sa voiture. Une balle de 11 mm 45 lui a été tirée dans le dos. A 22 heures il meurt sans avoir repris connaissance à l’hôpital Necker.
Voilà ce que les lecteurs de l’époque ont pu lire dans la plupart des journaux du lendemain. D’autres précisions seront données les jours suivants. La voiture s’est rangée le long du square des Invalides [aujourd’hui square d’Ajaccio], à hauteur de la rue de Grenelle. C’est Denoël qui a envoyé Jeanne Loviton demander un taxi, en lui disant qu’il la rejoindrait au théâtre. On pense que les agresseurs étaient au moins deux. On a retrouvé la manivelle et le cric « assez loin de la voiture », ce qui permet de croire qu’il s’en est servi pour se défendre.
Le crime a été commis « dans une partie bien éclairée » du boulevard. « Par ce pluvieux dimanche soir, les rues de ce paisible quartier sont désertes ». Aucun témoin n’y a assisté. Un garde mobile en faction devant le ministère du Travail est le seul à avoir entendu un coup de feu. Deux employés qui sortaient du même ministère, et qui ont découvert le corps, n’avaient rien entendu. Le commissaire chargé de l’enquête croit à un crime crapuleux. Ce n’est sans doute pas la personnalité qui était visée mais son portefeuille. Si les agresseurs n’ont pas eu le temps de voler, c’est à cause de l’arrivée des deux employés du ministère sur les lieux. Le portefeuille contenait 12.000 francs.
Le corps de l’éditeur a été découvert sur le bord du trottoir opposé à celui où se trouvait la voiture, une Peugeot 202 immatriculée 4848 RNI au nom de « l’éditeur Domat-Montchrestien ». La douille a été retrouvée à quelques mètres de la voiture. Quant à Mme Loviton, elle a appris la nouvelle de l’agression dans le commissariat même, par un appel de Police-Secours ; elle a ensuite accompagné les agents sur les lieux du crime.
La presse passe en revue quelques hypothèses : crime de rôdeur, crime politique, crime passionnel ? Un curieux écho, toutefois, dans Libération Soir, le seul de ce genre : « Faut-il songer, comme le suggérait un éditeur, que quelqu’un l’ait tué pour s’emparer de sa maison d’édition ? »
Un témoin se fait connaître dès le 5 décembre ; c’est un colonel en retraite qui demeure rue de Grenelle, face à l’endroit où s’est déroulée l’agression. Il a clairement entendu appeler « au voleur », puis un coup de feu.
France-Soir se rend rue de l’Assomption. Jeanne Loviton fait répondre que « Madame est alitée et ne reçoit personne », ce qui n’empêche pas l’échotier de publier son papier. Il a remarqué « l’intérieur confortable, luxueux même » de l’appartement, il rappelle que « Mme Levidon » [sic] fut, en 1935, « en même temps qu’une des femmes les plus célèbres de Paris, la compagne du romancier Pierre Frondaie à qui elle inspira, dit-on, par les désagréments qu’elle lui causa, Le Voleur de femmes ». Elle dirige les maisons d’édition « Les Cours de droit » et Domat-Montchrestien, et elle doit posséder une fortune rondelette.
Jeanne Loviton est entendue ce même jour par la P.J., ainsi que Cécile Denoël et d’autres familiers de l’éditeur ; leur audition n’a rien apporté de nouveau à l’enquête, mais le témoignage de Mme Loviton « semble prouver avec certitude que l’agression fut tout à fait fortuite ». Crime crapuleux, confirme un employé d’Aragon à Lettres Françaises, « c’est infiniment probable. Il n’en reste pas moins vrai que s’il avait été arrêté, comme c’eût été justice, il serait sans doute encore en vie. »
Le 11 décembre a lieu l’enterrement. Une messe est célébrée à midi dans l’église St-Léon, place Dupleix, et l’éditeur est inhumé dans un caveau provisoire au cimetière du Sud-Montparnasse. Crime de rôdeur. C’est la version dont la police et la presse se contenteront durant quatre ans.
*
Le 28 décembre 1949, le juge Goletty décide, à la demande de Cécile Denoël, de rouvrir l’enquête qu’il avait clôturée deux ans plus tôt par un non-lieu. La plaignante estime que la mort de son mari pourrait avoir un rapport avec des questions d’intérêt. Mais la presse révèle aussi que la nouvelle plainte contre X déposée par l’avocat de Mme Denoël vient à la suite d’une autre plainte, plus ancienne celle-là, qui concerne la succession de l’éditeur, et dont bien peu de journaux ont rendu compte.
Tout a débuté le 21 janvier 1946. Ce jour-là les actionnaires de la Société des Editions Denoël sont réunis rue Amélie sur convocation des Editions Domat-Montchrestien, « propriétaires de 1 515 parts de la société ». Sont présents : Mme Loviton [1515 parts], M. Boyer contrôleur principal de l’Enregistrement représentant l’administration des Domaines [1480 parts], et Max Dorian [3 parts] ; Pierre Denoël [2 parts], dont on ignore l’adresse, n’a pu être contacté. Il s’agit de nommer un nouveau gérant : ce sera Mme Jeanne Loviton, « par 2 995 voix contre 3 voix et 2 abstentions ».
La veuve de Robert Denoël réagit avec quelque retard. Le 22 février, elle demande que des scellés soient apposés sur la garçonnière de son mari, boulevard des Capucines, mais la pièce a déjà été « passée à l’aspirateur ». Elle attaque ensuite la validité de la cession de toutes ses parts qu’a consentie Denoël le 25 octobre 1945, considérant que si la signature et la mention « Bon pour cession de 1 515 parts » sont bien de sa main, la date et le nom du cessionnaire ont été « frauduleusement inscrits, après coup, dans les blancs laissés à cet effet dans le corps de l’acte enregistré le 8 décembre 1945 ».
Cécile Denoël soutient donc que cette cession de parts constitue une manœuvre frauduleuse. Le blanc-seing donné par l’éditeur n’était qu’un moyen de soustraire ses biens à une confiscation éventuelle, comme il l’a fait pour les Editions de la Tour. C’est Jeanne Loviton qui, selon elle, a complété les « blancs » du document après l’assassinat, et pas dans le sens que son mari entendait lui donner. Mme Loviton le nie mais ne peut apporter la preuve du paiement des parts à l’éditeur. Le tribunal des référés ordonne alors la mise sous séquestre des parts litigieuses. Le Populaire est à peu près seul à rendre compte de l’affaire le 12 avril, soit un bon mois plus tard.
Le 17 mai, Mme Loviton a demandé à la Cour d’appel la levée du séquestre mais n’a pu l’obtenir ; le 1er juin celle-ci confirme la décision du tribunal civil, en attendant la décision sur le fond.
Cette décision a dû tomber début juin. Nous ne l’avons vue mentionnée nulle part mais, le 7 juin, Mme Denoël fait appel à un jugement la déboutant dans l’affaire des biens et des parts « accaparés frauduleusement » par sa rivale.
Le 20 décembre1946, la Chambre des mises en accusation de la Cour d’Appel conclut à un non-lieu dans l’affaire des parts et laisse à Mme Loviton le bénéfice du doute quant aux affaires personnelles, argent, meubles, livres, vêtements, qu’elle aurait conservés, du fait qu’elle vivait maritalement avec l’éditeur depuis plus d’un an, créant ainsi une « communauté de fait ».
Ce jugement, qui fait date, a paru suffisamment intéressant pour que la Gazette du Palais en publie tous les attendus en janvier 1947, ce qui nous permet de savoir que Mme Denoël a produit des factures de meubles et de vêtements livrés à son mari depuis 1943, mais « n’a pu apporter la preuve qu’ils se soient trouvés en possession de celui-ci dans l’un des locaux qu’il occupait » avec Jeanne Loviton. D’ailleurs cette dernière « a fait rapporter certains objets qu’elle avait cru pouvoir distribuer, à titre de libéralités, après la mort de son amant ». Quant à la montre en or du défunt, de grande valeur, Mme Loviton fait valoir qu’elle aurait été acquise par elle en échange d’une montre-bracelet « du même genre », restée en possession du défunt. Ainsi présentée, l’explication, « dont la fausseté n’a pas été démontrée, est plausible ». Les éléments matériels et intentionnels nécessaires à la constitution du délit de vol faisant défaut, le non-lieu est justifié.
Après ces détails un peu sordides, voyons l’objet principal de la plainte, c’est-à-dire l’accusation d’appropriation frauduleuse des parts. Le tribunal estime qu’il importe de rechercher si, au moment de sa mort, Denoël avait ou non manifesté « auprès de divers témoins » son intention de céder ses parts de sociétaire des Editions Denoël.
On ne saurait écarter les déclarations de l‘agent d’affaires parisien Lucien selon lequel Denoël et sa maîtresse se sont présentés, en mars 1945, à son bureau pour lui demander de préparer l’acte de cession, lequel a été complété par lui le 25 octobre 1945. Il explique le délai apporté à la régularisation de l’acte par la double raison que Denoël, poursuivi devant la Cour de Justice, avait laissé le projet en suspens jusqu’au classement des poursuites et que, d’autre part, une mutation ayant été envisagée dans la personne des gérants de la société des Editions Domat-Montchrestien, le nom de la personne habilitée à la représenter à l’acte devait être éventuellement réservé (20), ce qui est confirmé par la lettre adressée le 15 février 1945 par Denoël à l’Administration des Domaines, ainsi que « dans des rapports à ce sujet ayant eu lieu entre les Domaines et le cabinet d’affaires Lucien jusqu’au moment où la cession prévue a été réalisée ».
Le tribunal relève encore que la partie civile elle-même reconnaît que l’éditeur, écarté de sa maison rue Amélie, continuait de travailler sous le couvert des Editions Domat-Montchrestien, rue Saint-Jacques, ce qui « atteste le fait d’un transfert d’intérêts dont l’acte incriminé pourrait bien n’avoir été que l’expression de droit ». Il considère que, quelle que soit la date à laquelle les additions litigieuses ont été effectuées, il est décisif qu’elles n’aient point altéré la substance de l’acte : en effet Mme Loviton n’y est intervenue qu’agissant au nom des Editions Domat-Montchrestien, bénéficiaire de la cession consentie par Denoël, laquelle n’a jamais été en sa possession.
Mais le 24 décembre 1948, le Tribunal de Commerce annule la cession qu’il estime simulée, condamne Mme Loviton à la restitution et accorde à Mme Denoël 500 000 francs de dommages-intérêts. Les deux parties se pourvoient en appel. Madame Denoël réclame cinq millions.
Le 2 novembre 1949, l’affaire est portée devant la Cour d’Appel. Abel Manouvriez rend compte des plaidoiries des deux avocats dans Paroles françaises (21) :
- Me Rozelaar, l’avocat de Cécile Denoël : « Il fut suggéré à Denoël, et il accepta l’idée, d’entrer dans une sorte de clandestinité, de s’effacer et de céder ses parts, de façon à permettre à son entreprise de continuer à fonctionner et de bénéficier de crédits bancaires. Début 1945, un projet fut établi et rédigé par un homme d’affaires, la date et le nom du bénéficiaire étant laissés en blanc. » L’avocat affirme que ces mentions ont été rajoutées après la mort de l’éditeur, lequel n’avait pas forcément l’intention d’épouser Mme Loviton ; il fait état d’un appel téléphonique, fin novembre 1945, au cours duquel l’éditeur avait dit à sa femme de « tout arrêter; pas de divorce, tout peut encore s’arranger ». Il rappelle quelques dates dont le rapprochement est significicatif : 25 octobre 1945, cession prétendue des parts ; 2 décembre, assassinat de l’éditeur ; 8 décembre, enregistrement de la cession de parts ; début 1946, notification à la Société des Editions Denoël. « La mort a été mise à profit...Quand les scellés sont mis sur l’appartement que Mme Loviton louait pour Denoël, on ne trouve rien. Ses vêtements, ses livres, sa montre en or, ont disparu. Quant à son compte en banque, il est à sec. Où est passé le reste de ce qu’il possédait ? »
Il aborde ensuite la question des 1 515 parts cédées par Denoël aux Editions Domat-Montchrestien pour 757 000 F : « Une plaisanterie ! 757 000 francs, c’était peut-être la valeur nominale des parts. Leur valeur réelle était bien plus élevée. Le fonds de commerce valait 7 à 8 millions. Jamais Denoël, qui adorait son fils, n’aurait consenti à le dépouiller ainsi. L’adversaire a dû avouer que le versement n’avait pas eu lieu le 25 octobre 1945, le jour où l’acte aurait été régularisé et la quittance donnée, mais seulement le 30 novembre. Nous affirmons qu’il n’a pas plus été effectué le 30 novembre que le 25 octobre. Le livre de caisse de la Société Domat-Montchrestien porte trace d’une opération invraisemblable que voici : le 30 novembre Mme Loviton verse à son titre personnel dans la caisse de cette société dont elle est gérante, 757000 F. et s’en fait donner reçu. Puis, cette opération faite de la main droite, elle retire, de la main gauche, la même somme et en donne reçu à la caissière ! Cette mise en scène n’a été orchestrée que parce que, en décembre 1945, Mme Loviton sait bien que jamais Mme Denoël ne consentira à lui céder les parts, qu’il y aura procès et qu’il lui faudra prouver comment elle a payé. »
- Me Rosenmark, « adversaire redoutable dans un procès civil », répond à ce réquisitoire au nom de la Société des Editions Domat-Montchrestien, que la thèse de Mme Denoël n’est qu’un roman et que la « machination » qu’elle prête à Mme Loviton s’explique de la façon la plus aisée. Il présente tout d’abord sa cliente, « une femme charmante, d’une intelligence et d’une activité remarquables ». A la mort de son père, en 1942, elle a repris la direction des « Cours de droit » ; elle a hérité de lui des parts dans la Société Domat-Montchrestien, dont elle est gérante : « On prétend que Mme Loviton et les Editions D-M, c’est la même chose. Profonde erreur : aux Editions D-M, Mme Loviton ne possède que la minorité des parts, la majorité étant tenue par une personne qu’on ne peut souçonner d’être un simple prête-nom, Mme Yvonne Dornès, fille d’un conseiller à la Cour des Comptes, animatrice d’une société bien connue et à caractère quasi officiel, S.V.P. »
Il rappelle ensuite la situation critique des Editions Denoël à la Libération : « L’homme qui en est la cheville ouvrière est l’objet de poursuites, les parts de M. Andermann sont sous séquestre. Comment faire marcher une affaire dans ces conditions ? Il décide donc, sur conseils unanimes, de vendre ses parts. En mars la cession est décidée mais remise au jour où on y verra clair, où le classement escompté aura été obtenu en Cour de Justice. Le projet est établi par un homme d’affaires, tapé avec deux mentions en blanc : le nom du cessionnaire et la date. Mme Loviton et Mme Dornès alternant à la gérance, on ne pouvait deviner d’avance qui serait la gérante au moment de la signature. On ne pouvait pas savoir non plus d’avance quand on signerait. »
L’avocat soutient que le divorce était décidé, comme l’atteste certaine lettre que Mme Denoël affirme n’avoir jamais reçue, qu’il a bien fallu lire à l’audience, et dans laquelle son mari accumule tous ses griefs. La partie adverse n’invoque que des lettres non datées et un coup de téléphone impossible à vérifier. « Elle n’a jamais été une compagne pour lui. Elle n’a jamais été capable ni de donner un coup de téléphone, ni d’organiser une réception, ni de faire une démarche, ni de seconder en quoi que ce soit son mari. Tout ce dont Mme Denoël était incapable, Mme Loviton l’apportait à Denoël. Il savait que, passée dans ses mains, comme le voulaient les auteurs, sa société reprendrait vie et prospérerait de nouveau. Il savait que Mme Loviton était toute disposée, quand son fils aurait l’âge d’homme, à lui faire une place dans la direction ».
Me Rosenmark en vient au « grand argument » invoqué aussi bien par l’adversaire que par le Tribunal de commerce dans son jugement du 24 décembre 1948 : « les 757.000 francs n’ont pas été retrouvés. Ici encore nous avons réponse : trois créanciers de Denoël nous ont écrit pour nous certifier que, dans les jours qui précédèrent sa mort, Denoël leur a remboursé des prêts s’élevant au total à 600.000 francs. Que veut-on de plus ? ».
Le tribunal n’avait retenu que la vente simulée, il n’a pas assigné à cette simulation un objet frauduleux ou illicite : « Qui s’agissait-il de tromper ? Les Domaines ? Denoël était assez bien conseillé pour savoir qu’en cédant ses parts avant la fin de ses difficultés, il n’évitait nullement la confiscation : une telle cession était, d’avance, frappée de nullité.»
Il se lance ensuite dans une vibrante défense de sa « malheureuse cliente, restée alitée trois semaines, veillée nuit et jour, ne pouvant trouver de repos que grâce à des piqûres. Peut-on imaginer qu’elle ait pu, durant ces heures tragiques, concevoir et exécuter l’abominable opération qu’on lui prête ? En luttant pour conserver ses parts, elle n’a pas lutté pour s’assurer une fortune. La charge des Editions Denoël est terriblement lourde. Elle a usé à ce travail sa santé. Elle s’est attachée à une œuvre de relèvement singulièrement ardue, et elle ne l’a fait que pour exécuter, comme le disent tous les amis de Robert Denoël, la volonté du mort. »
L’avocat de Mme Loviton marquera un point ce jour-là. La Cour ne se prononce pas et nomme un expert, Paul Caujolle, pour examiner toutes ces écritures litigieuses. On ignore toujours qui sont les trois créanciers de Denoël.
*
Quelques jours plus tard, l’hebdomadaire Détective va résumer à sa manière cette affaire embrouillée, et se mettre résolument du côté de la veuve et de l’orphelin (22). Il rappelle que Robert Denoël a, depuis février 1945, ajouté à sa clandestinité une simulation de la vente de ses parts afin d’éviter, en cas de coup dur, la confiscation de ses biens : « Mais Mme Loviton, qui possède de hautes et puissantes relations, veillait jalousement sur son poulain, et le 13 juillet 1945 celui-ci bénéficiait d’une ordonnance de classement devant la Cour de Justice. Mais sa société faisait encore l’objet d’une poursuite et il devait comparaître dans le courant du mois de décembre devant la Commission d’épuration du livre ». On ne voit pas où le journaliste veut en venir, jusqu’à ce qu’il écrive: « Et c’est ici que se place le côté le plus troublant de cette affaire : alors que Denoël manifestait nettement l’intention de reprendre en mains son entreprise, alors qu’il écrivait à des amis très chers qu’il entendait rentrer chez lui, alors que le 3 décembre il avait rendez-vous avec son directeur commercial [Auguste Picq] pour recevoir des mains de ce dernier une attestation, signée du personnel de sa maison d’édition, qui demandait au Comité d’épuration du livre de permettre à Denoël de reprendre la gérance de son affaire, il était mystérieusement assassiné. »
Le magazine rappelle ensuite les circonstances de l’assassinat, où l’on n’apprend rien de neuf, si ce n’est que Jeanne Loviton se serait jetée sur le corps sans vie de son amant en s’écriant: « Pardonne-moi, mon chéri, c’est ma faute ! » Ce sont les détails de ce genre qui assuraient les ventes de Détective.
La presse, France-Soir en tête, va reprendre dès le 13 janvier 1950 tous les éléments de l’affaire et les commenter. Plusieurs points que l’enquête aurait pu préciser, « si elle avait été faite », sont passés en revue :
- De la rue de l’Assomption, que le couple a quittée à 20 h. 45, au boulevard des Invalides, une demi-heure c’est long, à une époque où les rues n’étaient guère encombrées.
- Le boulevard des Invalides n’est certainement pas le chemin le plus court pour se rendre d'Auteuil à Montparnasse, mais il se trouve à deux pas de la rue Amélie, siège des Editions Denoël, et du domicile, rue Las-Cases, d’un des familiers du couple Denoël-Loviton : Maurice Percheron, qui n’a pas encore été entendu par la justice.
- Pourquoi, alors que voitures et taxis sont rares, un homme enverrait-il sa compagne chercher un taxi au commissariat ? « Nous craignions d’arriver en retard au théâtre » a dit Mme Loviton. Pour changer une roue, il faut dix minutes ; elle risquait d’attendre bien plus longtemps un taxi. Mme Loviton « avait peut-être d’autres raisons de s’éloigner de la voiture en panne », écrit France-Soir. Son chauffeur, le lendemain, est venu chercher la voiture (qui n’a pas été mise sous scellés) et a changé la roue sans difficulté particulière.
- D’autres passagers n’avaient-ils pas pris place dans la Peugeot ? N’y eut-il pas discussion entre l’un d’eux et l’éditeur, connu pour sa violence et sa force redoutable ?
- Le couple a déjeuné le 2 décembre à Saint-Brice, chez une amie. Cette dame n’a pas été entendue. L’éditeur a ramené de Saint-Brice à Neuilly deux personnes qu’on n’a pas cherché à retrouver. Ne serait-il pas intéressant de les interrroger ? D’autre part des contradictions ont été relevées lors de la première enquête entre plusieurs témoins et leur emploi du temps. Enfin des bruits ont couru selon lesquels les conclusions d’une enquête parallèle menée par la direction des Renseignements Généraux de la Préfecture de police étaient opposées à celles de l’enquête menée par la brigade criminelle. Le dossier aurait été gardé secrètement par le préfet de la Seine, lequel dément formellement ces affirmations (23).
Georges Gherra, qui va signer les articles les plus documentés sur l’affaire, recueille le témoignage de Cécile Denoël. Elle rappelle que « la balle qui a tué son mari est de 11 mm. 45, qu’on a conclu à un meurtre de rôdeur, probablement un " nègre américain ", alors que le calibre du colt dont est dotée l’armée américaine depuis 1941, est de 11 mm.43 ». Cela prouve au moins qu’il ne s’agissait pas d’un déserteur américain. Quant à Jeanne Loviton, elle se dit « très heureuse de la décision prise par le Parquet, et est persuadée que toute la lumière sera faite sur cette affaire qui bouleversa une période heureuse de sa vie ».
Le 17 janvier, Paul Bodin signe dans Carrefour un long article intitulé « Le Dessous des cartes » où il rappelle une fois encore les circonstances du drame, en ajoutant que l’emploi du temps de Jeanne Loviton fut vérifié et que les enquêteurs ont admis qu’elle était au poste de police lorsque le meurtre eut lieu. « L’arme du crime était celle d’un tueur et il semble bien que le même genre d’arme ait été employé, ultérieurement, dans des règlements de compte sensationnels ». Le journaliste ne dit pas lesquels.
Il fait le portrait de Jeanne Loviton, qui représentait pour Denoël « une étape importante de sa vie. Car cette femme très élégante lui apportait ce qui lui avait toujours manqué : des relations et des possibilités de financement. L’éditeur, qui avait de grands projets, avait dressé, d’accord avec son amie, un plan d’association selon lequel il cédait la moitié des parts des Editions Denoël aux Editions Domat-Montchrestien. Mais, contrairement à ce qu’on a prétendu, il l’avait fait en toute liberté, envisageant en retour la possibilité d’une très large extension de ses affaires. Il avait notamment l’intention de créer à Paris, avec le concours de son amie, un " Palais du livre " qui aurait abrité un centre d’échange international du livre, un club d’écrivains et d’éditeurs, un cinéma, etc. Ce club devait constituer une des plus grandes entreprises de l’édition française.»
Paul Bodin examine ensuite le cas des Editions de la Tour, créées à la Libération: « Il avait pour cela emprunté de l’argent [à Maurice Percheron], grâce à Mme Voilier, choisi comme gérant de cette maison l’ami même de sa femme [Maurice Bruyneel], auquel il avait fait signer, une semaine avant l’attentat, une cession de parts en blanc. Cette cession devait devenir effective le 4 ou le 5 décembre. Elle devait, en effet, être enregistrée au nom des nouveaux propriétaires. Mme Denoël hérita, régulièrement, les Editions de la Tour. » Cette information n’a été reprise nulle part ailleurs. Bodin veut-il dire que Denoël comptait récupérer, pour Jeanne Loviton et lui-même, cette petite société ? Le fait est que Maurice Percheron, propriétaire de 33% des parts, a fait valoir, après la mort de l’éditeur, ses droits dans la société auprès de Bruyneel, mais j’ignore comment les choses ont été réglées. La faillite des Editions de la Tour a été prononcée en décembre 1946.
Le journaliste évoque encore un « dossier noir constitué par Denoël, dont on parlait dans tout Paris et qui mettait en cause d’autres éditeurs. L’un d’entre eux aurait eu recours à une police politique renommée pour abattre un témoin gênant. » Mais il ajoute qu’une police politique n’aurait pas agi de cette façon ; nul ne pouvait prévoir qu’un pneu de la Peugeot éclaterait à cet endroit, et il était facile d’exécuter l’éditeur dans d’autres circonstances. Denoël, qui circulait fréquemment à motocyclette, était extrêmement vulnérable, surtout quand il rentrait au domicile de son amie, rue de l’Assomption. Quant aux pièces qui composaient le dossier noir, « on affirme aujourd’hui qu’elles ne constituaient un mystère pour personne ».
Le 20 janvier, Aux Ecoutes révèle que l’éditeur Wilhelm Andermann a entrepris, contre l’administration des Domaines, une procédure en vue de récupérer ses parts dans la Société des Editions Denoël, et qu’il a choisi l’avocat même de Mme Denoël, « qui a soudain déclenché l’offensive parallèle et tapageuse que l’on sait ».
Paroles Françaises du même jour rappelle que la Cour a nommé en novembre 1949 l’expert Caujolle dont le rapport sera sans doute décisif dans l’affaire de la cession de parts, et que la demande de réouverture de l’enquête sur le meurtre de l’éditeur par Mme Denoël, viserait à influer, dans un sens favorable pour elle, sur les décisions de l’expert : « Mais cette hypothèse semble sans fondement sérieux, car dans tous les cas le supplément d’enquête n’arrête pas l’expertise que son caractère technique met à l’abri des fluctuations de l’actualité journalistique ».
Le 22 janvier, La Presse publie un long article non signé contenant plusieurs détails intéressants. On y relève d’abord que, le 2 décembre 1945, Jeanne Loviton a demandé à un agent en faction rue de Grenelle (probablement celui qui se trouvait devant l’entrée du ministère du Travail) de lui indiquer le commissariat, alors qu’elle « connaît tout le quartier pour avoir résidé tout près, rue Casimir-Périer ». Le commissariat de la rue de Grenelle se trouve en effet près de la rue Casimir-Périer. Il est à nouveau question du « mystérieux dossier » que Denoël avait préparé pour assurer sa défense, le 3 décembre : « Or ce dossier ne contenait, suivant un de ses proches collaborateurs qui l’aida à le constituer, que des coupures de la Bibliographie de la France démontrant que la plupart des grands éditeurs avaient publié des livres imposés par les Allemands, alors que trois maisons seulement étaient poursuivies : Grasset, Sorlot et la sienne. » Ce proche collaborateur est René Barjavel, qui me confirma cette version.
Des « amis intimes » de l’éditeur ont affirmé que Denoël avait l’intention de refaire sa vie avec Jeanne Loviton, qui lui apportait « ce dont il était aussi dépourvu en 1945 qu’à son arrivée à Paris, vingt-cinq ans plus tôt : de l’argent et des relations. Car si Denoël avait réussi à payer ses dettes, pendant la guerre, où les affaires de librairie marchaient bien, il ne s’était pas enrichi pour autant. On estime qu’à la Libération il ne disposait pas de plus de quelques centaines de mille francs. »
Durant le déjeuner qu’il avait pris chez la comédienne Marion Delbo (Mme Henri Jeanson à la ville), à St-Brice, « il avait évoqué ce " Palais du livre ", exposition permanente de librairie internationale qu’il s’apprêtait à fonder aux Champs-Elysées, avec l’appui financier de Mme Loviton. Rien n’indiquait donc un changement possible dans ses sentiments envers celle-ci » (24).
Six jours plus tard, Le Cri de Paris ne craint pas d’écrire que « le président de la troisième chambre de la Cour a estimé suspectes les coïncidences de certaines cessions de titres et de l’assassinat de Robert Denoël. Avant de confirmer ou d’infirmer le jugement du Tribunal de commerce, il a demandé une expertise à M. Caujolle. Il s’agit actuellement de savoir si Mme V..., grande profiteuse de l’assassinat, y a joué ou non un rôle d’exécutante ou de complice. Seule une instruction loyale peut nous l’apprendre ».
Féroce, le chroniqueur poursuit : « Les réactions passionnées d’un certain public s’expliquent par la personnalité même de Mme V... Elle fut avocat à la Cour de Paris et l’épouse du regretté Pierre Frondaie avec lequel elle dirigea une collection à la Librairie Emile-Paul. Elle quitta son mari, et sa carrière fut celle d’une très jolie femme. Ses charmes lui attirèrent pas mal d’amis influents. D’abord un très haut fonctionnaire de la police judiciaire, puis une dame exerçant des fonctions publiques, et qui est devenue l’épouse d’un président du Conseil. D’autres encore. Voici quelques jours la préfecture de police démentait officiellement qu’un de ses agents eût fait classer un dossier relatif à l’assassinat de Robert Denoël. Ce démenti même prouve que l’on a dit beaucoup le contraire. On a dit, en outre, pas mal d’autres choses au sujet de démarches qu’aurait eu à subir le Président de la 3e Chambre de la Cour. Il est évident que ce haut magistrat n’est pas de ceux qu’une démarche féminine influence. César n’aurait pas toléré telle immixion de sa femme en matière de justice. La IVe République est anti-césarienne. » (25).
Le 24 mars, un autre hebdomadaire, Juvénal, renchérit: « La première information menée sur l’assassinat de l’éditeur Denoël fut rapidement stoppée, bien que l’on n’eût point découvert le meurtrier. Voilà que l’affaire rebondit, sous l’impulsion d’un homme d’action, condamné à mort sous Vichy. C’est qu’en effet, la maîtresse de Denoël, une femme au cœur d’airain, mais non de cœur pur, n’ignore rien de l’auteur ni des circonstances du drame, puisque celui-ci s’est déroulé sous ses yeux. Seulement, voilà : on chuchote que cette Walkyrie aurait un faible pour une personnalité en place. Ce serait la raison pour laquelle l’affaire aurait été mise en sommeil, une première fois. L’instruction qui vient d’être reprise dans le cabinet de M. Gollety pourra-t-elle être poursuivie sans entraves ? » (26).
Le 26 mars, la veuve et la maîtresse de Robert Denoël sont confrontées durant deux heures dans le cabinet du juge Gollety : aucune information n’a filtré.
Le 2 avril, Georges Gherra signe un dernier papier dans France-Soir : il contient des éléments nouveaux. L’inspecteur principal Vauge, chargé de la seconde enquête sur la mort de l’éditeur, a découvert « un document inconnu jusque là, lequel a été placé sous scellés ». Il s’agit d’un feuillet appartenant au livre de nuit d’un gardien au Ministère du Travail.
Le soir du 2 décembre 1945, ce gardien « avait consigné les allées et venues et les paroles échangées entre lui et deux personnes dont la présence au ministère, un dimanche soir, entre 21 h. 10 et 21 h. 30, lui avait paru insolite. Ce fait banal en apparence lui était apparu si important le lendemain qu’il avait arraché la feuille du livre de nuit ». Il en rendit compte à son chef qui lui conseilla de la garder. C’est cette feuille qu’il a remise « il y a quelques jours à l’inspecteur. Le contenu de celle-ci est gardé secret. »
Gherra passe en revue l’emploi du temps de l’éditeur au cours des heures qui ont précédé sa mort. A Saint-Brice où ils ont déjeuné et passé une partie de la journée, il est prévu que Denoël et Jeanne Loviton resteront pour dîner. En fin d’après-midi Denoël change d’avis et préfère rentrer. Entretemps, il a reçu un coup de téléphone ; de tous les témoins, un seul se souvient de ce fait : c’est le gouverneur; les autres ne peuvent l’affirmer.
Le couple quitte Saint-Brice vers 18 heures, dépose à Neuilly le ménage Baron, et rentre rue de l’Assomption. Denoël dîne rapidement, « au point qu’il néglige le dessert », dit la bonne. Vers 20 heures, au moment de partir, il a une longue conversation téléphonique. Il quitte la maison entre 20 h. 15 et 20 h. 30, pour se rendre à Montparnasse. Boulevard des Invalides, entre 21 h. 20 et 21 h. 23, il est touché par une balle de 11 mm. 45 tirée dans le dos à moins d’un mètre cinquante. La douille est retrouvée dans le gravier, à dix mètres en avant de la voiture.
C’est tout, mais Gherra conclut son article en présentant désormais Denoël « comme la victime d’un crime d’intérêt camouflé peut-être en crime crapuleux » (27).
Le 29 avril, une nouvelle confrontation a lieu dans le cabinet du juge d’instruction, « entourée de la plus grande discrétion », entre Mme Loviton, Mme Denoël, « et plusieurs personnalités importantes » [certains journaux écrivent : « plusieurs des intimes de l’éditeur »].
Le 30 avril, Express-Dimanche a consacré à l’affaire « un très long article », que je n’ai malheureusement pu retrouver. Il devait contenir des éléments importants puisque Mme Loviton a déposé une plainte en diffamation contre le journal et l’auteur, leur réclamant solidairement cinq millions de dommages-intérêts, pas moins. Un hebdomadaire qui évoque cet article le 5 mai, le commente ainsi: « Le moins qu’on en puisse dire est que M. Pierre Rolland-Lévy, magistrat et membre du Conseil supérieur de la magistrature, y est durement mis en cause. » On apprend encore que Mme Loviton a déposé deux autres plaintes en diffamation contre Juvénal et Le Cri de Paris, « qui avaient publié des articles de même inspiration ».
De la même époque doit dater un article anonyme intitulé : « Duel de femmes autour d’une maison d’édition », dans lequel un journaliste met en cause les « puissantes relations » de Jeanne Loviton : « ce procès risque d’éclabousser la femme d’un des plus importants personnages de la IVe République. Mme Loviton est une femme d’affaires expérimentée. Ses ennemis laissent entendre que c’est à l’influence d’une amie dont le mari occupe encore des fonctions gouvernementales, qu’elle doit d’avoir obtenu la levée de l’administration provisoire dont était dotée la maison Denoël. Force est de constater, ajoutent-ils, que, depuis l’assassinat de Robert Denoël, tous les procès qu’a engendrés sa disparition se sont terminés en queue de poisson, à commencer par l’enquête sur le crime lui-même. A la surprise générale, le procès intenté devant la Cour de justice contre les Editions Denoël est également classé, alors qu’on s’attendait à la confiscation. La Société Denoël constituait tout l’actif - 20 millions de francs environ - de la succession de l’éditeur.» (28).
Certains journaux, on le voit, n’hésitent pas à mettre en cause des personnalités en place. Pour un lecteur de l’époque, les périphrases dont on use pour désigner Suzanne Borel, la femme de Georges Bidault, sont transparentes. Pourtant ces articles seront les derniers du genre. La presse, avec un bel ensemble, va faire le silence absolu sur l’affaire, sauf pour annoncer les décisions de la Cour d’appel ou pour présenter de plates excuses à Mme Loviton.
Le 6 juillet 1950, le juge Goletty rend une seconde ordonnance de non-lieu dans l’affaire de l’assassinat de Robert Denoël, « aucune des nouvelles hypothèses émises n’ayant pu être confirmées ». Cécile Denoël a aussitôt annoncé qu’elle interjetait appel de cette décision.
Le 29 juillet, la Chambre des mises en accusation de la Cour d’Appel de Paris confirme l’ordonnance de non-lieu rendue le 6 juillet par le juge d’instruction.
Le 13 décembre, la 3e Chambre de la Cour d’Appel de Paris, « adoptant les conclusions de l’expert Caujolle, a déclaré régulière et valable la cession de parts consentie par Robert Denoël, de son vivant, aux Editions Domat-Montchrestien, dont Mme Jeanne Loviton est gérante, et a rejeté la demande de Mme Denoël. »
Le 22 et le 29 décembre 1950, Le Cri de Paris et Juvénal font amende honorable et reconnaissent que les échos qu’ils ont publiés précédemment « étaient basés sur des informations malignes dont l’inexactitude est aujourd’hui démontrée. Toujours objectifs et soucieux de vérité, nous sommes heureux de donner à Madame Loviton ce témoignage ».
La suite de l’histoire ne figure plus dans les journaux mais dans les documents officiels. La voici dans sa concision :
Le 10 janvier 1951, Cécile Robert-Denoël épouse Maurice Bruyneel.
Le 1er octobre, Mireille Fellous, fille adoptive de Jeanne Loviton, cède à la société Zed appartenant aux Editions Gallimard, les six parts qu’elle détient dans la Société des Editions Denoël. Le même jour, Georges Seguy cède à la même société les quatre parts qu’il possède dans la société Denoël.
Le 15 octobre, Jeanne Loviton cède à la même société 2 656 parts qu’elle détient dans la Société Denoël et, le lendemain, elle démissionne de ses fonctions de gérante.
Le 10 février 1952, Jeanne Loviton cède les 334 parts qui lui restent dans la Société Denoël : 250 parts à Jacques Lang, industriel parisien, 84 parts à Henri Lozé, autre industriel parisien.
*
On a présenté Robert Denoël comme un Rastignac liégeois. Rastignac se faisait des relations, Denoël des amis. Le but était le même, pas les moyens. Toute la carrière de l’éditeur est jalonnée d’amis plus ou moins fortunés auxquels il demande, à un moment ou à un autre, une assistance financière. Une lettre de Céline récemment publiée, féroce et pénétrante, définit ainsi le personnage : « Il n’a aucune parole, il ment comme il respire. Il crapulaille le plus ingénument du monde. C’est un Belge - c’est un jésuite, c’est un homosexuel c’est un éditeur. Cela fait beaucoup. Comme " refoulé " lui alors est servi. Ses démêlés avec Dabit sont fameux. Brouille d’amants, brouille d’argent, brouille littéraire - aussi quelle haine pour finir. Mais il a des qualités de jésuite, habile en affaires tenace, audacieux - et belge, déjà un peu germanique - plus efficace que les français. Mais cependant brouillon, gâcheur, aucun respect du boulot. Mais encore de l’enthousiasme et une certaine spiritualité ratichonne - Ses mains sont terribles regardez-les et quand il mange - une brute avide sans merci - un curieux mélange. Charmant avec ceci. » (29). Charmant aussi, Céline. Mais il donne quelques clefs magistrales pour comprendre ce curieux animal littéraire qu’était Denoël.
Jésuite certes, puisque étant passé par leurs mains dès l’âge de huit ans. Un peu cheval fou aussi, supportant mal les contraintes d’une famille dévote, et filant à Paris à la première occasion, à dix-huit ans. Et puis fin lettré, respectueux de la littérature plus que des littérateurs, et capable de très belles critiques, ce dont témoignait Max Jacob, qui lui écrivait en 1943 : « J’écrivais hier à Jean Milo : " Le seul critique littéraire que nous ayons c’est Denoël ; ses ‘ vient de paraître ’ sont des chefs-d’œuvre de justesse et de justice. Garde et conserve tes ‘ vient de paraître ’ et quand tu en auras cinq cents, publie-les en volume, avec le titre et une petite préface de... Edmond Jaloux - lequel pourra l’être, " jaloux ". » (30).
Enthousiaste, à n’en pas douter, au point de décider les écrivains non seulement à publier chez lui, mais aussi à régler la facture de l’imprimeur quand c’est nécessaire. Jean de Bosschère, son premier auteur, disait de lui qu’il était « l’un des rares éditeurs de Paris qui s’égalent aux auteurs qu’ils acceptent » (31). Céline, contrairement à ce qu’il dit à sa secrétaire en 1945, écrivait dix ans plus tard, après avoir rappelé les « odieux penchants » du personnage : « un côté le sauvait... il était passionné des Lettres... il reconnaissait vraiment le travail, il respectait les auteurs... » (32).
Eugène Dabit est plus nuancé : « C’est un homme qui ne manque pas de goût, de courage et d’adresse » (33). « Denoël promet des merveilles mais ne tient, ne peut tenir ses promesses » (34). Trois mois séparent ces deux lettres ; entretemps l’écrivain a reçu des offres alléchantes de Gallimard, et ceci explique cela. « Brouille d’argent, brouille littéraire », sûrement, « brouille d’amants » ? Je ne crois pas. Pas avec Dabit. Mais Céline veut voir en Denoël « un notoire enculeur - l’amant de Dabit ! et de Steel ! et de 20 autres ! » (35).
Il est vrai que le Liégeois, sur ce point précis, s’est rapidement émancipé, l’homosexualité masculine et féminine ne le gênant pas personnellement, et pouvant être utile à ses visées éditoriales.
Le témoignage de Philippe Hériat ne manque pas d’intérêt : « Robert Denoël était alors un vigoureux et beau garçon d’une intelligence vive et d’une forte puissance de travail. Il prétendait conquérir Paris et en " avaler " les plus grands éditeurs. Beau programme. Mais un certain désordre dans les idées, une conception assez fausse de la réussite, jointe à une méconnaissance toute provinciale de ce qu’est réellement Paris. » (36). Rémy Hétreau, un peintre que Denoël avait encouragé, restait sensible, trente ans plus tard, aux qualités de cet « homme souriant, grand, calme et puissant, qui savait faire confiance et donner confiance en soi » (37).
Arthur Pétronio n’a rien publié chez Denoël ; il l’a connu en 1920, alors que tous deux venaient de créer une éphémère revue littéraire liégeoise : « C’était un caractère vif et emporté, à l’ironie mordante, soit par vocation soit par amusement. Turbulent et expansif, coléreux et cordial, toujours en gésine de vastes programmes, adorant le langage cru au service de la vérité. Il avait un fond de bonté cachée sous un rire sardonique. Il avait un sang riche et était d’une nature furieusement indépendante. Il tenait en haute estime Bernanos, Giraudoux, Hellens, Cendrars, Larbaud, Montherlant, Drieu, Max Jacob, Fargue, Jouve, Valéry, Tzara et Delteil. » (38).
Contrairement à son frère Georges, Robert Poulet n’a connu Denoël qu’en 1930. Il lui a confié Handji que Grasset avait tardé à accepter. Cinquante ans plus tard, il le regrettait encore : avec Grasset, un prix littéraire était, croyait-il, assuré... D’où peut-être le portrait peu amène mais sagace qu’il a publié en juin 1979 : « La fourberie luisait dans un de ses yeux et l’enthousiasme dans l’autre. De fait, un fervent et un tricheur à la fois. La conjonction des deux signes était peut-être nécessaire pour que l’entreprise Denoël réussît. Il se lança dans le maquis parisien, où il se distingua tout de suite par ce qu’on pourrait appeler un excès d’entregent. Son adaptation au milieu - le 6e arrondissement, les parlotes de café, les combinaisons qui s’échafaudent lundi et s’effondrent mercredi - eut l’aspect d’un roman picaresque. Tout allait bien, tout allait mal; on se faisait des amis, dont la moitié étaient des tapeurs et des créanciers. Il échappait à tout par une suite de chances et de ruses, enveloppées d’une frénésie verbale très habilement dosée. L’aventurier, sans cesse sur le point de gagner la partie ou de sauter. Pas escroc du tout. N’aurait pas volé un centime à qui que ce fût. Simplement il se regardait comme le serviteur précieux de la chose littéraire et en déduisait que de sordides considérations moralistes ou législatives ne devaient pas embarrasser son zèle ni en offusquer l’inspiration [...] Un éditeur qui aimait l’argent. Mais pas plus que la littérature. »(39).
Jeannine Buissounouse, qui l’interviewe en 1938, note : « L’attitude de l’homme est parfaitement simple et cordiale, mais le regard ne vous appartient pas. Un joueur ? Vous l’aviez tout de suite deviné. » (40). Elsa Triolet : « Porteur de lunettes, épaules de débardeur, ce jeune Belge promettait de devenir un grand éditeur, tant il avait d’intérêt, de passion pour la littérature, tant il avait le goût du risque et des affaires. » (41). Paul Vialar : « J’ai connu Denoël triomphant. Je l’ai connu blessé. Jamais je ne l’ai connu déloyal, même s’il eut, par moments, quelque faiblesse qui s’explique par son amour forcené de son métier qu’il exerça avec génie. » (42). Un journaliste bruxellois va l’interviewer en 1942 : « Le physique de l’homme traduit le caractère. Tête romaine, figure romantique mais empreinte d’énergie. Les yeux observateurs, sous les lunettes, pétillent d’esprit. » (43). Georges Champeaux, qui l’a rencontré en 1936, le décrit ainsi : « De haute taille et large d’épaules, de lourdes lunettes d’écaille bien posées sur un nez hardi, il tient à la fois de Joseph Kessel et de Jacques Doriot. Un éditeur " d’attaque ". » (44).
Un homme qui en impose malgré sa petite trentaine, et dont René Barjavel (qui a quelques années de moins que lui) écrira en 1978, dans une formule définitive : « Denoël a été mon patron, mon maître et mon ami » (45). Robert Beckers, un Liégeois qui l’a connu dès 1922 et l’a suivi jusqu’à sa mort, le qualifie de « curieux, entreprenant, convaincant. Il avait non seulement du goût mais du flair [...] l’un des hommes les plus cultivés, les plus humains que j’ai connus » (46). Gilbert Dupé dont le roman publié par Denoël en 1939, La Foire aux femmes, avait obtenu un beau succès, conservait le souvenir d’un homme « aimable, sérieux, d’un éditeur consciencieux et compétent: je n’en ai pas rencontré de cette valeur par la suite » (47). Gerhard Heller, l’homme de la Propaganda Staffel, m’assurait en 1979 qu’il « avait toujours eu beaucoup d’estime pour lui, et admiré son talent d’éditeur, son courage » (48). Carlo Rim, qui apréciait sa volonté de vaincre, son caractère ambitieux, son culot et ses folles imprudences, estimait que Denoël était un personnage « hors du commun qu’on ne doit juger qu’avec le recul » (49).
Cinquante années de recul permettent de vérifier que Robert Denoël s’est imposé en deux ans dans l’édition parisienne, qu’il s’est hissé au rang des plus grands et y est demeuré. Il a réussi ce tour de force dans le seul domaine littéraire, et à une époque où beaucoup d’éditeurs luttaient pour leur survie. Neuf prix Renaudot lui ont été attribués de 1931 à 1939, ses découvertes éditoriales ont marqué les années trente, et il n’a pas été remplacé.
*
Cet « éditeur d’attaque » avait, au moins, deux points faibles, qui ont vraisemblablement causé sa perte : l’argent et les femmes. Robert Denoël était un jouisseur forcené, doté d’un fort tempérament. Mais deux femmes seulement me paraissent avoir pesé réellement sur sa destinée.
Cécile Brusson est née à Liège dans une famille haute en couleurs puisque sa mère était lutteuse de foire. Elvire Herd, c’est son nom, avait pas mal bourlingué quand elle rencontra Walthère Brusson, un garçon-boucher qui reconnut sa fille née le 19 septembre 1906. Deux ans plus tard, au cours d’une tournée Elvire s’était amourachée d’un lutteur noir et l’avait suivi en Afrique du Sud. L’affaire tourna court, et elle dut s’engager dans une brasserie pour subsister. C’est là qu’elle rencontra un ingénieur anglais, Walthère Ritchie-Fallon, qui l’épousa en 1914 et dont elle eut un fils en 1916. Est-ce que la petite Cécile vécut à Cap Town durant ces années ? L’état-civil liégeois dit le contraire, mais Cécile raconta par la suite qu’elle avait connu une jeunesse dorée en Afrique du Sud, ce dont témoignait l’accent anglais qu’elle en avait ramené. Ce qui est sûr c’est que sa mère quitta Ritchie-Fallon en juin 1923 et revint définitivement à Liège, où elle ouvrit un café populaire. Cécile, qui était rousse et avait d’admirables yeux verts, aidait sa mère au comptoir. Est-ce dans ce café que Denoël l’a rencontrée ? Cécile Brusson assurait que c’était au cours d’un bal costumé, le 8 mars 1925 (50). L’austère famille bourgeoise de Robert Denoël ne voulut pas entendre parler de cette fille de saltimbanques, comme on peut s’y attendre ; les jeunes gens se revoient en cachette, puis Cécile rejoint Robert à Paris en octobre 1927 : « Je vais avoir à côté de moi une femme ou plutôt une enfant. Je devrai être à la fois son amant, son tuteur et un peu son éducateur. Elle arrive toute neuve, toute fraîche en dépit de quatre années de vie dans le milieu le plus détestable. [...] La vie, pour elle, ressemble surtout à une grande partie de camping. De temps en temps, il faut travailler mais tout s’accomplit dans les rires et le bonheur... Jusqu’à l’âge de 16 ans sa vie a ressemblé à cela en effet » (51).
Les débuts des « deux Noël », comme les appelait Carlo Rim, vont avoir une tout autre coloration : « Je suis toujours à la veille d’être saisi, de voir mon électricité coupée. Je reçois des lettres de créanciers, des pneumatiques menaçants, des sommations... », écrit-il en janvier 1928 à Champigny, malgré quoi Cécile s’habitue à cette vie précaire : « Ma femme, habituée à l’abondance, à l’argent, ne songe même pas à s’étonner de la situation. Elle vit près de moi et cela lui suffit pour respirer le bonheur. » Le 2 octobre 1928, Cécile et Robert se marient ; Robert Beckers, l’ami liégeois, est leur témoin. Leur unique enfant, Robert, naîtra le 14 mars 1933. Cette maternité difficile aboutira à une hystérectomie, deux ans plus tard. A partir de ce moment, Cécile cessera pratiquement de travailler rue Amélie, et se transformera en femme d’intérieur, recevant les relations de son mari dans le bel appartement qu’ils ont loué près du Champ de Mars.
Denoël, qui avait un coeur d’artichaut, a toujours accumulé les aventures. « Il avait, sur ce point, la moralité d’un pacha ou bien d’un roi de France : une épouse honorée, aimée et mère des enfants légitimes, une favorite interchangeable et de nombreuses houris d’occasion...» (52). Cécile supporta les incartades de son mari jusqu’en 1943. Ensuite les choses se gâtèrent tout à fait car sa nouvelle maîtresse n’était pas la première venue, et l’éditeur en paraissait fort amoureux. La séparation eut lieu en août 1944, ensuite le divorce fut décidé.
Jeanne Loviton dite Jean Voilier était une de ces femmes d’exception qu’on appelle égéries. Outre Pierre Frondaie, elle avait connu les faveurs de Claude Aveline, Maurice Garçon, Jean Giraudoux, Robert de Billy, d’autres encore, notamment des personnalités politiques et de hauts magistrats. Elle faisait partie du Tout Paris, avait de puissantes relations, un appartement à Auteuil, un château dans le Lot, et pas mal d’argent.
Denoël l’avait rencontrée en janvier 1943 à l’endroit même où il passa sa dernière journée : chez Mme Henri Jeanson, à la Tour de Nézant. Elle était alors la maîtresse de Paul Valéry, ce qui compliquait un peu les choses. Les lettres que l’éditeur lui a envoyées à partir de cette époque et jusqu’à septembre 1945 ne laissent aucun doute sur ses sentiments :
« C’est une douce merveille de vous aimer. Je sors de chez vous un peu titubant, la tête à l’envers, les mains chaudes de vous avoir touchée, frémissantes encore, la bouche meurtrie un peu d’avoir baisé la vôtre, mais avide encore et qui se tend vers votre cou, vers vos lèvres. Je ne quitte pas vos bras [...] vous me dites “ Chéri ” et je me sens fondre » [avril 1943]. Dans des termes fort proches, Valéry lui avait écrit son attachement: « J’aimerais tant que tu me donnes la sensation que je t’apporte quelque chose. Je ne veux pas tout recevoir de toi, de tes yeux, de ta voix, de ta bouche et de tout, de ta nature si riche et si nombreuse. » [juin 1943].
Denoël était plus exigeant que le vieil écrivain ; le 15 août 1943 il terminait une lettre ainsi : « Dis-moi que je suis toujours dans ton cœur, que tu as renvoyé la cohorte trépignante qui t’entoure et que tu es bien décidée à me donner la première place dans la fameuse " organisation ". » Neuf jours plus tôt, Valéry avait écrit à Jeanne qu’il espérait que son séjour « au castel [de Béduer] pourra s’organiser. J’espère que nous serons bien, que nous serons seuls ». Rien à voir avec une cohorte trépignante, et Valéry devait tout ignorer de cette fameuse organisation. Nous aussi, malheureusement.
Jeanne Loviton fera finalement son choix, et Denoël restera seul en lice. On a dit que cette décision avait précipité la mort du poète, le 20 juillet 1945.
Pourtant Denoël s’est montré très compréhensif et a toujours respecté les amours de son égérie. Le lendemain de la mort de Valéry, il la console en ces termes : « je pensais que tu avais apporté à ton ami ses dernières joies. Pense à tout ce qui est perdu, mais pense aussi à tout ce qui a été créé entre vous, pense à ses tourments, mais pense surtout à l’aiguillon que tu as été pour sa pensée et pour son coeur ». Après la mort de Giraudoux, le 31 janvier 1944, il lui avait déjà écrit : « je suis tout triste de ton chagrin. J’aurais voulu être près de toi, que tu reposes sur mon épaule, tes pleurs se seraient doucement taris, j’aurais endormi ta peine. »
Ce qui le tracasse le plus, en réalité, ce sont ses affaires. Depuis son départ forcé rue Amélie, il se sent « incapable, par situation, par impossibilité matérielle, de résoudre les problèmes à ta place. Mais je vois maintenant poindre le jour où tout cela va changer. Dès octobre, ta vie va prendre une autre tournure parce que je pourrai y jouer un rôle vraiment actif. Mes petites affaires seront sorties de la période préparatoire et seront en plein rendement. Quant aux tiennes, je les conjuguerai avec les miennes pour une part tout au moins et tu commenceras tout doucement à t’en éloigner pour les quitter ou, en tout cas, en secouer la servitude dans le courant 1946. A ce moment j’aurai repris un rôle actif au grand ou demi-jour, peu importe, mais le bénéfice [8 juillet 1945 ; photocopie interrompue] ».
Le 29 juillet 1945, alors que sa maîtresse se repose à Divonne, il lui demande de ne pas se soucier « de la question argent. J’ai tout réglé ici. J’emporte avec moi assez d’argent pour notre séjour. Nous règlerons ces comptes à la rentrée. Et à partir de novembre, je crois bien que la question d’argent ne se posera plus du tout entre nous. »
Durant ces temps difficiles, son fils est resté à la campagne ; de retour à Paris au cours de l’été, il voit de temps à autre son père, qui écrit à sa maîtresse : « Nous effleurons le sujet famille sans y entrer encore. Mais cela vient. Au mois de septembre ce sera chose faite ».
Les Editions Denoël obtiennent en juillet 1945 le prix Goncourt, pour la première fois, avec un roman d’Elsa Triolet. « Les Goncourt ont fait coup triple », écrit Léautaud dans son Journal, « la dame Triolet est russe, juive et communiste. C’est un prix cousu de fil rouge ». Vingt mille exemplaires ont été vendus : « par conséquent», écrit Denoël, « dirigée par des feignants la maison réalisera au moins 15 millions de chiffre cette année. C’est dire que quand tout l’orchestre fonctionnera, on l’entendra de loin. Cela me donne un vif plaisir, car je pense que dès l’heureux moment venu, tu pourras envisager notre avenir avec tranquillité. Je laisserai volontiers quelques plumes à l’opéra pour reprendre au plus vite le contrôle de mon petit théâtre personnel. » (18 juillet 1945).
Ce sont là tous les éléments que j’ai pu tirer des lettres, soigneusement caviardées, de Robert Denoël à Jeanne Loviton, qui m’ont été confiées parce qu’elles prouvaient l’attachement de l’éditeur à sa maîtresse. A l’opposé je n’ai pu obtenir communication de la moindre lettre de cette époque à sa femme, mais peut-être n’existent-elles pas.
Que faire d’un tel dossier ? Ecouter les témoins, c’est entendre la voix de la maîtresse ou de la veuve, car chacun a pris parti pour l’une ou pour l’autre, suivant ses intérêts. Disons-le, les partisans de la veuve - et Cécile Brusson n’avait, en somme, à faire valoir que cette qualité - sont rares. Dans la jungle littéraire c’est fort mince. Une maîtresse intrigante mais bien en cour emporte tous les suffrages.
*
L’affaire serait banale si Denoël n’avait mêlé passion et affaires. Madame Loviton, juriste de formation, était une affairiste chevronnée ; si l’éditeur a compté sur elle pour renflouer sa maison, il n’est pas douteux qu’elle aura pris de sérieuses options sur les avoirs de sa Société. La cession de parts en blanc n’a rien de surprenant, Denoël était coutumier des blanc-seings. Tout se complique quand, après sa mort, Cécile Denoël n’a d’autre ressource que d’attaquer la validité de cette cession et affirmer que son mari avait l’intention de rentrer chez lui, ce qui déclenche des procès en cascade et met en lumière le rôle trouble de sa rivale qui, selon la plupart des commentateurs de l’époque, va faire jouer ses relations pour obtenir gain de cause.
Le poids de ces interventions politiques a sans doute été décisif. La presse note que Madame Loviton gagne ses procès quand Georges Bidault est aux affaires, et qu’elle les perd quand il les quitte. Si un hebdomadaire met en cause ses relations, elle n’hésite pas à l’assigner en réclamant des dommages astronomiques, ce qui dissuade les autres. Dans la maison d’édition où elle règne sans partage à partir de février 1946, et où Cécile Denoël n’a jamais été la « patronne », la plupart des membres du personnel se rallient à la nouvelle direction. Seul l’irascible Auguste Picq, directeur commercial depuis juillet 1944, décide d’affronter Jeanne Loviton (sans pour autant prendre parti pour Madame Denoël) : il est promptement licencié, le 31 janvier 1948.
Les avocats de Madame Loviton ne manquent jamais de rappeler avec quel courage elle a repris une maison d’édition exsangue et tenu bon la barre pendant cinq ans. Il faut bien constater qu’à peine les derniers procès terminés, elle cède la société à Gaston Gallimard après avoir racheté leurs parts aux Domaines.
A la fin de sa vie, Cécile Denoël m’écrivait que sa rivale n’avait peut-être été qu’un rouage dans une organisation politico-affairiste, qui se servait de son mari pour couvrir des opérations douteuses. L’éditeur en savait trop, c’était son silence qu’on voulait, sa maison d’édition n’étant que le prix accordé à une forfaiture. Elle évoquait des voyages en Suisse de son mari, accompagné d’une dame qui se disait sa femme, des fournitures de papier exceptionnelles en un temps où le papier n’était accordé qu’aux amis des amis, des capitaux qui lui passaient entre les mains pour aller remplir d’autres poches ou des comptes en banque numérotés... « Vérifiez bien », m’écrivait un jour Robert Beckers, « tout ce que vous dit Cécile. Elle a toujours, disons un peu " arrangé " la vérité ».
Pourtant, d’autres qu’elle ont échafaudé des romans. René Barjavel avait rédigé, disait-il, un récit intitulé « Les sept morts de Robert Denoël », qui passait en revue, sur le mode romanesque, les différentes versions de ce crime non élucidé. Après la mort de l’éditeur, l’écrivain Barjavel aurait assuré à Cécile Denoël qu’il n’écrirait « plus rien jusqu’à ce qu’elle ait repris en mains la maison ». C’est le même Barjavel, chef de fabrication rue Amélie, qui allait identifier, en 1950, l’écriture de son « patron et ami » figurant sur l’acte de cession de ses parts aux Editions Domat-Montchrestien - écriture contestée par sa veuve depuis quatre ans. Mais d’autres virages byzantins ont eu lieu dans le cabinet du juge d’instruction.
A la Libération, Bernard Steele courait, dit-on, les cafés à la mode vêtu d’un uniforme de colonel de l’armée américaine, mais il ne rêvait nullement quand il déclara à Robert Beckers que « Denoël était mort comme il avait vécu, en gangster », avant que l’autre ne le mette à la porte. Steele avait revu Denoël plusieurs fois au cours des semaines qui ont précédé sa mort et il était probablement au courant de certaines de ses affaires.
Paul Vialar, qui, avec Georges Bidault, avait « accompagné de Gaulle descendant les Champs-Elysées », et occupé l’appartement de Denoël « pour qu’il ne fût pas occupé comme il le craignait par quelque résistant au petit pied », avait à l’époque demandé à ses amis résistants si le meurtre de l’éditeur ne serait pas une exécution : « Tous ont haussé les épaules ». Pour lui, cette mort ne doit rien aux idéologies ; Denoël « a été abattu par un déserteur de l’armée américaine ». A ses yeux, il n’est pas d’autre version plausible. Une lettre que lui adressait Denoël le 18 juillet 1945 ne lui laisse pas le moindre doute sur les sentiments et les projets de l’éditeur : « J’ai gagné la difficile partie ou plutôt Jeanne l’a gagnée pour moi. Il ne s’agit plus que d’attendre le vent favorable pour faire voguer le bateau. Et j’ai l’impression qu’avec l’escorte du Voilier, il va faire une course fastueuse. » D’autre part il avait vu Denoël quarante-huit heures avant sa mort, rue de l’Assomption, où on avait parlé de se rendre le dimanche soir au spectacle d’Agnès Capri. Ce jour-là les deux hommes s’étaient promenés dans Paris à bord de la vieille voiture de l’éditeur, « dont l’un des pneus avait rendu l’âme et que nous avions dû réparer. » Paul Vialar en rajoute peut-être un peu, mais une partie de son œuvre a été publiée aux Editions Domat-Montchrestien, et Jeanne Loviton est une de ses amies de jeunesse.
Maximilien Vox, nommé administrateur provisoire des Editions Denoël le 20 octobre 1944, raconte dans ses mémoires (inédits) que cette nomination lui avait été quasiment imposée : « L’ordre venait de Gabriel Le Roy-Ladurie en personne, qui tenait par-dessus tout à savoir en bonnes mains les intérêts (légitimes) d’une personne de son entourage - qui se trouvait être la meilleure et plus chère amie de Robert Denoël. » Je ne crois pas que Vox se trompe. Le Roy-Ladurie était le fondé de pouvoir de la banque Worms, auprès de laquelle Denoël espérait obtenir un prêt important, mais je doute que Jeanne Loviton ait investi le moindre argent dans l’affaire Denoël en 1944. Le temps impose souvent à la mémoire certains télescopages, d’autant que l’imprimeur continue ainsi : « Mon erreur fut d’imaginer que l’on puisse, dans une pièce policière, jouer à la fois le rôle du témoin et celui du juge d’instruction... »
*
J’en étais là dans mes recherches, il y a bien des années, quand je m’avisai que j’ignorais où se trouvait le corps de Robert Denoël. En dix ans d’investigations, il ne m’était pas venu à l’esprit de poser cette question-là, à qui que ce fût, preuve peut-être que l’œuvre a éclipsé l’homme et que son existence terrestre n’a plus guère de sens, sauf pour ses proches.
Justement sa veuve venait de mourir, le 20 janvier 1980, et son mari m’écrivait que Cécile reposait dans « un paysage qu’elle aime, presqu’en pleine campagne, dans un très petit cimetière à flanc de colline ; elle a, comme elle le souhaitait, la tombe la plus simple qui soit ».
Quand j’évoquai celle de Denoël, je reçus cette réponse de Maurice Bruyneel : « Aussi bizarre que cela puisse sembler, nous ignorons, Robert junior et moi, où elle se trouve exactement. Pour nous le corps physique n’a qu’une importance très secondaire lorsque l’âme l’a quitté. Il est possible que Denoël soit enterré au cimetière Montparnasse. » Dans un post-scriptum, il me faisait savoir qu’il venait de retrouver une lettre du service municipal des pompes funèbres de Paris, datée du 1er avril 1953, adressée à Mme Denoël, lui apprenant qu’elle pouvait acheter une concession dans le cimetière Montparnasse : « Je ne sais plus ce que nous avons fait, mais je pense qu’en huit ans, nous lui avions sans doute trouvé une autre place que le caveau provisoire ».
Je m’informai au cimetière du Sud-Montparnasse. Robert Denoël était resté dans son tombeau provisoire jusqu’au 10 avril 1973, date à laquelle, « sur décision administrative », ses « restes ont été transférés dans une tranchée gratuite au cimetière de Thiais ». Le fonctionnaire me confirmait dans la même lettre que « les mises en demeure adressées au signataire de la demande d’inhumation sont restées sans effet ».
Il n’y avait rien de commun entre la mort de Cécile Denoël, sa petite tombe discrète à flanc de colline, et le charriage, sept ans plus tôt, des « restes » de son mari dans une fosse commune de Thiais mais, je ne sais comment, le sentiment que j’avais été quelque peu empaumé s’installa dans mon esprit.
Jeanne Loviton ignorait, elle aussi, où se trouvait la tombe de son amant. Je le lui appris et j’eus droit pour le coup à une grande scène de détresse rétrospective. C’en fut trop. Je flanquai tout ce dossier dans un tiroir. J’étais un provincial, je le suis resté.
*
Quand on prend connaissance des éléments de cette curieuse affaire (53), on ne peut s’empêcher de se poser des questions que le jugement de 1950 a occultées. Céline, par exemple, n’y va pas par quatre chemins dans sa correspondance ; il voit en Jeanne Loviton « une probable assassine » (54), « jupitérienne en certains milieux troubles » (55), et ces milieux ne peuvent être que juifs : « j’ai l’idée que ce sont eux avec la mère Voilier complice qui ont buté Bobby. Très dangereux gang » (56). Il ne manque jamais d’évoquer « ses talents archi connus de lesbienne consacrée par le Tout Paris » (57), pourtant il ne paraît pas avoir entendu parler de Jeanne Loviton avant la mort de son éditeur, ce qui ne l’a pas empêché de l’insulter dans ses lettres d’exil et jusque dans ses romans où elle figure sous les noms de « mère Cascamèche », « Marquise Fualdès », ou « Madame Thérèse Amirale, tôlière, fée maligne aux Invalignes » (58).
« Aux Invalignes », tout repose sur son seul témoignage, validé par l’ordonnance de non-lieu rendue en juillet 1950. Proposer une autre version, c’est le remettre en cause. En privé, Auguste Picq jurait ses grands dieux que l’assassinat était prémédité, et que Denoël connaissait fort bien ses agresseurs puisqu’ils se trouvaient, disait-il, dans sa Peugeot. Et ce ministère duTravail, où circulent un dimanche soir deux « employés » qui découvrent l’assassiné... Picq « l’aspic », comme l’appelait Céline, était peut-être de parti pris.
J’ai pourtant entendu d’autres proches de l’éditeur, qui avaient leur idée sur ce meurtre, notamment à propos d’une porte dérobée dans le jardin du ministère du Travail, qui se trouve sur le boulevard des Invalides, et qui aurait permis aux agresseurs de s’éclipser. Des noms m’ont été suggérés, qui ne sont pas inconnus du public. Je possède des plans, des photographies de cet endroit... Simenon, j’en suis persuadé, en aurait tiré un roman palpitant. Pour ma part, j’ai renoncé à démêler les fils peu catholiques de cette ténébreuse affaire. C’est peut-être le Diable qui est derrière.
Je me suis interrogé longtemps sur l’héritage de Denoël. Qu’aura gagné Mme Loviton, à part le sobriquet de marquise Fualdès, qui lui restera ? Elle a racheté les parts de l’éditeur à leur valeur nominale, 500 F, pour les revendre cinq ans plus tard deux fois plus cher, mais la monnaie française n’a cessé de perdre de sa valeur entre 1945 et 1951, et on ignore à quel prix elle a racheté leurs parts aux Domaines et à Yvonne Dornès. Les 2 990 parts qu’elle détenait en 1951 ont été rachetées 2 990 000 F. Combien lui auront coûté tous ses procès ?
*
Tout cela nous ramène à un anniversaire que personne ne songe à commémorer. La biographie de cet éditeur hors normes reste à écrire. Personnellement, j’ai assez donné. A vingt ans j’ai suivi à la trace un homme qui m’échappera toujours, je le sais bien. Parfois les mots de Bernard Steele me reviennent, qui disait que Robert Denoël était mort comme il avait vécu, « en gangster ». C’est sans doute ce sentiment qui prévaut dans son imposante famille liégeoise, laquelle, aujourd’hui encore, veut ignorer cet aventurier qui perpétuera son nom bien plus sûrement que les notables qui la composent.
Il me passe encore des rages, je l’avoue, à propos de personnes que j’ai côtoyées durant ces années-là. Des indélicatesses ont été commises. J’ai des amitiés mortes sur les bras. Le temps s’en charge. Ma vie est ailleurs.
De temps à autre, je me demande, et ne cherche jamais à connaître la réponse : quelle pièce proposait Agnès Capri dans son théâtre de la rue de la Gaîté à Montparnasse, le dimanche 2 décembre 1945 au soir ?
Notes
1. Lettre à Marie Canavaggia [14 décembre 1945], publiée pour la première fois dans L’Herne en 1963 .
2. Lettre à Champigny, avril 1935.
3. Témoignage inédit, novembre 1979.
4. Lettre à Champigny, décembre 1936.
5. Interview de Bernard Steele à l’hebdomadaire suisse Construire, septembre 1971.
6. Lettre à sa femme, septembre 1939.
7. Pascal Fouché, L’Edition française sous l’Occupation. Paris, BLFC, 1987, I, p. 33.
8. Lettre à Jean Rogissart, octobre 1940.
9. Cette petite société au capital de 25 000 F existait en fait depuis avril 1937 sous le nom « La Publicité vivante », créée en participation avec son ami Robert Beauzemont. Depuis novembre 1940, Denoël en est le seul actionnaire réel, puisque le second partenaire, Guillaume Ritchie-Fallon, est le demi-frère de sa femme. Il ne fait donc qu’en modifier le nom mais l’apport de numéraire de la nouvelle associée est bien réel : c’est elle qui va renflouer le compte des N.E.F. (100 000 F en bons d’armement), notamment pour mettre en chantier Les Beaux Draps.
10. Lettre à Jean Rogissart, 20 septembre 1944.
11. Fouché, op. cit., I, p. 218.
12. Lettre de Paul Marion au ministre des Finances, Yves Bouthillier, 17 mars 1942 [reproduite dans: Fouché, op. cit., I, p. 219]. On voit l’importance rétrospective de l’avis défavorable du secrétaire général à l’Information : si Denoël avait pu obtenir d’une banque française l’argent dont il avait besoin, nul doute qu’il ne se serait pas trouvé à la Libération dans d’aussi mauvais draps. Cette attitude hostile est d’autant plus incompréhensible que Marion n’ignore pas que Denoël est l’éditeur de Céline puisque, le 8 juin 1942, il informe la Commission de contrôle du papier d’édition qu’il désire que « la réédition chez Denoël des œuvres de M. Louis-Ferdinand Céline soit facilitée dans toute la mesure du possible étant donné la valeur et l’intérêt de ces ouvrages » [cf. P.-E. Robert, Céline & les Editions Denoël. Paris, IMEC, 1991, p. 177].
13. Acte de cession enregistré au Tribunal de commerce le 13 juin 1944. Je n’en ai pas obtenu copie ; une lettre de Maurice Bruyneel, datée du 6 mars 1976, donne les précisions suivantes : 67% des parts sont attribuées à M. Bruyneel, 33 % à Maurice Percheron. « Bien entendu », dit Bruyneel, « nous n’avions pas mis un centime dans l’affaire.»
14. Actes des 14 novembre 1944 et 10 juillet 1945.
15. L’acte de constitution de la nouvelle société, daté du 1er juin 1944, indique que les deux frères ont apporté 500 000 F en vue de l’acquisition de l’affaire. Pour l’anecdote « Les Trois Magots » existaient toujours à la même adresse en 1969.
16. Actes sous seing privé du 30 septembre et du 5 octobre 1944.
17. Les exclus sont : Baudinière, Jacques Bernard, Grasset, Henry Jamet, Jean de La Hire, et Sorlot. Le cas de Denoël n’a pu être examiné « puisque, n’étant pas Français, il ne faisait pas partie du syndicat », ce qui est une erreur puisqu’il y a été admis en 1932.
18. Cet éditeur avait pourtant envoyé, le 6 mars 1945, une lettre au ministre de l’Information dans laquelle il déclarait qu’il serait « aussi préjudiciable, pour le prestige français, de voir subsister certains noms de firmes comme " Editions Denoël " que de laisser par exemple subsister le nom de certains journaux comme Gringoire ou Le Pilori même avec une direction nouvelle » (Fouché. op. cit.). Il est vrai que Mme Loviton était capable de provoquer d’étonnants retournements.
19. Lettre à Jean Proal, 3 août 1945.
20. Jeanne Loviton et Yvonne Dornès, majoritaire dans la société, alternaient à la gérance des Editions Domat-Montchrestien.
21. Abel Manouvriez. « La Volonté du mort », Paroles Françaises, 18 novembre 1949.
22. ***. « Quatre ans après, le mystère de la mort de l’éditeur Robert Denoël sera-t-il un jour éclairci ? », Détective, novembre 1949 ? J’ignore si l’article a réellement paru: Maurice Bruyneel ne m’en a transmis qu’une copie dactylographiée.
23. Dans un écho du 3 décembre 1949 intitulé « Un secret bien gardé », Combat avait déjà annoncé que la Préfecture de police « possédait un dossier gardé secret et susceptible de faire rebondir l’affaire sur le plan de la justice répressive », ce qui lui avait valu une lettre de Mme Loviton où elle annonçait qu’à la suite de cet article, elle avait chargé son avocat de saisir le Procureur général : « Celui-ci a répondu que M. le Préfet de police avait fait connaître au Parquet de la Seine que ses services ne possèdent aucun document inédit et n’ont appris aucun élément nouveau à propos du meurtre de Robert Denoël » (Combat, 7 janvier 1950).
24. ***. « L’Affaire Denoël restera l’énigme n° 1 du demi-siècle », La Presse, 22 janvier 1950.
25. Le Cri de Paris, 28 janvier 1950.
26. ***. « L’Assassinat de Denoël », Juvénal, 24 mars 1950.
27. Georges Gherra. « Une Enigme digne d’un roman policier : l’éditeur Denoël, assassiné le 2 décembre 1945, aurait été victime d’un crime d’intérêt », France-Soir, 2 avril 1950.
28. Journal ou hebdomadaire non identifié.
29. Lettre des 27 et 28 octobre 1945, in : Lettres à Marie Canavaggia. Tusson, Ed. du Lérot, 1994, II, p. 242.
30. Lettre de Max Jacob à Robert Denoël, 31 décembre 1943 (collection Jeanne Loviton).
31. Jean de Bosschère. Portraits d’amis. Paris, Ed. Sagesse, 1935.
32. D’un château l’autre. Gallimard, 1957, p. 15.
33. Lettre à Roger Martin du Gard, 13 octobre 1929 (collection Pierre Bardel).
34. Lettre au même, 5 février 1930 (idem).
35. Lettre à Marie Canavaggia, 10 mai 1948 ; op. cit., II, p. 106.
36. Philippe Hériat. Retour sur mes pas. Namur, Wesmael-Charlier, 1959.
37. Témoignage écrit, octobre 1979. Il a illustré en 1944 L’Hôtel du Nord.
38. Témoignage écrit, mai 1976.
39. Robert Poulet. « Robert Denoël », Ecrits de Paris, juin 1979.
40. Jeannine Bouissounouse. « Comment travaillent nos éditeurs : chez Robert Denoël ». Toute l’Edition, 19 février 1938.
41. Elsa Triolet. Préface au Cheval blanc, Gallimard, collection « Folio », 1966.
42. Paul Vialar. Témoignage écrit, janvier 1980.
43. ***. « Robert Denoël, découvreur de talents et lanceur de chefs-d’œuvre », Voilà, 27 novembre 1942.
44. Georges Champeaux. « M. Denoël », Les Annales politiques et littéraires, 25 juillet 1936.
45. Lettre à l’auteur, 25 avril 1978.
46. Lettre à l’auteur, 11 mai 1978 et 27 juillet 1979.
47. Lettre à l’auteur, 26 mai 1980.
48. Lettre à l’auteur, 25 octobre 1979.
49. Lettre à l’auteur, 18 novembre 1979.
50. Cette date, qui ne faisait aucun doute pour Cécile, est contredite par plusieurs lettres de Robert Denoël, qui écrivait en juin 1927 à Mélot du Dy : « J’ai revu à Liège une jeune fille que j’aimais depuis quatre ans », et à Victor Moremans, en octobre 1927 : « Elle s’appelle Cécile, nous nous aimons depuis quatre ans ». Denoël a publié, à partir de septembre 1924, plusieurs contes sous le pseudonyme de Robert Marin, en hommage au champion de lutte liégeois Constant-le-Marin, l’oncle de Cécile.
51. Lettre à Champigny, août 1927.
52. Souvenirs de Cécile Brusson, dans : Albert Morys [Maurice Bruyneel]. « Cécile ou une vie toute simple », récit inédit (1982).
53. Toutes les pièces que j’ai rassemblées sur l’affaire Denoël ont été déposées en 1982 à la défunte BLFC, place Jussieu, Paris Ve, où elles étaient disponibles sur simple demande. Je suppose qu’elles ont été transférées depuis à l’IMEC, rue de Lille, Paris VIIe, puisqu’un dénommé Pierre-Edmond Robert les a utilisées, sans le dire, dans son essai paru en 1991 : Céline & les Editions Denoël.
54. Lettre à Marie Canavaggia, 25 [septembre 1947], op. cit., I, p. 429.
55. Idem, 25 [septembre 1947], op. cit., I, p. 431.
56. Idem, [21 mars 1948], op. cit., II, p. 70.
57. Idem, 6 [janvier 1948], op. cit., II, p. 12.
58. On ne devrait, avec Céline, jamais sous-estimer certaines maladresses qui peuvent le heurter définitivement chez un correspondant. Ainsi Mme Loviton, qui lui écrit le 14 janvier 1948 qu’elle voit en un curieux tableau « les Editions Denoël, tête basse, menottes aux poignets, et, dans le dos, frappé en gros caractères sur leurs vestes de prisonniers : votre nom » [L’Année Céline 1990. Ed. du Lérot, 1991 p. 25], a toutes les chances de se rappeler à son plus mauvais souvenir. Cette lettre ne manquait pourtant pas de bon sens, notamment pour ce que Denoël avait dû subir à cause de Céline et de Rebatet, mais la gaffe était commise, irrémédiablement.
2002
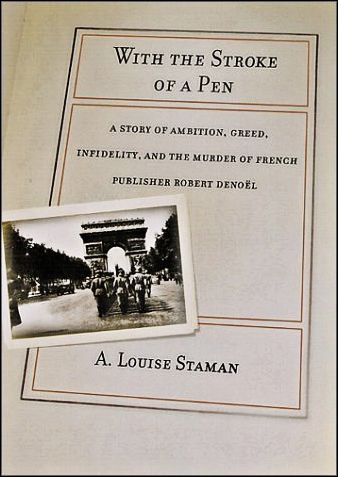
© La biographie romancée de Robert Denoël par Louise Staman, publiée par St. Martin's Press à New York, est parue discrètement en novembre. C'est un peu par hasard que j'en ai appris l'existence grâce à l'Internet. J'ai fait ensuite connaissance avec l'auteur et distribué son livre dans ma librairie liégeoise. C'était, je crois, les premiers exemplaires qui circulaient en Europe. J'ai rendu compte du livre dans Le Bulletin célinien n° 248 de décembre 2003 :
L'Assassinat de Robert Denoël
Le dimanche 2 décembre 1945 l’éditeur Robert Denoël, qui se rendait au théâtre avec Jeanne Loviton, fut assassiné alors qu’il s’apprêtait à changer la roue de sa voiture. C’est durant l’absence de son amie, qui s’en était allé demander un taxi au commissariat le plus proche, qu’il fut abattu d’une balle de fort calibre, dans le dos, par quelque rôdeur. Crime crapuleux, sans témoin, devant le ministère du Travail, à deux pas de l’esplanade des Invalides.
Ce compte rendu stéréotypé, qu’on peut lire depuis cinquante ans sous la plume de tous les auteurs qui ont eu à évoquer le meurtre d’un éditeur prestigieux, a vécu. On ne pourra plus parler de crime fortuit après avoir lu l’ouvrage de Louise Staman, qui a eu accès à un dossier hautement intéressant : celui que les Archives de la ville de Paris possèdent sur l’affaire Denoël.
Comme il s’agit d’une biographie romancée, l’auteur s’autorise à interpréter les textes officiels comme elle l’entend, et il arrive, par exemple, que telle scène imaginaire n’a d’autre fonction que de restituer des propos figurant dans certains procès verbaux de la police judiciaire. On peut trouver le procédé irritant mais il m’a paru que cette « licence poétique » était bien utile pour éclairer les arrière-plans et les recoins de cette affaire très complexe, qui se termine tragiquement pour son principal protagoniste.
Dans ses lettres du Danemark Céline, qui a suivi attentivement l’affaire dans la presse et recueilli chez ses correspondants parisiens maintes informations, parle de Jeanne Loviton, l’héritière de l’éditeur, comme d’une « probable assassine ». Et il est vrai que cette femme y a joué un rôle extrêmement ambigü, mais elle n’agissait pas seule, et les auteurs de cette machination sont restés sinon inconnus, du moins impunis.
Ce qui est frappant dans ce livre, c’est de découvrir comment certaines personnes qu’on peut qualifier d’intouchables en sont arrivées, grâce à un jeu subtil et complexe de relations et d’influences, à bloquer peu à peu le cours de la justice.
Est-ce que la police a, d’emblée, reçu l’ordre de négliger certains faits et témoignages ? On pourrait le croire quand on lit que la voiture à bord de laquelle circulait l’éditeur fut restituée sans examen au chauffeur de Mme Loviton, dès le lendemain du meurtre. Critiqué pour son manque de rigueur, l’inspecteur Ducourthial (ça ne s’invente pas !) répond dans son rapport : « Sur quelle partie de la voiture aurait-on pu, par ailleurs, relever des empreintes digitales ? Pour quelle raison la voiture de Mme Loviton aurait-elle été saisie, alors que le meurtre s’est déroulé non pas à l’intérieur, mais à l’extérieur ? »
Avant de quitter son domicile, Denoël a eu une longue conversation avec un ami, qui répond à Ducourthial : « Je ne saurais dire exactement de quoi nous avons parlé au cours de cette communication qui dura au moins 20 minutes. » Cet homme est le dernier à avoir parlé à Denoël le soir du crime, juste avant son départ pour les Invalides, et le policier, qui a attendu neuf mois avant de l’interroger, ne cherche pas à en savoir plus.
Les premiers témoins à découvrir le corps de l’éditeur sortaient du ministère du Travail. Ils sont avocats, et l’un d’eux est chef de cabinet du ministre communiste du Travail. Il ne refuse pas formellement d’être interrogé mais préfère envoyer un témoignage écrit à la police, qui s’en contente. Quant à l’homme qui l’accompagnait, il « ne peut certainement rien ajouter à ces déclarations, il n’a rien vu ni entendu de plus que moi-même », écrit l’avocat communiste. Ducourthial tentera bien, dix mois plus tard, d’obtenir une déposition de cet avocat mystérieux: « Rendez-vous fut pris mais il ne vint pas », et par la suite : « il promit de nous faire parvenir ses déclarations par lettre, lettre que nous n’avons jamais reçue. »
On voit que la justice veille à ne pas déranger les gens en place, mais elle n’hésite pas à arrêter, durant une semaine, tous les malandrins porteurs d’un calibre semblable à celui qui a tué Denoël, pour le cas où ils récidiveraient.
Le Courrier de Paris a publié, deux jours après le meurtre, le récit d’un témoin visuel (en donnant ses nom et adresse !) qui décrit éloquemment l’agression de l’éditeur par trois « zazous » qui cherchaient à le voler puis qui en vinrent à le tuer parce qu’il les menaçait d’un cric de voiture. C’est si véridique que la police adopte cette version, au demeurant plausible. Mais quand Ducourthial est forcé d’interroger l’auteur de l’article, celui-ci lui avoue « que le scénario, tel qu’il l’expose, est de sa pure imagination et que ce témoin n’existe pas ». Le policier va-t-il se fâcher, inculper le journaliste ? Non pas, car cet article « n’est pas le seul du genre et qu’il n’a pas l’habitude de faire état des fantaisies de la presse ». L’instruction est close en janvier 1946 : crime de rôdeur.
Sur le plan civil, des événements inquiétants ont lieu. Des cessions de parts en blanc ont été enregistrées après la mort de Denoël, dépossédant sa veuve et son fils de la maison d’édition ; la garçonnière où il était domicilié depuis la Libération a été vidée de ses papiers, de ses livres ; quand Mme Denoël envoie un huissier au domicile de Mme Loviton, chez qui l’éditeur vivait maritalement, elle déclare qu’il ne possédait rien, juste les 12 000 francs qu’on a retrouvés sur lui. Cécile Denoël n’est pas femme à se laisser faire et elle va, durant cinq ans, livrer un combat sans merci pour récupérer son héritage et découvrir l’assassin de son mari.
Peut-être commet-elle alors l’erreur de lier le civil au pénal et de croire que le voleur est aussi l’assassin. Tous ses efforts ont un seul but : démasquer sa rivale. Le livre de Mme Staman nous restitue les péripéties sordides de ces procès en cascades qui ne déboucheront sur rien. Mme Loviton était du côté des puissants, elle avait les relations et les moyens qu’il fallait pour faire clôturer par un non-lieu une enquête qui devenait fort dérangeante, puisque le commissaire principal de la PJ parisienne concluait, en mai 1950, « que M. Denoël aurait pu trouver la mort à l’issue d’un rendez-vous consécutif à un appel téléphonique, à la suite d’une longue discussion dont l’objet reste indéterminé, mais qui pourrait avoir eu pour objet la possession du dossier qu’il avait constitué en vue de sa comparution devant le Comité d’épuration du Livre.»
La Littérature revenait par la petite porte. Mme Staman propose le scénario suivant : Denoël, ayant compris d’où soufflait le vent de la justice en 1945, avait imaginé d’arranger le procès de sa maison d’édition, comme Jeanne Loviton l’avait fait pour son dossier personnel quelques mois plus tôt, c’est-à-dire en payant. En payant un avocat communiste réputé pour ses bonnes relations au Palais. Quel était le prix de cet arrangement ? Le dossier constitué pour sa défense et qui mettait en cause d’autres éditeurs ? Une valise de pièces d’or, comme le pensait sa veuve ? Les deux ? Il importe de savoir que, désormais, la police était persuadée que l’éditeur n’allait pas au spectacle, mais à un rendez-vous capital, qui tourna mal, et où il laissa la vie.
En juillet 1950 eurent lieu dans le cabinet du juge d’instruction des confrontations assez extraordinaires que Mme Staman retranscrit pour notre édification. Jeanne Loviton ne craignait pas les questions de la veuve de l’éditeur, elle les tournait en dérision, se montrait insolente. Son procès était arrangé, c’était l’essentiel. Plus délicate fut la rencontre entre Cécile Denoël et le mystérieux avocat « du 2 décembre 1945 », enfin prié de s’expliquer sur sa présence aux Invalides. Mais jamais, par exemple, son confrère communiste ne fut importuné.
Tout cela tournait à la confusion pour la Justice, et le procureur général Besson mit fin à cette parodie d’instruction en prononçant un non-lieu plus énorme encore que le reste. Pour Cécile Denoël, c’était la ruine. Jeanne Loviton revendit aussitôt la « maison de l’assassiné » à son concurrent Gallimard, qui n’attendait que cela depuis quinze ans.
On quitte ce livre un peu abasourdi par l’iniquité des différents jugements rendus, tant au civil qu’au pénal, et par l’arrogance d’une femme qui ne cesse de jouer les persécutées tandis qu’elle écrase sans état d’âme son adversaire. On appréciera, par exemple, le rapport rédigé à la troisième personne que Jeanne Loviton adresse, sur un ton sans réplique, au Procureur Général pour que cessent les attaques dont elle est l’objet.
On se demande ensuite comment un dossier aussi explosif a pu se transformer en pétard mouillé. Affaire d’état ? Sans doute. Pourquoi ne pas l’avoir détruit, alors ? Le fait est qu’il existait toujours en 1990, puisque l’auteur en cite de nombreux passages.
Le public américain auquel le livre s’adresse avait besoin d’être éclairé sur l’Occupation, la Collaboration, l’Epuration : ces rappels historiques, dont un lecteur français peut faire l’économie, disparaîtront probablement de l’édition française - s’il se trouve un éditeur français qui prenne le risque de cette publication. Car, il faut le savoir : tous les noms propres sont réels.
2004

© Ce troisième Bulletin célinien consacré à Robert Denoël est paru en août, soit près de deux ans après la publication à New York de la biographie romancée de Louise Staman, et six mois avant sa traduction française à Paris. Il contient un entretien de l'auteur avec Marc Laudelout [« Le Destin tragique de Robert Denoël »]. Je lui ai adjoint une Chronologie [1943-1973], et une préface qui est aussi un compte rendu du livre de Louise Staman.
Céline et Denoël
Quand Céline rencontre Denoël en juin 1932, l’éditeur belge, fils de bourgeois, intellectuel, n’a pas encore trente ans. Il fait un métier d’« épicier », n’a pas de fortune, et profite de la bonne volonté d’un commanditaire américain. Mais il a de l’ambition, le sens des affaires, et il accepte d’enthousiasme son Voyage au bout de la nuit.
Seulement, le contrat proposé est singulier : l’auteur ne touchera ses 10 % de droits qu’à partir du 4e mille. Quand on croit au succès d’un roman, se protège-t-on de la sorte ? Céline lui fera payer cher sa frilosité en exigeant à chaque nouveau livre une augmentation de ses droits d’auteur jusqu’au pourcentage énorme de 18 % sur les prix de vente.
En attendant, on invente pour la presse une histoire de manuscrit anonyme emballé dans un journal par une femme de ménage : cela manque de panache mais colle tellement mieux à la condition miteuse de Bardamu-Céline. Denoël a toujours refusé de se laisser distribuer par Hachette, contrairement à Gallimard qui a justement un petit roman à placer pour le Goncourt et qui va obtenir le prix en intriguant auprès des jurés.
Les Loups sombreront rapidement dans l’oubli, le Voyage va lancer l’auteur et son éditeur. Erreur stratégique de Gaston, qui en voudra à mort à Denoël, avec lequel il s’est déjà frotté à propos de L’Hôtel du nord. Céline dira par la suite que tous ses ennuis lui sont venus du Voyage, c’est aussi le cas pour son éditeur. Mais l’écrivain retient surtout que son livre n’a pas eu le Goncourt à cause de lui. Finies les relations cordiales : « Je hais tout ce qui ressemble à de l’intimité, amitié, camaraderie, etc. Considérez moi comme un excellent placement, rien de plus, rien de moins.»
Entre 1933 et 1936, Denoël mène bien sa barque, reçoit des manuscrits d’auteurs reconnus, rachète plusieurs fonds d’édition, lance des magazines. Il doit cela à Céline, il le sait. En mai 1936, tout se fige : « j’essaye de sortir des décombres que le Front Populaire m’a fait tomber sur la tête », écrit-il à une amie. Mort à crédit est sorti à un mauvais moment et il n’obtient pas le succès escompté, mais l’essentiel est ailleurs : les ennuis de trésorerie commencent.
Céline s’est tué au travail, il attend sa juste récompense, et voilà Denoël qui le règle par à-valoirs, par traites... Steele est sur le départ, il n’injecte plus rien dans l’affaire. L’écrivain enrage : « Denoël mon éditeur pratiquement en faillite. Il me doit 50.000 fr ! Il n’a plus un sou ! Tous les maquereaux se valent !»
Céline sait que son éditeur doit payer son personnel, payer des droits à quelque 150 auteurs, publier des nouveautés, régler les imprimeurs : aucune importance. « Moi qui l’ai faite, cette maison ! » écrira-t-il à Paraz. Il l’a faite et défaite. En octobre 1936 il ira jusqu’à assigner son éditeur pour une traite impayée, au pire moment de ses déboires financiers. La rupture est consommée.
Choisir un éditeur, et « le dresser », conseille-t-il à Paraz. Simenon fera beaucoup mieux avec Sven Nielsen, éditeur débutant : le contrôler en finançant son entreprise. Rien de pareil chez Céline : Denoël va mal, tant pis pour lui, c’est un maquereau, il a le goût belge, etc. Jusqu’au bout, Céline l’invectivera. Et toujours pour des questions d’argent : son avidité est sans limites et il ne fait preuve d’aucune compréhension pour son éditeur en difficultés. En janvier 1940, quelques semaines avant la débâcle, il n’a pas d’autre préoccupation : « Il s’agit d’argent vous le pensez bien. Il ne me paye rien - plus rien depuis des saisons ! C’est la crapule absolue et belge et patriote et neutre et jésuite et tout sauf juif ce qui lui permet encore d’autres saloperies...»
Denoël est ce qu’on peut appeler un excellent professionnel. Il n’a plus aucune illusion à propos de son écrivain-vedette, mais il admire son œuvre. Céline publie-t-il des livres antisémites, il lui emboîte le pas, tout au moins pour la presse : « Une clarté fulgurante étalait à cru l’effroyable purulence, la hideuse décomposition d’un monde possédé, pourri, liquéfié par plus d’un siècle de domination juive », écrit-il en 1941 dans Le Cahier Jaune. Est-il lui-même antisémite ? Pas vraiment. Dans sa correspondance, on voit bien qu’il n’adopte pas les idées de l’écrivain. Quand il envoie à une amie un exemplaire de Bagatelles pour un massacre, il lui écrit que le livre l’a « beaucoup amusé : je ne sais si vous aimerez ce délire jusqu’au bout ». On reste dans la littérature.
Durant l’Occupation, Denoël se dépense sans compter pour obtenir du papier en vue de réimprimer tous les ouvrages de Céline ; en mars 1944 il lui rappellera d’ailleurs que ses livres ont absorbé l’année d’avant près de 25 % du papier qu’il a utilisé pour ses 150 auteurs : « Vous êtes », lui écrit-il, « le seul auteur français qui ait eu des réimpressions sans arrêt. Vous êtes certainement l’auteur français qui a touché le plus de droits d’auteur depuis l’armistice ».
Cela n’empêchera pas l’écrivain d’attribuer à son éditeur la responsabilité des rééditions de ses pamphlets antisémites : « Robert Denoël était donc maître absolu, souverain exclusif, de ma production littéraire. Il publiait et republiait à sa volonté, à sa seule volonté, tous mes ouvrages. Je n’étais pour rien dans mes rééditions ». Quand il écrit ces contre-vérités, Denoël est mort depuis cinq ans, on peut donc le charger, mais aujourd’hui encore, certains croient que les rééditions sous l’Occupation sont dues à ses problèmes de trésorerie. Il n’en est rien : aucun retirage n’a pu se faire sans l’aval de l’écrivain, qui n’hésitait d’ailleurs pas à réclamer lui-même du papier auprès de Karl Epting, directeur de l’Institut allemand.
En 1945, alors que Céline s’est réfugié en Allemagne, Denoël, qui aurait pu facilement rentrer en Belgique et échapper aux poursuites, reste crânement à Paris. Sa maison d’édition est sa raison d’être et il n’entend pas qu’on la lui confisque sans combattre. Est-ce que Céline se fait du souci pour lui ? On pourrait le croire en lisant une lettre qu’il adresse en septembre 1945 à sa secrétaire : « J’ai pensé tous les jours à lui le malheureux il ne s’en doute certainement pas. » Mais dès le mois suivant il revient sur ses habituelles appréhensions : « Il a dû bien me voler depuis mon départ ». Or à cette époque Denoël vit clandestinement dans un garni, sa maison est sous séquestre, et c’est Maximilien Vox qui dirige la maison.
Voilà un nom « qui fleure sa Palestine », dit Céline, et c’est sûrement un coquin : « où iront les bénéfices ? à Vox ? au séquestre ? à l’Etat ? » Tout de même, il a de funestes pressentiments au sujet de Denoël : « Sa place n’est plus à Paris en ce moment à tourner autour de son repaire Amélie. Il devrait être en Belgique ou en Hollande à préparer l’avenir. » Il a aussi une bonne connaissance du milieu de l’édition, et il sait que son éditeur a des ennemis vigilants : « Je suis inquiet aussi pour Bobby. Gallimard ne le lâchera jamais. Il s’agit de régler les rancunes personnelles. Vous parlez si les idées on s’en fout bien ! surtout Gallimard. » Cette lettre est du 1er décembre 1945, la veille de la mort de Denoël.
Il y aurait un livre à écrire sur cet étrange assassinat et sur ses prolongements. Dans sa biographie romancée, Louise Staman a publié des documents mettant clairement en cause la bonne foi des enquêteurs et des magistrats qui eurent à s’occuper de cette affaire, où les interventions ministérielles furent nombreuses. On n’avait pas tué Denoël parce qu’il avait publié Céline, mais on le laissa croire. D’un crime de droit commun, on fit un crime politique. Fort habilement on laissa entendre que l’imprudent Liégeois, qui avait publié à la fois Rebatet et Triolet, avait été victime de sa duplicité. Peu de journaux rappelèrent que Gallimard avait fait beaucoup mieux en utilisant Drieu et Paulhan. L’important était de masquer la spoliation d’une maison d’édition par un débat idéologique.
A Copenhague Céline, lui, n’est pas longtemps dupe : « ce bas crime... tout de même bien douteux... il est mort comme Jérôme Coignard une nuit d’accident de voiture... était-ce le même meurtrier ?... » , écrit-il le 10 décembre 1945 à sa secrétaire. L’image est audacieuse puisque l’abbé Coignard fut assassiné par un juif kabbaliste, mais il a appris que la maîtresse de l’éditeur, qui l’accompagnait le soir du crime, s’appelle Loviton : elle doit donc appartenir au « clan Lévy ». Il ignorera toujours que Jeanne Pouchard, enfant naturelle, ne doit son patronyme juif qu’à l’homme qui épousa sa mère quand elle avait dix ans.
Louise Staman a le privilège d’habiter les Etats-Unis où tout peut s’imprimer. Elle n’hésite donc pas à citer les noms des personnes impliquées dans cet assassinat qui permit, grâce à un tour de passe-passe juridique et à la complaisance des tribunaux, de mettre la main sur une des plus prestigieuses maisons d’édition parisiennes, avant d’aboutir dans le giron d’un confrère qui la convoitait depuis quinze ans : Gaston Gallimard.
Certes la présence sur les lieux du crime d’un avocat communiste tel que Roland Lévy, chef de cabinet au ministère du Travail, devant lequel Denoël fut retrouvé agonisant, n’implique pas qu’il y ait participé. Pas plus que celle de l’avocat résistant Guillaume Hanoteau, qu’on retrouvera plus tard... chez Céline à Meudon, alors qu’il travaillait pour Paris Match. Mais les deux hommes n’avaient pas d’alibi, et c’étaient des familiers de Jeanne Loviton, la « fée maligne » qui s’était éclipsée au bon moment.
Bien sûr, qu’une cession de toutes les parts que détenait Denoël dans sa maison d’édition, au profit de Jeanne Loviton, n’ait été enregistrée que six jours après sa mort, ne signifie pas que la bénéficiaire ait commis un faux en écriture, ou qu’elle ait fait assassiner son amant pour s’emparer de sa maison, même si c’est ce que soutint Cécile Denoël.
Pour cela il faut des preuves, et la justice n’en trouva pas. Il n’y avait que des présomptions. On peut s’indigner que Roland Lévy, devenu membre du Conseil supérieur de la Magistrature, n’ait jamais été interrogé directement par la police, mais il aurait fallu pour cela que la loi le permît. On peut être choqué que le procureur Besson, dans son réquisitoire, laisse imprimer que « la présence de M. Hanoteau à proximité des lieux, le soir et à l’heure du drame, est due à un concours de circonstances extraordinaires », sans avoir cherché à savoir lesquelles, mais le rapport de police ne disait-il pas que « Aucun élément de l’information ne permet de suspecter son attitude » ?
Cécile Denoël eut beau affirmer en 1950 que « dans les milieux littéraires de la capitale, tout le monde parlait de cette affaire, mais que personne n’osait réellement dire ce qu’il en savait, chacun étant tenu par une sorte de terreur muette », on ne la prit pas au sérieux : les communistes n’étaient plus au gouvernement et Guillaume Hanoteau avait été radié du barreau parisien, ils ne pouvaient donc avoir de réel pouvoir et peser sur la décision d’un procureur.
Il y avait bien les relations de Jeanne Loviton, qu’on retrouvait partout dans la magistrature et jusqu’à la tête du gouvernement, et qui semblaient peser en permanence sur les procès civils et judiciaires opposant la veuve et la maîtresse ; il y avait son avocate communiste, Simone Penaud, dont on disait qu’elle était en 1945 la maîtresse de Roland Lévy, lequel avait fait partie, avant guerre, du cabinet de Me Rosenmark, l’avocat même de Mme Loviton ; l’alibi de Jean Voilier-Loviton n’était pas bien solide, qui assurait qu’elle avait quitté Denoël pour aller quérir un taxi « parce qu’elle craignait d’arriver en retard au théâtre » mais qui était incapable de dire à quelle heure elle l’avait laissé seul.
Le certificat médical qui lui donnait droit à ce taxi avait été délivré par un ami médecin, dont la signature n’avait pas été légalisée, dix jours avant le meurtre. Son attitude devant la Cour avait quelque chose d’arrogant lorsqu’elle répondit qu’« elle n’était pas chauffeur de taxi » quand on lui demandait pourquoi le trajet de la rue de l’Assomption à Montparnasse devait passer par l’esplanade des Invalides.
Tout cela était troublant et donnait à l’affaire une odeur un peu spéciale, que Céline avait sentie de loin, mais ne constituait pas le début d’une preuve. Le mérite du livre de Mme Staman est de nous avoir restitué cette odeur, qui est celle de la concussion.
2006

© Ce quatrième numéro spécial consacré à Robert Denoël est paru au moment où Jean Jour allait publier à Paris Robert Denoël, un destin, préfacé par Marc Laudelout, et quelques mois après que j'eusse créé mon site consacré à Denoël sur www.thyssens.com. Il contient un texte de Henry-Jacques sur Denoël datant de 1930 ; une étude de Pierre-Marie Dioudonnat consacrée à Jeanne Loviton ; la réédition d'un article de Denoël datant de 1941 : « Comment j'ai connu et lancé Louis-Ferdinand Céline » ; un entretien Marc Laudelout - HenriThyssens.
Entretien avec Henri Thyssens
C'est en 1979 que j'ai fait la connaissance de Henri Thyssens. Je venais d'éditer le premier numéro de feue La Revue célinienne qui cumulait de nombreuses imperfections. Il eut l'indulgence de ne pas (trop) les souligner et, au contraire, m'encouragea à persévérer. C'est ainsi qu'une amitié est née, il y aura bientôt trente ans. Henri avait déjà commencé à s'intéresser au destin de Robert Denoël, originaire de Liège comme lui.
Aujourd'hui, il lui consacre un remarquable site Internet, s'attachant à étudier sa biographie, sa production éditoriale et les circonstances mystérieuses de son assassinat. En une phrase, il a résumé sa brève existence : « Il aura été l'éditeur du plus grand écrivain de ce siècle, et l'un des hommes les plus libres de sa génération, mais sa fulgurante trajectoire s'est achevée tragiquement sous les balles d'un sicaire. » Vous lirez dans ce numéro un entretien avec celui qui est devenu le spécialiste incontesté d'un des éditeurs francophones les plus fascinants de la première moitié du siècle passé.
Les retrouvailles ont lieu dans une brasserie au cadre rétro, située près de la Grand-Place de Bruxelles, au cœur des Galeries Saint-Hubert. De retour d'un séjour aux Etats-Unis d'Amérique, Henri Thyssens est prolixe sur le sujet qui nous intéresse tous deux. Rien d'étonnant à cela : il est sans nul doute celui qui connaît le mieux la personnalité et l'œuvre éditoriale de Robert Denoël. Au lieu de lui consacrer un livre, il a opté pour un site Internet entièrement voué à celui qui fut l'éditeur de Céline de 1932 à 1944. Cette réalisation constitue une réussite sans équivalent appelée en outre à s'enrichir durant les années à venir.
Conversation à bâtons rompus avec ce libraire liégeois qui a consacré plus de trente années à étudier la vie et l'œuvre de son célèbre concitoyen disparu tragiquement le 2 décembre 1945.
Quand as-tu commencé à l'intéresser à Robert Denoël et qu'est-ce qui t'a amené à travailler sur lui ?
Au début des années 70, mon vieil ami l'éditeur Pierre Aelberts, qui l'avait connu, me raconta son histoire. Elle finissait mal. J'ai voulu savoir pourquoi.
Le fait que tu sois, comme lui, d'origine liégeoise a-t-il joué un rôle quant à ton intérêt pour la destinée de cet homme ?
Probablement. Mais c'est surtout sa fin tragique qui posait question.
Sur quels aspects tes recherches ont-elles porté et quelles ont été les différentes étapes de ce travail ?
Aelberts pensait que les communistes l'avaient exécuté, à cause de ses idées, ou à cause de ses publications. J'ai voulu connaître les deux.
L'hypothèse formulée par Aelberts n'était pas la seule, en fait. Quelles sont celles qui ont été envisagées à l'époque ?
La famille Denoël penchait pour une affaire politico-affairiste. Personnellement, je n'avais aucun opinion préconçue. Mais une fois qu'on connaît le dossier, on ne perd plus de temps avec d'improbables rôdeurs.
A quelles difficultés as-tu été confronté au cours de cette recherche ?
Dès 1974 j'ai rencontré Pierre Denoël, son frère cadet. A cause de lui, aucun membre de sa famille n'accepta de me recevoir : on me soupçonnait de vouloir, pour d'inavouables motifs, remuer un passé douloureux. Sauf Cécile, la veuve de l'éditeur, qui m'accueillit chaleureusement.
Quels sont les témoins de la vie de Robert Denoël qui t'ont le plus impressionné, dans un sens ou dans l'autre ?
Jeanne Loviton : une noire égérie, extrêmement séduisante et inquiétante. Il n'y avait pas un mot qui ne fît l'objet d'un calcul, pas un geste qui n'aboutît à une pose - j'étais, après chaque visite, soulagé de quitter son immeuble de l'avenue Montaigne, et pressé d'y retourner.
Pourrais-tu expliciter cette réaction ambivalente ?
Son intelligence était redoutable, sa parole aussi : elle me fascinait, et m'effrayait un peu. Mais je ne pouvais m'empêcher d'y retourner : un mot, une confidence, lui échapperaient peut-être. J'étais jeune.
Et Cécile Denoël ?
Cécile était malade depuis longtemps, mais ses souvenirs (et ses convictions) étaient intacts. Elle m'a beaucoup aidé, sans se soucier des ukases de la famille Denoël. Après sa mort, son mari, Albert Morys, en a fait autant. C'était très méritoire.
C'est elle, je crois, qui t'a signalé l'existence du texte de la pièce Progrès qu'elle détenait ?
Oui, elle m'a montré ce tapuscrit inédit lors de ma première visite, en 1977. Il était à vendre ; je n'avais pas les moyens de l'acheter. Je l'ai signalé à Jean-Pierre Dauphin. Il s'est rendu chez elle peu après avec Henri Godard, a négocié l'affaire, et publié le livre au Mercure de France. Il avait fait une belle trouvaille.
Quel genre d'homme était Robert Denoël ? S'il fallait en faire un bref portrait psychologique, qu'y aurait-il à dire ?
Un homme extrêmement complexe, à la fois dominant et dominé, refoulé et exubérant, rieur et angoissé, un vrai derviche. Louise Staman a, dans son livre, cité le mot de Céline qui qualifiait Denoël de « zèbre », en rappelant que ce charmant animal a la faculté de se camoufler grâce à ses rayures changeantes.
En quoi ses origines familiales et sociales expliquent-elles en partie la trajectoire qui fut la sienne ?
Il n'a vécu que pour la littérature. Déçu par Liège, où il n'en a pas trouvé digne de lui, il s'est tout naturellement tourné vers Paris. Un certain atavisme, probablement (son grand-père était avocat et écrivain), et un besoin furieux de quitter un milieu familial conventionnel, où il était en conflit permanent avec son père, expliquent en partie son itinéraire.
Robert Denoël était aussi un lettré et s'est essayé à l'écriture. Quel regard portes-tu sur ses écrits littéraires ?
Il a écrit toute sa vie, sans jamais trouver l'inspiration, alors qu'il détectait admirablement le talent des autres : c'était un vrai éditeur. Mais il excellait dans la critique littéraire. Max Jacob notait en 1943 : « Le seul critique littéraire que nous ayons c'est Denoël ; ses " Vient de paraître " sont des chefs-d'œuvre de justesse et de justice. »
Hormis des articles de critique littéraire, qu'a-t-il laissé ?
Des nouvelles assez anodines dans les journaux et revues belges, au cours des années 20. Mais il n'a jamais cessé d'écrire, jusqu'à sa mort : des nouvelles, toujours aussi anodines. Elles sont restées inédites.
Pour quelle raison n'as-tu jamais rédigé une biographie de ce personnage ? Sont-ce les circonstances de son assassinat qui rendent la chose tellement épineuse ?
Bien entendu. Un jugement a été rendu en juillet 1950 qui fait l'impasse sur la question. Impossible de le remettre en cause sans risquer de procès. Comment écrire une biographie complète dans ces conditions ?
Peux-tu rappeler précisément la teneur de ce jugement de 1950 ?
En fait, c'est un non-lieu qui a été prononcé, le 28 juillet 1950, par la Cour d'appel de Paris. Cela signifie que si l'on disposait aujourd'hui de faits nouveaux touchant son assassinat, on pourrait, très théoriquement, obtenir la réouverture de l'enquête. Ce n'est pas le cas pour l'arrêt définitif concernant sa succession, prononcé le 13 décembre 1950 par la même juridiction.
Quels sont les éléments qu'a apportés le livre de Louise Staman ? En quoi a-t-il fait progresser la connaissance du dossier ?
Louise a eu accès à un dossier de police extrêmement délicat, et n'a pas eu peur de s'en servir. L'édition américaine de son livre contenait des affirmations audacieuses que ses traducteurs français ont supprimées, par peur des procès.
En quoi consistaient ces affirmations audacieuses ?
Louise mettait en cause Gaston Gallimard : selon elle, il aurait peut-être trempé dans l'attentat des Invalides, voire même l'aurait commandité, avec d'autres éditeurs.
Les circonstances de son assassinat demeurent mystérieuses mais que peut-on affirmer avec certitude aujourd'hui ?
Qu'il est mort d'une balle dans le dos. C'est une certitude.
Certes ! Mais quelles sont la ou les hypothèses qui apparaissent le plus plausibles aujourd'hui ?
Il y eut trois enquêtes de police : la première conclut au crime crapuleux. La deuxième aussi, mais n'excluait pas la présence possible, aux Invalides, « d'une tierce personne dont Mme Loviton tairait le nom » et qui serait le meurtrier. La troisième conclut à un assassinat à la suite d'une discussion concernant le « dossier noir » constitué par Denoël, et qui mettait en cause d'autres éditeurs. Cette conclusion mettait à mal la version de Jeanne Loviton : Denoël allait à un rendez-vous, qui se transforma en guet-apens.
Sur ton site, tu indiques que l'agenda Hermès de Denoël constituait « la seule pièce à conviction dont disposait la partie civile pour convaincre la justice que l'éditeur avait, avant sa mort, brassé des affaires d'édition très importantes, et qu'on ne pouvait prétendre, comme le faisaient Mme Loviton et ses amis, qu'il n'avait d'autre fortune que les 12 000 francs retrouvés dans son portefeuille ». Qu'est devenu cet agenda ?
L'agenda se trouve, j'imagine, au greffe du Tribunal de Paris. Cécile Denoël en avait tiré une copie photographique très fidèle, dont elle m'a confié un exemplaire. Je l'ai déposé, avec mes autres dossiers Denoël, à la BLFC, dont les archives ont été versées à l'IMEC. Un dénommé Derval, qui gère le fonds Denoël, m'a fait savoir que l'ayant droit de Robert Denoël avait accordé une « exclusivité de recherche » à la dame qui est payée pour rédiger une biographie de l'éditeur. Le calepin n'est plus accessible, même pour moi ! Dommage, car ce document est d'un grand intérêt.
Céline apparaît comme un auteur sans beaucoup de scrupules face à son éditeur mais Denoël lui-même fut-il sans reproches à l'égard de son auteur-vedette ?
Céline a fait et défait les Editions Denoël. La maison a pris son essort grâce à lui, puis elle a subi ses exigences déraisonnables ; chaque nouveau contrat lui était prétexte pour réclamer des avantages supplémentaires. Il a saigné la trésorerie pendant toute sa carrière chez Denoël. L'éditeur, qui n'était pas en position de refuser, méprisait cette avidité mais plaçait le génie de l'écrivain au-dessus de tout : pas une fois il ne l'a lâché.
Mais Céline avait-il vraiment conscience de mettre parfois en péril l'existence même des Editions Denoël ? Il aura un comportement assez semblable avec Gaston Gallimard qui disposait, lui, d'une solide assise financière...
Céline ne pouvait ignorer que Denoël avait de grosses difficultés financières, en 1936-1939, par exemple, puisqu'il l'a écrit à tous ses correspondants, en forçant même le trait : « Denoël en faillite, qui ne me paye plus », etc. Il était hanté par la « peur de manquer ».
Denoël était assurément un éditeur dans l'âme mais ses prises de position (je songe notamment à l'article sur Céline qu'il signa dans Le Cahier Jaune) étaient-elles uniquement opportunistes ? En d'autres termes, était-ce ou non un homme de conviction, avec des idées politiques relativement précises ? Et partageait-il les idées de Céline ?
Denoël s'engageait trop, il se croyait moralement obligé de soutenir ceux qu'il publiait. Son article du Cahier Jaune et les interviews qu'il a accordées à propos de sa collection « Les Juifs en France » sont, à mon avis, opportunistes. Seule comptait la survie de sa maison d'édition. Ses convictions personnelles était tout autres. Il publiait des auteurs juifs, avait des amis juifs, des maîtresses juives - dont certains ont témoigné à son procès, en juillet 1945. Un « zèbre » de l'édition.
Denoël était-il plus coupable que ses confrères parisiens ? Qu'avait-il essentiellement à se faire pardonner ?
Il était plus coupable que les autres puisqu'il avait eu du succès, qu'il était un homme libre et qu'il était Belge. Mais si on examine son catalogue, on trouve peu d'ouvrages compromettants : cinq ou six sur quelque 300 volumes publiés entre 1940 et 1944. Seulement, parmi ces quelques livres-là, il y a Les Décombres, un des plus gros succès de l'Occupation, et les rééditions des pamphlets de Céline, faites à sa demande, rappelons-le.
Quelle fut véritablement son attitude sous l'Occupation ? Etait-elle ambiguë ?
On a mis en cause sa duplicité : un coup pour Rebatet, un coup pour Triolet. Mais on oublie qu'Elsa Triolet n'a jamais été inquiétée jusqu'en 1944 : c'est un article intempestif des Lettres Françaises clandestines, à propos du Cheval blanc, qui a attiré sur elle l'attention des autorités françaises. Ses livres se sont vendus durant toute l'Occupation. Denoël écrivait, début 1937 : « Je continue à publier communistes et royalistes avec plaisir et sans aucune sorte de cynisme. » Seul comptait le talent, et il a maintenu cet adage jusqu'au bout. On a vu, après la Libération, ce que donnait l'édition idéologiquement correcte...
Si on compare, par exemple, son activité sous l'Occupation avec celle de Bernard Grasset, que peut-on dire ?
Que Grasset s'est, lui, vraiment engagé dans la collaboration, et pas seulement par les livres qu'il publiait. Il allait au-devant des exigences de l'occupant.
Sait-on si Denoël a, comme Gaston Gallimard, « raté » certains auteurs qui lui avaient soumis leurs manuscrits ?
Personnellement je n'en connais pas, mais il a dû commettre des erreurs de jugement. Si l'on disposait des archives de sa maison, on pourrait mieux apprécier ses refus éditoriaux.
Connaît-on maintenant la ou les raisons pour lesquelles Céline n'obtint pas le Goncourt en 1932 ?
La raison en est purement commerciale : à cette époque, la maison Hachette faisait et défaisait les grands prix littéraires. Le roman de Céline était publié par un éditeur indépendant, qui refusait de lui céder la distribution de ses livres. Si le Voyage avait eu le prix, Hachette aurait dû acheter, comptant, des milliers d'exemplaires. Avec le roman de Mazeline édité chez Gallimard, dont le trust vert avait la distribution, rien de tel : un dépôt à six mois, sans bourse délier. Il suffisait donc de s'assurer du vote de l'un ou l'autre juré. En l'occurrence ce sont deux Belges, les frères Boex dits Rosny, qui firent l'affaire.
La relation que Céline eut avec Denoël apparaît assez ambiguë. De la défiance, parfois du mépris, mais aussi de l'estime et même de la considération, semble-t-il. Est-ce exact ?
Il semble que l'estime est venue après la mort de l'éditeur. Durant treize ans ce furent plutôt des rapports de force. D'ouvrier à épicier, si l'on veut. Ce qui me frappe, c'est son manque de reconnaissance pour tous les efforts de Denoël en sa faveur. Quand il accepte Voyage, après trois refus ailleurs ; quand il défend Mort à crédit alors que la presse l'éreinte ; quand il prend parti en faveur de ses pamphlets, alors que rien ne l'y oblige ; quand il le réédite durant toute l'Occupation alors que le papier est rare. Rien, vraiment, ne paraît trouver grâce à ses yeux. Seule la mort paraît l'avoir « racheté ». Après tout, c'est lui qui a vraiment mis sa peau sur la table...
Dès le début, Céline refuse d'ailleurs l'amitié de Denoël et veut précisément s'en tenir à de strictes relations auteur-éditeur. Il y a une anecdote fameuse à ce sujet...
On connaît l'histoire du panier de fruits envoyé à Montmartre alors que Céline était souffrant, et renvoyé à l'expéditeur : « Je suis familier, pas intime », aurait-il dit. C'est une anecdote. Mais je crois Cécile Denoël quand elle raconte que Céline répondait à ses invitations à dîner. Tout paraît changer avec le Goncourt manqué.
Quelles sont les grandes lignes que l'on peut tirer d'une analyse de la production éditorale de Robert Denoël ?
Tout d'abord, la recherche constante de la qualité, de préférence chez de jeunes écrivains. Si j'obtiens l'autorisation de publier sa correspondance, on pourra vérifier avec quelle minutie il lit - seul - les manuscrits littéraires, proposant ensuite des améliorations, refusant au besoin de les publier tels quels. En 1943 Barjavel déclarait à un journaliste : « J'étais jusque-là un journaliste, il a fait de moi un écrivain. En une matinée, il m'a appris mon métier. C'était un homme fantastique. A part Céline, tous ceux qui sont passés chez lui lui doivent quelque chose de leur talent. »
Ensuite, c'est le souci de coller à l'événement : les livres politiques (des deux bords) publiés par Denoël entre 1936 et 1939 constituent une remarquable bibliographie de la Guerre d'Espagne.
Le grand problème de Denoël ne fut-il pas qu'il n'eut jamais les moyens de ses ambitions ?
Ce fut un problème constant jusqu'à 1942. Quand les capitaux furent enfin là, ils étaient allemands, c'était la guerre et le papier manquait.
A ce propos, Céline se plaignait d'être réédité sous l'Occupation sur du papier de piètre qualité. Les autres auteurs de Denoël auraient-ils été favorisés de ce point de vue, ou est-ce encore un exagération typiquement célinienne ?
Oh, Céline va plus loin : il dit qu'il a toujours été imprimé sur du « papier chiotte », que Denoël ne lui a jamais consacré un sou de publicité, etc. On a compris. Mais il est vrai qu'en 1943, par exemple, Denoël a publié une édition de luxe fort coûteuse d'un roman de sa maîtresse d'alors, Dominique Rolin, tandis que les livres qui sortaient de la rue Amélie étaient tirés sur papier de bois.
Est-ce encore possible de faire en sorte que Robert Denoël ait une sépulture digne de ce qu'il fut ou est-ce aujourd'hui totalement impossible ?
Il y a vingt-cinq ans j'ai posé cette question au conservateur du cimetière de Thiais : c'était parfaitement possible. J'avais reçu les prix de l'exhumation, le tarif des concessions. Mais il fallait encore obtenir l'autorisation de la préfecture de police : or, il existe un ayant droit. C'est à lui que revenait cette décision.
Pour quelle raison as-tu décidé de créer ce site Internet entièrement consacré à Denoël ?
L'aide de Louise Staman a été déterminante : son dossier de police m'a permis de combler d'importantes lacunes dans ma documentation. Et je n'avais aucune envie d'en faire un livre : l'Internet, indéfiniment corrigible, m'a paru le moyen le plus approprié pour un travail qui doit compter actuellement quelque 700 pages, et qui est appelé à en recevoir 500 autres, notamment dans le domaine bibliographique. Aucun éditeur n'aurait pu prendre en charge une telle somme. Pas assez commercial.
Que peut-on actuellement y trouver ?
J'ai divisé le site en plusieurs rubriques :
* Une Bibliographie qui, en ce moment, n'est qu'une énumération des livres publiés par Denoël à différentes enseignes, mais quand le système sera opérationnel, chacun de ces titres renverra, d'un simple « clic » (je l'espère) à sa fiche détaillée.
* Une Chronologie biographique (qui ne se termine pas en 1945, mais en 2006).
* Un Dossier de presse qui devra encore s'étoffer car, outre les articles qui parlent de Robert Denoël, je mets en ligne ses interviews et, bientôt, il y aura ses propres articles dans la presse belge et parisienne.
* Une rubrique Documents qui, en ce moment, ne contient que les actes de ses différentes sociétés, mais qui comportera d'autres pièces.
* Une série de Notices biographiques consacrées à des auteurs, amis et amies, qui ont joué un rôle déterminant dans sa vie, et que je développerai peu à peu.
* Deux rubriques importantes consacrées, l'une à son assassinat, l'autre aux différents procès intentés par sa veuve entre 1946 et 1950.
* Une rubrique qui m'est chère mais qui n'est encore qu'en projet : sa correspondance. Denoël était un épistolier de talent. Ses lettres à Champigny sont admirables.
Tout le site est illustré de photos et de documents mais il en viendra d'autres : je dois d'abord m'assurer que leur mise en ligne est autorisée.
Outre le livre de Louise Staman et les divers articles que tu as écrits dans Le Bulletin, que peut-on lire de notable sur Robert Denoël aujourd'hui ?
En 1975 personne ne voyait l'intérêt d'une biographie de cet éditeur. En 1995 encore, le numéro du Bulletin célinien publié à l'occasion du cinquantenaire de sa mort est le seul hommage qu'on lui ait rendu dans la presse. La biographie romancée de Louise Staman a relancé l'intérêt du public, surtout en France, malgré une traduction édulcorée.
Le journaliste liégeois Jean Jour va publier un essai intitulé Robert Denoël, un destin aux Editions Dualpha. Et une journaliste française a été chargée, il y a cinq ans, par les Editions Fayard, puis par Fayard/Denoël, de rédiger une biographie qui devrait paraître en 2007 et qui, dit-on, fera autorité. Il faut le croire puisqu'on l'affirmait avant même qu'elle fût rédigée. Malgré la difficulté à parler de corde dans la maison d'un pendu, on peut espérer que cette dame, que la presse qualifie de « chagrineuse d'étouffeurs », conservera assez d'indépendance pour mener à bien cette entreprise périlleuse.
*
© En août parut le premier « Spécial Céline » d'un organe de presse dirigé par Joseph Vebret et publié par Robert Laffont : La Presse littéraire. Il contient, aux pages 43-46, un entretien Frédéric Saenen - Henri Thyssens :
« Le destin de Robert Denoël était inéluctable »
Henri Thyssens était déjà connu pour être un professionnel du livre et un célinien de la première heure, auquel on doit d'avoir constitué, dans les années 80, les cinq catalogues de vente Tout Céline qui, même s'ils sont pour la plupart introuvables, font encore autorité. Il est désormais également le spécialiste incontournable de Robert Denoël. Le site qu'il lui consacre (à l'adresse www.thyssens.com) atteste d'un labeur minutieux, rigoureux, remarquable. On y trouve non seulement une biographie détaillée de cet éditeur à la trajectoire fulgurante et un inventaire des publications des maisons successives qu'il fonda, mais aussi les « minutes », au sens propre, de cette fatale nuit de décembre 1945 où il se fit lâchement assassiner d'une balle dans le dos, en plein Paris. Evocation de celui sans qui l'œuvre de Céline n'aurait peut-être pas connu la même destinée...
Robert Denoël est connu pour avoir révélé Céline au grand public, mais Voyage au bout de la nuit n'était pas sa première audace éditoriale. Pourriez-vous nous parler du parcours atypique de ce jeune homme avant cette grande année de 1932 ?
La première chance de Robert Denoël est L'Hôtel du Nord, mais on ne peut parler d'un coup d'audace : si Eugène Dabit n'avait proposé de partager les frais de l'édition, je ne suis pas sûr qu'il l'aurait publié. Quoiqu'un journaliste ait, en 1936, publié un article intitulé « Denoël, l'audace », je n'arrive pas à le qualifier d'audacieux. Au travers de sa correspondance, j'ai découvert un éditeur soucieux de publier des ouvrages de qualité, et attentif à ne pas gaspiller l'argent que Bernard Steele a injecté dans sa maison d'édition. Pour moi, le vrai coup d'audace de Denoël, c'est Mort à crédit. En 1936, c'était un roman révolutionnaire (je parle du style). Et Denoël voit très clairement sa nouveauté. Steele, pas du tout. Et je me demande si les dissensions entre les associés ne débutent pas avec ce livre-là.
On sait, notamment à travers sa correspondance à « Gaston coffre-fort », « Paulhan-Loukoum » et Nimier, quelles furent les relations, souvent tendues et inamicales, que Céline entretint avec la maison Gallimard. Quelle était au juste la nature de ses rapports avec son premier éditeur et comment évoluèrent-ils ?
Céline a décidé une fois pour toutes que les éditeurs sont des épiciers, et il les traite comme tels. Avec Gaston, malgré les insultes, il reste déférent : c'est un « fermier général », il personnalise le pouvoir, l'argent. Denoël est pauvre, et il le traite beaucoup plus durement. L'éditeur sait qu'il a besoin de Céline, il adopte donc un profil bas, jusqu'en 1944 : là, il lui répond comme il convient. Ce rapport de force qu'établit Céline avec les gens qui sont ses obligés a quelque chose de déplaisant, à mes yeux. C'est une sorte de jeu, un jeu pervers. Il incendie ses interlocuteurs pour voir jusqu'où il peut aller. Quitte à s'excuser ensuite, en plaisantant, bien entendu.
L'année dernière fut publiée en français la version - selon toute vraisemblance assez romancée - de la mort de Denoël par l'universitaire A. Louise Staman. Que pensez-vous de cette enquête ? Quelles sont, d'après vous, ses failles majeures ?
Le travail de Louise Staman était, à l'origine, d'une grande rigueur. Son éditeur américain lui a dit : « Faites-en un roman, on le vendra. Tel quel, il n'intéressera personne aux U.S.A. » Louise l'a donc remanié mais en maintenant les appels de notes. D'où l'aspect hybride de son livre. Elle avait été sensible à cette histoire malheureuse, et elle ne voulait pas d'un roman à clef : elle a donc aussi conservé tous les noms réels. Les archives auxquelles elle avait eu accès lui permettaient de lever une partie du voile sur le mystère de la mort de l'éditeur, et la « licence poétique », l'autorisaient à donner son avis sur les commanditaires possibles de cet assassinat. L'éditeur français n'a pas eu cette audace : le livre aurait été saisi. Cela dit, les archives en question ne lèvent pas tous les doutes, car la justice française a prononcé à temps un non-lieu, et les nouvelles investigations que réclamait l'avocat de la veuve de l'éditeur n'ont jamais eu lieu. Pourtant, on touchait au but, la police avait finalement fait son travail, mais le procureur de la République a, fort obligeamment, stoppé l'enquête.
Pourquoi le mystère qui entoure la mort de Denoël est-il encore aujourd'hui une question aussi sensible, sur laquelle le voile ne semble pas prêt d'être levé ? Pensez-vous que la biographie de la journaliste Pascale Froment apportera à l'affaire des éclairages inattendus ?
Parce que cette enquête mal menée, ces jugements partiaux, remettent en cause la justice française tout entière. Les policiers, les juges, les magistrats, ont mal fait leur travail. Le pouvoir politique est intervenu à tous les niveaux de décision. En vérité, l'affaire Denoël illustre magistralement le problème d'une justice aux ordres du pouvoir. Les juges qui ont prononcé ces non-lieux se sont déshonorés. Le rappeler est déjà un scandale. Si Mme Froment, qui a été engagée par Fayard et qui se retrouve aujourd'hui chez Denoël, c'est-à-dire chez Gallimard, a le culot de le démontrer, et elle a tous les éléments pour le faire, elle aura rempli son contrat.
Quels sont les aspects du personnage Denoël qui vous touchent le plus ?
Sa passion pour la littérature française, et le refus de sa « belgitude ». Denoël était, de ce point de vue, un homme de la fin du XIXe siècle. Il vivait toujours à la grande époque où Maeterlinck tutoyait Mallarmé, où les revues littéraires belges faisaient référence à Paris. Le réveil fut dur et il eut lieu à Paris, dès 1928 : il n'eut plus aucune indulgence pour ce qui se publiait en Belgique, à l'exception de quelques poètes. Si on examine son catalogue, on se rend compte qu'il n'a, en seize ans, publié qu'une dizaine de compatriotes. Il s'est vraiment cru « parisien » : ce fut sa plus grande erreur.
Question de pure spéculation pour conclure : que pensez-vous que Robert Denoël serait devenu s'il n'avait été assassiné, ce soir de décembre 1945 ? Aurait-il échappé à l'Epuration ? Aurait-il poursuivi sa carrière d'éditeur sulfureux ?
Robert Denoël ne pouvait échapper à l'Epuration. Il était le bouc émissaire tout trouvé : Belge, sans carte d'aucun parti, sa condamnation aurait donné bonne conscience à la fois aux autres éditeurs français, et aux épurateurs. En supposant que, grâce aux relations politiques de sa maîtresse, il y eût échappé, je ne lui vois pas d'avenir après 1945 : il était, vous le dites bien, qualifié de « sulfureux » en raison de ses publications durant l'Occupation. Céline et Rebatet étaient en prison, Aragon et sa femme l'avaient lâché, ses confrères le détestaient. Comment travailler dans ces conditions ? D'autre part, je ne l'imagine pas rentrant en Belgique pour y ouvrir une petite maison d'édition. Plus j'y pense, plus je me dis que son destin était inéluctable.
2007
© L'article suivant a été publié dans Le Bulletin célinien n° 182 de décembre 2007 :
Archives, chercheurs et petites rapines
En décembre 1995 Le Bulletin célinien publiait un article que j'avais consacré à l'éditeur Robert Denoël à l'occasion du cinquantenaire de sa mort. Dans une note en fin de page je rappelais que « toutes les pièces que j'ai rassemblées sur l'affaire Denoël ont été déposées en 1982 à la défunte BLFC, place Jussieu, Paris Ve, où elles étaient disponibles sur simple demande. Je suppose qu'elles ont été transférées depuis à l'IMEC, 25 rue de Lille, Paris VIIe ».
Elles ont, en tout cas, été utilisées à deux reprises : en 1985 par Dauphin et Fouché pour leur Bibliographie des écrits de Céline, et par P.-E. Robert dans son essai : Céline et les Editions Denoël paru en 1991. C'est peu, mais je me disais que mon travail n'avait pas été inutile, puisqu'on l'utilisait. Un journaliste chargé récemment par les Editions Denoël de rédiger une notice biographique du fondateur de la maison, n'a pas eu cette possibilité.
André Derval, qui dirige ce secteur de l'IMEC, lui a fait savoir qu'il ne disposait pas de cette documentation. Alerté par ce journaliste, j'ai donc interrogé l'IMEC. Dans sa réponse ô combien prudente, Derval me faisait savoir qu'il avait fourni à M. Philippe Pierre-Adolphe « tous les renseignements qui étaient à sa connaissance sur le sujet », et qu'il transmettait ma lettre « au président en exercice de la BLFC, M. Pascal Fouché », lequel, selon lui, pourrait m'apporter les informations que je demandais. La réponse de Fouché arrivera peut-être un jour, mais j'en doute.
Entretemps M. Pierre-Adolphe a téléphoné au « président en exercice de la BLFC ». Et enfin, en voilà un qui savait où se trouvaient mes cinq classeurs de documents denoéliens : chez lui, tout simplement. Comme le journaliste lui rappelait que toutes ces pièces avaient été mises à la disposition des chercheurs et qu'il faisait de la rétention d'informations, Fouché lui répondit qu'il pouvait appeler cela comme bon lui semblait, mais qu'il ne les communiquait pas.
Fouché s'arroge donc le droit de disposer seul de ce qu'on confie à l'organisme qu'il dirige. Quel recours pour l'auteur du dépôt ? Aucun. J'ai bien signé en 1982 un document attestant que j'offrais ces archives, mais je n'en ai pas même une copie. Tout cela était sans grande importance, à l'époque. L'affaire Denoël ayant cessé de me passionner, j'avais donné le résultat de mes recherches à qui en ferait meilleur usage, voilà tout.
Aujourd'hui je me pose quelques questions. Depuis combien de temps le « président » Fouché chambre-t-il mes denoëleries ? La BLFC n'avait pas de catalogue, il était facile de les soustraire à la curiosité des visiteurs. Autant dire que ces dossiers ont à peine existé, puisque les documents utilisés par les deux chercheurs cités plus haut sont référencés « BLFC », sans plus. Ce pauvre Denoël n'a pas de chance ! Même archivé, il tourne fantôme.
En relisant les notes du livre de P.-E. Robert, j'ai tout de même découvert deux lettres de Denoël portant la référence : « Inédit. Fonds Denoël, IMEC ». Il y a donc un fonds Denoël à l'IMEC. Derval ne m'a pas écrit formellement qu'il n'existait pas. Et Fouché n'a pas écrit qu'il le détenait. Tout va mieux ! Les documents sont inaccessibles mais ils existent, c'est déjà ça.
J'ai relancé Derval, lequel s'est bien gardé de répondre à ma question, qui était toute simple : quel est le statut du fonds Denoël à l'IMEC ? Il a, c'est un fait, appartenu à la BLFC, mais qu'est devenue la BLFC ? Puisque Derval renvoie mon journaliste à Fouché, « président en exercice », c'est qu'elle existe toujours. A quelle adresse ? A celle de l'IMEC, lequel a absorbé une partie de ses collections, monnayées par Dauphin, après son évincement par Fouché. Pourquoi maintenir la BLFC à l'IMEC, et pourquoi Derval accepte-t-il les ukases d'un Fouché, accessoirement directeur du développement d'Electre, organe de pointe du Cercle de la Librairie française ?
Un joli mic-mac, dans tous les cas, et qui ne fait pas honneur aux intéressés. Mais je suis sans excuse puisque j'ai côtoyé ce petit monde durant des années et que j'ai pu vérifier qu'il n'existe nulle part ailleurs clique plus sournoise, intéressée, manipulatrice, carriériste. Avais-je vraiment le droit de penser que l'intérêt des Lettres passerait avant les intérêts privés ? Quand on confie de l'inédit à un « chercheur », son souci majeur est de le cacher aux autres, et de l'utiliser pour ses propres « communications ». C'est la loi du genre, elle n'a pas d'exceptions. Toutes ces carrières sont bâties sur le cannibalisme absolu, sans remords, sans merci.
Qui se souvient de Jacques Boudillet ? Qui sait combien de documents extraordinaires il a exhumés, de correspondances il a débusquées, de pistes il a tracées, de la Bretagne au Danemark, pendant des années, pour le plus grand profit des carriéristes tard venus ? Sa belle documentation : phagocytée, céliniens ! On en trouve des morceaux de choix dans plusieurs ouvrages « pionniers » des années 70-80, signés de noms prestigieux, et qui font référence. Il a tout de même reçu une petite médaille en chocolat : son nom figure sur l'Album Pléiade auquel il a collaboré.
Personnellement je me fous des médailles mais j'ai horreur des prédateurs sournois, des salopes opportunistes. A l'IMEC comme à la BLFC, je le dis bien haut, ce sont des vampires des Lettres, indignes des archives qu'on leur confie. Ces gens-là reçoivent des crédits du ministère de la Culture pour gérer un fonds de documentation, et ils ne font rien d'autre que de monnayer des « primeurs » à quelques comparses qui leur renverront d'opportuns ascenseurs, le moment venu. Tout ça pour la plus grande gloire de Louis-Ferdinand Céline, bien entendu.
2008
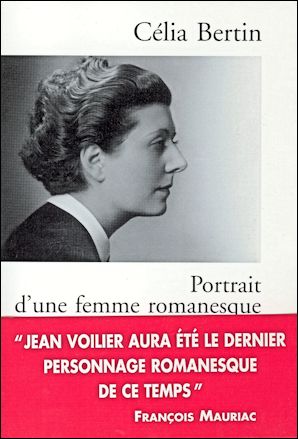
© L'ouvrage de Célia Bertin, qui n'est pas une biographie de Jeanne Loviton mais une sorte de « portrait » intimiste, est paru en février. Je l'ai signalé sur mon site avant d'en rédiger un compte rendu dans Le Bulletin célinien n° 296 d'avril 2008. Le texte a été reproduit ensuite sur un site Internet consacré à Louis-Ferdinand Céline.
Une biographie complaisante
La parution en février de cette biographie a été saluée poliment par la presse qui, généralement, s’est bornée à reproduire le prière d’insérer de l’éditeur. Paresse des chroniqueurs ? Désintérêt pour une égérie oubliée, ou pour une biographe de 88 ans qui a rédigé un livre un peu embrouillé ? J’avais bien des raisons de décortiquer ce travail où les non-dits sont plus importants que la prose en zig-zag de l’auteur, et je me suis appliqué à relever les sources qui concernent Céline, Pierre Frondaie et Robert Denoël.
Dans L’Express, Jérome Dupuis regrettait que Célia Bertin eût totalement occulté les passes d’armes entre Jeanne Loviton et Louis-Ferdinand Céline : par bienséance ? se demandait-il, en rappelant qu’elle avait écrit à son sujet : « Ses injures sont si énormes qu’elles peuvent être rapidement écartées ». On n’écarte pas si aisément Céline : Mme Bertin aurait mieux fait de se pencher sur certaines de ses accusations, à première vue insensées.
Certes ses lettres envoyées du Danemark entre 1947 et 1950 sont outrancières : l’écrivain en veut à cette nouvelle éditrice inconnue qui refuse de le rééditer et il demande à ses correspondants parisiens des détails croustillants à son sujet qui lui permettront d’en faire une « mère Cascamèche » manipulatrice, lesbienne juive débridée et « probable assassine » de son éditeur. Mme Bertin préfère croire que Céline était « dévoré par la haine qu’il nourrissait contre Robert Denoël et qu’il avait reportée sur Jeanne.»
Leur utilisation aurait sans doute mené trop loin Célia Bertin, mais aurait permis de prendre connaissance des lettres envoyées par Jeanne Loviton à Céline : car cette égérie archivait tout ce qui la concernait ou, du moins, ce qui n’écornait pas sa légende. Pour parfaire l’image qu’elle voulait laisser d’elle, elle avait rédigé en 1969 un « Curriculum vitae » dont Célia Bertin s’est servi tout au long de son livre, en oubliant que « Jean Voilier » était aussi romancière.
C’est pourquoi le chapitre consacré à Pierre Frondaie sort tout droit de ce pensum écrit à la troisième personne par Jeanne Loviton, qui fut sa femme entre 1927 et 1936. Or les archives personnelles de Frondaie ont été déposées en 2002, trois ans après que Mme Bertin eût entamé ses recherches : on ne voit pas ce qui a pu l’empêcher de les consulter ou de rechercher l’endroit où elles avaient été entreposées.
Outre le « Curriculum vitae » lovitonien, quelles ont été ses sources pour les pages consacrées à Robert Denoël ? Elle l’écrit en début de volume : elle a rencontré Pascale Froment, auteur de La Grande Biographie de l’éditeur que l’intelligentsia parisienne annonce depuis des années. On a peine à croire que l’ouvrage de Mme Froment contient cette version lovitonienne de l’assassinat des Invalides, telle que nous la sert Mme Bertin.
Il faut croire que Mme Célia Bertin a volontairement gommé les péripéties judiciaires qui ont succédé à l’assassinat de Denoël, puisqu’il s’est trouvé une autre biographe, oubliée dans les remerciements, pour lui communiquer le texte du rapport d’enquête établi en 1950 par la police judiciaire et ce rapport-là remettait en cause le témoignage de Jeanne Loviton. Mme Célia Bertin, qui instruit surtout à décharge, a préféré le passer sous silence.
Quant aux lettres de Denoël à sa maîtresse utilisées dans le livre, ce sont les mêmes qu’avait sélectionnées en 1982 Jeanne Loviton pour mon édification, avant de m’en fournir des copies soigneusement caviardées. Faut-il croire que les ciseaux de sa fille adoptive ont fait le même choix, vingt ans plus tard ? Les extraits qui figurent depuis 2005 sur mon site « Robert Denoël, éditeur » sont identiques à ceux publiés dans le livre de Mme Bertin qui, je préfère le croire, doit ignorer mes publications sur l’Internet.
La grande affaire de Mme Bertin a été de révéler l’étrange ascendance de Jeanne Loviton, édulcorée dans son « Curriculum vitae » : sa mère, Juliette Pouchard, était « de petite bourgeoisie, et son père, Fernand Loviton, orphelin d’un père officier supérieur, abandonna ses études de droit pour l’épouser. » Considérant les précisions qu’elle donne ailleurs, c’était en effet un peu trop conventionnel, et Mme Bertin s’est dit qu’il fallait approfondir davantage cette question.
Elle le fait curieusement : « Avec les éléments que j’avais ou avais eu entre les mains, je pense que j’ai longtemps refusé d’admettre ce qui était à l’origine le vrai drame, la souffrance de toute sa vie : la blessure laissée par sa naissance hors mariage. [...] Un jour, une copie de l’acte de naissance de la préfecture de la Seine, me fut montrée.» N’est-il pas d’usage, pour un chercheur, de se procurer d’abord ce document, qui ne coûte que quelques euros à la préfecture, et que j’ai reproduit dès 2006 sur mon site ?
Juliette Pouchard, « artiste », est une fille-mère, et Jeanne, une bâtarde, selon le langage d’alors. Le mariage de Fernand Loviton avec sa mère n’eut lieu que le 24 juillet 1913, alors qu’elle avait dix ans. Or Juliette Pouchard, dont le nom d’artiste était Denise Fleury, n’a rencontré Ferdinand Loviton qu’en juillet 1907 : il n’a donc pas voulu réparer une faute commise en 1902. Jeanne est l’enfant d’un autre, resté inconnu.
A cet endroit Mme Bertin place un commentaire singulier. Ayant relevé que Juliette Pouchard était domiciliée dans une rue du XVIIe arrondissement proche du boulevard Péreire, elle nous apprend que ce quartier était alors habité « par des actrices d’une renommée moyenne et par des demi-mondaines, d’un rang inférieur à celles qui tiennent le haut du pavé, en résidant dans le VIIIe arrondissement ».
Il est probable, poursuit-elle, que Juliette Pouchard « appartient à l’une de ces deux catégories sociales ». Laquelle ? elle ne le dit pas. « Et comment, de quoi vivaient-elles ? Denise avait-elle renoncé à ses talents d’ « artiste » ? Mme Bertin suggère bien « chanteuse » ou « diseuse » ou « peintre », mais corrige aussitôt : « Cela est moins plausible mais peut-être plus honorable ».
Quels lourds secrets Célia Bertin avait-elle à révéler à propos des « talents » de la mère de Jeanne Loviton, morte le 16 avril 1935, on ne le saura pas. Et d’autre part, elle croit qu’ « il n’existe plus de piste pour rejoindre les membres de cette famille maternelle que Jeanne, sûrement, voulut oublier. »
Célia Bertin paraît ignorer que Juliette Pouchard n’était pas la première fille-mère de la famille. Sa propre mère, Jeanne Jotras, l’avait mise au monde en 1876 alors qu’elle avait dix-neuf ans, de père inconnu, et avait épousé en 1880 l’orfèvre Louis Pouchard, qui avait alors donné son nom à la petite fille. Ainsi Juliette Pouchard porta le nom de Jotras durant trois ans, tout comme Jeanne Loviton s’appela longtemps Pouchard, ou Fleury, du nom d’artiste de sa mère.
Il y avait, après cette succession de naissances illégitimes, de quoi créer un vrai « syndrome du bâtard » dans la famille, et placer l’existence de Jeanne Loviton sous le signe de la dissimulation, du désir de revanche, et de la réhabilitation.
« Jeanne-Jean » devint une aventurière aux goûts de luxe qui traversa quantité de milieux où elle conquit hommes et femmes avec beaucoup de brio. On ne trouve guère de sincérité chez cette égérie, tout au moins avec les personnes de l’autre sexe, mais Mme Bertin préfère croire qu’il s’agit de sincérités successives.
En réalité elle avait un compte à régler avec les hommes, à commencer par celui qui fut son père biologique, qu’elle finit par retrouver en 1942. Là encore, Célia Bertin préfère biaiser : Jeanne l’a rencontré, elle connaît son nom, mais préfère nous le livrer sous la forme d’une charade. Son vrai père était alors « un ingénieur agronome, il vit à la campagne où il s’occupe d’un haras. Il a aussi un bureau à Paris dans le VIIIe arrondissement, près de la gare Saint-Lazare, où il exerce le métier d’expert, évaluant des propriétés.»
Jeanne l’a retrouvé grâce à un billet à ordre daté de 1913 et signé d’un nom à particule, le même que celui d’un historien né, comme elle, en 1903. En fait il a abandonné sa mère pour épouser une cousine, elle-même enceinte de ses œuvres ! Et cet enfant, qui porte son nom, est devenu archiviste-paléographe, spécialiste du XVIIIe siècle. Jeanne Loviton ne fait jamais rien à moitié : pour s’assurer qu’il s’agit bien du même père, elle devient la maîtresse de ce lointain cousin, et obtient les précisions qu’elle voulait.
Que voulait-elle, au juste ? Se trouver une ascendance digne du personnage qu’elle s’était façonné : une bâtarde royale, en somme. Malheureusement le noblion coupable de sa naissance lui paraît bien « ordinaire ». Elle l’oublie donc, définitivement. Cécile Denoël, enfant illégitime, elle aussi, avait eu plus de panache en donnant à ses mémoires le titre : « La Bâtarde ». Il est vrai que Cécile savait d’où elle venait. Pour Jeanne, tout reste à vérifier.
Cette femme tout en calculs et manœuvres nous est présentée par Célia Bertin comme « le dernier personnage romanesque de ce temps », selon le mot de François Mauriac qu’elle a apposé sur la bande-annonce de son livre. Mais c’est un mot que Mauriac n’a pas écrit, et s’il l’a dit, c’est à Jeanne Loviton elle-même car elle était la seule à s’en souvenir.
Célia Bertin nous aura proposé une lecture complaisante des écrits autobiographiques de Jeanne Loviton romancés par Jean Voilier. Cette femme multiple et fascinante méritait mieux que ces 320 pages d’hagiographie. C’était sans doute un livre de trop pour Célia Bertin, qui n’a pas été à la hauteur de son sujet.
© En avril parut un deuxième « Spécial Céline » de La Presse littéraire. Il contient, aux pages 134-136, un texte relatif à la découverte de Voyage au bout de la nuit par Denoël, suivi de : « Comment j'ai connu et lancé Louis-Ferdinand Céline », datant de 1941 et publié en 1989 par Le Bulletin célinien. Il a été repris aux pages 32-34 d'un « Spécial Céline » n° 12 paru en avril 2014.
Mythes et légendes
L'histoire du manuscrit de Voyage au bout de la nuit déposé subrepticement rue Amélie, en juin 1932, par un écrivain inconnu qui aurait oublié de donner son adresse, m'a toujours fait sourire. On sait que Céline a déposé une copie dactylographiée de son roman chez Gallimard et chez Figuière - peut-être aussi chez Bossard et chez Kra - avant de le proposer chez Denoël et Steele. Chez Gallimard, où il fut réceptionné le 14 avril 1932, on tarda à lui répondre mais une correspondance existe, qui montre l'impatience de l'auteur à se faire éditer. Chez Eugène Figuière, on met plusieurs mois avant de lui faire une proposition, mais on connaît son adresse.
Pourquoi, chez Denoël et Steele, Céline aurait-il fait preuve de désinvolture avec le manuscrit d'un roman dont il écrivait, deux mois plus tôt, à Gaston Gallimard : « C'est du pain pour un siècle entier de littérature » ?
Je montrerai bientôt, sur mon site Internet consacré à Robert Denoël, la part de fantaisie (très calculée) que le jeune éditeur mettait dans ses communiqués de presse, afin de promouvoir le roman d'un écrivain inconnu. Rappelons simplement qu'en 1929, il avait réussi le tour de force de transformer en portier d'hôtel borgne un artiste-peintre dont il avait publié le premier livre, ce que l'auteur regretta ensuite : « A l'origine, Denoël et moi avons fourni les éléments d'une légende touchante. Maintenant, elle est connue de tous ; avec le " populisme ", ce sera un poids qu'il me faudra traîner », écrivait Eugène Dabit, un an après la parution de L'Hôtel du Nord.
Examinons le témoignage des personnes présentes aux Editions Denoël et Steele en juin 1932. Depuis avril 1930, cette petite maison d'édition emploie six personnes rémunérées : Robert Denoël et Bernard Steele, gérants ; Auguste Picq, comptable ; Madeleine Collet, secrétaire ; Max Dorian, attaché de presse ; Georges Fort, emballeur et réceptionniste. Plusieurs amis et parents vont et viennent rue Amélie, sans qualification particulière : Cécile Brusson, la femme de Robert Denoël ; Robert Beckers, chargé de la publicité ; Juliette Geneste, sa femme, devenue par la suite Mme Jean Delannoy.
Robert Denoël parle, dans le texte ci-après, d'un manuscrit enveloppé dans un papier d'emballage dont l'étiquette portait l'adresse d'un de ses confrères. Sur l'étiquette, le nom d'une dame qui lui avait envoyé cette semaine-là un autre manuscrit, le sien. Les deux manuscrits ne sont donc pas arrivés ensemble rue Amélie. Bernard Steele déclare : « Figurez-vous que j'arrive un matin chez Denoël et Steele et mon associé me dit : " J'ai pris hier soir un manuscrit sur le bureau. Je l'ai lu. Il s'appelle Voyage au bout de la nuit d'un certain Louis-Ferdinand Céline. " [...] On cherche alors le papier d'emballage : il y avait l'adresse d'une dame. On lui envoie un petit mot. » Max Dorian parle d'une visiteuse qui vante les mérites du roman dont elle apporte elle-même le manuscrit. Philippe Hériat confirmera plus tard son récit.
Dans cette version, il ne peut y avoir aucun mystère quant à l'auteur du livre, puisque c'est lui qui envoie cette « intermédiaire bénévole ». Cécile Denoël écrit : « Alors que nous étions au théâtre, un inconnu avait apporté rue Amélie un paquet qu'il avait remis au vieux Georges après la fermeture de la maison. Au moment de remonter à l'appartement, Denoël, selon son habitude, passe par son bureau », découvre le manuscrit et s'y plonge toute la nuit. Le lendemain on cherche l'adresse de l'inconnu, on interroge le magasinier, qui répond : « J'allais m'en aller quand on a sonné. J'ai ouvert. Ce monsieur m'a demandé si vous étiez là. J'ai dit non. Alors il m'a dit : " Bon, ça ne fait rien, donnez-lui ça. " J'ai bien demandé de la part de qui, il a répondu : " Ça n'a pas d'importance ". Et il est parti. J'ai mis le paquet dans votre bureau. » Cécile ajoute que Georges décrit ainsi le visiteur : « C'est un monsieur grand, un peu dans votre genre, patron, grand et mince, avec une houppelande comme la vôtre... » Pour le reste elle confirme l'histoire du manuscrit enveloppé dans un papier d'emballage portant le nom d'une dame habitant Montmartre.
Juliette Geneste a aussi donné sa version en août 1945 à Jean Galtier-Boissière, qui l'a retranscrite dans son Journal : « On reçoit un soir un manuscrit ; elle en lit cent pages, les trouve extraordinaires, en parle avec enthousiasme à Robert Denoël qui, jusqu'au petit matin, dévore le Voyage au bout de la nuit. Puis l'éditeur se précipite à l'adresse indiquée par l'auteur ; mais rue Lepic il ne trouve qu'une femme de ménage ; elle indique que le docteur est à son dispensaire. Denoël y court, fait signer un contrat. »
Il est impossible de ne pas voir dans tous ces témoignages la part déterminante que chacun voudrait avoir prise dans la découverte du fameux manuscrit. Le seul témoin fiable aurait été Georges Fort, le magasinier, dont il est avéré qu'il a réceptionné le volumineux envoi.
Quelle que soit la version choisie, une dame intervient dans la remise du manuscrit. Celle du « papier d'emballage » habitait le même immeuble que Céline à Montmartre et a été identifiée récemment par Laurent Simon : elle s'appelait Denise Cools (1903-?) et avait publié deux ouvrages quand elle rencontra Denoël en juin 1932 : La Palette chez Messein en 1926 et Pour une dame qui se croyait vivante aux Editions du Tambourin en 1931. Le catalogue de la Bibliothèque Nationale n'en mentionne pas d'autre.
C'est à peu près tout ce qu'on peut tirer des différents témoignages recueillis entre 1933 et 1973. Si l'on examine les faits, les dates, et les chiffres, qui contrastent avec l'enthousiasme rétrospectif des principaux témoins de cette époque, une autre version peut être proposée. Deux ans après sa constitution, la Société des Editions Denoël et Steele est déficitaire. En 1931 elle a publié 26 ouvrages, en 1932 elle n'en fait paraître que 17. Les dépenses publicitaires ont absorbé une part importante du budget et un prix Renaudot n'a pas suffi à éponger ses dettes.
Le 14 avril, Céline a déposé son manuscrit chez Gallimard, et il relance cet éditeur jusqu'au 13 juin : après cette date, un accord a été passé avec Denoël. Entre le 13 et le 30 juin 1932, des nuits de doute ont succédé aux jours d'enthousiasme. Denoël doit persuader son bailleur de fonds d'injecter de l'argent frais dans la société, et Bernard Steele ne possède pas en propre l'argent nécessaire : c'est sa mère, Beatrice Hirshon, qui possède les fonds.
Le 30 juin on signe un contrat qui ressemble fort à un compte d'auteur : pas de droits avant le 3 001e exemplaire vendu. Le 1er octobre, quinze jours avant la mise en vente du roman, Mme Hirshon verse 65 000 francs à la société dont elle devient actionnaire, et le Voyage peut enfin décoller.
Mais tout le monde préfère la légende de l'inconnu à la houppelande qui dépose, un soir, son manuscrit en oubliant de donner son nom et son adresse.
2010

© Le catalogue de cette bibliothèque célinienne appartenant à Patrice Espiau, tiré à huit exemplaires, n'a pas été commercialisé, pas plus que les livres et documents qu'il contient : c'est un inventaire de 175 pages (352 numéros). Chaque thème est précédé d'une introduction par Patrice Espiau, Ségolène Beauchamp, Eric Mazet, Jean-Paul Louis, et Marc Laudelout. Je me suis chargé de préfacer le chapitre « Robert Denoël » :
Robert Denoël (1902-1945)
Bruxellois de naissance mais Liégeois de formation, Robert Denoël fut un élève moyen, un soldat médiocre, un universitaire désinvolte - mais un fin lettré. Rien d’autre n’avait d’importance, à ses yeux, que la littérature française. Quand il mit le pied à Paris, en 1926, c’est tout naturellement dans une librairie qu’il débuta. Deux ans plus tard, sans le sou, il lançait son premier livre. Au quatrième, il tenait déjà un succès : L’Hôtel du Nord.
Rejoint peu après par un dilettante américain qui lui apportait l’argent dont il manqua toujours cruellement, il publiait le plus grand roman de son siècle. Succès absolu, inexpiable, pour l’auteur comme pour l’éditeur : « C’est pour le Voyage qu’on me cherche ! », écrira Céline, plus tard.
Pour Mort à crédit ce fut un déluge d’anathèmes, auquel Denoël répondit crânement par une courageuse Apologie, cependant que le franc du Front Populaire fondait inexorablement. Huit prix littéraires n’empêchèrent pas Bernard Steele de quitter le bateau qui, durant cinq ans, allait voguer au gré des tourmentes politiques et financières.
Dix ans après ses débuts, Denoël pouvait s’enorgueillir de quelque 500 titres inscrits à son catalogue, mais sa maison d’édition, qui faisait vivre 14 employés, n’était plus qu’une coquille vide : faute de capitaux, il en était réduit à publier des livres aux frais de leurs auteurs.
Un partenaire financier se présenta en 1941 mais ce n’était pas un mécène : cet éditeur participait, comme ses confrères allemands, à une politique de prises de contrôle des maisons d’édition françaises. Il fallut s’en accommoder.
A la Libération, 12 ouvrages furent reprochés à Denoël, dont trois pamphlets de Céline, et un de Rebatet, qui avaient été les « best sellers » de l’Occupation. Les témoignages d’auteurs communistes qu’il avait publiés et protégés lui firent défaut. Il était devenu le bouc émissaire de l’édition parisienne qui, comme lui, avait eu recours aux services de la Propaganda Staffel, mais avec moins de succès que lui.
Un non-lieu fut prononcé en juillet 1945 mais la menace n’avait pas disparu. On pensait à lui dans les ténèbres, il l’avait compris, et il constitua un dossier fort dangereux à charge de ses confrères, où il démasquait leurs sociétés écrans, leurs capitaux douteux, leur marché noir du papier, leurs relations avec les autorités allemandes.
Denoël eut l’imprudence d’en parler. Ses jours étaient désormais comptés. Son exécution eut lieu le 2 décembre 1945, d’un seul coup de colt, tiré dans le dos. « Crime crapuleux », déclara la police, le soir même.
Trois enquêtes demandées par sa veuve aboutirent à un non-lieu. Sa maîtresse hérita de sa maison d’édition, qu’elle céda peu après à son concurrent le plus hargneux : Gaston Gallimard.
« La maison, naguère minuscule et poussiéreuse, élève largement et hautement sa façade. Il en sort beaucoup de livres, qui ne sont pas ceux que son fondateur eût choisis. Et les auteurs auxquels il tenait le plus sont partis, happés par l'Ennemi triomphant. La quantité a remplacé la qualité, sous le regard impersonnel d'Amélie. Mais le tiroir-caisse tinte plus souvent qu'en 1930, et c'est un bruit qui aurait enchanté l'agile Robert. Un éditeur qui aimait l'argent. Mais pas plus que la littérature », écrivait Robert Poulet, trente ans après sa mort.
Il restait à cet éditeur hors normes à poursuivre, par-delà la mort, un parcours aussi chaotique que sa carrière : inhumé dans un caveau provisoire, où il fut bientôt oublié, son corps fut jeté, le 3 juillet 1973, dans une fosse commune du cimetière de Thiais.
2011
© Cet entretien Emeric Cian-Grangé - Henri Thyssens a été publié sur le site du Petit Célinien le 11 octobre, dans le cadre de la série « Les Entretiens du Petit Célinien ».
Vous avez écrit : « A vingt ans j'ai suivi à la trace un homme qui m'échappera toujours, je le sais bien. » Cet homme, assassiné d'une balle dans le dos le 2 décembre 1945, s'appelait Robert Denoël. Comment expliquer semblable engouement pour celui qui fut, de 1932 à 1944, l'éditeur de Louis-Ferdinand Céline ?
Il s’est trouvé que l’éditeur de Céline était Liégeois, et qu’il fut assassiné dans des circonstances non élucidées. Quand on est du pays de Simenon, et qu’on a vingt ans, on ne peut s’empêcher de jouer les Rouletabille. En 1975, j’arrivais en terrain vierge. Personne ne s’était penché sur sa vie et sa carrière. Sa famille voulait l’oublier, il lui faisait honte ! La preuve : elle l’a laissé pourrir dans une fosse commune. Ce fut l’élément catalyseur. Un challenge, en somme.
Vous lui consacrez d'ailleurs un site Internet (www.thyssens.com). Fruit d'un travail érudit, réactualisé en permanence, il rend hommage au seul éditeur assassiné à la Libération. Quel genre de chercheur êtes-vous ? Quelles sont vos méthodes de travail ?
Solitaire et sans méthode. Je travaille à l’instinct. Jeanne Loviton, à qui j’avais écrit sans vergogne qu’elle avait sans doute « trempé dans la soupe », me disait qu’heureusement, mon instinct sauvait la mise. J’ai un peu de culture générale, de la mémoire, et le sens du classement.
Robert Denoël avait à son actif environ 700 publications, dont certaines ont obtenu un succès considérable, à l'image de Voyage au bout de la nuit (1932), ou de l'ouvrage de Lucien Rebatet, Les Décombres (1942). Il a également publié les écrits de combat de Louis-Ferdinand Céline, ainsi que l'essai politique de George Montandon, Comment reconnaître le juif (1940), dans la collection « Les Juifs en France ». Est-il possible de dresser avec justesse le portrait de celui que Céline qualifiait de « zèbre » ? Quels sont les écueils à éviter quand on travaille sur un dossier aussi sensible, sujet à de nombreuses controverses ? Est-il par ailleurs risqué d'évoquer les circonstances mystérieuses de son assassinat ?
Le mot de Céline m’avait amusé. Louise Staman (qui a rédigé un petit essai inédit : « Le Zèbre tricolore ») m’a rappelé l’étrange personnalité du zèbre : est-il blanc à rayures noires, ou noir à rayures blanches ? C’est tout Denoël : un hybride très attachant, un miroir à deux faces. Robert Poulet soulignait son côté cauteleux, Céline son côté arrogant. Il était les deux.
Les différentes enquêtes policières ont été scellées par un non-lieu définitif prononcé le 28 juillet 1950 par la cour d’appel de Paris. On ne peut donc plus mettre qui que ce soit en cause dans l’affaire de son assassinat, mais on a le droit d’en exposer les circonstances. Comme disait l’autre : « Je ne balance pas, j’évoque.»
Le côté sensible de l’affaire ? La France est le seul pays occupé à avoir collaboré activement. Le sentiment honteux qui l’accable depuis plus de soixante ans l’amène à chercher des boucs émissaires. C’était déjà le cas en 1945. La collaboration intellectuelle, c’est une histoire belge. On n’a rien trouvé de mieux.
Dans une lettre adressée à Milton Hindus (28 juillet 1947), Céline écrivait : « Denoël n'a jamais rien compris - Il m'a édité par hasard - Il a essayé par la suite de retrouver, détecter, découvrir 20 Célines, 20 fours. » Qu'aurions-nous retenu de l'homme et de son entreprise s'il n'avait pas publié Céline ? Aurait-il connu un autre destin ?
Denoël savait lire, et même s’il n’a pas publié Voyage dans l’urgence de l’enthousiasme, comme on l’a cru longtemps, il est un des seuls à avoir compris la force novatrice de Mort à crédit. Son Apologie est là pour le rappeler. Denoël sans Céline ? Impossible à imaginer. Ces deux-là devaient se rencontrer. Vous voyez Céline chez Gaston dès 1932, émasculé, et le Goncourt dans un fauteuil... ? A livre révolutionnaire, éditeur intrépide.
Nous connaissons votre intérêt pour l'œuvre de l'auteur de Mort à crédit. Vous êtes notamment l'éditeur de sa correspondance avec Evelyne Pollet (in : Cahiers Céline, 5) et le fondateur de la série Tout Céline (1981-1990). Que pensez de ce qu'il écrit à Claude Lafaye, le 20 octobre 1947 : « L'écrivain, au fond, c'est le raté de tous les arts, poésie, musique, théâtre, politique, le bâtard de toutes les muses ! Qu'il lui soit beaucoup pardonné » ? Le considérez-vous néanmoins comme un écrivain majeur ?
Céline est l’écrivain le plus novateur du XXe siècle. Certains lui accolent Proust, pour se donner bonne conscience. Moi, non : même si son œuvre a été publiée au début du XXe siècle, Proust appartient au siècle précédent. Céline donc, tout seul.
Quels sont les ouvrages de Céline qui vous ont le plus marqué ? Pensez-vous par ailleurs que son œuvre traversera le temps et qu'il sera toujours possible, pour les prochaines générations, de lire Féerie pour une autre fois ou la trilogie allemande ?
Voyage, Mort à crédit, Bagatelles pour un massacre. Pour décrypter Féerie, il faut déjà un appareil critique. Pour la trilogie, il en faudra un plus imposant, si l’on se réfère à la culture générale affligeante qui se profile. Céline redeviendra un écrivain pour cénacles. Tant mieux : on voit bien le mal que son écriture a causé dans la littérature actuelle, qui n’en a retenu que la grossièreté. Il est resté incompris, le fils raffiné de la dentellière.
En 2003 vous avez édité « Tout Simenon » [La Sirène], un catalogue de vente [livres et autographes] consacré à « l'homme à la pipe ». Dans son ouvrage intitulé Céline, même pas mort ! (Balland, 2011), Christophe Malavoy fait dire à l'écrivain : « Mac Orlan, Simenon, ça sonne juste, tout de suite vous êtes dedans. Simenon est très fort pour ça. Il perd pas son temps à prouver qu'il sait écrire (...) Voilà, il vous a embarqué en deux, trois phrases, il vous lâche plus. Il y a du génie chez cet homme. Il y a ceux qui écrivent du dedans, comme lui, et les autres, du dehors. » Qu'est-ce qui rapproche les deux écrivains ?
Il a écrit ça, Malavoy ? C’est joliment dit. Céline et Simenon : une atmosphère immédiate, en effet. Ce qui les rapproche ? La mort, qui traverse tous leurs livres.
Pour conclure cet entretien, parlons de votre profession : vous êtes libraire, spécialisé en généalogie et héraldique, linguistique, livres illustrés et régionalisme. Le 8 octobre 1953, dans une lettre adressée à Paraz, Céline écrivait : « Mais le livre est agonique - il a fait son temps - Ce ne sont plus des livres les romans actuels, ce sont des scénarios - Le cinéma bouffe tout - Il restera les " livraisons " pour débiles mentaux qui traînent par millions dans les gares, les trains, les chiots, les ateliers. Ça ne se lit pas, ça se regarde. C'est d'ailleurs plein de photos. » Les professions du livre ont-elles encore un avenir ? N'est-il pas paradoxal d'être libraire et d'utiliser un support dématérialisé pour diffuser ses travaux sur Denoël ?
Touché. Un libraire qui renie le livre est un renégat, mais aucun éditeur n’aurait accepté de publier un ouvrage remis sans cesse sur le métier. Il a fallu, j’avais pas le choix : mon travail n’est pas terminé ; j’ajoute, je corrige en permanence. C’est vrai que le papier me manque, ça me turlupine. Cela ne date pas d’hier : pendant toute ma carrière j’ai vendu des livres de généalogie et de régionalisme, alors qu’il n’y a que la littérature française qui m’émeut. Je dois être pervers, ou masochiste, ce n’est pas fixé.
Mais je suis sûr d’une chose : je mène mes recherches sur Robert Denoël
avec probité, sans œillères, je n’occulte rien. Quand on se trouve dans
le dernier versant, on va à l’essentiel.
2013
© Article paru dans Le Bulletin célinien n° 348 de janvier :
La Rupture Steele - Denoël
Les raisons pour lesquelles Bernard Steele a quitté Robert Denoël, alors que leur maison d'édition venait d'enregistrer ses meilleures recettes grâce à plusieurs prix littéraires, restent un sujet de controverses. Pourquoi cet Américain fortuné, qui a investi beaucoup d'argent dans les Editions Denoël et Steele, se retire-t-il d'une affaire au moment où elle se rentabilise ?
Si l'on se tient à ses déclarations, Steele avait, très tôt, envisagé de faire de l'édition : « J'ambitionnais de publier des traductions d'auteurs contemporains, américains et anglais, dont la plupart n'étaient alors connus en France que de nom. » Après sa rencontre avec Denoël il décide d'abandonner ce projet « en faveur de celui, peut-être moins ambiltieux, que nous avions échafaudé ensemble : publier des ouvrages de jeunes auteurs français, ou de langue française. »
Leur association, qui date d'avril 1930, durera donc six ans. Celui qui apporte l'argent nécessaire à la constitution de leur société, c'est lui, mais pas entièrement. C'est sa mère, Beatrice Lesem, veuve de Charles Hirshon depuis peu, qui gérait la fortune familiale, laquelle ne lui était pas entièrement destinée puisque cinq enfants étaient nés de leur union entre 1904 et 1915.
Bernard Steele a épousé Mary Mocknaczski le 26 décembre 1921, et une fille leur est née le 28 novembre 1922. Le trio débarque à Paris début mai 1925 et habite au 9 rue Marbeau (XVIe) avant de s'installer dans un bel appartement de la rue Eugène Delacroix.
Que fait Bernard entre 1925 et 1929, date à laquelle il emménage au 7 rue Dupont des Loges, près de l'Ecole militaire ? On l'ignore, mais voilà un Américain sans emploi (et qui n'en cherche pas), père de deux enfants (sa seconde fille est née à Paris en 1926), qui habite durant quatre ans avec sa petite famille dans des quartiers chics de Paris, avec l'ambition de devenir éditeur, et qui n'y fait absolument rien.
A cette époque Sylvia Beach et Adrienne Monnier accueillent depuis plus de huit ans les intellectuels américains (Hemingway, Ezra Pound, Man Ray) et français (Larbaud, Gide, Valéry) dans leur librairie de la rue de l'Odéon : Steele ne paraît pas connaître « Shakespeare et C° » puisque c'est dans une vitrine des « Trois Magots » qu'il découvre, en décembre 1929, l'édition française d'Ulysse, publiée par la même Adrienne Monnier.
Bernard est en apparence un « désœuvré », mais il achètera en 1932 une villa à Montmorency pour s'y retirer quand la vie parisienne lui paraît trop trépidante. Anaïs Nin, qui le rencontre en 1933, écrit à son sujet dans son Journal : « Il est raffiné et malheureux. Je ne m'y trompe pas. Il ne s'intéresse pas à l'édition ni à la littérature, il veut vivre sa propre vie ».
Mais pour quoi faire ? Bernard est féru de musique classique : sa collection était estimée, à cette même époque, à plus de 2 000 « long playing ». A l'automne 1934 il a créé, avec un disquaire du boulevard Montparnasse, une société musicale : « L'Anthologie sonore », qui occupe un local au 19 rue Amélie (où René Barjavel trouvera celle qu'il épousera peu après) : il s'agit de musique ancienne, folklorique et classique. Dans une interview accordée en 1942 à un hebdomadaire belge, Denoël dira qu'après son départ, Steele « s'était investi dans la musique ».
En réalité, Bernard a quitté Montmorency au début des hostilités et s'est installé à Tourtour, près de Draguignan, au « Domaine des Chênes », un mas qu'il avait acquis en 1937 et qu'il quitta définitivement en juin 1940 pour rejoindre son pays d'origine. Revenons à notre propos : pourquoi Bernard Steele quitte-t-il Robert Denoël, en décembre 1936 ?
François Gibault, qui avait rencontré Bernard Steele et Cécile Denoël, écrivait sans ambages : « Il y avait eu entre eux bien d'autres sujets de dissensions et beaucoup de différends d'ordre financier. Steele, lassé de boucher les " trous " de l'entreprise et d'honorer les traites et autres engagements que Denoël prenait en imitant sa signature, lui avait vendu ses parts le 30 décembre 1936. »
Robert Beckers expliquait autrement le départ de l'Américain : « Steele intervenait dans les dépenses mensuelles pour 50 000 F, et parfois plus. Il finit par se croire exploité. »
Auguste Picq, le comptable des Editions Denoël et Steele depuis leur origine, m'écrivait : « Steele s'est fâché avec Denoël à cause de Céline dont il n'acceptait pas le comportement et les exigences. »
Céline aurait-il été au centre des dissensions entre les deux associés ? Ses pamphlets antisémites sont parus bien après le départ de l'Américain, sauf Mea culpa (décembre 1936) mais, comme l'écrit Steele, Céline ne lui aurait jamais témoigné d'e sympathie : « Après son retour de Russie, nos relations, déjà peu cordiales, se sont rapidement détériorées à cause de son antisémitisme naissant dont j'ai été, je crois, une des premières cibles. »
Chez Céline, l'antipathie est immédiate, en effet. Alors que Denoël passe ses vacances en Vendée, il lui écrit, le 3 août 1933 : « J'ai envoyé à Steel une lettre de verte engueulade à propos des comptes. Il me dégoûte. Voici trois jours que je lui demande 2 Voyage dont j'ai besoin et rien reçu. S'il fait toutes les livraisons de même, la maison est foutue. »
Une semaine plus tard il a reçu ses comptes mais cela n'apaise pas sa colère : « J'ai reçu de Steel hier enfin mes comptes. Je n'ai pas fini de me complaire à la lecture de ces faux notoires et tarabiscotés. »
Auguste Picq, qui était le véritable destinataire de ces lettres incendiaires, ne s'est jamais plaint de l'agressivité de l'écrivain, qu'il estimait. Bernard Steele (dont Céline estropiait systématiquement le nom) était donc bien la cible de ses sarcasmes.
Est-ce que cette atmosphère défavorable aurait pu provoquer le départ de l'Américain ? Personnellement je n'y crois pas, mais je m'interroge à propos d'un hebdomadaire conservateur, L'Assaut, dont Denoël avait, en août 1936, accepté la diffusion, et que Steele évoque à deux reprises : ce fut, dit-il, le motif de son départ.
Qu'était-ce donc que L'Assaut, dont le premier numéro parut le 13 septembre 1936 ? Commune, le mensuel d'Aragon, écrit en octobre que, « grâce à la libéralité de M. Fabre-Luce (des deux cents familles et du Crédit Lyonnais) vient de paraître un nouvel hebdomadaire, L'Assaut. [...] Les plus éminentes personnalités qui composent la section d'Assaut levée par M. Fabre-Luce [...] sont MM. Pierre Frédérix, Bertrand de Jouvenel, Georges Blond et Robert Brasillach. »
Frédérix est un « obscur fasciste », Jouvenel a servi Mussolini, Hitler, Doriot, Franco, et il est à présent « pensionné sur la cassette du comte de Paris ». Les hommes d'Assaut sont interchangeables : Blond et Brasillach sont aussi à Candide, à L'Action Française, à Combat... Il s'agit donc d'une querelle idéologique. L'Assaut est de droite, voilà tout.
Qu'est-ce qui aurait pu irriter Steele, dans ce journal, au point de quitter sa maison d'édition en pleine ascension ? Ce qui est sûr est qu'il ne s'agissait pas d'une question d'argent puisque, en 1945, le compte de Bernard Steele étaient toujours créditeur, rue Amélie, ce qui signifie que Denoël ne lui avait payé que partiellement ses parts dans l'affaire.
Le désaccord devait venir de beaucoup plus loin. Bernard Steele n'était pas un éditeur dans l'âme : il réclamait des « retours sur investissement » trop rapides. Et Denoël était un « flambeur » capable de mettre en difficultés leur fragile société, comme il l'avait fait en 1935 à propos des Cenci, la pièce théâtrale d'Antonin Artaud où un rôle avait été accordé à sa femme.
François Gibault me disait récemment : « Denoël et Steele, c'était une union contre nature. » C'est aussi mon avis. Louise Staman, qui travaille à la biographie de Bernard Steele, devrait mettre tout le monde d'accord.
© Article paru dans Le Bulletin célinien n° 351 d'avril.
Denoël et Céline : année 36
A la fin du mois de février, Robert Denoël a reçu les nouvelles exigences de Céline pour Mort à crédit, et il lui écrit qu'il est d'accord en principe sur tous les points : « Je ne veux pas discuter puisque vous êtes le plus fort », mais il proteste avec énergie contre deux points additifs au contrat existant. Céline exige d'être réglé chaque fin de mois sur les ventes aux libraires, pendant les six premiers mois qui suivront la parution du livre : « Je sais que vous faites allusion dans ce paragraphe aux versements d'Hachette, mais nous avons depuis deux ans un accord général avec Hachette, qui prend tous nos livres en dépôt et qui règle d'une façon convenable, au fur et à mesure des ventes, par conséquent il n'y a plus de versement comptant de ce côté. » Quant au « comptant » réglé par les libraires, il se réduit à très peu de chose, « car le libraire ne paie jamais pour un livre, mais pour l'ensemble de ses ventes du trimestre : il serait impossible de s'y reconnaître. »
L'autre exigence, moins raisonnable encore, serait de partager « à égalité entre l'éditeur et l'auteur » les bénéfices réalisés sur la vente des exemplaires de luxe : « Il nous est impossible d'évaluer ces bénéfices », répond l'éditeur, « le tirage des exemplaires de luxe étant compris dans le premier tirage de l'ouvrage. »
Denoël accepte néanmoins de donner à l'auteur « les droits maximums, c'est-à-dire 18 % du prix fort » sur ces ventes. Cette dernière concession lui sera funeste car Céline va bientôt exiger « les droits maximums » sur tous les tirages.
Le lendemain, le nouveau contrat d'édition « pour toute la production future » de Céline prévoit qu'il percevra 12 % du prix fort des exemplaires vendus de 0 à 20 000, 15 % de 20 001 à 50 000, et 18 % au-delà. L'auteur se réserve tous les droits de traduction et d'adaptation au cinéma et au théâtre.
Pour le paiement de ses droits d'auteur durant les six mois qui suivent la mise en vente d'un ouvrage, Denoël a accepté un système fort compliqué pour sa comptabilité, qui n'a plus rien à voir avec les règlements semestriels habituels dans l'édition française.
Il a donc à peu près cédé à tous les caprices coûteux de l'écrivain. Une clause nouvelle prévoit aussi que « l'auteur, en aucun cas, ne pourra être " cédé " à une autre " raison sociale ". »
Enfin l'écrivain a obtenu de faire supprimer la « passe », ce qui n'est pas rien : il s'agit de la quantité de papier supplémentaire à mettre en œuvre pour compenser la gâche due aux différents réglages des matériels. La passe est généralement exprimée en pourcentage, qui varie selon le chiffre du tirage, la qualité du travail et le nombre de passages sur machine que nécessite l'impression. Plus simplement, ce sont des exemplaires tirés en sus du tirage convenu pour pallier les éventuels défauts de fabrication. Son pourcentage oscille entre 5 et 10 % du tirage.
Est-ce que Céline a entendu parler des exigences de Simenon chez Gallimard ? En 1933 Gaston a accepté de signer un contrat avec le romancier stipulant que l'auteur et l'éditeur toucheront chacun 50 % des bénéfices réalisés sur chaque roman publié, étant entendu que Simenon en fournira six chaque année. Céline n'a pas la capacité d'écriture du Liégeois, mais ce qu'il obtient chez Denoël est très inhabituel. Il est vrai qu'en contrepartie l'éditeur a obtenu l'exclusivité de toute la production célinienne : c'est ce que l'écrivain, après la guerre, appellera une clause léonine, en occultant les avantages qu'il a lui-même obtenus.
Le 6 mars Bibliographie de la France annonce l'ouverture de la souscription aux tirages de luxe de Mort à crédit, soit 990 exemplaires, qui sera « irrévocablement close le 15 mars ». La parution du livre en librairie sera reportée à cinq reprises entre le 5 avril et le 25 mai, Céline apportant, jusqu'à la dernière minute, de nouvelles corrections.
Le 12 mars Denoël concède à Céline, toujours plus exigeant, « que les droits de 18 % prévus au-dessus de 50 000 exemplaires commenceront à courir à partir du 40 001e exemplaire », au moins pour Mort à crédit.
Mais, au cours des mois suivants, la presse se fait aussi l'écho de dissensions entre l'auteur et ses éditeurs à propos de passages scabreux du roman. « Dans Mort à crédit, il y avait trois pages impossibles à publier ; l'imprimeur refusait de les imprimer », dira plus tard Denoël à André Roubaud.
Cette affaire de censure a fait couler beaucoup d'encre et n'a toujours pas été éclaircie. On s'accorde à imputer à Robert Denoël la décision de caviarder ces passages litigieux. Selon lui, c'est l'imprimeur qui décide de ce qu'il peut, ou non, imprimer ! Pourquoi alors, refusera-t-il d'apposer son nom au colophon du livre, puisque les passages en question ont été caviardés ?
On ne croit pas un instant que Denoël - ne parlons pas de Steele, complètement absent de ce débat - ait, par pudibonderie, décidé de censurer un livre qu'il admire et auquel il va consacrer tous ses efforts pour le faire connaître. Il a parcouru tous les classiques érotiques et il en a publié à l'occasion. Ce qui doit l'effrayer, c'est de trouver, dans un roman qu'il sait exceptionnel et donc destiné à devenir classique, des passages d'une crudité insupportable. Céline a associé dans les scènes censurées, non pas amour et mort, comme à la fin du XIXe siècle - Denoël est, par sa formation, un homme du siècle précédent - mais sexe et merde. Le freudisme a fait son chemin en France depuis quinze ans, et Denoël a été l'un des premiers éditeurs à en diffuser l'œuvre, mais son application dans un roman doit le révulser.
Seul un avocat spécialiste de l'édition et de la presse aurait pu décider valablement du risque réel qu'il y avait à maintenir ces passages érotiques. Denoël en a consulté un, mais on ne sait lequel. Sous le titre : « Censure préalable », Le Nouveau Cri du 28 mars révèle que « l'éditeur a cru devoir, cette semaine, consulter un avocat sur l'opportunité de leur impression. Celui-ci a fait valoir que, depuis une quarantaine d'années, aucunes poursuites pour outrage aux mœurs n'avaient été décidées contre un écrivain français et que, par conséquent, il conseillait d'imprimer carrément les passages incriminés (vingt-cinq pages environ sur les six cent cinquante du manuscrit). Cependant l'éditeur hésite... [...] En dernière heure, un accord semble être sur le point de se réaliser quand même. Le livre paraîtra mais, à la place des lignes litigieuses, l'éditeur, prenant seul la responsabilité de cette censure préalable, fera imprimer des lignes de points. » Le 12 juin Elie Faure écrivait à Céline : « Pourquoi avoir consenti à supprimer justement les passages érotiques ? Concessions trop larges aux éditeurs, à mon sens. »
Je n'ai, jusqu'à présent, aucune indication quant à l'opinion de l'éditeur, autre que celle qu'il a propagée dans les journaux de cette époque. Je note simplement que, dans le domaine du sexe, Denoël fut plus sourcilleux que dans celui de la politique, où Céline allait le mener, l'année suivante.
Le 30 mars Denoël, à la fois amer et ironique, écrit à Céline, qui a encore fait valoir on ne sait quelle exigence à propos du paiement de ses droits d'auteur : « Il m'est absolument indifférent de vous régler par traite ou par chèque, dès l'instant que nous nous mettons d'accord sur la somme à décaisser quelques jours à l'avance. Ne craignez pas de me ruiner : au contraire, j'ai toujours considéré votre présence dans cette maison comme une source appréciable de revenus. Soyez assuré de ma reconnaissance. »
Le 9 mai Le Nouveau Cri annonce la mise en vente de Mort à crédit, retardée à cause de l'écrivain et de sa méthode de travail. Jusqu'à la dernière minute il a procédé, sur le manuscrit, à de multiples corrections : « Il fallut alors le lui arracher quotidiennement, par petites feuilles dactylographiées couvertes de ratures. Et les jours passèrent après les jours, tandis que l'imprimeur et l'éditeur se désolaient : « Mort à crédit, gémissait Denoël ; mais moi, il m'assassine comptant ! »
La mise en librairie du roman, tiré à 25 000 exemplaires, a finalement lieu le 12 mai. Denoël a bien obtenu de l'auteur que l'on supprime les passages « contraires aux bonnes mœurs » mais Céline a exigé que ces passages figurent en blanc dans le texte.
Dans Bibliographie de la France Denoël passe cette annonce retentissante : « Cet ouvrage, qui sera une date dans l'histoire des lettres françaises, s'annonce comme un formidable succès. Les commandes que nous avons déjà notées dépassent tellement nos prévisions les plus optimistes qu'une réimpression sera nécessaire avant même la mise en vente. »
L'éditeur a aussi prévu deux affiches, une en largeur, une en hauteur, qui seront envoyées aux libraires en même temps que les « offices », mais pas de photo de l'auteur, « qui s'oppose à la mise en vitrine de son portrait ». Chaque jour ou presque, Denoël passe des « réclames » flamboyantes en faveur du livre dans les journaux à gros tirages, comme Paris-Soir ou L'Intransigeant.
Le 16 mai Le Nouveau Cri fait de nouveaux commentaires sur les passages caviardés du roman : « Cependant, il en reste. Et, à la dernière minute, l'imprimeur a refusé de mettre son nom à la fin de l'ouvrage, craignant sans doute pour la réputation de sa firme. Mais la loi est formelle : il faut un nom d'imprimeur. Alors c'est l'éditeur qui a mis le sien, prenant ainsi la responsabilité totale de la publication. » En effet, au colophon, c'est l'indication : « Imprimerie des Editions Denoël et Steele, 19, rue Amélie, Paris » qui a été subsituée au nom de l'imprimeur Robert Bussière, 74 rue Lafayette, à Saint-Amand.
Mort à crédit ne se vend pas aussi rapidement que prévu. Le volume coûte cher et la crise est sévère pour tout le monde. Robert Denoël, qui se refuse à baisser son prix de vente, doit faire preuve d'ingéniosité. En témoigne cette annonce qu'il fait publier, sous le titre « Economie », dans L'Intransigeant du 26 mai : « Que vaut-il mieux ? Acheter trois volumes insignifiants à 15 F ou dépenser 25 F pour un chef-d'œuvre que l'on lira et relira ? La réponse est aisée. C'est pourquoi Mort à crédit, le chef-d'œuvre de Céline, voit ses éditions se succéder à une cadence incroyable malgré son prix. Les lecteurs y gagnent. »
Alors que le livre suscite une belle polémique dans la presse, Céline écrit à son ami Henri Mahé : « J'avais déjà vendu 25 000 quand le blumisme est arrivé. S'en relèvera-t-il ? » L'écrivain anticipe, une fois encore : c'est le premier tirage, daté du 8 mai, qui fut de 25 000 exemplaires. Il est possible qu'en raison des annonces de parution dans la presse, qui ont débuté en mars, les commandes se soient accumulées, mais une lettre de Denoël datée du 30 juillet le montre bien, c'est le nombre de volumes fournis aux libraires qui s'élève à quelque 25 000 exemplaires, et qui a justifié deux retirages, l'un daté du 23 mai, l'autre du 17 juin. Les ventes, elles, vont stagner dès le mois de juin.
Le 4 juin voit la victoire du Front Populaire aux élections législatives. Au cours des semaines suivantes, le gouvernement socialiste de Léon Blum instaure de nouvelles lois sociales sur les conventions collectives, les congés payés et la semaine de 40 heures. Des grèves, surtout corporatistes, éclatent dans tout le pays. Deux mois plus tard, c'est au monde de l'édition qu'il va s'attaquer. Denoël, qui a bataillé durant tout le mois de mai en faveur de Mort à crédit, suspend ses « communiqués ». Il est vrai que la presse, elle aussi, est victime de grèves « perlantes ».
A la mi-juillet Denoël fait paraître Apologie de Mort à crédit, qu'il a tiré à 3 000 exemplaires, et qu'il annonce dans Bibliographie de la France : « Une mise au point qui s'imposait ». Quelques jours plus tard, il prévient Céline que, contrairement à ce qu'il espérait, il ne pourra lui régler 23 000 francs le lendemain : « Les circonstances actuelles me contraignent à me tenir strictement dans les limites du contrat que nous avons passé le 28 février 1936. »
Depuis l'avènement du Front Populaire, Céline sait que son éditeur a de grosses difficultés de trésorerie et il ne doit pas ignorer que Bernard Steele est sur le point de le quitter, ce qui ne manquera pas de déstabiliser la maison d'édition. A la fin du mois d'août il a en effet contacté Ramon Fernandez, qui fait partie du comité de lecture de Gallimard : « L'aiguillage vers la NRF prend tournure. Je pousse, croyez-le. J'en ai soupé de ma galère. Elle n'est que trous ! », écrit-il à la mère de Fernandez.
Début septembre, un huissier mandaté par Céline se rend rue Amélie pour encaisser une traite de plus de 25 000 francs ; l'employé qui l'y accueille lui apprend que Denoël est sorti et ne lui a laissé « ni ordres ni fonds pour payer ». La traite sera protestée par la Lloyds Bank, six jours plus tard.
Est-ce la lettre que lui envoie Denoël, le 28 octobre (reproduite ci-dessous), ou les trois prix littéraires qu'il s'adjuge quelques semaines plus tard, qui le font réfléchir ? Ou encore son attitude courageuse face à la critique hostile à Mort à crédit ? Toujours est-il qu'il choisit finalement de rester rue Amélie.

© Article publié dans Le Bulletin célinien n° 356 d'octobre, à l'occasion de la parution chez Gallimard d'un ouvrage de Robert Kopp : Un Siècle de Goncourt, dans lequel trois pages sont consacrées à « L'affaire Céline ». Il a été réédité dans Le Bulletin célinien n° 402 de décembre 2017.
Automne 1932 : Céline et le Goncourt
Le 26 octobre 1932, alors que Les Loups de Guy Mazeline sont salués par la presse (les critiques parlent d'un roman balzacien), les membres de l'Académie Goncourt fêtent chez Drouant le retour de Lucien Descaves qui, depuis 1917, votait par correspondance. Les autres académiciens sont Jean Ajalbert, Pol Neveux, Rosny aîné, Rosny jeune, Léon Hennique, Léon Daudet, Raoul Ponchon, Gaston Chérau et Roland Dorgelès.
Les journaux écrivent que Descaves a cédé aux instances de Dorgelès mais d'aucuns savent que l'auteur de Sous-offs a repris sa place à table en vue d'assurer le succès de son candidat en décembre : Louis-Ferdinand Céline.
Le mois suivant, Le Figaro passe en revue les romans qui devraient être prochainement distingués par des prix littéraires, et les favoris sont les mêmes pour tous les prix : Guy Mazeline pour Les Loups (Gallimard), Céline pour Voyage au bout de la nuit (Denoël et Steele), et Simone Ratel pour La Maison des Bories (Plon). Les outsiders sont : André Billy pour La Femme maquillée (Flammarion) et Jean-Richard Bloch pour Sybilla (Gallimard).
Le 30 novembre, les membres du jury Goncourt se réunissent pour une « répétition générale des votes » au cours de laquelle le prix est virtuellement décerné à Céline avec cinq voix, celles de Descaves, Daudet, Ajalbert, et des deux Rosny, dont l'un est président du jury et dont la voix compte double (1). Robert Denoël fait retirer 10 000 exemplaires de Voyage (alors que le premier tirage n'est pas épuisé) et imprimer une bande portant : « Le 29e prix Goncourt ».
Le 6 décembre, Léon Daudet consacre - sans le nommer - le roman de Céline dans un retentissant article en première page de L'Action Française. Lucien Descaves, qui parle d'un livre « de haulte graisse », en fait autant dans Le Journal. L'Intransigeant, lui, publie l'avis d'André Chamson : « Le plus grand vagabondage humain que l'on ait pu faire depuis le 2 août 1914 » (date de la mobilisation générale).
Le lendemain, le prix Goncourt est attribué au premier tour à... Guy Mazeline pour Les Loups, avec six voix. Trois voix (Descaves, Daudet, Ajalbert) ont été données à Céline ; une, celle du président Rosny aîné, à Raymond de Rienzi.
La réaction de Descaves est virulente : « J'étais retourné avec plaisir à l'Académie Goncourt mais je n'avais pas pensé devoir être obligé d'arriver à la salle à manger en passant par la cuisine ! », s'écrie-t-il. Roland Dorgelès, élu à l'Académie Goncourt trois ans auparavant, tente de le calmer : « Descaves, ne croyez pas que quelque chose se soit combiné en dessous, vous vous tromperiez. » Descaves réplique, avant de quitter la séance : « Non, je ne crois pas qu'il y ait eu manœuvre, j'en suis sûr. Au revoir, pourquoi voulez-vous que je reste ici ? »
Les jurés accusés d'avoir modifié leur vote en dernière minute sont deux Belges, les frères Boex dits Rosny. L'aîné a porté ses deux voix sur un « roman de l'ère secondaire » publié par les Editions Tallandier : Les Formiciens, livre sans doute estimable de l'avocat Raymond de Rienzi puisqu'il s'est trouvé un éditeur pour le rééditer en 1984 dans une collection de science-fiction.
Des articles de presse mettent en cause le distributeur Hachette (qui, depuis le 29 mars, a l'exclusivité de la vente des ouvrages de Gallimard) dont les manœuvres en coulisse ont empêché la victoire d'un livre publié par une maison d'édition indépendante.
Dans Le Crapouillot Descaves, qui ne décolère pas, déclare : « Je sais les moyens dont certains disposent pour imposer leur choix. Je sais la presse qui est vendue et ceux qui sont à vendre ; je n'y peux rien. »
Jean Galtier-Boissière, directeur du Crapouillot, écrit : « Dans les semaines ayant précédé l'attribution du prix Goncourt, un roman signé de son président Rosny aîné n'a-t-il pas paru dans L'Intransigeant, le grand quotidien du soir tirant à 400 000 dont le directeur est alors Léon Bailby ? L'un de ses principaux collaborateurs se nomme précisément Guy Mazeline. » L'Intransigeant, dont Mazeline était le chroniqueur judiciaire, publia en effet en feuilleton La sauvage aventure, un roman inédit de Rosny aîné, entre le 20 novembre et le 23 décembre 1932 (il ne parut en librairie qu'en 1935, chez Albin Michel).
Dans Le Huron, Maurice-Yvan Sicard est encore plus direct : « On sait comment, à l'admirable Voyage au bout de la nuit, fut doucement substitué le bouquin pommadé de Guy Mazeline. L'affaire, cette année encore, fut menée par Dorgelès et les deux Rosny, dont l'un est sourd et l'autre certainement idiot... Chaque année, la voix du président de l'Académie Goncourt est achetée au plus offrant. »
En réalité, l'initiateur de cette cabale est due au cadet des académiciens, Roland Dorgelès, comme le dévoileront plusieurs hebdomadaires satiriques dont L'Œil de Paris, le 24 décembre : « Sont restés fidèles à Céline : MM. Lucien Descaves, Jean Ajalbert et Léon Daudet. Le transfuge (car il n'y en a qu'un, M. Rosny aîné ayant voté au premier tour pour M. de Rienzi, convaincu qu'il y en aurait un second, au cours duquel il se rallierait à Céline) fut M. Rosny jeune. Il avait pourtant adressé, quelques jours avant l'attribution du prix, une lettre à M. Céline, dans laquelle figurait cette phrase : " Votre livre est en tous points admirable : je ne vous en dis pas plus ". On dit qu'il a cédé, en faveur de M. Mazeline, aux instances de M. Roland Dorgelès. C'est également M. Dorgelès que M. Descaves rendait responsable de l'échec du favori quand, refusant de dejeuner avec ses collègues, et quittant pour la seconde fois l'Académie avec éclat, il dénonçait violemment " les tractations louches auxquelles avait donné lieu ce scrutin faussé ". »
Rosny aîné et Dorgelès assignent alors Galtier-Boissière et Sicard en correctionnelle. Le jugement sera rendu le 4 janvier 1934 : le directeur du Crapouillot, qui avait envoyé une lettre d'excuses, bénéficiera de la suspension du prononcé. Sicard, demeuré intransigeant, écope, lui, de 30 000 francs d'amende. Albert Dullin, le président de la 12e Chambre correctionnelle, ne craint pas de déclarer que le livre de Céline « contient des expressions triviales et insupportables, susceptibles de révolter les lecteurs non avertis, qu'une récompense littéraire doit protéger contre d'aussi désagréables surprises ». Il félicite donc les jurés Goncourt de lui avoir préféré le roman de Mazeline.
Prix de consolation pour Voyage au bout de la nuit : il obtient, le 7 décembre, le prix Renaudot, avec six voix, non pas au premier tour, comme on le lit parfois, mais au troisième. Robert Denoël fait imprimer une nouvelle bande-annonce pour le livre : « Un formidable succès. Prix Théophraste Renaudot ».
Le 17 décembre, Le Cri du jour rappelle que si Céline avait eu le Goncourt, les Messageries Hachette « auraient dû acheter d'emblée au moins 20 000 exemplaires de Voyage au bout de la nuit, payés comptant. Il fallait éviter cela. » (2). Ce qui fut fait.
La principale victime de cette élection lamentable sera Guy Mazeline : quand il mourut, le 25 mai 1996, à l'âge de 90 ans, l'aimable romancier breton n'avait plus rien publié depuis 1967... chez Flammarion. Gaston Gallimard - qui avait entretemps récupéré Céline (et les Editions Denoël) - l'avait lâché depuis 1958.
Notes
1. Gilbert Charles, dans Le Figaro du 9 décembre, revient sur l'incident du Goncourt, non pas à propos des « combines » dénoncées par Descaves, mais pour cette « pré-élection » qui eut lieu avant l'attribution du prix et qui donnait le roman de Céline gagnant : « M. Descaves nous révèle là de bien étranges procédés. Les Goncourt s'en seraient-ils tenus à leur premier vote, nous aurions le droit d'être surpris de ces deux réunions, l'une précédant l'autre de huit jours. Si la première était la bonne, en effet, nul besoin, n'est-il pas vrai ? d'en avoir une seconde. Et si la première était, de quelque manière, fictive, quel sens lui peut-on bien trouver ? »
2. « L'Affaire du Goncourt ». Article non signé paru dans Le Cri du jour du 17 décembre : « Que se cache-t-il derrière tout cela ? Nous allons le dire. Il s'agit, en réalité, de grosses questions d'argent et là, comme dans bien d'autres domaines, c'est l'argent qui a agi. Le public ignore que les Messageries Hachette font, peu à peu, le trust de l'édition française. Concessionnaires des bibliothèques de gares et de métros, propriétaires de quelque quinze cents dépôts de Paris et de province, elles ont cherché depuis dix ans à mettre la main sur toute l'édition française...
C'est ainsi qu'elles se sont assuré " l'exclusivité " de vente de toute la production des Editions Ferenczi, Tallandier, Gallimard (NRF). Elles n'ont pas encore réussi à avoir Grasset, mais d'aucuns prétendent que ce sera pour 1933. Les autres firmes, Plon, Stock, Albin Michel, Fayard, travaillent à perte avec Hachette, mais n'ont pas osé lui résister ouvertement. Seule, à côté de la maison Larousse, une jeune maison lui a refusé tout avantage : c'est celle que dirigent MM. Denoël et Steele. Ceux-ci ont même écrit à un encenseur d'Hachette, M. Fortunat Strowski, une lettre rendue publique qui fit quelque bruit.
Or, MM. Denoël et Steele sont les éditeurs du Voyage au bout de la nuit de L.-F. Céline, tandis que Gallimard édite Les Loups de Guy Mazeline. Si Céline avait eu le Prix Goncourt, que se serait-il passé ? Hachette aurait dû acheter d'emblée au moins 20 000 exemplaires de Voyage au bout de la nuit, payés comptant, soit, avec les remises d'usage, environ 300 000 francs à décaisser. Il fallait éviter cela.
Un conseil fut tenu quelques jours après le déjeuner où M. Céline avait triomphé. Le résultat est que M. Bailby, ami personnel et patron de M. Mazeline, collaborateur à L'Intran, s'entretint auprès de Rosny aîné, et lui prit un roman... qui passe dans L'Intran actuellement. Une autre maison d'édition, vassale d'Hachette, traitait au même moment avec M. Rosny cadet. MM. Dorgelès et Chérau, amis de M. Mazeline, mis au courant de l'affaire, racontaient bien haut à qui voulait entendre qu'ils aimaient beaucoup le livre de Céline et voteraient pour lui. Seulement leur choix était fait. On sait ce qui se passa.
Mais l'opinion publique est alertée. Les écrivains, en grande majorité, révoltés par l'intrigue qu'ils soupçonnaient et que nous dévoilons, crient leur indignation. La vente du prix Goncourt 1932 marche mal... si mal que les éditeurs en ont ramené le prix de vente de 20 F à 15 F. Quinze francs pour un livre de 600 pages ! Tous les gens de métier savent que c'est vendre à perte. Ils comprennent maintenant pourquoi... »
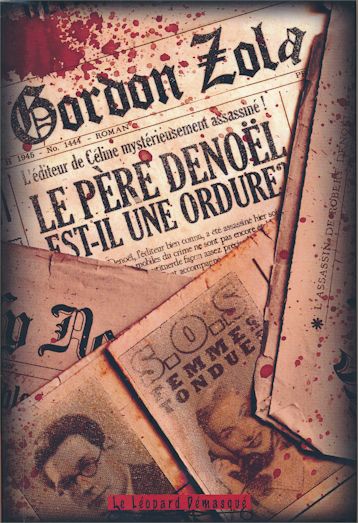
© Le roman « historico-déconnant » de Gordon Zola, pseudonyme d'Eric Mogis, est paru en novembre. Je l'ai signalé sur mon site, avant de commenter sa version de l'assassinat de l'éditeur.
J'en ai donné une présentation plus complète dans Le Bulletin célinien n° 359 de janvier 2014. La version ci-dessous a été écourtée pour la publication dans la revue.
Un roman sur l'assassinat de Denoël
Gordon Zola a surgi chez moi en juillet 2013, lorsque j'ai trouvé sur l'Internet l'annonce d'un ouvrage appelé « Qui a tué Robert Denoël ? » Ce ne pouvait être qu'une provocation puisque chacun sait que, depuis trente ans, Robert Denoël est une chasse non gardée que je me suis octroyée, faute de concurrents.
L'auteur répondit sans tarder à mon premier courriel : « Je travaille actuellement sur ce roman dans ma collection de livres historico-déconnants où je prends un soin particulier aux décors historiques. Cela fait longtemps que le sujet me titille, m'étonnant toujours de voir dans le milieu de l'édition une méconnaissance totale de cette affaire Denoël. Grand amateur de Céline, comme vous, je crois, je ne pouvais manquer de m'intéresser à son inventeur ! »
Son inventeur ! C'était osé. Je décidai de rencontrer cet insolent qui, sur le plan littéraire, a choisi de tout parodier, sauf son livre de chevet : Mort à crédit. Total respect à Ferdinand. Tous les autres peuvent passer à sa moulinette et il ne s'en prive pas.
Erick Mogis a moins de cinquante ans, est originaire du Calvados et il a pris le temps de faire trois filles avant de créer, en 2004, sa propre maison d'édition, « Le Léopard masqué », pour y publier ses livres sous le pseudonyme de Gordon Zola (télescopage de Flash Gordon et d'Emile Zola).
Il prit le risque de parodier Hergé et entama « Les Aventures de Saint-Tin et son ami Lou » : plusieurs titres virent le jour entre 2008 et 2010 : Le Crado pince fort, Saint-Tin au gibet, Les Poils mystérieux, L'Affaire tourne au sale - avant que le redouté Nick Rodwell, ayant-droit du dessinateur, ne fasse saisir en référé ces ouvrages pour contrefaçon. Il faut savoir que tous ces volumes sont munis d'une couverture illustrée qui parodie les albums originaux - mais il s'agit bien de romans et non de bandes dessinées.
En première instance le tribunal d'Evry estima que ces ouvrages ne constituaient pas une contrefaçon des œuvres originales mais les « parasitaient » et condamna « Le Léopard masqué » à 40 000 euros de dommages et intérêts. Erick Mogis fit appel et fit plaider qu'une parodie n'est pas parasitaire et ne saurait constituer un délit. En 2011 la cour d'appel lui a donné raison. Il a perdu beaucoup d'argent dans cette affaire mais a récolté bien davantage : la reconnaissance de son travail, qui est considérable. Gordon Zola ne se contente pas de parodier : il étudie en profondeur l'ouvrage ou le sujet ciblés.
Son livre concernant l'assassinat de l'éditeur de Céline s'appelle Le Père Denoël est-il une ordure ? Un clin d'œil au film de Jean-Marie Poiré et son « S.O.S. détresse amitié » qui devient ici « S.O.S. femmes tondues », dans le cabinet d'avocat de Lucien Bonplaisir, le héros de l'histoire qui doit bien emprunter quelques traits à Courtial des Péreires.
Sa route croise celle de Zoé Etarivo (olé), une pimpante comédienne qui fut la maîtresse de Rebatet et de Robert Denoël - lequel lui a confié à la veille de sa mort un inquiétant dossier dont il compte se servir au cours du procès de sa société d'édition. Il causera sa perte, comme il a causé celle de l'éditeur : un exécuteur des basses œuvres, le « raseur des mûres », l'égorge. Mais Zoé a aussi été suivie et l'avocat subit à son tour deux tentatives d'assassinat à la dynamite, où l'inspecteur Ducourthial est sérieusement blessé.
Bonplaisir se rend compte que ces attentats sont liés et contacte Cécile Denoël pour comprendre cette embrouille éditoriale devenue affaire de droit commun. La veuve désigne l'instigatrice de cette machination : celle qui a « hérité » de la maison d'édition Denoël. L'ami qui lui tient compagnie, un ancien coursier belge et alcoolique de la rue Sébastien-Bottin, met, lui, en cause son ancien patron, qui a tout « mis en musique ».
Entretemps l'exécuteur a enlevé la secrétaire de l'avocat. Il a laissé à son intention un message lui donnant rendez-vous boulevard des Invalides, le 2 décembre 1946 à 21 heures. Bonplaisir se rend compte qu'il s'agit de l'un de ses clients, un coiffeur gomminé nommé Lhermoät qui l'a consulté pour un manuscrit, « Les Essais de mon peigne », le même vraisemblablement qui a déposé une bombe à son cabinet.
L'avocat rend alors visite à Ducourthial à l'hôpital Cochin et lui démontre que son enquête a été bâclée. Il compare hardiment l'affaire au roman de Gaston Leroux : l'assassinat de l'éditeur, c'est un « Mystère de la chambre jaune » mais en extérieurs. Le but de l'agression était le vol, pas le meurtre. Denoël a été abattu dans sa voiture par l'un des deux hommes avec lesquels il avait rendez-vous pour son affaire de procès, le reste est mise en scène : les deux comparses traînent son corps sur le trottoir d'en face, pendant que Jeanne Loviton s'éloigne vers la rue de Grenelle.
L'avocat recommande encore à Ducourthial de vérifier si l'un de ces deux « témoins » est gaucher. Pourquoi ? Parce que Denoël se trouvant assis à la place du conducteur, celui qui lui tire dans le dos à travers le siège ne peut être que gaucher, considérant la trajectoire de la balle, entrée sous l'omoplate gauche et ressortie sous le sein droit. Et d'assigner à Jeanne Loviton une rôle actif assez inattendu, celui de « colmateuse de trou de balle » !
L'histoire se termine sur les lieux du meurtre de l'éditeur. Le coiffeur psychopathe, armé de son rasoir, révèle à Bonplaisir ce que contient le fameux dossier noir de Denoël, objet de toutes les convoitises : les noms de ses commanditaires, qui viennent d'ailleurs de l'engager pour supprimer une autre « crevure » au Danemark : Louis-Ferdinand Céline. Bonplaisir l'abat alors d'une balle dans la tête.
Le décor de ce roman policier échevelé est rigoureusement exact : l'auteur y a d'ailleurs inclus des interrogatoires policiers et des extraits de presse. Il fait se côtoyer des personnages imaginaires et des témoins réels de l'affaire : Jeanne Loviton, Cécile Denoël, le juge Gollety, Pierre Roland-Lévy, Guillaume Hanoteau, Gaston Gallimard, etc. : tous sont destinés à apporter à l'enquêteur les éléments d'une affaire que la police a (intentionnellement) compliquée mais qui, remis à leur juste place, mènent à une explication rationnelle de l'assassinat de Robert Denoël.
Si le roman débute assez lentement par une réunion d'épurateurs qui projettent de liquider des confrères compromis, très vite l'histoire s'emballe et le lecteur finit par courir avec Bonplaisir qui boucle son enquête sur les chapeaux de roue. Le rythme est bien maîtrisé grâce à des dialogues foisonnants. Le style est plus difficile à définir : on y trouve des réminiscences de Céline et d'Audiard, mêlées à des jeux de mots à la Pierre Dac. Un curieux mélange qui donne à ce roman pas si « historico-déconnant » que cela, un ton singulier qui ramène à la phrase placée par l'auteur en exergue de la plupart de ses livres : « Quand ce qui prête à rire donne à penser ».
2014
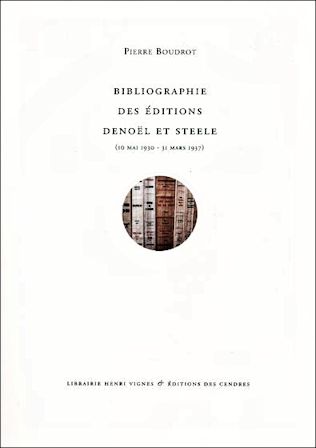
© L'ouvrage de Pierre Boudrot est paru en avril et je l'ai signalé peu après sur mon site, avec quelques réflexions sur son interprétation des publications politiques de l'éditeur. J'en ai donné une critique plus serrée dans Le Bulletin célinien n° 364 de juin 2014 :
Bibliographie des Editions Denoël et Steele
Voilà un ouvrage comme on aimerait en voir plus souvent. La bibliographie, essentielle pourtant, a toujours été la parente pauvre de la littérature. La preuve, ici encore : le volume est tiré à 499 exemplaires. Henri Vignes en caressait déjà le projet il y a plus de quinze ans. Sur le plan technique il est parfait : le libraire de la rue Saint-Jacques a du métier, ses notices sont irréprochables, et il rétablit les données défaillantes à la BnF des quelque 222 titres publiés entre 1930 et 1937 par les éditeurs de la rue Amélie grâce aux éléments fournis au dépôt légal et portés sur des fiches conservées aux Archives Nationales de Fontainebleau : achevés d'imprimer, dates de mise en vente et de dépôt, chiffres des tirages ordinaires.
Le bibliographe avait l'ambition de montrer plus que des notices techniques. Il s'est adjoint les services de Pierre Boudrot, diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris et docteur en histoire de l’université Paris-Sorbonne, pour commenter le contenu des ouvrages décrits, comme il l'avait fait précédemment pour les Editions de Minuit (2010) et de la NRF (2011).
Rappelant la « trajectoire fatale » de Robert Denoël « ouverte en 1937 par le départ de son associé Bernard Steele », qui allait aboutir en 1942 à la publication « infamante » des Décombres puis à son assassinat, trois ans plus tard, Boudrot a examiné de près les publications à caractère politique de la maison de la rue Amélie.
Des publications dont les jeunes éditeurs, férus de littérature, auraient sans doute fait l'économie si la politique européenne ne les y avait amenés. Le jour même de leur installation rue Amélie, le parti national-socialiste emportait les élections en Allemagne. En France les affaires Oustric et Stavisky aboutissaient, le 6 février 1934, à des émeutes meurtrières place de la Concorde. Deux ans plus tard le Front populaire prenait le pouvoir.
La carrière éditoriale de Denoël et Steele est donc parsemée de mouvements politiques parfois violents qu'il était illusoire d'ignorer. D'emblée Pierre Boudrot attribue à Denoël leurs publications favorables à la droite, « à la réprobation inquiète de son associé », écrit-il à propos d'un ouvrage de Gaston Chérau consacré aux événements du 6 février 1934.
Il fait mieux : de ce livre, assure-t-il, « date aussi le différend idéologique qui ne cessera de s'aggraver entre les deux associés pour aboutir au retrait de Bernard Steele, trois ans plus tard. ». Sur quoi se base-t-il pour émettre un avis aussi formel ? Aurait-il eu accès à des documents que nous ignorons ?
Pas du tout : Boudrot a lu le témoignage de l'Américain datant de décembre 1964, qu'on trouve sur mon site : « Peu après les événements du 6 février 1934, nous nous sommes aperçus, Denoël et moi, que nous n'étions plus du tout d'accord. » D'accord sur quoi, au juste ?
Au cours des ces six années de coexistence (qu'on suppose pacifique), Bernard Steele ne s'est exprimé à propos de rien, sauf de musique et de psychanalyse, dont il est féru. Pour le programme d'édition il a fait confiance à Denoël : c'était son rôle de bailleur, et il a bien rempli son contrat.
Mais en août 1936 la coupe est pleine : « La part active que prit Denoël à la rédaction et à l'administration d'un hebdomadaire politique [L'Assaut] que venait de lancer Alfred Fabre-Luce fut, pour moi, l'événement décisif qui motiva mon départ des Editions Denoël et Steele et le retrait de mon nom de la raison sociale. »
L'Assaut est assurément un organe de droite et il a été créé pour combattre la politique de Front populaire, dont souffraient toutes les entreprises, à commencer par celles de l'édition. L'argent investi par Steele dans sa maison d'édition fondait inexorablement mais c'est bien Denoël qui écrivait à Champigny, le 28 août 1936 : « Pour moi, j’essaye de sortir des décombres que le Front populaire m’a fait tomber sur la tête », avant de marquer une pause : « Steele m’interrompt pour m’annoncer son départ pour New York. Il va régler certaines affaires dans ce pays incroyable où il y a encore des affaires, où il y en a même plus que jamais. » Bernard Steele fait des affaires. C'est plus tard qu'il leur trouvera une justification idéologique.
Après son départ Denoël ne modifiera rien à sa politique éditoriale. En janvier 1937 il écrit à Champigny : « Je continue à publier communistes et royalistes avec plaisir et sans aucune sorte de cynisme. » C'est en effet ce qu'il fera durant des années : compenser Céline par Aragon, René Gontier par Pablo Neruda. Durant la Guerre d'Espagne il publiera autant de royalistes que de républicains. Après la disparition de L'Assaut, il reprendra la distribution de la revue Europe.
Pierre Boudrot aurait dû relire cette lettre de Céline datant d'avril 1939 à son ami René Dagorne, auteur d'un livre publié chez Denoël où il dénonçait l'antisémitisme de ses pamphlets : « Denoël doit être aussi bien content - c'est un affamé de controverses et batailles sous son toit. » Tout Denoël est là : le pour et le contre, et de préférence chez lui.
En septembre 1939 il s'engage en éditant Notre Combat, un hebdomadaire dont tous les numéros seront saisis par les Allemands. Sa société est virtuellement en faillite, les banques françaises lui refusent un prêt indispensable à la reprise de ses activités, et un tiers de son stock est saisi en juin 1940.
Le tournant décisif se situe quatre mois plus tard : mis en demeure de publier des ouvrages favorables à l'occupant s'il veut conserver sa maison d'édition, il édite des libelles antisémites et des ouvrages collaborationnistes. Il n'y a plus de pour et de contre : c'est l'Allemagne qui dicte désormais sa loi, et tous les éditeurs qui poursuivront leurs activités durant la guerre devront s'en accommoder.
Le procès insidieux fait à Robert Denoël quant à ses publications politiques avant la guerre est mal venu, d'autant qu'il tend à dédouaner son associé américain dont on ne connaît pas la biographie, qui reste à écrire. Ce sera chose faite, je l'espère, au cours des mois à venir, grâce à son dossier au FBI.
On l'ignore encore : Bernard Steele était un agent du Département d'Etat américain. Comme Elsa Triolet était une Dame du Kremlin. Jamais éditeur français ne fut aussi bien « encadré ».
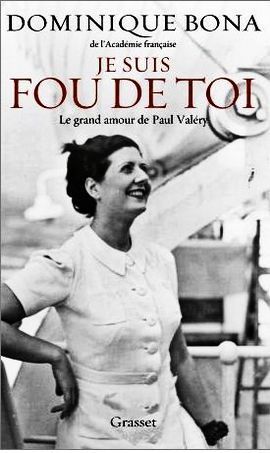
© Le livre de Dominique Bona est paru le 10 septembre 2014 chez Grasset. La presse lui a fait bon accueil mais on ne peut dire qu'il fut encensé, comme l'ouvrage fourre-tout de Célia Bertin en 2008. Est-ce à cause de son titre, qui n'est pas heureux, ou en raison de son élection à l'Académie Française ? Tous ses ouvrages biographiques, que je n'ai pas lus, lui avaient valu les louanges de ses pairs. Pas celui-ci, je ne sais pourquoi. Il convient donc de le saluer comme il le mérite, même si je suis de parti pris. Cet article a été repris dans Le Bulletin célinien n° 372 de mars 2015.
Je suis fou de toi. Le grand amour de Paul Valéry
Autant le dire : je suis, comme tout le monde, amoureux de Dominique Bona. Cette académicienne catalane de soixante ans m'a conquis. Pas par l'ouvrage dont je voudrais parler mais par sa personnalité. Sa distinction, sa joliesse, me touchent. Elle parle avec retenue, écrit avec finesse et talent, et lit avec pénétration.
C'est de cela qu'il est question : son livre, sur le plan biographique, n'apporte rien que nous ne sachions déjà. Mme Bona n'est pas une biographe de terrain, elle lit les autres, mais elle les lit bien, et elle en tire un récit très personnel qui constitue une biographie magistrale de Jeanne Loviton. Elle aurait pu titrer son livre : « Jeanne Loviton, la muse redoutable », mais elle l'avait déjà utilisé pour Gala, l'égérie d'Eluard, de Max Ernst et de Dali.
D'ailleurs, Jeanne Loviton n'est ni une muse, ni une égérie, elle le dit bien. Ce n'est pas une demi-mondaine, comme sa mère, ni une intellectuelle, comme son père adoptif, ni même une femme d'affaires, comme son géniteur. « Jeanne Voilier », comme elle l'appelle tout au long de son livre, est autre chose, et aucun de ses amants et amantes n'a pu la qualifier réellement.
Jeanne est tout cela, avec un petit quelque chose d'indéfinissable qui la rend très dangereuse car elle est capable d'aimer (sommairement) puis de tuer (définitivement). Cette femme est ce que j'appelle un succube, ce qui n'engage que moi. Toute sa vie en témoigne. Elle ne laisse que désolation sur son passage. Elle survit à tous ses naufrages supposés, alors que les autres sont emportés.
Paul Valéry, Jean Giraudoux, Robert Denoël, Yvonne Dornès, sont de ceux-là. Ils périssent en mer ou ailleurs, et elle leur survit, pour mieux raconter ces malheurs qu'elle n'a pas suscités mais qu'elle dit assumer. Le poète du Cimetière marin en fut une victime exemplaire. Denoël aussi, sans aucun doute, mais lui n'eut pas le temps de voir le côté sombre de sa dulcinée : six mois après sa rencontre, il était mort.
2016
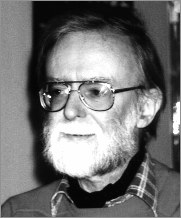 2016
2016
© Les articles nécrologiques qui parurent dans la presse liégeoise après sa disparition étaient généralement bienveillants car tous les journalistes savaient que ce vieux briscard bougonnant était un coeur tendre (lui, aurait dit : un tenderfood), malgré la rosserie de ses articles sur les arts et les lettres. Il n'y avait pas de milieu : ou c'était bon, et il l'écrivait, ou c'était mauvais, et il l'écrivait aussi. C'est ce qui m'avait toujours fasciné chez lui : une liberté de ton qu'on ne trouve que rarement dans la presse, où les plumes tournent vingt fois dans l'encrier avant d'écrire. Cet article fut publié dans Le Bulletin célinien n° 391 de décembre 2016.
In memoriam Jean Jour
C'était un bien vieil ami. On s'était connus dans une engueulade à propos de Céline, justement, qu'il n'aimait guère. C'était curieux parce que Jour était un tendre, comme Ferdinand, mais toujours à deux doigts de s'enfurier, pour un rien. « Ton Céline, tiens, il m'aurait envoyé en cabane pour un mot de travers, comme le dernier bicot, tu vois ? Un être nocif, moi, je te le dis ».
Son modèle à lui, c'était Simenon. A dix-huit ans, il lui avait consacré un mémoire à l'université de Liège, quand il s'appelait encore Jean Wathieu. Né comme lui à Outremeuse, le 9 avril 1937, il était féru de romans policiers. Dès 1959 il entrait à La Wallonie, où il apprit le métier sur le tas, avant d'en claquer la porte, puis de filer en Amérique en 1968 pour y parcourir une trentaine d'états, le nez au vent. Dès son retour, deux ans plus tard, il enfila des jeans, une chemise à carreaux, un gilet sans manche et un foulard, qu'il ne quitta plus. Le gamin d'Outremeuse s'était transformé en cow-boy, et il traduisit ensuite quantité de romans américains, tout en écrivant des romans, des essais, des chroniques folkloriques liégeoises.
A la Gazette de Liége, où débuta le petit Sim en 1919, il tint ensuite la rubrique des expositions d'art. C'est là qu'on s'était peignés pour la première fois. Le graveur Jean Dols aimait Céline, et Jour grommelait à ce sujet. L'estampe qui l'enfuriait s'appelait « Le ballon » : gravée en 1936, elle représentait Ferdinand et Courtial discutant devant « le Zélé ». C'était un hommage direct à Mort à crédit, un très grand roman, lui assurais-je, peut-être le plus grand du XXe siècle, « autre chose que Pedigree ». Il en étouffait dans sa barbe, me menaçait des pires sévices avant de concéder : « C'est vrai que ça compte, un roman comme ça. Mais plus grand que Pedigree ? Apprends à lire, tiens, bouquiniste ! »
On s'est chamaillés comme ça pendant quarante ans. En 2006 il me fit la surprise de me demander conseil à propos de Denoël, dont un éditeur parisien lui avait commandé une biographie, après que celle de Louise Staman eût paru en français et eût fait quelque bruit à Paris.
« L'éditeur de Céline, n'est-ce pas, Jean, l'auteur de Mort à crédit ? » Ah, se récriait-il, « mais un Liégeois ! et sa femme, Cécile, baptisée comme moi à l'église Saint-Pholien, comme Simenon, c'est tout dire ! »
Céline n'avait pas emporté sa décision. C'est Liège qui comptait ! C'est là qu'il est mort le 27 octobre dernier, mon vieux cow-boy, d'une leucémie foudroyante. On n'a pas eu le temps de se rabibocher à propos de Mort à crédit, un bien beau roman, cependant. Mais pas plus que Pedigree, c'est sûr.
2017
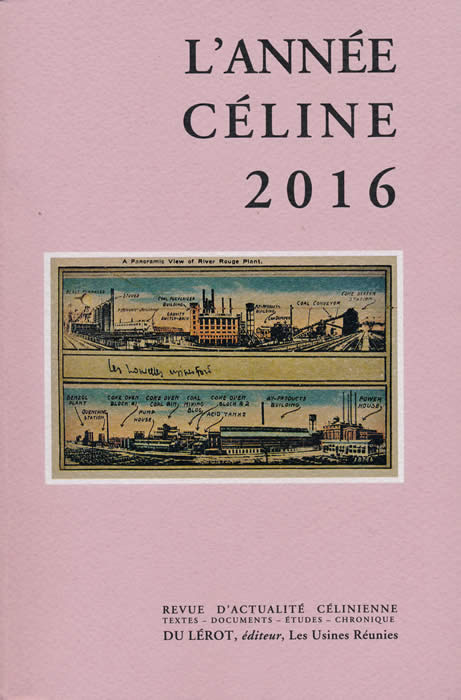

© L'article paru ici a été publié d'abord sur mon site « Robert Denoël, éditeur », avec plus de détails que le permettait le cadre du volume, mais les reproductions de l'éditeur sont d'un autre qualité que les miennes sur Internet. On notera la médiocrité technique du tableau d'André Paz (1930), qui avait dû ajouter plus tard les mains d'une poupée à sa composition.
Jeanne Loviton, fille de personne
Fils de l'amour ou fils d'amourettes
Tous les enfants sont des poètes
Ce n'est qu'après...
[Jacques Brel]
Elle fut sans doute la femme la plus insultée par Céline dans sa correspondance, et jusque dans son oeuvre. Le lecteur non prévenu de D'un château l'autre [1958] peut se demander, à propos d'un passage concernant l'assassinat de son éditeur sur l'Esplanade des Invalides en 1945, qui l'auteur désigne par le sobriquet de « Marquise Fualdès », car le commentateur de l'édition de la Pléiade se borne à préciser qu'il s'agit de la gérante des Editions Denoël, sans dévoiler son nom. Céline l'avait déjà évoquée ailleurs, toujours à propos de la mort de Denoël, sous le surnom de « Mme Thérèse Amirale, tôlière, fée maligne aux Invalignes » [Féerie pour une autre fois, 1952]. Le même commentateur consent à préciser : « C'est Mme Voilier (« Amirale ») qui était alors gérante de la maison d'édition ».
En publiant les Lettres de Céline dans la Pléiade en 2009, il devenait hasardeux d'éluder la notice qui revenait à cette «fée maligne » puisque l'écrivain la cite à quarante reprises, toujours pour la brocarder en termes fleuris. Pourtant le lecteur n'y apprendra que son patronyme et son pseudonyme littéraire.
Tant de discrétion à propos d'une dame longuement mentionnée dans plusieurs ouvrages récents (1) a de quoi surprendre. C'est qu'elle avait elle-même beaucoup dissimulé, comme en témoigne la biographie de Mme Célia Bertin qui n'obtint l'accès aux archives personnelles de Jeanne Loviton qu'au prix d'une discrétion absolue quant à ses origines. C'est donc les archives publiques qu'il convenait de consulter pour découvrir l'ascendance de cette égérie mondaine si bien calfeutrée.
Jeanne Louise Anne Elisabeth Pouchard est née, de père « non dénommé », un mercredi 1er avril 1903, à une heure et demie du soir, au domicile de sa mère, Louise Juliette Pouchard, une artiste de 26 ans qui habitait 15 rue Juliette Lamber, dans le XVIIe arrondissement de Paris. Cette naissance a été déclarée le 3 avril à la mairie du XVIIe par son grand-père maternel, Louis Pouchard, 49 ans, orfèvre 8 rue Chapon, dans le IIIe arrondissement, qui a assisté à l’accouchement de sa fille ce qui, à cette époque, était assez inhabituel.
Juliette Pouchard était née le 3 septembre 1876 à 22 heures au n° 67 de la rue de Bretagne (IIIe arrondissement), chez Isabelle Blanc, une sage-femme qui se chargea de déclarer l'enfant à la mairie, deux jours plus tard. Juliette, née de père «non dénommé », était la fille naturelle de Jeanne Sophie Jotras, brunisseuse, 19 ans, domiciliée place de la Corderie 8, dans le quartier du Marais (IIIe arrondissement).
Sophie Jotras était donc une fille-mère dans le dénuement puisqu'il ne s'est trouvé aucun parent pour déclarer la naissance de Juliette à la mairie du IIIe. Le 21 février 1879 la mairie du IIIe arrondissement enregistra un acte du 13 février par lequel Sophie Jotras reconnut sa fille. Le 20 mai, celle du XIe arrondissement enregistra un acte daté du 3 mars par lequel Louis Pouchard la reconnaissait à son tour.
L'orfèvre Pouchard fit beaucoup plus : le 24 janvier 1880 il épousa - sans contrat de mariage - Sophie Jotras à la mairie du XIXe arrondissement et, à cette occasion, les époux Pouchard-Jotras déclarèrent « reconnaître et vouloir légitimer Juliette, née à Paris le 3 septembre 1876 et enregistrée le surlendemain en la 3e mairie ». Juliette Jotras, la mère de Jeanne, est donc devenue Pouchard le 24 janvier 1880, quatre ans après sa naissance.
Le 10 mai 1903 eut lieu, en l'église Saint-Martin-des-Champs, le baptême de Jeanne Pouchard. Sa mère, Juliette Pouchard, était plus connue sous son nom d'artiste : Denise Fleury, et il semble que Jeanne porta aussi ce nom de scène jusqu'en 1913.
En juillet 1907 Denise Fleury fit la connaissance d'un éditeur avec qui elle se lia durant six ans, avant de l'épouser. Né le 22 septembre 1876 à Arras, rue du Saumon n° 9, Ferdinand Alphonse Louis Loviton avait créé en 1899, les Cours de Droit, 3 place de la Sorbonne.
Le 24 juillet 1913 eut lieu le mariage de Juliette Pouchard et de Ferdinand Loviton à la mairie du VIe arrondissement, qui légitimisait la petite fille : Jeanne Pouchard devint Loviton ce jour-là, à l'âge de dix ans. L'abbé Jules Lemire [1853-1928], ami de longue date de Ferdinand Loviton, dont il fut le témoin au mariage civil, bénit leur union, quatre jours plus tard, en l'église Notre-Dame des Champs. Curieusement l'abbé, dans un cahier personnel de 1913, évoque toujours « Denise Fleury » et sa fille, « la petite Jeanne Fleury », qui ne s'appellent pas encore Loviton, mais qui ne paraissent plus porter le nom de Pouchard, sauf pour l'état-civil.
Le 14 mai 1914 eut lieu la première communion de Jeanne en l’église Saint-Séverin (Ve). La famille Loviton habite désormais 9 rue du Val-de-Grâce (Ve). Après de brillantes études de droit, Jeanne Loviton devient en 1926 la secrétaire de l'avocat Maurice Garçon, avant d'épouser Pierre Frondaie, le 24 mai 1927. Dès alors elle n'affiche plus que le patronyme de son mari : en toutes circonstances, elle signe Jeanne Pierre-Frondaie, jusqu'à leur divorce, en 1936.
La mort de sa mère, « Denyse Fleury », le 16 avril 1935, coïncide avec l'adoption d'un nouveau nom : Jeanne Loviton se transforme en Jean Voilier, « pour des raisons littéraires » : elle ne publiera sous ce pseudonyme masculin que trois romans entre 1936 et 1942, mais le conservera toujours, sauf pour l'état-civil.
Jeanne Loviton surgit dans la vie de Céline en septembre 1947, alors qu'il s'efforçait de faire rééditer ses romans, après 18 mois de réclusion à Copenhague. En octobre 1945 Robert Denoël lui aurait cédé toutes ses actions et, à sa mort, elle hérita de la majorité des parts dans sa société d'édition. Cet héritage fut contesté, sans succès, par la veuve de l'éditeur.
Le 27 janvier 1947 elle avait été nommée gérante de la Société des Editions Denoël, qui restait sous l'administration provisoire de Maximilien Vox. Grâce à l'appui politique de Suzanne Bidault, l'administrateur fut relevé de ses fonctions le 15 mai et Mme Loviton prit alors pleinement possession de la maison de la rue Amélie, où elle occupa désormais le bureau de Robert Denoël, avec la tutelle très théorique de l'administration des Domaines, propriétaire de 48 % des actions de la société.
Son premier souci fut d'assainir ses finances : « Pour l'instant je m'attelle au redressement financier de la maison, ce qui n'est pas mince besogne. Dans un mois nous serions obligés de déposer le bilan de ce que ces Messieurs [Vox et son ami Raymond Pouvreau] m'ont laissé si je n'arrivais à trouver les millions nécessaires au redémarrage », écrivait-elle le 24 juillet à Paul Vialar.
Mme Loviton s'y prit de deux manières : en diminuant le pourcentage accordé aux auteurs, et en soldant les stocks existants. La plupart des ouvrages furent bradés au tiers de leur prix catalogue. Aucun titre de Céline, de Cendrars ou de Vialar n'y figurait : les auteurs à succès restaient disponibles à leur prix originel. Les ouvrages polémiques, interdits ou indésirables, avaient disparu des circuits traditionnels. On les trouvait chez les bouquinistes des quais de la Seine, souvent à des prix prohibitifs.
C'est dans ce contexte difficile qu'elle prit contact avec des écrivains qui n'avaient pas figuré sur les listes de soldes et auxquels elle réclamait de la compréhension : « Je suis contrainte de demander à mes auteurs qui sont mes amis de soutenir mon effort en diminuant leurs exigences » [lettre à Vialar, 24 juillet].
On ne connaît pas la lettre qu'elle adressa en septembre 1947 à Céline. Sans doute lui avait-elle proposé de rééditer ses livres en termes alambiqués mais vagues, comme à son habitude. Entretemps Marie Canavaggia avait mis l'écrivain au courant de son rôle équivoque dans l'assassinat de son éditeur car, dès le 25, il lui écrivait : « La néo-Bobby nous l’attendons de pied ferme, cette probable assassine... » Leurs échanges n'aboutirent à rien, au grand désapointement de l'écrivain.
On connaît la suite : menaces de procès chez Jeanne Loviton, lettres injurieuses chez Céline, qui les envoyait rue Amélie « aux bons soins de Robert Denoël, assassiné »... Tous ces atermoiements finirent par lasser l'écrivain, qui la jugeait incapable de redresser la maison Denoël, même si elle gagnait son procès en épuration. Après l'avoir comparée à Denoël, « qui était un sacré caïd », il admet qu'elle « a des dispositions - suceuse de Valéry - maîtresse de la directrice d'SVP etc., mais elle ride et sa pétasserie fait le vide... » [à Me Naud, 21 décembre 1947].
Des lettres maladroites qui montrent les limites du professionnalisme de la nouvelle éditrice (« installez minet sur vos genoux, bourrez votre pipe, car je ne serais pas brève ») ne pouvaient qu'enfurier l'écrivain exilé, d'autant qu'elle lui imputait le déclin de sa maison en montrant « les Editions Denoël, tête basse, menottes aux poignets et, dans le dos, frappé en gros caractères sur leurs vestes de prisonniers : votre nom. » Le 8 décembre 1947 la rupture était consommée : Céline écrit à Jeanne Loviton pour lui faire savoir qu’il reprend sa liberté, son contrat étant rompu pour cause de non-réimpression de ses ouvrages.
Ce qui d'emblée avait intrigué Céline, dont on connaît le penchant pour l'anthroponymie (2), c'est le vrai nom de cette héritière contestée : « Cette Mme Voilier doit bien s'appeler Birchembourg ou Levy-Axman ? », écrit-il à sa secrétaire, le 13 octobre. Trois jours plus tard il mentionne, dans une lettre à Paul Bonny, les nouvelles Editions Denoël « direction " Mme Voilier " qui doit bien se nommer au fond Meyer-Levy en réalité ». Le 23 octobre il y revient : « La maquerote qui a remplacé Denoël et Max Vox - (dénommée Voilier ! Je crois Lévy ! de son nom véritable) - me fait des approches. »
Comme souvent chez lui, c'est par assonance qu'il procède : Loviton = Lévitan = Lévy = juif. Or Ferdinand Loviton ne l'était pas et il avait transmis à sa fille adoptive une éducation chrétienne. Elle ne fut jamais, à ma connaissance, inquiétée à ce sujet durant l'Occupation.
En novembre Céline avait reçu à Copenhague la visite de René Héron de Villefosse [1903-1985], « très renseigné sur la mère Voilier - C’est très amusant. Elle est la maîtresse de la directrice d’ S.V.P. »
SVP était un service de renseignements téléphoniques pour le grand public créé dès 1935 et dont Yvonne Dornès [1910-1994] avait pris le contrôle entre 1939 et 1953. L'historien paraît s'être tenu à des potins sans conséquence mais il avait bien d'autres révélations à faire au sujet d'une femme qu'il avait rencontrée dans des circonstances très particulières.
Célia Bertin raconte que Jeanne Loviton découvrit en 1932 le nom de son père biologique sur un vieux billet à l'ordre de sa mère daté de 1913, signé du même nom à particule qu'un historien, archiviste-paléographe spécialiste du XVIIIe siècle, né la même année qu'elle. Elle rencontra cet historien, devint sa maîtresse et obtint de lui l'identité de son vrai père, qui était «ingénieur agronome, vivant près de Paris, possédant un haras, et un bureau à Paris près de la gare St Lazare, où il exerce le métier d'expert, évaluant des propriétés », écrit Mme Bertin.
Jeanne ne fit aucune démarche auprès de lui du vivant de son père adoptif, qui mourut le 23 janvier 1942. Quelques mois plus tard, elle prit rendez-vous sous un faux motif et le rencontra à son bureau parisien. Elle le trouva « bien ordinaire. Il n'a aucun des traits de caractère correspondant à sa classe sociale », écrit encore la biographe, qui relaie manifestement la version de Mme Loviton, transmise par sa fille adoptive, Mireille Fellous.
Quelques personnes connaissaient le secret de sa naissance illégitime. Célia Bertin mentionne Paul Valéry et Yvonne Dornès, mais on peut y ajouter Marguerite Thibon, son amie d'enfance, Mireille Fellous, sa fille adoptive, et Pierre Frondaie, qui publia en 1930 Béatrice devant le désir, un roman autobiographique dont l'héroïne, « élevée dans une institution religieuse de la rue Notre-Dame-des-Champs, orpheline d'une " fille-mère et d'un raté ", est élevée par un père d'adoption ».
Aucun de ces confidents privilégiés n'avait jamais révélé le patronyme proscrit mais Paul Valéry fit allusion, dans une lettre à Jeanne datée du 23 décembre 1941, à « son ‟ cousin ” H. de V. » qui lui avait écrit pour solliciter un rendez-vous. Les guillemets sont de Valéry : il savait que c'était un parent « de la main gauche ».
Ce « cousin » était précisément René Héron de Villefosse. Né à Paris le 17 mai 1903, il avait obtenu en 1926 le diplôme d'archiviste paléographe, et il s'affirma bientôt comme l'un des meilleurs historiens de la ville de Paris.
Son père, Antoine Héron de Villefosse [1845-1919], lui-même archiviste paléographe, ne pouvait être le géniteur mais c'est bien un apparenté porteur du même patronyme qu'il convient de découvrir, et Célia Bertin le confirme : René « n'est pas son frère, tout juste un lointain cousin » : l'homme recherché est donc un cousin d'Antoine Héron de Villefosse, né sans doute entre 1870 et 1880, comme celle qu'il engrossa au cours de l'été 1902.
Mme Bertin écrit : « l'infidèle l'a abandonnée pour épouser une cousine qui, elle aussi, était enceinte de ses œuvres ». Il aurait donc connu charnellement cette cousine et Juliette Pouchard au cours de l'été 1902, et deux enfants seraient nés de ses œuvres au cours de l'année suivante.
Les registres de l'état-civil parisien mentionnent une Marie Louise Antoinette Héron de Villefosse née le 12 septembre 1903 dans le VIe arrondissement et baptisée le 25 septembre en l'église Saint-Sulpice. Sa mère ne se trouva donc pas enceinte en même temps que Juliette Pouchard, puisque Jeanne était née le 1er avril 1903. L' « infidèle » avait fait son choix et délaissé Juliette, enceinte de trois mois, pour en épouser une autre : ce n'était pas un mariage réparateur.
Les parents de Marie sont Jean Félix Marie Héron de Villefosse et Marie-Thérèse d'Isoard de Chénerilles. Ils se sont mariés à Paris (Ier) le 7 octobre 1902. A cette époque Jean était artiste peintre et il habitait 17 rue d'Assas (VIe). C'est là que naquit la petite Marie, « demi-sœur » de Jeanne Pouchard.
Né le 10 décembre 1874 au château de Féricy, Jean était fils de Léon [1841-1881] et d'Anne de Maussion de Ménerville [1841-1874]. Orphelin à sept ans, il fut élevé par le colonel Thomas de Maussion, l'oncle de sa mère, ce qui l'amena à embrasser la carrière militaire, avant de se consacrer, à partir de 1925, à sa profession d'ingénieur agronome. Il mourut à Versailles le 23 janvier 1953.
Marie-Thérèse naquit le 25 mai 1882 à Meaux et mourut le 7 décembre 1960 à Versailles, après avoir mis au monde quatre enfants entre 1903 et 1914. Elle était la fille de Charles d'Isoard de Chénerilles, chef d'escadron au 5e Cuirassiers basé à Senlis, et de Marie Antoinette Héron de Villefosse [1860-1928], ce qui faisait d'elle, en effet, la petite cousine de son mari.
La famille Héron de Villefosse est vaste et ses racines nobles remontent au XIIIe siècle. Son blason qui porte d'azur au chevron d'or, accompagné de trois grenades tigées et feuillées du même, ouvertes de gueules, est prestigieux et le baron Léon, père de Jean, qui mourut à quarante ans au château de Féricy, était chevalier de la Légion d'Honneur depuis le 12 octobre 1872. La plupart de ses représentants sont présents dans les sciences et les beaux-arts.
Est-ce que le baron Jean Héron de Villefosse qui, comme sa mère, fut « artiste » à l'époque de la naissance de Jeanne, puis cavalier émérite (surveillant de 2e classe au haras de Pompadour en Corrèze jusqu'en 1899), et ingénieur agronome quand elle le connut, manquait de la « tenue » qu'elle prêtait à une classe de la société qui n'était, et ne sera jamais, la sienne ? Sa déconvenue fut totale et elle choisit, dit-on, d'oublier définitivement son existence.
Marie Héron de Villefosse mourut le 7 décembre 1995 dans le XVe arrondissement de Paris, six mois avant Jeanne. Contrairement à sa « demi-sœur » qui rêva toujours d'appartenir à la noblesse, Marie épousa le 4 août 1925 André Verlynde [1898-1987], un roturier lorrain dont elle eut quatre enfants, et dont elle divorça le 5 juillet 1943, avant de se remarier à Alger le 15 mai 1945 avec André Moyne, qui mourut la même année qu'elle.
Sa vie fut plus paisible que celle de Jeanne Pouchard-Fleury-Loviton-Frondaie-Voilier qui, faute d'avoir choisi un nom, n'en a honoré aucun, comme en témoigne sa tombe dans un petit cimetière de Versailles (3).
Mais cette indicible filiation féminine fut finalement préservée : le 28 octobre 1966, le Tribunal de Grande Instance de la Seine entérina l'adoption de Mireille Fellous qui, désormais, porte le nom de Fellous-Loviton. Elle est née le 29 juin 1923 à l'Hôpital Rothschild d'un couple de forains : son père s'appelait Jacob Fellous (juif tunisien né en 1874) , sa mère Ester Fruchter (juive polonaise née en 1897). On ne sait si la jeune fille fut abandonnée à sa naissance ou si ses parents furent ensuite déportés.
Henri Thyssens
1. Carlton Lake. Chers papiers. Mémoires d'un archéologue littéraire (Seghers, 1991)
François-Bernard Michel. Prenez garde à l'amour. Les muses et les femmes de Paul Valéry (Grasset, 2003)
Louise Staman. Assassinat d'un éditeur à la Libération. Robert Denoël (1902-1945) (E-Dite, 2005)
Jean Jour. Robert Denoël, un destin (Dualpha, 2006)
Jean Claudel. Cherche mère désespérément (Ed. du Rocher, 2007)
Célia Bertin. Portrait d'une femme romanesque, Jean Voilier (Ed. de Fallois, 2008)
Michel Jarrety. Paul Valéry (Fayard, 2008)
Paul Valéry. Corona & Coronilla. Poèmes à Jean Voilier (Ed. de Fallois, 2008)
Zola (Gordon). Le Père Denoël est-il une ordure ? (Ed. du Léopard Démasqué, 2013)
Dominique Bona. Je suis fou de toi. Le grand amour de Paul Valéry (Grasset, 2014)
Paul Valéry. Lettres à Jean Voilier (Gallimard, 2014)
Roy W. Brown. « A Chateau at War. The Chateau de Béduer 1939-1946 » (Association d'Art et d'Etudes du Lot, 2017)
2. En décembre 1943 il avait préfacé un ouvrage d'Armand Bernardini : Répertoire et filiation des noms juifs, que Denoël devait publier l'année suivante. Composé en janvier 1944, l'ouvrage resta à l'état d'épreuves. On trouve le texte de cette préface dans : J.-P. Dauphin. Céline et l'actualité 1933-1961 (Gallimard, 2003).
3. On peut consulter le site Internet « Robert Denoël, éditeur » (www.thyssens.com), où j'ai retracé la vie mouvementée de Jeanne Loviton, sans concession au romantisme dont on entoure habituellement l'égérie.
