Cécile Brusson
Cécile, Henriette, Emilie Brusson est née le 19 septembre 1906, à 23 heures, au domicile de sa mère, Elvire Herd, 28, rue Porte-aux-Oies, à Liège.
Les registres de population liégeois précisent que la petite fille fut reconnue à sa naissance par son père, Walthère Brusson, qui déclara sa naissance au bureau de l’Etat-Civil, et, le 4 juillet 1908, par sa mère.
Une enfant naturelle. Qui était sa mère ? Elvire Herd était née le 31 mai 1886 à Liège, sur la rive droite de la Meuse : il importe de le préciser. Georges Simenon revendiquera toujours son appartenance à cet « Outre-Meuse » qui est le quartier des artisans, avec ses codes, son folklore, son identité propre.
La maison Herd était située rue Porte-aux-Oies, à deux pas de l’église Saint-Nicolas, chère à la famille Simenon. C’est là que fut baptisée Cécile, le 23 septembre 1906.
L’historien des rues de Liège, Théodore Gobert, écrivait en 1928 à son sujet : « Depuis des siècles, cette rue recèle une population besogneuse dans sa presque totalité. A côté des mendiants, très nombreux, on y rencontre beaucoup d’ouvriers drapiers, des tisseurs, des tanneurs, etc. »
Dans les « mémoires » qu’il a rédigés en 1982, Albert Morys s’est attaché aux origines de sa femme et de ses parents, en se servant d’un enregistrement réalisé par Cécile en juillet 1979.

La rue Porte-aux-Oies vers 1910 (collections du Musée de la Vie Wallonne, Liège)
Selon Morys, Walter Brusson, qui « ressemblait au gangster Carbone », avait une ascendance corse : sa grand-mère était une demoiselle Bonaparte. Les registres de l’état-civil liégeois indiquent simplement que Walthère est « garçon-boucher », puis « fripier ». Ce garçon athlétique s’entraînait le soir dans la salle de sports qu’avait ouverte Henri Herd, l’oncle de Cécile.
Au cours d’une fête de quartier, Walter et Elvire conçurent Cécile. Ensuite, il ne fut plus question de mariage, pour d’obscures raisons familiales. Selon l’état-civil, Elvire était alors « artiste de foire » mais aussi, comme l’écrit Morys, « elle vendait de l'eau chaude à toute heure comme l'indiquait la pancarte écrite à la main et affichée à la porte de sa petite échoppe simple et proprette où l'on accédait en descendant deux ou trois marches. »
Walter Brusson, selon les registres de l’état-civil, quitta Liège pour Bruxelles en 1911, y revint en 1916 comme « négociant de meubles », et mourut à Soumagne le 26 juin 1967.
Il s’était marié le 27 février 1917 en Angleterre à Brensford avec Marie Koymans, née à Liège le 4 avril 1886, dont on ne sait rien. Une petite fille est née à Liège de leur mariage, le 11 août 1921, et y est décédée le 28 janvier 1934. Cécile ne l’a jamais évoquée.
La famille de la petite Cécile est, en réalité, celle des Herd. Le patriarche, Guillaume Herd, peintre en bâtiments, et sa femme, Helena Treffer, étaient d’ascendance prussienne et parlaient l’allemand entre eux, mais ils avaient veillé à ce que leurs onze enfants parlassent le français et le wallon. Les Herd exploitaient un café populaire où, sans doute, Cécile passa une partie de son enfance.

Le café Herd à Outre-Meuse vers 1910
L'un des fils Herd, Henri, était un athlète impressionnant qui, dès 1904, gagna des tournois de lutte gréco-romaine. Il choisit de combattre sous le nom de Constant-le-Marin, en hommage au prestigieux champion namurois Constant-le-Boucher. Pourquoi « marin » ? Parce qu’il avait l’ambition de porter « par-delà les mers et les océans » le nom de l’école liégeoise de lutte. C’est ce qu’il fit, en effet, en remportant, de 1908 à 1914, de prestigieux tournois au Canada et en Amérique du Sud ; il fut quatre fois champion du monde de sa discipline et décrocha quatre « ceintures d’or ».
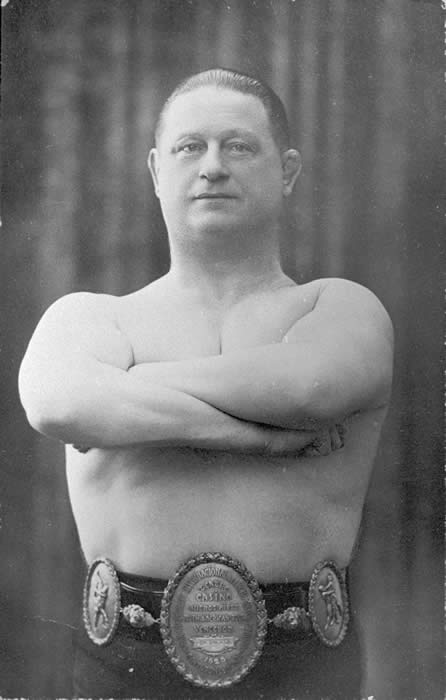

Ceinture d'or en 1908 En 1918 avec son autoblindée
En août 1914, bien que bénéficiaire d’un tirage au sort favorable qui l’exemptait, il s’engagea comme volontaire dans une unité de mitrailleurs qui combattit sur l’Yser. Il s’illustra ensuite sur le front de Galicie à bord d’un auto-canon, avant d’être gravement blessé. Son neveu, Fernand Houbiers, qu’on retrouvera en 1945 chez les Denoël, fit lui aussi partie, à seize ans, de ce corps belge d’autos blindées qui combattit les Allemands pour le compte du tsar Nicolas II de Russie.
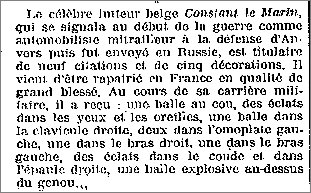
Rugby, 23 mars 1918
Malgré des blessures importantes Herd parvint, au prix d’une méthode personnelle de revalidation, à reconquérir, en 1921, le titre de champion du monde. Il se produisit par la suite un peu partout, et s’enrichit considérablement au cours de tournées en Amérique du Sud. C’est là qu’il passa la Seconde Guerre mondiale.
De retour à Liège en 1946, il y vécut paisiblement jusqu’à sa mort, en 1965. Il avait ouvert à Outre-Meuse un établissement nommé « Le Café des Lutteurs » dont le sous-sol était aménagé en salle de gymnastique où plusieurs générations de jeunes Liégeois vinrent s’initier à la lutte gréco-romaine, puis au sport-spectacle qu'est le « catch ».
Ce sport très particulier avait rapproché les Herd et les Brusson. Plus tard, Cécile décrira à Morys son géniteur, Walthère Brusson : « C’était ce que l'on peut appeler un beau mâle. Dix-neuf ans, la moustache conquérante comme il seyait à un don juan en ce début de siècle. Nous sommes en 1905. Très fier de sa carrure, de sa prestance et d'un je-ne-sais-quoi qui plaisait aux filles parmi lesquelles il faisait des ravages [...] Ce Walthère aussi était d'une force herculéenne ; il faisait " le Christ sur deux doigts " : entre deux barres parallèlement placées, assez écartées pour que seules ses mains y puissent prendre appui lorsqu'il avait les bras en croix et fixées bien au-dessus du sol. Dans cette position inconfortable, il repliait l'un après l'autre chacun de ses doigts pour rester ainsi, bras en croix à deux mètres du sol appuyé seulement sur une phalange du médius de chaque main ».
Quant à sa mère, Morys écrit : « Elle était capable de porter douze hommes, et non des moindres, en une pyramide humaine dont elle était la base et le soutien. Petit détail : Elvire Herd mesurait près de deux mètres (son passeport britannique de 1919 précise 6 pieds 1 pouce) [soit 1 m 85] et était taillée en proportions ».

Elvire Herd et Cécile Brusson en 1910
Cette athlète pratiquait aussi, c'est moins courant, la lutte, comme le raconte Georges Rem : « Il y eut même [vers 1905] des luttes de femmes où se rendirent célèbres les filles Herd, sœurs de Constant le Marin. C'est que les prises de gréco-romaine et de lutte libre répondaient admirablement au tempérament bagarreur des Liégeois.»
La légende veut qu’elle ait posé en 1905 pour le sculpteur Camille Sturbelle [1873-1944] en vue de la réalisation d'un monument dédié à Charles Rogier. La sculpturale femme nue qui se trouve aux côtés de Rogier serait Elvire Herd. L’inauguration de ce monument, à l’entrée du parc d’Avroy à Liège, eut lieu le 17 septembre 1905.

Selon les registres de l’Etat-civil liégeois, Walthère Brusson, Elvire Herd et leur fille Cécile vécurent chez les Herd, rue Porte-aux-Oies, de septembre 1906 à octobre 1907 ; ensuite Brusson alla s’établir rue Grétry, dans le quartier de Longdoz : on reste sur la rive droite, mais en s’excluant de la petite communauté d’Outre-Meuse. Elvire et sa fille demeurèrent dans la maison familiale jusqu’en juillet 1908.
Ensuite, Elvire paraît avoir mené une vie aventureuse, emmenant parfois sa petite fille avec elle, « pour la soustraire à la famille de son père ». On la retrouve à Neufchâtel où elle aurait servi de dame de compagnie à une vieille dame fortunée, avant de suivre le cirque Hagenbeck de passage dans la région, où elle avait retrouvé des amis de son frère. Ce cirque effectuait alors une tournée européenne qui le mena jusqu’en Russie.

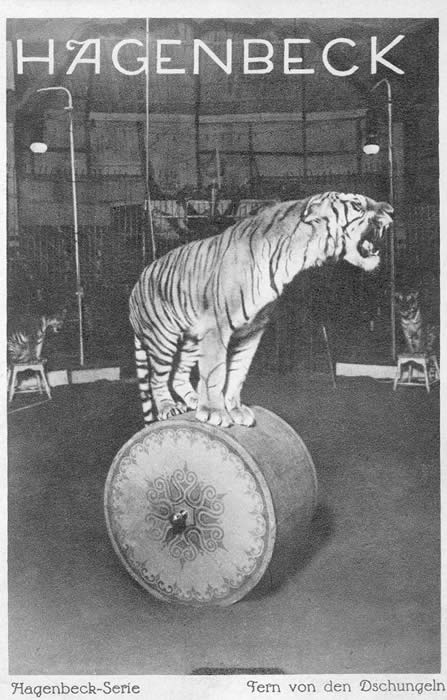
L’Etat-Civil confirme qu’à partir du mois d’août 1908 Elvire Herd a obtenu un visa en vue d’un « voyage pour sa profession de lutteuse ». C’est au cours d’une tournée qu’elle rencontra un athlète noir nommé Ilya Vincent dont elle tomba amoureuse. Elvire, écrit Morys, « était une force de la nature et avait une fâcheuse tendance à vouloir suivre ses instincts » : ayant appris que ce Vincent était rentré chez lui, en Afrique du Sud, elle prit le bateau pour Cap Town, où elle entreprit, en vain, de le retrouver.
Pour y subsister, elle s’engagea dans une brasserie du Cap ; c’est là qu’elle rencontra Walter Adolphus Ritchie Fallon, un ingénieur anglais né à Bristol le 8 novembre 1884, qui allait l’épouser le 4 mars 1914.
D’ascendance irlandaise par son père [Ritchie] et écossaise par sa mère [O’Fallon], Walter Ritchie Fallon avait séjourné à Cape Town en 1897 et avait fait, à partir de 1901, un apprentissage de trois ans chez l'architecte Edward Simpkin. De retour à Londres en 1906 il entreprit durant un an des études chez un architecte de Dixon, et rentra en 1910 au Cap où il construisit des écoles, des auberges et des hôpitaux pour le compte de l'administration. En 1912 il remporte le premier prix pour la construction d'abattoirs municipaux, et s'associe avec John Lyon, jusqu'en 1923. En 1922 et 1929 il fut président de l'Institut d'Architecture du Cap.
Le 27 mars 1916, Elvire donna naissance à un garçon qui reçut le prénom de Guillaume, ce qui était rare durant la Grande Guerre, et qu’on appella familièrement Billy. Ritchie-Fallon eut une influence heureuse sur l’éducation de la jeune Cécile, qui fut mise au pensionnat pour y suivre des études classiques.
On ne sait pas grand’chose de la vie du ménage Fallon-Herd. Selon Morys, fin 1916 ou début 1917, Walter Ritchie-Fallon décida de « partir pour la guerre », mais il ne dit pas où : « Je ne m'inquiète pas pour toi ni pour les petits, tu te débrouilleras très bien avec mes associés », aurait dit l’architecte.
Les associés de la Société Leeb, Ritchie-Fallon et Noall ne versèrent pas à sa femme ce que Fallon espérait, et Elvire dut avoir recours à l’état qui attribuait une pension, ou un secours modeste, aux familles des militaires en campagne.
Est-ce qu’elle prit peur quand l’épidémie mondiale de grippe espagnole, qui allait faire plusieurs millions de morts, atteignit, en juin 1918, l’Afrique du Sud, où elle décima 150 000 personnes en quelques mois ? On parlait, là-bas, non pas de grippe, mais de choléra, ou de peste, et il n’existait pas de vaccin - pas plus qu’en Europe, d’ailleurs, mais l’essentiel était peut-être de rentrer chez elle, où sa famille lui assurerait un train de vie meilleur.
Ou est-ce qu’Elvire fut ensuite reprise par sa « bougeotte » ? Morys écrit que sa nature « était de vif-argent ; elle ne pouvait tenir en place ».
En novembre 1919, Elvire Herd rentre à Liège, et s’installe à Grivegnée, 11 rue Vandenhoff, avec ses deux enfants. C’est alors que Cécile connut son père, Walthère Brusson. La suite de l’histoire est confuse mais pas anodine, car elle va déterminer Cécile à quitter Liège.
Si l’on en croit les registres de la population, Elvire Herd repartit ensuite en Afrique du Sud, le 27 mai 1920, et retrouva Ritchie Fallon qui habitait alors dans le Pinelands du Cap un cottage qu'il avait entièrement conçu. La notice que lui consacre John Walker sur le site de l'université de Pretoria indique qu'il vécut alors avec une « Française qui avait été lutteuse de cirque ». En juin 1922 une revue locale destinée aux ingénieurs lui consacrait un article élogieux, rappelant qu'il était connu parmi ses confrères comme un homme « capable, sérieux, travailleur, à l'honnêteté sans faille, et possédant un grand sens de l'organisation », le qualifiant même de parent proche du Capitaine Cuttle, le personnage de bonne volonté du roman de Dickens, Dombey and Son.
La vie au Cap avec cet homme de qualité devait sans doute peser à Elvire Herd, qui revint définitivement à Liège le 15 juin 1923, pour s’installer à Angleur, Rivage en Pot, n° 1, en compagnie de ses deux enfants. Il existe cependant une carte adressée du Cap par Cécile à sa mère : « A merry Xmas and a Happy New Year. Do come back soon darlings. Your own loving little daughter & sister. Cécile 5/12/23 ».
Selon Morys, Cécile avait préféré poursuivre ses études au Cap, en attendant le retour de sa mère. Mais Elvire ne rentrait pas « et semblait n'avoir nulle envie de revenir. Son mari et sa fille avaient beau lui écrire, la solliciter de toutes les façons ; c'était en vain », écrit-il.
Cécile serait alors rentrée à Liège, pour persuader sa mère de retourner au Cap. Devant la détermination d’Elvire à demeurer à Liège, Cécile voulut repartir : « Il n'en est pas question. Cet homme n'est pas ton père ; TU DOIS rester avec ta mère. Et si tu essaies de partir, je te ferai rechercher par la police : tu es encore mineure ! », lui aurait-elle dit.
Morys écrit que, prenant son mal en patience, Cécile se dit qu'il ne lui restait que deux ans et demi à attendre pour atteindre ses vingt-et-un ans révolus et ainsi pouvoir rentrer dans « son pays ».
Puisqu’elle avait entrepris des études de médecine au Cap, elle prit, dit Morys, une inscription à l’université de Liège, où elle suivit les cours du professeur Delmotte. Je n’ai pas retrouvé le nom de Cécile Brusson dans les archives de l’université. Quant à Elvire, elle ne retourna jamais en Afrique du Sud et son divorce avec Walter Ritchie-Fallon, qui mourut le 3 mars 1962, fut prononcé à Cap Town le 8 juin 1938.
Ce qui nous intéresse est de situer la date et l’endroit de la rencontre de Cécile Brusson et de Robert Denoël à Liège. Morys avait enregistré une fois pour toutes celle que lui avait donnée Cécile : le dimanche 8 mars 1925.
Ce soir-là, Robert aurait rencontré une jeune fille « resplendissante au visage ensoleillé, qui lui était apparue un soir de fête sous les habits de la Bohémienne de Franz Hals, dans un bal costumé et dont le regard l'avait envoûté ». Morys laisse entendre que cette rencontre a eu lieu au cours d'un des nombreux bals costumés qui se déroulaient à Liège durant la semaine du carnaval.


Cécile Brusson et Robert Denoël en 1925
Cécile n'évoquait pas de circonstances particulières et écrivait simplement : « nos routes et nos regards se croisent. Le coup de foudre n'existe pas que dans les romans. Il soude ce jour-là le destin de deux êtres jeunes, deux natures de formations opposées mais qui vont merveilleusement se compléter ». Le 8 mars 1945, alors qu'elle regagnait avec son fils leur appartement de la rue de Buenos-Ayres, où Robert n'avait plus remis les pieds depuis le mois d'août 1944, elle aurait rédigé ce billet à son intention :
« je rentre aujourd'hui à la maison que nous avons quittée avec tristesse lors des événements. Penses-tu que nous y voyant, le Finet et moi, tu ne regretteras pas notre vie familiale ? Il est encore temps Bobby de la reprendre si tu le désires. Dis moi ce que tu en penses. En tous cas fais-moi le plaisir d'accepter ce petit cadeau en souvenir de notre première rencontre, il y a vingt ans aujourd'hui déjà. »
Albert Morys, le second mari de Cécile, cite ce document dans son volume de souvenirs (« Cécile ou une vie toute simple »), avec ce commentaire : « Le 8 mars 1945, juste avant de rentrer chez elle, Cécile écrivit à Robert une lettre dont je viens de trouver le brouillon - par hasard comme si, intentionnellement, une main invisible l'avait placée là tout exprès sous ma main -. Je me souviens d'autant mieux de cette lettre que c'est moi qui la remis à Robert. »
Quand Robert Denoël eut à évoquer leur rencontre, il ne la situait pas en 1925 mais beaucoup plus tôt. Le 27 août 1927, il écrit à Champigny que Cécile « arrive toute neuve, toute fraîche en dépit de quatre années de vie dans le milieu le plus détestable ».
A Victor Moremans il écrit, le 11 octobre 1927 : « Elle s’appelle Cécile, elle passa son enfance au Cap, elle m’aime, nous nous aimons depuis 4 ans ».
A Mélot du Dy il écrit, début novembre 1927 : « j’ai revu à Liège une jeune fille que j’aimais depuis quatre ans. »
Leur rencontre daterait donc de la fin de l'année 1923, puisque Denoël fut mobilisé à Anvers jusqu'au 4 décembre 1923. Si Cécile tenait à ce que cette rencontre ait eu lieu au cours d'un bal costumé, on peut imaginer que le jeune homme fraîchement démobilisé a mené joyeuse vie en décembre 1923 : à Liège, il était courant à cette époque de se déguiser au moment des fêtes de fin d'année. A moins qu'il ait obtenu une permission en mars 1923.
Dans son roman autobiographique Moi qui ne suis qu'amour, publié chez Denoël en octobre 1948, Dominique Rolin écrit : « Il me raconta sa jeunesse, et comment au cours d'un bal costumé, il avait rencontré Léna [Cécile] dont l'éclatante beauté l'avait rendu fou ; il l'avait enlevée et épousée un an après. » [pp. 257-258]. Dominique Rolin ne pouvait tenir ce détail, qui n'a jamais été publié dans la presse, que de Denoël lui-même.
Mais pourquoi Cécile éprouve-t-elle le besoin de situer sa rencontre avec Robert Denoël le 8 mars 1925 ?
La réponse se trouve dans les registres de l'état-civil liégeois : depuis le 5 mars 1925, Elvire Herd et ses deux enfants, Cécile Brusson et Billy Fallon, sont domiciliés rue des Dominicains, n° 20, dans le quartier bourgeois du centre-ville, à deux pas des locaux de la prestigieuse Gazette de Liége où Denoël se rend régulièrement.
Or, dans une lettre datant de l’été 1945, Denoël a rappelé à sa femme dans quel milieu il l’a connue : « Tu voyais tous les jours les couples se faire et se défaire sous tes yeux. Tu vivais dans une maison où l’on vivait des amours d’autrui. Je sais que cela te dégoûtait car les contes qui hantaient les chambres de cette maison n’étaient pas beaux. Mais cela t’entourait. Tu baignais dans une atmosphère répugnante mais lourdement charnelle. Ton père, ta mère vivaient sous tes yeux dans le désordre. Tu assistais à leurs amours. Tes tantes, tes cousines, les hommes de ta famille vivaient d’une manière purement instinctive, incestueux, pédérastes, toujours affolés de désirs les uns pour les autres ».
Cette lettre, il faut le savoir, a été écrite par Robert Denoël à la demande de son avocate, Simone Penaud-Angelelli, mais n’a jamais été envoyée à Cécile Brusson. Elle se trouvait chez Jeanne Loviton, laquelle s’est empressée de la verser, le 2 décembre 1946, au dossier de son procès civil contre la veuve de l’éditeur. Elle fut lue intégralement à l'audience du 20 décembre 1946 par Raymond Rosenmark, l'avocat de Mme Loviton, devant la cour d'Appel de Paris, et fit un tort irréparable à Mme Denoël, qui fut déboutée le 20 décembre et perdit alors tous ses droits à la succession de son mari.
Une procédure de divorce par consentement mutuel avait été entamée par Cécile le 29 juin 1945. Est-ce que Robert Denoël a rédigé ce brouillon de lettre parce qu’il craignait que sa fantasque épouse revînt sur sa décision ? C'est ce que Jeanne Loviton déclara au commissaire Pinault, le 10 octobre 1946 : « Il me l'avait donnée en me disant qu'elle pouvait servir dans la suite du procès si sa femme ne tenait pas ses engagements d'un divorce d'accord. »
C’est donc une « charge » réclamée à Denoël par son avocate, qui n’oublie pas que son client a quitté le domicile conjugal en août 1944, et a refusé de le réintégrer lorsque sa femme l’en a sommé légalement en juin 1945.
Si l’on prend cette lettre stricto sensu, le doute n’est pas permis : lorsque Robert Denoël rencontre Cécile Brusson, c’est dans un café exploité par sa mère, Elvire Herd, et ce café est aussi une « maison de passe ».
Pour l’état-civil liégeois, la profession déclarée d’Elvire Herd à cette époque est « hôtelière », et celle de Cécile, « cabaretière ». En janvier 2006, un chroniqueur liégeois qui avait connu Elvire Herd à la fin de sa vie écrivait d'ailleurs : « Elle [Elvire] revint à Liège, tenir un café. Sa fille, Cécile Brusson, une rousse flamboyante, qui servait au café, séduisit un fils Denoël. »
Où se trouvait ce café ? Elvire Herd et ses deux enfants furent officiellement inscrits, entre le 15 juin 1923 et le 5 mars 1925, à Angleur, Rivage en Pot, n° 1. Cet endroit était, pour les Liégeois, l‘équivalent des rives de la Seine à Chatou ou Bougival pour les Parisiens du début du XXe siècle : une berge de la Meuse où les guinguettes accueillaient les familles bourgeoises le dimanche. Jean Jour, qui a publié en 2009 un ouvrage sur les hôtels, cafés et restaurants liégeois, a retrouvé cette annonce publicitaire :

Cette « Maison Blanche », située au 216 de la rue Renory à Kinkempois [commune d'Angleur, actuellement Seraing], et adossée au Rivage en Pot, appartenait après la Grande Guerre à Oscar Massoz [1888-1942], qui y employait sa femme, Joséphine Herd [1894-1966], et la plupart de ses belles-sœurs, dont Elvire, et sa fille Cécile. On y dansait tous les dimanches de quinze heures à minuit. Les noceurs qui manquaient le dernier bateau-mouche ou le dernier tram pouvaient louer une chambre à l’hôtel contigu.

Façade de la « Maison Blanche », rue Renory, vers 1925
La réputation de ce café dansant remonte au début du siècle, lorsque qu'un M. Hénin inaugura l'établissement. La bonne société des environs venait s'attabler dans ses jardins bordant la Meuse : c'était l'endroit à la mode.

Les jardins de la « Maison Blanche », côté Rivage en Pot, vers 1925
Robert Denoël laisse entendre que la respectable maison Hénin avait, avec l'arrivée de la tribu Herd, changé de caractère : la nouvelle direction en aurait fait un bastringue, à l'image du bistrot d'Outre-Meuse appartenant à Guillaume Herd : « C'était bruyant et populaire », écrit Jean Jour.
On y trouvait Elvire, la lutteuse de foire, son ex-mari, Walthère Brusson, le garçon-boucher devenu fripier, les filles Herd et leurs frères dont plusieurs étaient lutteurs. Et, au milieu de cette joyeuse compagnie, une jeune fille rousse aux yeux verts, âgée de dix-huit ans, qui servait au comptoir. Nous sommes loin de l'université de Liège, où Cécile aurait pris une inscription en médecine...
Dans cette lettre terrible de 1945, Robert rappelle à Cécile les circonstances de leur rencontre : « Déjà à dix-sept, dix-huit ans, tu avais les mêmes goûts que maintenant. Tu aimais les jeunes gens, leurs incertitudes, leurs désirs naïfs, leurs angoisses devant l’amour, ce besoin des tendresses maternelles qu’ils reportent sur les premières femmes qui les émeuvent. Tu avais autour de toi une petite troupe de jeunes gens dont j’étais sans doute le plus singulier et le plus attirant [...] Quand je suis venu te voir à Seraing et que je t’ai prise pour la première fois, tu t’es donnée avec une fougue que je n’ai pas oubliée. Plus tard, je me suis dit que seule une longue habitude de l’homme pouvait donner à une femme cette liberté dans le plaisir, cette fougue dans l’étreinte. »
Lorsqu’il décide, en octobre 1926, d’aller tenter sa chance à Paris, Denoël est inquiet : « Quand je t’ai quittée pour aller à Paris, incertain de toi, troublé, peut-être un peu effaré par ton milieu familial, incertain de moi aussi, de mes possibilités matérielles, craignant au surplus de m’engager définitivement, je t’aimais et tu m’aimais. Tu me préférais en tout cas à n’importe quel homme de ton entourage. »
Il sait qu’il n’a pas rencontré une jeune fille innocente : le milieu où elle a vécu durant trois ans l’a marquée. Mais il croit que l’éducation qu’elle a reçue au Cap reprendra le dessus : « Je vais avoir à côté de moi une femme ou plutôt une enfant. Je devrai être à la fois son amant, son tuteur et un peu son éducateur. Elle arrive toute neuve, toute fraîche en dépit de quatre années de vie dans le milieu le plus détestable. Elle arrive pourvue d’un formidable orgueil, d’une intelligence moyenne et d’un amour qui ne veut pas avoir de fin. Elle vient parce que je représente tout son espoir, toute sa vie. Et j’ai un peu peur devant tant de confiance, devant cette jeunesse, ces trésors. Elle ignore tout du coeur de l’homme. La vie, pour elle, ressemble surtout à une grande partie de camping. Il y a une rivière, de l’herbe, des arbres, des compagnons joyeux, au coeur innocent. De temps en temps, il faut travailler mais tout s’accomplit dans les rires et le bonheur. Le soir, on s’endort sous les étoiles et les bois s’endorment aussi et la rivière et les prairies. Le matin, quand on se réveille, le soleil luit, les oiseaux chantent et le bonheur recommence. Jusqu’à l’âge de 16 ans sa vie a ressemblé à cela, en effet. Depuis lors, elle attend que cet heureux temps revienne et elle croit bien que le mariage va le lui rapporter. », écrit-il à Champigny, le 27 août 1927.
D’autre part, c’est au moment d’un deuil familial que Denoël a proposé à Cécile de le rejoindre à Paris. Il n’est pas douteux, même s’il ne l’a pas souvent évoquée dans sa correspondance, qu’il portait à sa mère une grande affection. Le 20 mars 1927, il est rentré à Liège, d’où il écrit à Champigny : « Je suis depuis deux jours dans une ville où l’on tâche de refaire un peu de bonheur à un homme très vieilli par la mort de ma Mère. Ses enfants sont groupés autour de lui, pleins de santé, ivres de vie et de force, mais tous malgré cela un peu graves, conscients d’une absence que rien ne remplace. »
Dans son désarroi, il a revu la jeune fille : « J’ai été surprendre Cécile cette après-midi. Nous avons passé trois heures ensemble dans la ville. Elle m’aime. Elle m’aime comme une femme et non plus comme une enfant. Plus je la voyais, plus j’en étais ému. Nous nous sommes quittés vers sept heures. Nous ne parvenions pas à nous séparer [...] Sans doute, je ferai venir Cécile à Paris. Elle est encore retenue par des scrupules filiaux mais je crois qu’elle cèdera à son instinct et qu’elle viendra me rejoindre. »
Au cours des mois suivants, il traverse une profonde dépression : « Cela a été un silence complet. Je n’ai vu personne, je n’ai pas écrit une lettre depuis des mois. Il m’arrive parfois de devenir muet, impuissant à communiquer même avec les êtres chers. », écrit-il en juin à Mélot du Dy.
Début août, Champigny a fermé sa galerie d’art et Denoël tente de subsister en se livrant au courtage de tableaux et livres de luxe. Sa situation est on ne peut plus précaire. C’est le moment qu’il choisit pour demander à Cécile de venir le rejoindre : « Dans trois semaines, je me marie, j’épouse Cécile à la mode anglaise. Nous irons à Londres ou bien à Paris chez le consul anglais où l’on peut se marier sans consentement paternel. Vous vous étonnez, sans doute, de cette solution. J’ai proposé à Cécile de venir me rejoindre à Paris et de vivre avec moi. Elle a accepté. Cela m’a suffi. Comme, au fond, cela lui faisait un énorme plaisir de passer devant un clergyman, je le lui ai offert. Mon père l’ignorera provisoirement. Je crois qu’il n’autoriserait pas ce mariage. En tout cas, il le considérerait (lui et la famille) comme une catastrophe. »
Le 11 octobre, il écrit à Victor Moremans : « Malheureusement comme je me sens trop seul, je me marie dans quelques jours. Je dis malheureusement parce que tout mon entourage le pense et que ce mariage se fera secrètement, sans que ma famille en soit informée ».
Cécile écrit : « Le 14 octobre au matin, il est là. Mes malles sont prêtes. » Les jeunes gens s’installent rue du Moulin Vert. Cinq jours plus tard, Denoël annonce à Mélot du Dy : « Sans doute, vers la fin de l’année, vais-je ouvrir une librairie qui sera à la fois : salle d’exposition et bureau d’imprimerie. Le local est trouvé ».
Certes, Denoël avait dû prendre langue avec Anne Marie Blanche depuis longtemps, puisqu’il l’avait rencontrée chez Champigny l’année d’avant, mais cette conjonction d’événements heureux seront portés au crédit de Cécile Brusson, d’autant que c’est grâce à elle qu’il rencontre peu après un commanditaire : « Je connaissais un M. Boussingault, colonial, revenu du Congo et de l’Afrique du Sud après 15 ans et fortune faite. Ce Monsieur me portait de la sympathie, sympathie qui s’accrut quand il sut que Cécile allait devenir ma compagne. Autrefois au Cap il avait fait sauter Cès [Cécile] sur ses genoux. De là, à devenir commanditaire il n’y a qu’un pas. »
Les jeunes « mariés » vivent alors des mois exaltants dans une pauvreté « affolante » : « C’est comme une enfance retrouvée. Ma femme, habituée à l’abondance, à l’argent, ne songe même pas à s’étonner de la situation.»
Cécile écrit : « Point d'électricité, non plus que de meubles. Nous allons aux puces, chez des voisins, et, quelques jours plus tard, nous voilà installés dans un décor d'opéra-comique ! Malgré une impécuniosité chronique, nous recevons. Parfois avec un somptueux pot-au-feu mijoté sur mon minuscule réchaud à alcool, parfois avec une simple boîte de maquereaux aux aromates et au vin blanc. Les caisses à oranges rembourrées de copeaux de bois qui nous servaient de sièges, eurent l'honneur d'accueillir d'illustres personnages : Léon-Paul Fargue, Antonin Artaud, Max Jacob, André Salmon, Jean de Bosschère, Serge Moreux, le docteur Allendy et bien d'autres. » [« Denoël jusqu'à Céline »].
En mai 1928, Robert écrit à Champigny : « Mon mariage avec Cécile est une chose acceptée par mon Père. Dès qu’elle aura fait sa déclaration de domicile nous nous marierons. Mariage religieux et mariage civil. J’en suis très heureux parce que cela va donner à Cécile une certaine sécurité sociale qui lui manquait. »
Le mois suivant, est-ce la perspective du mariage, Cécile a des problèmes de santé : « Figurez-vous que le mariage qui semblait au début lui réussir admirablement au point de vue santé, ne continue pas à produire ses heureux effets. Depuis un mois la jeune Cécile se réveille tous les matins avec de la fièvre, parfois beaucoup, parfois peu, mais toujours de la fièvre. En plus des maux d’estomac, des nervosités invraisemblables, bref tout un cortège de maux dont nous voudrions tous apercevoir la fin au plus tôt. Je crois qu’un séjour à la campagne, loin des soucis et des empoisonnements matériels et moraux de Paris lui ferait le plus grand bien », écrit-il à Champigny.
Denoël l’ignorait-il encore ? Comme Louis-Ferdinand Céline, Cécile Brusson avait ramené d’Afrique du Sud une malaria « qui devait si lourdement peser sur sa santé tout au long de sa vie », écrit Morys.
Le mariage de Cécile et Robert Denoël a lieu le 2 octobre 1928. Cécile s'est déclarée domiciliée au 61 bis de la rue du Pré Saint-Gervais, une adresse de complaisance qui est celle d'Irène Champigny, et c'est pourquoi le mariage a été célébré à la mairie du XIXe arrondissement.
Robert découvre peu à peu le caractère de sa jeune femme : « elle ignore la mesure : ou bien ce sont des débordements d’amour et de tendresse ou bien des colères noires et qui durent. L’une et l’autre de ces formes de la passion sont assez fatigantes pour l’être destiné à en subir les contre-coups. » [Lettre à Champigny, décembre 1928].
Ces sautes d’humeur sont d’autant plus intempestives que Denoël assume le plus gros du travail, avenue de La Bourdonnais : « Vous vous souvenez peut-être du travail qu’il y avait à la galerie. Celui que je dois fournir est assurément le triple de celui-là. Et pour le faire, je suis à peu près seul. Anne s’occupe de ses gosses et du ménage, la douce Cécile fait des efforts méritoires et quelques courses mais à cela s’arrête la collaboration de ces deux jeunes femmes. »
Tandis qu'Anne Marie Blanche et ses enfants occupent l'appartement qui surplombe la Librairie des Trois Magots, avenue de La Bourdonnais, les Denoël demeurent dans le petit appartement loué par Robert en octobre 1927, où le jeune frère de Cécile, Billy Fallon, les rejoindra peu après. C'est la bohème dans toute son acception.
En novembre 1929 Denoël publie L'Hôtel du Nord, sans le moindre circuit de distribution. C'est sans doute à cette époque que Cécile se rend le plus utile en parcourant les libraires en taxi pour y déposer le roman de Dabit dans les librairies.
C'est ce même mois qu'a lieu, avenue de La Bourdonnais, la rencontre décisive avec Bernard Steele. Quatre mois plus tard, les Editions Denoël et Steele voient le jour et, en novembre 1930, les Denoël s'installent au premier étage de l'immeuble que la maison d'édition vient d'investir, rue Amélie.
En août 1931 Denoël écrit à Champigny : « depuis dix mois, j’ai été aidé par Cécile, un être que vous connaissez mal, pour l’avoir vue névrosée, faible, en lutte avec elle-même et le monde ». La jeune fille rebelle paraît avoir trouvé une assise dans un milieu qui lui est totalement étranger.
Le 14 mars 1933 était né Robert junior, dit « le Fifou », puis « le Finet » : « L’enfant est venu, source de délices. Pendant deux ou trois ans tu as été mieux équilibrée. Puis ont commencé tes amours avec Claude. Est-ce à Paris ? Est-ce dans le Midi ? C’est en tout cas, bien avant la guerre que votre liaison a commencé. Elle s’est déroulée sous les yeux du vieux et de la vieille Caillard, sous les yeux de l’enfant. C’est ce qui me peine le plus. C’est que tu t’étales devant ton fils. »
Claude Caillard, fils d’un professeur du Conservatoire de Nice, était l’un des multiples protégés des Denoël, qui avaient ouvert à son intention un magasin de T.S.F. au 21, rue Amélie, local appartenant précédemment à Robert Beauzemont.
[à poursuivre]
*
*
Comment un avocat de la qualité de Raymond Rosenmark [1885-1950], dont la clientèle se trouvait exclusivement dans les beaux quartiers de Paris, a-t-il pu accepter de se servir d'un tel document devant une cour d'appel ? L'enjeu était de taille mais n'excusait pas l'indélicatesse, d'autant que cette lecture fut assortie de commentaires à peine moins sévères.
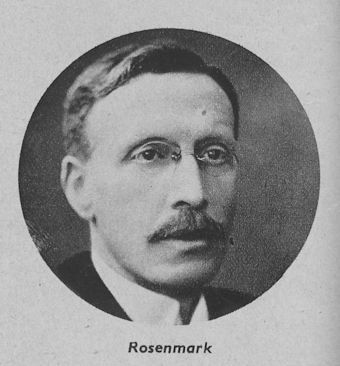

« La guerre des deux roses » selon la presse de l'époque
L'avocat de Cécile Denoël, Armand Rozelaar [1903-1973], avait, dans sa plaidoirie, mis en doute la volonté de Robert Denoël d'épouser Jeanne Loviton, et la validité de la cession de ses parts qu'elle avait produite devant les tribunaux.
Me Rosenmark choisit de lui répondre sur un tout autre terrain : « Elle n’a jamais été une compagne pour lui. Elle n’a jamais été capable ni de donner un coup de téléphone, ni d’organiser une réception, ni de faire une démarche, ni de seconder en quoi que ce soit son mari.
Tout ce dont elle était incapable, Mme Loviton l’apportait à Robert Denoël. Il savait que, passée dans ses mains, comme le voulaient les auteurs, sa société reprendrait vie et prospérerait de nouveau. Il savait que Mme Loviton était toute disposée, quand son fils aurait l’âge d’homme, à lui faire une place dans la direction.
L’hypothèse du vol des bons de caisse a été écartée par la Chambre des mises, ainsi que les machinations qu’on met à l’actif de Mme Loviton. Après le crime, la malheureuse femme est restée alitée trois semaines, veillée nuit et jour, ne pouvant trouver de repos que grâce à des piqûres. Peut-on imaginer qu’elle ait pu, durant ces heures tragiques, concevoir et exécuter l’abominable opération qu’on lui prête ?
La Cour lavera définitivement Mme Loviton de calomnies cruelles. En luttant pour conserver ses parts, elle n’a pas lutté pour s’assurer une fortune. La charge des Editions Denoël est terriblement lourde... Elle a usé à ce travail sa santé... Elle s’est attachée à une œuvre de relèvement singulièrement ardue, et elle ne l’a fait que pour exécuter, comme le disent tous les amis de Robert Denoël, la volonté du mort. »
Abel Manouvriez [1883-1963], qui avait assuré la chronique judiciaire de L'Action Française, de Je suis partout puis, après la guerre, d'Aspects de la France et de Rivarol, rendit compte de cette audience dans Paroles Françaises du 18 novembre 1949, et il n'avait pas pris fait et cause pour la veuve et l'orphelin : « Que Mme Denoël ait conçu contre sa rivale heureuse une rancune tenace, que cette rancune se soit traduite par toute une série d’accusations, par des procès, par un véritable acharnement à représenter Mme Loviton comme ayant voulu la dépouiller, elle et son fils, de l’avoir de son mari, nul ne songera trop à s’en étonner. " Rien ", a dit Balzac, " ne lie ou ne désunit davantage deux femmes que de faire leurs dévotions au même autel ". On inclinera même à croire que la désunion - terme faible - doit être le cas le plus fréquent... »
Louis-Ferdinand Céline, alors réfugié au Danemark, envoya quatre jours plus tard une volée de bois vert au journaliste : « Et puis cette dame Voilier qui profite du crime ?... Elle aurait dû demeurer souffrante non pas 3 semaines mais 30 ans à la suite de cette tragédie... La discrétion l'effacement s'imposaient... en bonnes manières...
[...] Quant à " l'incapacité mondaine " de Mme Denoël voilà une bien peu galante et lâche accusation... Je connais la maison Denoël vous pensez, sans le Voyage elle n'aurait jamais existé... Je connais aussi un petit peu Mme Denoël... Je sais qu'elle a contribué plus qu'aucune autre femme ou homme à l'édification de sa maison !... Qualités de femme du monde ? et peste ! Fort distinguée malade certes les derniers temps, très malade. Est-ce raison de divorce ? au contraire il me semble.
Denoël a joué, il était joueur... il a voulu se rétablir en jouant la carte " Voilier " - Il était tricheur aussi, très tricheur... Quelqu’un s’est aperçu qu’il trichait - c’est tout. Il avait bien des raisons d’atmosphère et d’époque pour jouer la carte " Voilier ". Mais le diable est maître des cartes... Je vous le dis - une affaire diabolique... »
Gustave Bruyneel, le père d'Albert Morys, réagit aussi à cet article, le 16 décembre 1949, dans une lettre adressée à Me Armand Rozelaar : « Pour " l'aide pécuniaire de Mme L... " : Robert m'a dit bien des fois qu'il avait acheté la majorité des parts des Editions D... [Domat-Montchrestien], qu'il a dû prendre comme à son habitude un prête-nom ; il disait également, lorsqu'il nous savait seuls que " ça coûte cher une maîtresse, surtout quand elle veut faire des affaires ".
Quant à l'instance en divorce, à ne pas être une compagne pour lui, etc ; j'ai ici sous les yeux la preuve que cela est absolument faux. Vous savez que de la Libération de Paris jusqu'au 8 Mars 1945, j'ai hébergé chez moi Madame Denoël et à ce propos je peux témoigner des sentiments qui unissaient Robert à Cécile et qui n'étaient pas ceux de personnes qui veulent divorcer. A ce moment-là, Robert habitait chez sa maîtresse mais venait déjeuner ou dîner presque tous les jours avec sa femme et, par la force des choses, j'assistais à ces repas. Il invitait même chez moi, toujours avec sa femme, des amis et auteurs [s'ensuit la liste des repas pris en compagnie d'écrivains entre le 20 août 1944 et le 8 mars 1945 : Paul Vialar, Aragon et Elsa, Elisabeth Porquerol, Maurice Percheron, Eliane Bonabel, etc.]
[...] J'ai lu aussi dans le même article de Paroles Françaises que Madame Denoël n'a jamais été capable ni de donner un coup de téléphone, ni d'organiser une réception, ni de faire une démarche, ni de seconder en quoi que ce soit son mari. Vous savez, Maître, et tout le monde le sait à Paris, que c'est avec sa femme et grâce à elle qu'il a pu fonder les Editions Denoël ; que sa table était une des meilleures de Paris et tous ceux qui ont eu la chance d'être reçus chez les Denoël peuvent témoigner que Cécile était (et est encore) une maîtresse de maison remarquable. Quant à " faire des démarches ", si l'on entend par là " donner ses faveurs " pour en avoir une récompense, il s'agit là d'un autre métier où la maîtresse rendra certainement des points à une professionnelle... et je pense que c'est en partie à cause de cela que ces ignobles procès durent depuis si longtemps ! »
*
Pour comprendre comment les relations entre Jeanne Loviton et Cécile Denoël ont pu atteindre une telle intensité dramatique, il faut examiner dans quelles circonstances elles se sont connues, sans perdre de vue leur caractère respectif. La châtelaine de Béduer, impérieuse et sûre d'elle, et la veuve de l'éditeur, théâtrale et colérique, appartenaient à des milieux radicalement différents. Robert Denoël, lui, passait de l'un à l'autre sans difficultés apparentes. Et même de l'une à l'autre sans trop de mal, tout au moins durant six mois.
Cécile ne connut son infortune qu'à la fin de l'année 1943, dix mois après que la liaison entre Jeanne et son mari eût débuté, et elle ne l'apprit de nul autre que lui. Denoël avait toujours procédé ainsi.
En 1927, alors qu'il s'était lié avec une jeune fille de Raincy (au point de déjeuner dans sa famille), il avait dû lui apprendre l'arrivée de Cécile : « j’ai dû faire souffrir atrocement la pauvre Hélène. Elle est revenue de la mer, toute dorée et toute rose, l’œil brillant, la lèvre rouge, avec du bonheur dans les membres, une gaîté de grande gosse, et un amour fortifié par l’absence. [...] Je l’ai laissée raconter Arcachon, la mer, ses amis et puis un moment je me suis senti du courage ou de la brutalité et je lui ai dit : " J’ai quelque chose de très grave à t’annoncer " - Elle a paru étonnée mais pas inquiète. Elle a fait : " Quoi ? " - " Je me marie dans quinze jours ". [...] dans mes bras, je la sentais tendue, contractée, presque haineuse. Elle n’a pas voulu que je l’embrasse. Elle ne voulait plus me voir. » [Lettre à Irène Champigny, 27 août 1927].
En mai 1945 c'est à sa maîtresse belge, Dominique Rolin, qu'il avouera sa liaison avec Jeanne Loviton : « Enfin l'homme de Paris m'adresse un mot lapidaire : il me fixe un rendez-vous en septembre chez un de ses amis. Et c'est là qu'il m'annonce avec douceur et fermeté que sa vie a changé : il a rencontré une femme très belle, très puissante et très riche. Je m'effondre à ses genoux. » [Le Jardin d'agrément].
Avec Cécile, les choses se passent très mal. Albert Morys déclare : « Je savais qu’une femme existait dans sa vie, depuis fin 1943, parce qu’il lui arrivait de découcher depuis cette époque. Il avait d’ailleurs informé Mme Denoël que, connaissant quelqu’un, ils allaient se trouver dans l’obligation de se séparer. [...] Vers fin 1943, le jour où M. Denoël annonça à sa femme sa résolution de la quitter, ils eurent une scène violente, à la suite de laquelle Mme Denoël tomba malade. » [Déclaration à la police, 20 septembre 1946].
La situation est d'autant plus pénible que Cécile ne connaît pas le nom de sa rivale. Elle ne l'apprendra qu'au cours de l'hiver 1944, alors que Denoël a quitté le domicile conjugal depuis trois mois : « Il quitta d’ailleurs bientôt ces derniers [ses amis Lemesle, rue Favart] pour aller vivre avec Mme Loviton, dont sa femme et moi n’avons connu le nom que plusieurs mois plus tard. » [Idem].
Gustave Bruyneel, chez qui Cécile s'était réfugiée à la Libération, l'a confirmé : « Au début de l’hiver 1944 Mme Denoël ayant appris que son mari avait une liaison avec Mme Loviton, me chargea d’aller me renseigner sur cette personne. C’est ainsi que je me présentai aux Editions Domat-Montchrestien où, sous un prétexte, je fus reçu par Mme Loviton, ce qui me permit de la décrire physiquement à Mme Denoël », déclare-t-il à la police, le 11 octobre 1946.
Quelques amis proches, peu nombreux, ont témoigné de la vie cahotique du couple.
Albert Morys, qui vécut chez les Denoël dès 1942, écrit : « Cécile
n'était pas une épouse complaisante, je l'ai déjà dit, mais elle
aimait son mari qui l'aimait malgré toutes ses incartades. Selon l'expression de celui-ci
: " Quand on a chez soi les meilleurs crus, il est agréable parfois d'aller boire
une piquette sur le zinc d'un bistrot
". En fait, cela ne l'amusait pas toujours : " Ah ! vous avez de la chance, mon
petit Morys, me disait-il parfois ; si vous saviez ce qu'elles me fatiguent à me tourner
autour ! "
- Personne ne vous oblige à vous laisser aller...
- Il faut bien être poli, n'est-ce pas ? Et puis, j'ai ma réputation à soutenir.
Et il était sérieux en me disant cela. Ce qui ne l'empêchait pas d'adorer sa femme. " C'est un boomerang cet homme-là ", me disait Cécile ; " il peut être lancé dans n'importe quelle direction, il me revient toujours. " Le plus beau de l'histoire, c'est que lorsqu'il avait un chagrin d'amour, il venait le raconter à sa femme ! Lorsqu'il avait conduit Thérèse au Portugal [durant l'été 1940], il était revenu dare-dare auprès de sa femme pour se faire consoler. » [« Cécile ou une vie toute simple »].
Maurice Percheron a connu Denoël et sa femme en 1934 et il est resté lié avec eux jusqu'à la Libération : « Nous nous recevions mutuellement, jusqu’au départ de Robert Denoël du domicile conjugal. Deux ou trois mois après son départ du domicile conjugal M. Denoël m’a mis au courant de sa liaison avec Mme Loviton, que je ne connaissais pas, et de son intention de l’épouser lorsqu’il serait divorcé. Je savais depuis 1935 que le ménage Denoël était désuni. Un seul lien subsistait : l’enfant. » [Déclaration à la police, 8 octobre 1946].
Très vite Percheron prit le parti de la maîtresse. Le 18 juillet 1945 Denoël écrivait à Jeanne : « Je ne vois personne sauf une fois les Percheron qui t’adorent décidément ». La suite des événements le confirmera, mais, pour ce qui concerne la vie privée des Denoël, même l'avocat de Cécile dut admettre qu'elle ne fut pas de tout repos : « Ce fut un ménage particulièrement agité, où la passion tenait la première place. La naissance du petit Robert Denoël en 1933 fut un rayon de soleil qui rapprocha les époux sur le plan sentimental sans cependant leur donner l'apaisement. » [Lettre de Me Armand Rozelaar au juge Gollety, 21 mai 1946].
Catherine Mengelle, qui avait naguère été amoureuse de l'éditeur et qui voyait toujours Cécile après la Libération, déclara à la police : « Mr Denoël, que j’avais rencontré en dehors de sa femme, m’annonça son intention de divorcer. Il me raconta qu’il était hébergé par une amie qui lui devenait très chère. Je lui ai demandé qui était cette amie. Spontanément il m’indiqua son nom : Mlle Loviton, et il ajouta qu’elle écrivait sous le pseudonyme de " Jean Voilier ". Cette liaison devait lui permettre d’avoir accès dans les milieux littéraires. » [31 janvier 1950].
Comme le commissaire de police lui demandait de qualifier leurs relations, elle répondit : « Nos relations ont simplement été amicales. Toutefois j’avoue que si Mr Denoël avait été libre c’est le seul homme avec qui j’aurais aimé faire ma vie. » Connaissait-elle Jeanne Loviton ? « Non. Mr Denoël avait voulu me la présenter, mais j’ai refusé de la connaître. » [Idem].
Irène Champigny, depuis longtemps amoureuse, elle aussi, mais fort bien renseignée par sa voisine, Marguerite Thibon, l'amie d'enfance de Jeanne Loviton, jugeait lucidement la situation : « Lui, si désintéressé, si généreux, je trouvais que c’était pousser le sens pratique fort loin qu’avoir choisi en plein écroulement de ses efforts un havre qui présentait l’avantage des plus puissantes relations parisiennes, un pied dans l’édition, etc... J’ai souvent pensé qu’avec son goût du risque, il eût mieux fait de risquer six mois de Fresnes. Grâce à la puissance occulte de J.V. [Jean Voilier] et de ses entours, certes, son nom ne fut jamais prononcé, son dossier fut enfoui, le non-lieu décrété. [...] La fatalité de son destin voulut qu’il résolut de se cacher au lieu d’admettre qu’il s’était trompé et avait perdu.
Mais personne ne me fera croire que c’est vrai, que vous étiez en instance de divorce, ou alors, c’est que tu étais consentante. Que Robert m’ait trahi d’amitié d’août 1944 à sa mort - mais qu’il ait vraiment résolu de se séparer de toi, je ne le puis croire. Que, par intérêt, pour se sauver, il ait forcé ce jeu avec l’autre, ce n’est pas joli... mais c’est possible. L’on peut cesser d’aimer un être, en aimer un autre. [...] Quand Robert, bouleversé, m’assurait qu’il t’aimait, qu’il ne romprait jamais son union avec toi. Or, à l’époque [1942], tu ne souffrais pas pour rien. Il était alors poussé, enivré, dans un tourbillon de nécessités, d’ondulations. Il était amoureux. Mais il savait bien que c’était un enivrement, que ces orages s’abattent sur nous, que nous en sommes les jouets, mais que ce qui compte, c’est la vie à deux.
Vous avez eu vingt ans de compagnonnage. Il t’aimait, Cécile. La mort te l’a arraché. Atrocement, mais jamais personne ne t’avait déracinée de son cœur. Comment l’aimerais-je mieux, moi son amie fidèle, qu’en te parlant ainsi ? Comment te prouverais-je mieux la valeur d’une tendresse que tu as délibérément écartée, qu’en t’assurant bien fort de son amour ? » [Lettre à Cécile Denoël, 22 décembre 1945].
*
Le 18 août 1944 Robert Denoël disparut du paysage littéraire parisien : il se savait poursuivi pour collaboration et il choisit de se cacher. Il quittait la rue Amélie mais aussi son appartement de la rue de Buenos-Ayres, et il encouragea sa femme à faire de même : on se trouvait alors au début de l'insurrection à Paris, et tous les débordements étaient possibles.
Les Editions Denoël furent administrées par leur directeur commercial, Auguste Picq, puis, à partir de novembre, par Maximilien Vox, nommé administrateur provisoire le 20 octobre.
Denoël trouva refuge dans un petit appartement du boulevard des Capucines, tandis que Cécile louait une chambre dans un hôtel de la rue de Lille, avant de s'établir dans l'appartement de Gustave Bruyneel, le père de Morys, 5 rue Pigalle. Le fils Denoël avait été mis en pension depuis plusieurs mois à Saint-Quentin-les-Anges, dans la Mayenne.
L'appartement de la rue de Buenos-Ayres (dont le bail et le contenu avaient été « cédés » le 30 septembre 1944 à Albert Morys) fut occupé entre le 20 août 1944 et le 8 mars 1945 par Paul et Magdeleine Vialar, à la demande de l'éditeur, qui craignait qu'il fût pillé ou réquisitionné.
Avant de quitter sa femme, Denoël avait tenu à ce qu'elle ne manquât de rien : « Mon fils et moi n’avons pas manqué d’argent à cette époque, mon mari ayant remis pour moi à M. Maurice Bruyneel, une première somme de 30.000 francs et, comme mon mari avait vendu par ailleurs la Librairie des Trois Magots, dont il avait versé entre mes mains 225.000 francs sur le produit de la vente (la vente avait produit 750 000 francs), nous avions de quoi vivre. » [Lettre de Cécile Denoël au juge Gollety, 8 janvier 1950].
L'acte de vente, daté du 9 juin, mentionne un prix de vente de 500 000 francs. Un dessous de table aurait donc été versé, que Cécile n'était pas obligée de dévoiler ; son mari a fort justement estimé qu'elle avait pris sa part, entre 1927 et 1930, dans la conduite de sa première librairie. Et il lui laissait leur appartement, confié momentanément à deux hommes de confiance, Paul Vialar et Albert Morys.
Robert Beckers, ami de longue date, affirmait : « D’après lui [Denoël], il avait remis une somme de 3 ou 400 000 francs à Mme Denoël et lui avait abandonné son appartement de la rue de Buenos-Ayres » [Déclaration à la police, 7 octobre 1946].
Interrogée à la même époque par la police, Jeanne Loviton déclara : « M. Denoël m’avait dit : " Je vais quitter ma femme, es-tu bien d’avis que je laisse tout ? ". Je lui ai répondu " oui ". M. Denoël est arrivé boulevard des Capucines avec deux valises contenant du linge, un ou deux vêtements et quelques petites affaires. Il m’avait dit : " Je repars dans la vie comme un étudiant " ».
Et comme un étudiant désargenté, à l'en croire ! alors que l'éditeur avait, depuis 1943, pris toutes les dispositions nécessaires pour que ses avoirs fussent calfeutrés en quelques endroits sûrs. Le premier était son pied-à-terre du boulevard des Capucines où, selon Me Rozelaar, « il apporta sa collection de livres, ses papiers personnels, son argent liquide, et qui devint son refuge. » [Lettre au juge Gollety, 21 mai 1946]. Mais un refuge loué au nom de sa maîtresse...
Sidonie Zupanek, la bonne de Jeanne Loviton, confirma les déclarations de sa maîtresse : « Tout ce que possédait Monsieur Denoël se trouvait dans sa chambre au 9 de la rue de l’Assomption. Il avait un costume, une robe de chambre, deux chemises, une paire de chaussures et des pantoufles. Ses affaires se trouvaient 39 Bd des Capucines, dans une ou deux valises et des cartons. » [Déclaration à la police, mai 1946. Sidonie se conforme aux ordres de sa patronne : le 9 de la rue de l'Assomption, où Denoël se fit en effet domicilier en octobre 1945 pour obtenir des cartes de ravitaillement, n'était qu'une remise à outils au fond du jardin].
Le 10 octobre 1946 Jeanne Loviton déclara encore à la police que Denoël
lui avait parlé de ses déboires conjugaux et lui avait expliqué que,
s'il n'avait jamais divorcé, c'était à cause de son fils, « bien
que sa femme lui eût donné jusque là bien des occasions de le faire,
mais que si j’acceptais de l’épouser il avait le sentiment qu’il
retrouverait un équilibre dans sa vie sentimentale et matérielle et que son
fils aurait à gagner en n’assistant plus aux discussions conjugales et en trouvant
un nouveau foyer. » Elle confirme sa déclaration précédente :
en quittant sa femme, Denoël lui avait demandé son accord « pour lui abandonner
tous les biens qu’il possédait, à savoir les meubles de son appartement
de la rue de Buenos-Ayres et l’argent liquide dont il disposait, moins une somme de
200 000 frs qu’il emportait avec lui. »
*
Robert Denoël garde, comme toujours, plusieurs fers au feu. Il a quitté sa femme le 18 août 1944 mais, deux jours plus tard, il demande à Gustave Bruyneel si elle est bien arrivée chez lui. Dès septembre il prend ses repas de midi chez les Bruyneel, y dépose son linge à laver, y reçoit des auteurs. Mais le soir, il dîne et dort rue de l'Assomption.
Ce bel arrangement prend fin en mars 1945 : Cécile rentre chez elle, rue de Buenos-Ayres, après le départ du couple Vialar, et Denoël finit par s'installer pleinement rue de l'Assomption. Le 8 mars Cécile lui a tendu une dernière perche, qu'il n'a pas voulu saisir : « Je rentre aujourd'hui à la maison que nous avons quittée avec tristesse lors des événements. Penses-tu que nous y voyant, le Finet et moi, tu ne regretteras pas notre vie familiale ? Il est encore temps Bobby de la reprendre si tu le désires. »
« Des pourparlers s'engagèrent afin d'éviter un procès en divorce qui aurait pu être long et acharné », écrit Me Rozelaar, le 21 mai 1946. « Un peu lasse, mais comprenant qu'en ayant l'air de céder sur certains points, elle ne perdrait pas son mari, Mme Denoël feignit d'accepter l'idée d'un divorce, mais fit traîner les choses en longueur en discutant sur le montant de la pension alimentaire qui lui serait allouée. »
Le 29 juin 1945 Cécile entame, auprès de Me Roger Danet, 85 rue de Richelieu, une procédure de divorce par consentement mutuel : « d’accord entre les parties, Mme Denoël avait fait à son mari une sommation de réintégrer le domicile conjugal et celui-ci avait répondu par le refus formel qui était prévu. »
Au cours de sa seconde enquête, l'inspecteur Ducourthial a vérifié si la procédure avait été menée normalement :
« Nous n’en avons pas trouvé trace au Tribunal
de la Seine, tant au greffe qu’aux conciliations, ce qui paraît indiquer que
l’instance n’était pas introduite. Il apparaît par ailleurs que
les époux avaient un avoué commun, Me Danet, 85 rue de Richelieu, lequel consulté,
nous a déclaré se retrancher derrière le secret professionnel.
Il nous a néanmoins fait connaître
sur le vu de la commission rogatoire de Monsieur le Juge d’Instruction, que c’est
fin juin 1945 que Mme Denoël lui fit part de se séparer de son mari, sans lui
révéler que celui-ci vivait avec sa maîtresse. Elle désirait se
mettre d’accord avec lui avant de commencer la procédure, pour sauvegarder les
intérêts de son fils.
Au début les époux étaient d’accord, mais par la suite M. Denoël s’opposait à verser une mensualité importante en raison des frais que cela entraînerait. Il proposait de verser de la main à la main le complément de cette mensualité, dont le montant ne nous a pas été indiqué, Me Danet prétendant ne pas la connaître, disant qu’il attendait que les parties soient d’accord afin de commencer la procédure. Mme Denoël n’acceptant pas les propositions de son mari, les choses en étaient restées là. » [Rapport du 15 novembre 1946].
Le 7 novembre 1945 Denoël avait écrit à sa femme qu'il acceptait de lui verser 15 000 francs de pension mensuelle mais que « sa situation officielle ne lui permet pas de donner plus de 6 000 frs, qu’il accepte donc de voir cette dernière somme figurer au jugement, mais qu’en sous-main, il versera la différence. »
C'est un arrangement dont Jeanne Loviton avait eu connaissance puisqu'elle déclara ensuite à la police : « Il devait payer 15 000 francs de pension alimentaire à sa femme. Il avait réglé les honoraires de Me Danet, avoué, et de Me Joisson, avocat de Mme Denoël, ayant lui-même choisi Me Simone Penaud pour le représenter. »
Robert Denoël était donc en mesure de régler, à la fin de l'année 1945, les honoraires de trois avocats, dont celui de sa femme. Mais ce qui importe est que la procédure de divorce n'avait pas été entamée officiellement au moment de sa mort.
*
Le dimanche 2 décembre 1945 à 21 heures 20, un attentat mit brutalement fin à toutes ces procédures. Robert Denoël fut abattu, d'une seule balle dans le dos, sur le boulevard des Invalides. On en trouvera le récit ailleurs. La chronologie qui suit ne concerne donc que Cécile Denoël, Jeanne Loviton, et leurs proches.
1945
2 décembre
A 21 heures 35 le corps de l'éditeur est emporté à l'hôpital le plus proche, rue de Sèvres. Jeanne a pris place dans le car de Police-Secours, en compagnie de cinq agents. Aux urgences de l'Hôpital Necker, la mort de Denoël est déclarée à 22 heures. Le gardien de la paix qui l'a accompagnéee déclare que Jeanne « prévint immédiatement le personnel de l’existence de Mme Denoël et de son fils, en demandant qu’ils soient avisés. Elle dit ensuite avoir téléphoné à une première amie, sans avoir pu la joindre, puis à une seconde, pour lui dire le malheur qui la frappait, et la supplier de venir tout de suite à l’hôpital. » Mais elle fut ramenée au poste de la rue de Grenelle et gardée à vue en attendant les enquêteurs.
A 23 heures l'inspecteur Ducourthial est sur place, et Jeanne Loviton lui fait ses premières déclarations. Il est rejoint peu après par le commissaire Duez, qui effectue en sa compagnie les premières constatations, « tant sur les lieux de l'attentat qu'à l'hôpital Necker, lors de l'examen du cadavre et de ses vêtements ». Jeanne est restée en garde à vue au poste de police durant leurs investigations. Entretemps ses amies Yvonnes Dornès et Françoise Pagès du Port, sont arrivées rue de Grenelle et demandent à la voir mais, écrit l'inspecteur Ducourthial, « nous leur avons interdit de communiquer avec elle, dans l’intérêt de notre enquête qui commençait. »
Ducourthial, assisté par trois inspecteurs, appartient à la Brigade Criminelle. Joseph Duez est le commissaire du quartier du Gros-Caillou. C'est lui qui aurait dû mener l'enquête si le juge d'instruction Ferdinand Gollety ne l'avait confiée par commission rogatoire à la « Crim » dès le lendemain matin.
Vers 23 heures 10 Cécile Denoël, qui a passé la soirée chez des amis, dans le quartier de l'Etoile, est prévenue de l'accident de son mari en rentrant chez elle par Albert Morys, resté rue de Buenos-Ayres et qui a été alerté par la police. Elle se rend ensuite en sa compagnie à Necker, où elle apprend la mort de Denoël et va reconnaître son corps à la morgue.
3 décembre
Vers 2 heures : A son retour rue de Buenos-Ayres, incapable de trouver le sommeil, Cécile entreprend d'appeler au téléphone plusieurs personnes durant la nuit, et tout d'abord Jeanne Loviton, dont elle ignore qu'elle accompagnait son mari au moment du drame et qu'elle se trouve alors en garde à vue au poste de police de la rue de Grenelle.
Vers 2 heures, 30 Sidonie Zupanek lui répond que Mme Loviton, sortie le soir même avec des amis, n'est pas encore rentrée : « J’ai alors prié la femme de chambre de faire savoir à sa maîtresse qu’il convenait de me téléphoner d’urgence, mon mari ayant été assassiné le soir même », déclare-t-elle.
En 1982 Morys a raconté cet épisode dans « Cécile ou Une Vie toute simple » : « Dès qu'elle eût appris, par les agents de police dépêchés à son domicile, " l'accident " survenu à son mari, Cécile s'était précipitée en pleine nuit, sous la fine pluie glaciale qui tombait ce soir-là à l'hôpital Necker où il avait été transporté. Je l'accompagnais et étais avec elle lorsqu'elle apprit que Robert Denoël était mort presque sur le coup d'une balle de revolver tirée dans le dos. Malgré l'heure tardive et la résistance de l'interne de garde, elle insista pour aller le voir immédiatement. Mais, dans son désarroi, elle eut une pensée pour celle qui avait voulu lui prendre son mari et me demanda : " Pendant que je vais auprès de lui, téléphone à sa maîtresse. Il est normal qu'elle sache ; elle l'aimait peut-être quand même après tout. " Nous ne savions pas alors qu'elle était, mieux que nous, renseignée sur le meurtre. »
Vers 3 heures : Jeanne Loviton, après un long interrogatoire par Ducourthial, est autorisée à rentrer chez elle. Elle rentre à Auteuil en compagnie des amies qui l'ont attendue près du poste de police, dans la voiture d'Yvonne Dornès.
Vers 3 heures 30, Jeanne appelle Cécile : « Allo, Mme Denoël ? Ici, Jeanne Loviton. Vous voulez sans doute savoir ce qui s’est passé ce soir ? J’allais ce soir au théâtre avec Robert. Un pneu de la voiture a éclaté. Robert m’a dit d’aller chercher un taxi au commissariat de police et de l’attendre au théâtre. Au commissariat, j’ai entendu un appel de Police-Secours [...] »
Je lui dis, écrit Cécile, « que le jour même, à 13 heures, elle pourrait, si elle le désirait, venir voir le corps une dernière fois à l’hôpital car on devrait l’emporter, et je lui demandai, au surplus, du linge pour me permettre d’habiller mon mari avant son enterrement. Elle me répondit affirmativement et je lui envoyai M. Gustave Bruyneel, auquel elle remit une chemise et du linge de corps. »
Albert Morys déclara à la police, le 20 septembre 1946 : « Dans la nuit, elle me chargea de l’appeler à plusieurs reprises au téléphone, afin de l’aviser de ce qu’elle venait elle-même d’apprendre, et lorsqu’enfin elle réussit à la joindre, dès les premières heures de la matinée du lundi, c’est elle-même qui lui donna rendez-vous pour l’après-midi à l’hôpital, afin qu’elle puisse voir une dernière fois M. Denoël. »
Jeanne Loviton l'a confirmé à sa manière : « C'est sur convocation de Mme Denoël qui désirait, disait-elle, sceller avec moi un pacte d'amitié, auprès de la dépouille de son mari, que je me suis rendue le 3 décembre, à 13 heures, à l'hôpital, accompagnée de Mme Dornès et du docteur Percheron. »
A 7 heures : Maurice Percheron, que Cécile avait tenté en vain d'appeler durant cette nuit tragique, lui répond enfin. Cécile écrit : « Lorsque je lui appris l’affreuse nouvelle, il me répondit qu’il allait se renseigner ».
Percheron déclara à la police : « J’ai téléphoné à Mme Loviton par la suite, elle n’était pas en état de répondre mais sa femme de chambre m’a prié de sa part de l’accompagner à l’hôpital pour un dernier hommage, ce que j’aurais fait moi-même personnellement sans invitation de qui que ce soit. Mme Loviton vint me chercher en voiture et me fit part d’un coup de téléphone qu’elle avait reçu de Mme Denoël, la priant de venir, " aucune rivalité amoureuse ne pouvant subsister après une pareille catastrophe "... J’accompagnai Mme Loviton avec une de ses amies, Mme Dornès, et me trouvai en face de Mme Denoël et de plusieurs autres personnes. »
A 11 heures, Gustave Bruyneel se rend chez Jeanne Loviton, « Mme Denoël m’ayant chargé de me rendre à son domicile, 11 Rue de l’Assomption, pour y demander une chemise, un caleçon et une cravate afin d’ensevelir son mari. [...] Ce jour-là, en arrivant rue de l’Assomption, je vis une femme descendre d’une voiture qu’elle pilotait elle-même. »
Bruyneel n'a pas reconnu Jeanne Loviton, qui demande alors à sa bonne de lui remettre le linge demandé, mais quand il raconte, en rentrant rue de Buenos-Ayres, qu'elle conduisait sa voiture, c'est la stupeur. Il s'agissait en fait de la voiture d'Yvonne Dornès, que Bruyneel ne connaissait pas.
A 13 heures a lieu à la morgue de l'Hôpital Necker la rencontre entre Jeanne Loviton et Cécile Denoël. Dans le premier courrier qu'il adresse, le 21 mai 1946, au juge Gollety, Me Armand Rozelaar décrit ainsi la scène : « Mme Loviton ayant fait demander à Mme Denoël l'autorisation de revoir le corps à l'Hôpital Necker et Mme Denoël n'ayant pas cru devoir le lui refuser, on vit, dans l'après-midi, arriver à l'hôpital Mme Loviton, défaillante, s'appuyant au bras du docteur Percheron. »
Maurice Percheron, dans une déclaration à la police du 8 octobre 1946, la présente autrement : « J’accompagnai Mme Loviton avec une de ses amies, Mme Dornès, et me trouvai en face de Mme Denoël et de plusieurs autres personnes. Mme Denoël refusa d’abord de serrer la main de Mme Loviton, ce qui me surprit étant donné le coup de téléphone de la matinée, puis ensuite au contraire invita chaleureusement Mme Loviton à embrasser Robert Denoël en déclarant : " Vous y avez droit, vous l’aimiez assez " ».
Jeanne Loviton dit simplement : « Mme Denoël était déjà là, accompagnée de M. Bruyneel et de diverses autres personnes. Le Dr Percheron me conduisit vers elle ; dans un geste mélodramatique elle refusa de prendre la main que je lui tendais. » [Déclaration à la police, 10 octobre 1946].
Cécile n'a pas témoigné de cette rencontre sauf pour relever la présence, aux côtés de sa rivale, de Maurice Percheron, qui a « crié à la cantonade qu’il s’agissait indubitablement d’un crime crapuleux commis par un nègre américain ». C'était une information de première main car la presse n'en avait pas encore rendu compte.
A 14 heures, le corps de l'éditeur quitte la morgue de l'Hôpital Necker pour l'Institut médico-légal, rue d'Assas, où il sera autopsié, le lendemain.
Vers 17 heures Abel Gorget, le chauffeur de Jeanne Loviton, récupère sa voiture accidentée au poste de police de la rue de Grenelle, muni d'une autorisation « délivrée par le commissariat de la rue Saint-Guillaume, après entente avec le commissariat de la rue Amélie » : « Lorsque j'eus l'occasion de réparer la roue avant droite crevée, j'ai constaté que cette crevaison s'était produite à la suite d'un éclatement du pneumatique dû au mauvais état de celui-ci » [Déclaration à la police, 13 octobre 1946].
Robert Beckers, qui avait longuement téléphoné à Denoël la veille au soir, a appris la nouvelle de son assassinat par la radio, vers 14 heures : « J’ai d’abord téléphoné à Mme Voilier et j’ai appris la mort de Denoël au cours de cette communication avec une personne au service de Mme Voilier. J’ai ensuite appelé Mme Denoël. Je lui ai demandé ce qu’elle savait, je lui ai présenté mes condoléances ». Beckers, comme Percheron, s'adresse d'abord à la maîtresse avant d'appeler l'épouse : il est dans la confidence. A ses yeux, le couple Denoël-Brusson s'est défait depuis longtemps, et il sait que son ami vivait rue de l'Assomption.
Irène Champigny a entendu le même programme : « Toujours seule dans ma chaumière, je n’avais pas ouvert l’appareil de radio depuis bien des semaines ; quand, le lundi, sans savoir l’heure... sans regarder, sans chercher un poste, mue par un geste forcé, j’ouvris pour entendre le milieu de la phrase sans espoir : «...diteur Robert Denoël a été abattu hier...» [Lettre à Cécile Denoël, 22 décembre 1945].
Marion Delbo, chez qui Denoël a passé sa dernière journée, déclara en 1950 : « Mme Yvonne Dornès, amie de Mme Loviton, m’a téléphoné et m’a dit : " Hier soir en te quittant, Robert Denoël a eu un accident très grave. Denoël a eu un pneu crevé, il pleuvait un peu, Jeanne ne voulait pas rester sur le trottoir, ils se trouvaient en retard, elle est allée chercher un taxi au commissariat de police et quand elle est revenue dans le taxi elle a trouvé Denoël étendu par terre, blessé. " Par la suite elle m’a avoué qu’il était mort et qu’il se trouvait à la morgue. Mme Dornès ne m’a pas dit qu’il s’agissait d’un crime et sur le moment j’ai cru que Denoël avait été victime d’un accident de voiture. Ce n’est que par la lecture des journaux que j’ai appris ce qui s’était passé. » Elle a ensuite tenté d’appeler Jeanne Loviton au téléphone « mais je n’ai jamais pu l’avoir à l’appareil. C’est Mme Dornès, ou une infirmière, ou une femme de chambre qui me répondait, en me faisant connaître que Mme Loviton était sous le coup d’un choc nerveux et ne pouvait me répondre ».
Raymond Pouvreau, directeur-adjoint provisoire des Editions Denoël, a appris la mort brutale de l'éditeur « par un coup de téléphone de M. Vox, qui venait lui-même de l’apprendre par un journaliste. J’ai, par la suite, eu l’occasion d’en parler avec le commissaire de police du quartier, lequel m’a paru être de l’avis qu’il s’agissait d’un meurtre crapuleux. »
Paul Vialar a appris la mort de son ami « par un coup de téléphone d’un ami, M. Holer, qui est également une relation de Mme Denoël. » Robert Holer était un ami parisien de Cécile et de Morys. En fait, Cécile a bien tenté de l'appeler au cours de la nuit tragique mais la communication a été interrompue. Il a ensuite appelé sa maîtresse : « Mme Loviton que je connaissais également m’a confirmé la mort de Denoël dès le jour même à la suite d’un appel téléphonique. Je lui ai rendu visite chez elle ; je l’ai trouvée absolument prostrée et désespérée. »
4 décembre
Cécile et Jeanne reçoivent de multiples témoignages de sympathie, et souvent de la part des mêmes personnes car, dans le milieu de l'édition, tout le monde se connaît.
Cécile reçoit rue de Buenos-Ayres la visite de son frère, Billy Ritchie-Fallon, qui est à Paris depuis septembre. Outre des condoléances, il avait à présenter une requête singulière de la part de Jeanne Loviton, qui souhaitait obtenir de sa veuve un souvenir personnel de son amant, « par exemple son carnet Hermès qu'il gardait toujours sur lui ».
Les deux femmes ignorent que ce petit carnet qui se trouvait dans une poche de son veston quand il fut abattu est resté à Necker : « Je le fis aussitôt bloquer à l'Hôpital Necker avec ses autres affaires », déclara Cécile à la police, le 23 mai 1946.
Interrogée par la police, Jeanne dut convenir de sa demande insolite, formulée vingt-quatre heures après la mort de son amant : « Il est exact que j’ai exprimé à M. Fallon, frère de Mme Denoël - qui était devenu mon ami, Robert Denoël me l’ayant présenté et lui ayant exposé les raisons de son divorce avec sa sœur, ce qu’il avait fort bien compris - que je serais contente si Mme Denoël voulait bien me donner l’agenda que Robert portait sur lui au moment de sa mort. Je disais d’ailleurs à Fallon qu’il ne me restait rien de Denoël et que j’attachais à cet objet sans valeur un prix sentimental. Je sais que sur ce carnet M. Denoël notait une partie de ses rendez-vous, et des prévisions financières, ainsi que tous autres calculs. »
Il y avait bien d'autres objets « sans valeur autre que sentimentale » ayant appartenu à son amant qui se trouvaient alors chez elle mais elle ne leur trouva apparemment aucun attrait et s'en défit au cours de la semaine suivante.
Maximilien Vox rend visite à Cécile à 19 heures. Il a été, le 3 décembre avant 9 heures, l'un des premiers avertis de l'attentat par son fils, Flavien Monod, qui est un ami de Guillaume Hanoteau. C'est lui qui apprend à sa veuve que Hanoteau et Lévy se sont trouvés sur les lieux du drame peu après l'attentat.
Selon Cécile, Vox lui aurait déclaré qu'en raison de la mort de Denoël, « il n’y avait plus aucune raison pour qu’il continue à rester administrateur de son entreprise, et qu’il tenait à ma disposition les carnets de chèques et les comptes. »
Il lui aurait fait une confidence surprenante selon laquelle un de ses amis, « médecin des hôpitaux de Paris », l'avait appelé le lendemain de l'assassinat pour lui apprendre qu'il accompagnait le couple dans sa voiture pour se rendre au théâtre et qu'ils avaient été agressés en l'absence de Jeanne, déclarant qu'il avait pu se sauver tandis que son ami « restait sur le carreau ».
Vox affirma à la police n'avoir jamais fait une telle déclaration et Cécile fut obligée d'admettre que Vox ne lui avait pas donné le nom de cet ami médecin, mais qu'il avait promis de passer la voir le lendemain pour lui révéler son nom.
Cécile, sous le coup d'une émotion qui dura longtemps, se mit à échafauder des théories de complots plus ou moins raisonnables. Celui-ci avait le mérite de la vraisemblance : Robert et Jeanne avaient fort bien pu être accompagnés, ce soir-là.
Vox réfuta aussi les déclarations qu'elle lui prêtait à propos de la maison d'édition : « A aucun moment, je ne lui ai offert les carnets de chèques, ni les comptes de la société ; j’ai simplement pu dire que les héritiers allaient pouvoir reprendre rapidement la gestion de l’affaire et que ma mission, de ce fait, serait terminée. »
5 décembre
Cécile reçoit la visite de Maurice Percheron, qui lui explique, « au nom des auteurs de la maison Denoël, qu'il faut absolument se débarrasser par les moyens les plus rapides de la déplorable administration » de Maximilien Vox et de son adjoint, Raymond Pouvreau, qui prélèvent 100 000 francs par mois au minimum sur les recettes de la maison d'édition, écrit Me Rozelaar au juge Gollety, le 21 mai 1946.
On ne voit pas pourquoi Percheron se préoccupe alors de la gestion d'une maison d'édition sous tutelle où il n'a rien publié depuis 1943 : c'est aux Editions de la Tour que Denoël a édité ses brochures patriotiques au cours des mois précédents mais il est vrai qu'il est actionnaire de cette société d'édition, et sans doute l'éditeur lui a-t-il parlé de la situation calamiteuse de sa maison de la rue Amélie, la seule qui compte à ses yeux.
Au cours de cette visite, Cécile lui a demandé d'accepter « la subrogée tutelle de l’enfant, ce que j’acceptai aussitôt, cette demande m’ayant d’ailleurs été faite par Denoël quelques années avant, quand il envisageait sa mort au cours des bombardements de Paris », déclara-t-il à la police, le 8 octobre 1946.
Pourquoi une subrogée tutelle ? Le Code civil dit : « Dans toute tutelle il y aura un subrogé tuteur, nommé par le conseil de famille. Ses fonctions consisteront à agir pour les intérêts du mineur, lorsqu'ils seront en opposition avec ceux du tuteur ». J'ignore qui devait être le tuteur légal du fils de Robert Denoël.
Interrogé par les policiers, Percheron déclare : « Je lui déclarai que je prendrais mon rôle de subrogé tuteur au sérieux et je la mis en garde contre la gestion que son mari m’avait signalée défectueuse de M. Maximilien Vox et son adjoint. Je ne connais ni l’un ni l’autre de ces messieurs mais les renseignements que m’avait donnés Denoël, et que sa femme avec laquelle il était en instance de divorce devait ignorer, me paraissaient suffisamment graves pour que je la mis [sic ] au courant. Je n’avais aucun intérêt matériel en jeu et je n’avais comme intérêt moral que celui de répondre à la proposition d’être subrogé tuteur, rôle dont je n’ai d’ailleurs plus entendu parler. »
Selon lui, Cécile lui a parlé de ses difficultés financières : « Elle me dit ensuite qu’elle désirait faire un très bel enterrement mais qu’elle se trouvait cependant un peu gênée. Ayant à mon tour téléphoné à Mme Loviton et lui ayant fait part des conversations que j’avais eues avec Mme Denoël, Mme Loviton me dit qu’elle prenait à sa charge tous les frais d’enterrement, désirant que cela fût " bien ". Je téléphonai donc à Mme Denoël, qui me remercia de mon intervention et me dit textuellement : " Dites à Jeanne que je l’embrasse ". »
Au cours de la semaine eurent lieu de curieuses tractations entre les deux femmes, toujours par l'intermédiaire de Percheron, qui s'en expliqua : « Le lendemain Mme Denoël m’avertit que les frais s’élèveraient à 120 000 frs et me chargea de demander un chèque à Mme Loviton. Celle-ci, trouvant la somme considérable, envoya Mme Dornès à la Maison de Borniol qui, justement, fournissait à une maison secondaire et qui donna un devis d’une soixantaine de mille francs. Je téléphonai donc à Mme Denoël qu’elle aurait intérêt à s’adresser à la Maison Borniol, au lieu d’un sous-traitant de celle-ci et, qu’en tout cas les factures n’avaient qu’à être envoyées à Mme Loviton, qui réglerait sur le champ. Il n’y eut jamais de suite à cette tractation. »
Me Rozelaar réfuta cette version : « Avec dignité, Mme Denoël refusa ces deux propositions. Elle paya les frais d'obsèques et se refusa à tout contact commercial avec l'ancienne maîtresse de son mari. »
René Barjavel s'est rendu seul rue de Buenos-Ayres. Au cours de la conversation il a évoqué la situation de la maison d'édition : « pensant que l’action intentée contre Robert Denoël était éteinte du fait de sa mort, je lui ai dit que la maison allait pouvoir repartir sur ses bases primitives et qu’on allait enfin sortir du provisoire ». Dans son esprit, cela signifiait que la mort de l'éditeur annulait toutes les poursuites (ce en quoi il se trompait) et que l'administration provisoire de Vox n'avait plus de raison d'être. Mais il s'est, dit-il, gardé de mettre en cause sa gestion.
Il admet cependant en avoir parlé avec Percheron : « nous nous sommes entretenus de la situation dans laquelle se trouvaient les Editions Denoël à la suite du décès de Robert ; nous avions envisagé qui pourrait reprendre en main cette affaire et avions convenu que seule Mme Loviton était capable de sauver la maison. Il s’agissait là toutefois de projets pour la réalisation desquels Mme Loviton n’avait même pas été consultée ».
C'est Percheron qui lui a appris que Jeanne Loviton avait proposé de payer les frais de l'enterrement : « au cours de nos conversations avec Mme Denoël, cette dernière m’a parlé de Mme Loviton avec sympathie. C’est dans cet état d’esprit que j’ai pu dire à Mme Denoël, émettant une opinion toute personnelle, que si Mme Loviton prenait l’affaire en main, elle sauvegarderait les intérêts de l’enfant. »
Il n'était en aucun cas mandaté par Jeanne, dont il n'a fait la connaissance que huit jours après la mort de l'éditeur. Il n'a donc pu parler à Cécile du « rachat des parts de Robert Denoël dans son affaire, pas plus que je ne lui ai dit que Mme Loviton était désireuse de faire une rente à l’enfant et qu’elle lui rétrocéderait les parts à la majorité de celui-ci. »
Paul Vialar n'a été interrogé par la police que cinq ans après les faits mais il se remémore parfaitement sa visite chez Mme Denoël : « j’ai rendu visite à sa femme en compagnie de MM. Barjavel et Percheron, mais à aucun moment il n’a été question tant au cours de cette visite qu’à toute autre époque, d’une démarche pour l’amener à céder les parts de son mari dans la Société Denoël à Mme Loviton, cette cession ayant déjà été faite, tout au moins d’après les propres déclarations de M. Denoël. [...] En réalité la visite faite à Mme Denoël avec MM. Barjavel et Percheron avait pour but de la mettre ou courant des intentions de Mme Loviton vis-à-vis du mineur en vue d’assurer son avenir et son entrée dans la maison lorsqu’il en aurait l’âge. »
Me Rozelaar avait, le 21 mai 1946, écrit au juge Gollety que Percheron, Barjavel et Vialar, venus ensemble voir Mme Denoël, lui avaient déclaré que Jeanne Loviton « accepterait de racheter à la succession les parts de la Société Denoël, et s'engagerait à faire une rente à l'enfant, en promettant de lui revendre à sa majorité ces parts en totalité ou en partie ». Les deux premiers l'avaient contesté ; Vialar reconnaît, lui, être venu chez elle en leur compagnie.
Pour ne rien arranger, Robert Beckers, dont les déclarations sont souvent confuses, déclarera en 1950 : « Si mes souvenirs sont exacts, le mardi 4 décembre, j’ai déjeuné avec Mme Denoël à son domicile, peut-être également en compagnie de M. Barjavel. A l’issue de ce déjeuner, M. Vialar et Mme Vialar sont également venus ; au cours de la conversation, il a été décidé qu’une réunion d’auteurs de la maison qui pourraient être joints aurait lieu, afin de défendre la mémoire de M. Denoël et de sauvegarder les intérêts des Editions Denoël qui étaient également ceux des auteurs. J’ai proposé comme lieu de réunion l’appartement de Mme Lenoir, 56 rue Galilée à Paris (8e). »
Beckers, qui n'est pas un auteur Denoël, n'a pas assisté à cette assemblée mais il affirme qu'elle a bien eu lieu, et qu'elle réunissait René Barjavel, Gilbert Dupé, Lucienne Favre, Maurice Percheron, Jean Proal et Paul Vialar. Cette réunion avait été initiée par Percheron et il s'en expliqua à la police, le 8 octobre 1946 : « Je lui signalai [à Cécile] l'intérêt qu'il y aurait, lorsque les parts allemandes détenues par les Domaines seraient vendues, à ce qu'elles n'allassent point dans n'importe quelles mains et je suggérai que, peut-être, on pourrait porter comme acheteur un groupe d'auteurs de la maison qui recèderaient ensuite les parts à l'enfant. [...] Les parts resteraient ainsi dans les mains d'abord des auteurs de la maison puis ensuite de l'héritier, au lieu d'être rachetées par un concurrent ou par un capitaliste quelconque. Il ne fut jamais question des parts possédées par Mme Loviton. Robert Denoël m'avait, plusieurs mois avant, confirmé la cession de ces parts. » Il en parla ensuite à Me Rozelaar, qui trouva l'idée pertinente.
Beckers admet avoir entendu parler des propositions de Jeanne Loviton : « Très peu de temps après le décès de M. Denoël, probablement dans la semaine qui a suivi le décès, en tout cas avant l’enterrement, j’ai appris soit par M. Barjavel, soit par M. Vialar, soit par M. Percheron, et certainement pas par personne d’autre, que Mme Loviton avait proposé à Mme Denoël par personne interposée, de lui verser des mensualités qui lui auraient permis d’élever le fils de Robert Denoël, et qu’elle lui aurait fait proposer en même temps de faire entrer le jeune Robert Denoël dans la maison d’édition de son père, quand il aurait été assez âgé pour se familiariser avec le métier d’éditeur, s’il en manifestait le goût. »
Cécile est désorientée par la tournure affairiste de ces entretiens et demande à réfléchir, avant de s'adresser à un avocat, Mme Armand Rozelaar. Les gens qui viennent la voir lui parlent des affaires de son mari comme s'ils y étaient mêlés. Ils le sont tous, en effet, mais elle l'ignore car, depuis leur séparation, Denoël ne la tient plus au courant de la marche de ses éditions et moins encore, de leur comptabilité - dont elle ne s'est jamais préoccupée durant quinze ans.
8 décembre
Enregistrement au greffe du tribunal de commerce de la Seine d'une cession de 1 515 parts de la Société des Editions Denoël appartenant à Robert Denoël au profit de la Société des Editions Domat-Montchrestien, représentée par sa gérante, Jeanne Loviton. Le document, daté du 25 octobre 1945, a été déposé par l'administrateur de biens Jean Lucien, 11 rue Bernoulli (VIIIe).
Cette prise de contrôle de la Société Denoël ne sera signifiée aux actionnaires de la Société Domat-Montchrestien que le 9 janvier 1946.
11 décembre
Enterrement de Robert Denoël dans un caveau provisoire du cimetière du Sud-Montparnasse, aucune concession n'étant disponible. Une messe a été célébrée à midi à l’église Saint-Léon, place Dupleix, dans le XVe arrondissement (c'est la paroisse dont dépend l'appartement des Denoël, rue de Buenos-Ayres).
Albert Morys raconte : « Le jour de l'enterrement, c'était un homme qui conduisait le deuil avec sa mère. Plus ferme que jamais, le regard haut et droit, l'œil sec. Plus tard, on a dit que le fils n'avait pas plus de cœur que sa mère. Ils avaient, l'un et l'autre, un courage indomptable. Mais nul ne saura jamais combien chacun d'eux a pu pleurer lorsqu'il se fut enfermé dans sa chambre. A cet enterrement, parmi les amis, les auteurs, trop peu nombreux il faut le dire, la couardise dépassant encore l'ingratitude, je reconnus deux ou trois des " houris" de Robert. »
Je n'ai pas trouvé de compte rendu de ces obsèques discrètes qui n'ont réuni que quelques dizaines de personnes. Côté familial, la présence de Billy Ritchie-Fallon, Fernand Houbiers et Jean Déome est avérée. Les amis proches : Albert Morys, Gustave Buyneel, Serge Moreux. Dans le milieu de l'édition : Bernard Steele et Marie Canavaggia. Parmi les amies de cœur, que Morys qualifie curieusement de houris : Dominique Rolin.
1946
Le 9 janvier, la Société des Editions Domat-Montchrestien avise la Société des Editions Denoël qu’elle est devenue propriétaire de toutes les parts de Robert Denoël, et demande une réunion de ses actionnaires en vue de nommer un nouveau gérant.
Le même jour, Jeanne Loviton avise officiellement ses associées que la Société des Editions Domat-Monchrestien a acquis 1 515 parts dans la Société des Editions Denoël.
Le 15 janvier, Jeanne Loviton convoque Max Dorian à l'assemblée des actionnaires de la Société des Editions Denoël qui aura lieu, rue Amélie, le 21 janvier.
Le 21 janvier a lieu, rue Amélie, une assemblée des actionnaires de la Société des Editions Denoël. Sont présents : Jeanne Loviton [1 515 parts] ; M. Boyer, un contrôleur principal de l’Enregistrement représentant l’Administration des Domaines, séquestre des 1 480 parts de Wilhelm Andermann ; Max Dorian [3 parts] ; Pierre Denoël [2 parts], dont on ignore l'adresse en Belgique, n'a pu être contacté.
Le rôle de gérant échoit naturellement à l'actionnaire principal, Jeanne Loviton, dont les appointements mensuels sont fixés à 20 000 francs. Dorian, qui n'est qu'un prête-nom, s'est étonné de figurer dans l’acte de cession de parts à Andermann [celui de 1941 ou celui de 1943 ?] et déclare « réserver son droit de préemption sur lesdites parts ainsi qu’il est prévu aux statuts antérieurs dont il a connaissance ». Il fera en effet valoir ses droits en janvier 1949.
Le 25 janvier, l'inspecteur Ducourthial dépose son rapport (12 pages A4) concernant l'assassinat de l'éditeur, au terme duquel il conclut à un crime crapuleux.
Le 28 janvier, Cécile Denoël tente de faire apposer des scellés au domicile de Jeanne Loviton, rue de l'Assomption. Jeanne s'y oppose et répond que « les quelques effets personnels de Robert Denoël qui se trouvaient chez elle ont été distribués à la mi-décembre à des serviteurs ou remis à Mme Denoël ». Une motocyclette Peugeot, avec laquelle l'éditeur se déplaçait habituellement et réclamée par Mme Denoël était la propriété des " Cours de Droit ", rue Saint-Jacques. La bicyclette qu'il utilisait parfois « n'existe plus depuis un an ».
Le 28 janvier : Cécile Denoël dépose contre Jeanne Loviton une plainte avec constitution de partie civile pour vol, escroquerie, abus de confiance, faux, usage de faux et abus de blanc seing. L'instruction est confiée au juge Jean Bourdon, au grand dépit de Me Rozelaar, qui avait signalé au Parquet que l'enquête sur la mort de l'éditeur était du ressort du juge Ferdinand Gollety.
En même temps, Mme Denoël assigne en référé Mme Loviton et la Société des Editions Domat-Montchrestien, bénéficiaire apparente de la cession de parts, devant le Tribunal civil de la Seine pour faire nommer un séquestre des parts, en attendant la solution du procès qui oppose désormais la succession Denoël à Mme Loviton.
Le 29 janvier, le capital social de 400 200 F [inchangé depuis le 21 décembre 1938] de la Société des Editions Domat-Monchrestien, divisé en 1 334 parts de 300 francs, subit quelques modifications. Jeanne Loviton s'attribue 1001 parts, Yvonne Dornès 268, Mireille Fellous 65. L'objet de la société est aménagé : en plus de l'impression et l'édition d'ouvrages juridiques, il y est ajouté celle d'ouvrages littéraires.
Le 4 février, Cécile Denoël fait apposer des scellés sur l'appartement occupé par son mari, 39 boulevard des Capucines, et qui contient alors une valise porte-manteaux portable, et trois cartons renfermant des effets personnels. Jeanne Loviton déclare à la police que ce sont les seuls objets qui aient appartenu à son amant, mais elle ajoute qu'elle y a joint plusieurs vêtements qu'elle avait distribués et qu'elle a repris ensuite (deux costumes à Abel Gorget, son chauffeur ; une montre-bracelet à René Barjavel ; un pardessus, un veston et un gilet à Gorges Fort, le magasinier des Editions Denoël).
Mlle Pinet, clerc de l'avoué Danet, agissant à la requête de Mme Denoël, « fait toutes réserves contre les déclarations de Mme Loviton pour ce qui concerne : un appareil Rolleiflex, enviton 3 000 volumes, romans, livres anciens, livres de luxe, livres reliés, manuscrits de divers auteurs, contrats avec les auteurs, nombreux papiers personnels, meubles, portrait de M. Denoël, objets d'art, monnaie d'or, et devises. »
Le 5 février, Jeanne Loviton proteste officiellement « contre les termes de la sommation délivrée le 28 janvier 1946, jugeant inutile de répondre aux sarcasmes déplacés de Mme Denoël », répétant que Robert Denoël « n’avait rien emporté avec lui, laissant à sa femme tout ce qu’il possédait [...] et qu’il avait dû vendre ses livres pour des raisons de nécessités pressantes. »
Le 28 février, le président du Tribunal civil de la Seine donne satisfaction à la requête du 28 janvier de Cécile Denoël et nomme Me Roger Danet, avoué, séquestre des parts litigieuses. Jeanne Loviton interjette immédiatement appel : l’affaire sera plaidée le 18 mai.
Le 2 mai, Cécile Denoël se constitue partie civile dans l'instruction ouverte par le Parquet sur la mort de son mari. Si elle a tardé à le faire, écrit-elle au juge Gollety, « c'était pour permettre à la police et à la justice d'effectuer leurs recherches en toute objectivité. Mais, devant l'impression de carence totale de l'enquête », elle prie le magistrat de la convoquer sans attendre.
A sa connaissance, « aucune perquisition, aucune recherche, aucune enquête quelconque n'a été effectuée », ce qui est exagéré, mais il est vrai que la Brigade Criminelle a conclu rapidement à un crime crapuleux.
Le 18 mai : L'affaire des parts mises sous séquestre est plaidée devant la 1ère Chambre de la Cour. L'arrêt sera rendu à quinzaine.
Le 21 mai : Me Armand Rozelaar adresse au juge Gollety un mémoire de 9 pages justifiant la constitution de partie civile de sa cliente. L'avocat, pour qui le civil et le pénal sont liés, est forcé d'y aborder les deux aspects de l'affaire, dont l'un est du ressort du juge Bourdon, l'autre du juge Gollety.
Il y mentionne différentes « manœuvres inquiétantes » dont sont victimes Cécile et son fils depuis le début du procès. Pour la veuve de l'éditeur, il s'agit de personnes qui, ayant appris qu'elle avait besoin d'argent, lui proposent de sous-louer des pièces de son appartement. Une autre fois c'est un individu bizarre qui lui propose d'éditer un ouvrage « de provocation » intitulé : « Hitler, roi des juifs ».
Le fils de l'éditeur a alors treize ans, il est donc fragile. Or, dit l'avocat, alors qu'il jouait « à la guerre ou aux Peaux-Rouges » avec des pistolets de bois sur le Champ de Mars avec des garçons de son âge, un automobiliste qui les observait a braqué un véritable revolver sur lui et il s'est enfui, apeuré ».
Dans ses mémoires, Albert Morys revint sur ces incidents, y en ajoutant d'autres : une voiture qui monta sur un trottoir où Cécile marchait, au risque de l'écraser ; deux balles tirées du Champ de Mars en direction de sa fenêtre, où elle écrivait ; une tentative d'enlèvement du fils de l'éditeur dans un terrain vague... Il fut alors décidé que Robert junior irait passer quelques mois à Liège chez Elvire Herd, la mère de Cécile.
En mai, Sidonie Zupanek a quitté le service de Jeanne Loviton. Elle est réentendue par la police et déclare que « tout ce que possédait M. Denoël se trouvait dans sa chambre au 9 de la rue de l'Assomption. Il y avait un costume, une robe de chambre, deux chemises, une paire de chaussettes et des pantoufles. Ses affaires se trouvaient 39 bd des Capucines, dans une ou deux valises et des cartons. »
En réalité Sidonie ne trouvera une nouvelle place que deux mois plus tard, comme le révélera Me Rozelaar. En attendant elle se conforme aux directives de sa patronne. L'inspecteur Ducourthial épinglera ses contradictions dans son rapport du 15 novembre 1946 : elle a déclaré qu'elle savait que Robert et Jeanne se rendaient au théâtre, le soir du drame. Or dans la nuit du 2 au 3 décembre, Sidonie lui avait dit qu'ils étaient sortis sans lui faire part de leurs intentions. A Cécile Denoël qui l'avait appelée au cours de cette même nuit, elle avait répondu qu'ils étaient sortis avec des amis. Elle dit encore que le couple était rentré rue de l'Assomption vers 19 h 30, alors qu'elle situait auparavant ce retour vers 19 heures. Elle parle de deux places pour le théâtre, qu'elle a remis à Jeanne avant leur départ, quand il s'agissait d'un seul billet pour deux places. Et elle assure que les quelques affaires personnelles de l'éditeur se trouvaient au 9 rue de l'Assomption (une cabane à outils) quand elle parlait naguère de la chambre qu'il occupait chez sa patronne...
Le 1er juin : La 1ère Chambre de la Cour confirme la décision du premier juge, l’instruction étant toujours en cours. Les parts litigieuses resteront chez Me Danet.
Le 18 juillet : Dans une lettre qu’il adresse au juge Gollety, Armand Rozelaar s’inquiète de documents produits par Jeanne Loviton, au cours de la procédure civile. Après avoir rappelé que tous les papiers que possédait l’éditeur à son bureau, boulevard des Capucines, ont disparu peu après sa mort, il rappelle que Jeanne Loviton en a déposé un au greffe du tribunal « qu’elle n’a pu retrouver que dans les papiers personnels de Denoël. Il s’agissait du brouillon d’une lettre que celui-ci entendait adresser à sa femme et qu’il ne lui a d’ailleurs jamais envoyée ».
Il a appris que Mme Loviton s’était rendue à Figeac quelques jours après la mort de Denoël, et que, peu après la mise sous séquestre des parts litigieuses de la Société des Editions Denoël [28 février 1946], elle est partie pour la Suisse où elle a résidé à plusieurs reprises : « la partie civile pense qu’il serait peut-être utile de faire rechercher, tant à Béduer que dans le ou les coffres que Mme Loviton possède vraisemblablement dans une ou plusieurs banques en Suisse, les documents personnels ayant appartenu à feu M. Denoël. »
Le 24 août, l'inspecteur Ducourthial, assisté par deux gendarmes de Figeac, effectue une perquisition au château de Béduer. Aucun document n'y a été saisi. Etaient présents : Jeanne Loviton, Simone Penaud, Jacques Mallarmé, Maurice Percheron.
Le 30 octobre : Le juge Bourdon rend une ordonnance de non-lieu dans l'affaire de vol, escroquerie, abus de confiance, faux, usage de faux et abus de blanc seing initiée par Cécile Denoël, le 28 janvier, contre Jeanne Loviton. Cette ordonnance a été signifiée le 6 novembre à la veuve de l'éditeur, qui fait appel dès le lendemain.
Le 15 novembre, l'inspecteur Ducourthial dépose son rapport (44 pages A4) concernant l'assassinat de Robert Denoël. Il conclut, comme précédemment, à un crime fortuit.
Le 20 décembre, la Chambre des Mises en accusation de la Cour d'appel de Paris confirme l'ordonnance du 30 octobre et déboute Cécile Denoël, avec des « attendus » qui méritent l'attention.
Sur l'inculpation de vol : la Cour considère que Denoël, séparé de biens par contrat de mariage, et habitant maritalement depuis un an avec Jeanne Loviton, une communauté de fait a ainsi existé qui « ne permet pas d'accueillir autrement qu'avec une extrême circonspection toute présomption d'appropriation frauduleuse, de la part de celle-ci, d'objets personnels à celui-là. »
La partie civile a tenté de « déterminer le corps du délit allégué, mais il demeure incertain ». Cécile Denoël a bien produit des factures d'achats de vêtements et de meubles livrés à Denoël depuis 1943, mais « elle n'a pas été à même de rapporter la preuve qu'ils aient été en possession de l'éditeur dans l'un des locaux qu'il occupait avec la dame Loviton, au jour de son décès ».
D'ailleurs, sur réclamation de la veuve de l'éditeur, Jeanne Loviton « a fait rapporter les objets qu'elle avait cru pouvoir distribuer, à titre de libéralités, après le décès de son amant ». Le non-lieu est donc justifié concernant le vol.
Sur l'inculpation de faux et usage de faux : il s'agit de l'acte de cession de toutes ses parts dans sa société d'édition par Denoël au profit de sa maîtresse. Il n'a pas été contesté que la signature et la mention « Bon pour pour cession de 1 515 parts », qui la précède, sont de la main de Robert Denoël.
Il est seulement allégué que le nom de la dame Loviton et la date du 25 octobre 1945 « ont été frauduleusement inscrits après coup, dans les blancs laissés à cet effet dans le corps de l'acte enregistré le 8 décembre 1945, et ratifié par délibération de l'assemblée générale de la société le 21 janvier 1946 ».
La Cour a relevé dans le mémoire de Me Rozelaar qu'il avait écrit qu' « absent de son entreprise, Denoël continuait à travailler sous le couvert des Editions Domat-Monchrestien : la partie civile elle-même atteste le fait d'un transfert d'intérêts dont l'acte incriminatif pourrait bien n'avoir été que l'expression de droit. »
Cécile et son avocat n'ont pas vu venir le coup. Dans leur esprit, Denoël travaillait chez Domat-Montchresrtien parce qu'il en avait pris le contrôle en rachetant la majorité des actions sous le couvert d'un prête-nom (Yvonne Dornès), mais, pour les juges, c'est bien Domat-Montchrestien qui avait racheté les parts majoritaires de Denoël.
Le non-lieu est donc justifié quant à l'inculpation de faux et usage de faux. Cécile Denoël entend « subsidiairement, faire substituer aux infractions servant de base à sa plainte, celle d'abus de blanc-seing, d'escroquerie et d'abus de confiance, et sollicite un complément d'information. »
Ce non-lieu, auquel elle n'interjeta pas appel, fut signifié à Mme Denoël le 2 janvier suivant.
Le 30 décembre : Jeanne Loviton obtient, à la suite de cette décision, la levée du séquestre sur les parts qu'elle détient dans la Société des Editions Denoël. Cette ordonnance sera confirmée, le 19 juillet 1947, par un arrêt de la Cour d'appel.
1947
Le 25 janvier, un chroniqueur de la Gazette du Palais rend compte de cet arrêt inattendu et conclut que « la cohabitation, même adultérine, constitue pour la femme une présomption d'appropriation légitime ; la conclusion serait que la concubine serait mieux placée que la femme mariée qui, elle, si elle divertit les objets de communauté, commet le délit civil du recel et se voit infliger les sanctions de l'article 792 du Code civil. La " communauté de fait " est désormais préférable, pour la femme, à la communauté légale ! Voilà une nouvelle ombre sur l'institution du mariage, dont certains annoncent déjà le crépuscule. »
Le 27 janvier : Jeanne Loviton est nommée gérante de la Société des Editions Denoël par 2 995 voix contre 3 voix et 2 abstentions, ces dernières étant celles de Max Dorian et Pierre Denoël. Cette nomination a été différée à cause des multiples procédures initiées par Cécile Denoël depuis janvier 1946.
Le 15 mai : L’administration provisoire des Editions Denoël est levée après validation de la cession des parts de Robert Denoël aux Editions Domat-Montchrestien.
1948
Le 12 janvier : Auguste Picq, directeur commercial et fondé de pouvoirs des Editions Denoël, est licencié « par Mr Couillard, directeur adjoint des Domaines, pour le motif de suppression d’emploi, le 12 janvier 1948, à l’instigation de Mme Loviton, devenue gérante des Editions Denoël, depuis un certain temps », déclara-t-il à la police le 1er février 1950.
Le 20 janvier : Les Editions de la Tour créées par Robert Denoël à la Libération sont déclarées en faillite.
Le 30 avril : Les Éditions Denoël passent en Cour de justice. L’administrateur judiciaire de la société, M. Weil, nommé le 23 février précédent, y comparaît en compagnie de son conseil, Me Joisson, et du directeur des Domaines de la Seine, en qualité d’administrateur séquestre des parts de Wilhelm Andermann.
La Cour de justice, qui est dirigée par le président J.R. Castel, acquitte « purement et simplement la Société des Editions Denoël, des poursuites engagées contre elle, sans dépens ». C'est un jugement qui provoque de nombreuses réactions dans la presse.
Le 7 mai : Aux Ecoutes, l'hebdomadaire de Paul Lévy, après avoir rappelé que Denoël avait bénéficié d'un non-lieu en juillet 1945, écrit : « il restait cependant à juger la responsabilité de sa société, dont les Domaines détiennent toujours les titres, estimés à 9 millions. C’est en la personne de son administrateur provisoire que la société comparaissait devant la Cour. Robert Denoël ayant bénéficié d’un non-lieu, sa société pouvait-elle être condamnée ? Telle était la question posée aux jurés.
Avec beaucoup d’embarras, le commissaire du Gouvernement conclut par l’affirmative, tout en faisant remarquer à la Cour que si cette société était déclarée dissoute et ses biens confisqués, c’était une perte sèche de 9 millions pour l’Etat et la ruine des auteurs ayant des contrats datant d’avant-guerre. D’autre part, il convenait de ne pas oublier que Denoël devait céder ses parts à la société de Mme Loviton et qu’on portait à celle-ci un préjudice grave. Le ministère public suggéra donc de ne prononcer qu’une amende, même importante, qui laisserait intact le patrimoine social. »
L'hebdomadaire conclut que la Cour est allée encore plus loin que le réquisitoire modéré du commissaire du Gouvernement, M. Fouquin, en faisant droit aux conclusions de l'avocat de la Société des Editions Denoël.
Un quotidien non identifié écrit, à la même époque, que « c'est à l'influence d'une amie dont le mari occupe encore des fonctions gouvernementales, que Mme Loviton doit, notamment, d'avoir obtenu la levée de l'administration provisoire dont était dotée la maison Denoël. Force est de constater que, depuis l'assassinat de Robert Denoël, tous les procès qu'a engendrés sa disparition se sont terminés en queue de poisson. A commencer par l'enquête sur le crime lui-même. » Le nom de Suzanne Borel, l'épouse de Georges Bidault, n'est pas imprimé mais tout Paris sait que c'est une amie intime de Jeanne Loviton.
Le 24 décembre : Le Tribunal de Commerce de la Seine estime simulée la cession de parts des Éditions Denoël aux Éditions Domat-Montchrestien, et condamne cette société et sa gérante à payer solidairement à la veuve de Robert Denoël la somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts.
Mmes Denoël et Loviton se pourvoient immédiatement en appel de cette décision. Mme Denoël demande à la Cour d’appel d’élever à 5 000 000 de francs le montant des dommages-intérêts alloués par le tribunal.
Max Dorian, qui avait cru pouvoir faire valoir ses droits à propos des trois parts qu'il détenait dans la Société des Editions Denoël, a été débouté. Mais, le 8 janvier 1949 il écrit de New York à Cécile qu'il serait volontiers repreneur de la société, à l'aide de « substantiels concours de la part d’Américains (Bernard Steele m’a dit en octobre que ça ne l’intéressait plus, mais peut-être a-t-il changé d’opinion) ». Cécile Denoël ne donnera aucune suite à son courrier, pas plus que Louis-Ferdinand Céline, contacté à la même époque en vue de rééditer ses livres.
1949
Le 26 octobre : La 3e Chambre de la Cour d’appel de Paris, qui devait se prononcer dans l’affaire de la cession des parts des Éditions Denoël aux Éditions Domat-Montchrestien, remet son jugement à huitaine.
Le 2 novembre : La Cour d’appel de Paris n’infirme pas le jugement rendu le 24 décembre 1948 par le Tribunal de Commerce mais, s’estimant insuffisamment informée, nomme un expert-comptable pour examiner les écritures litigieuses.
Il est avéré que le montant de la cession de ces parts (757 500 F) n'a pas été versé le jour de la datation de l'acte, le 25 octobre 1945. Jeanne Loviton a fait valoir qu'elle avait, le 21 novembre 1945, avancé l'argent à la Société Domat-Montchrestien par l'intermédiaire de celle des « Cours de Droit », et qu'elle a payé Denoël « de la main à la main, sans témoin », le 30 novembre.
L'expert nommé par la Cour s'appelle Paul Caujolle [1891-1955]. Il est, depuis le 18 avril 1942, président du Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables : Croix de Guerre 1914-1918, Chevalier de la Légion d'Honneur, Croix de Guerre 1939-1945, médaillé de la Résistance, Caujolle est une autorité incontestée à cette époque. En 1945 il avait été chargé de vérifier les écritures de l'affaire Louis Renault.

Ce qui lui est demandé de vérifier est :
« 1° Quelle a été l’intention des parties au moment de la rédaction de l’acte litigieux, pour quelles raisons il a été laissé des blancs, dans quelles conditions ils ont été remplis,
2° Quelles étaient les ressources et les moyens d’existence de Robert Denoël en 1945, quelles ont été les sommes encaissées par lui et les dettes qu’il aurait payées en octobre et novembre 1945,
3° A quelle date exacte la somme de 757 500 fr aurait été effectivement versée, si elle l’a été, comment, au moyen de quels fonds et en vérifiant leur origine,
4° D’évaluer la valeur des parts litigieuses à la date du 25 octobre 1945, compte tenu des circonstances de la cause. »
Le 4 décembre Combat publie une déclaration explosive d'un des juges consulaires qui se sont prononçés, le 24 décembre 1948, pour la fictivité de l'acte de cession de ses parts par Robert Denoël : « Jamais nous n’avons reçu tant de sollicitations et des plus diverses. Si les juges officiels ont manqué de tenue, comme on l’a prétendu, dans ce procès nous avons tenu à prouver que le Tribunal de Commerce savait rendre justice. » Pourtant, ajoute le chroniqueur, le bruit court que la Préfecture de police posséderait un dossier, gardé secret, qui serait susceptible de faire rebondir l’affaire sur un nouveau plan, celui de la justice répressive.
Jeanne Loviton (qui se manifeste pour la première fois dans la presse) demandera, le 7 janvier, au quotidien d'insérer un droit de réponse : son avocat Rosenmark a saisi le Procureur général, qui s'est informé auprès du Préfet de Paris : ses services ne détiennent aucun dossier secret à propos du meurtre de l'éditeur.
Le 21 décembre, Me Armand Rozelaar adresse au Procureur de la République un mémoire de neuf pages A4 concernant l'affaire Denoël au terme duquel il demande la réouverture de l'enquête criminelle. Les documents nouveaux qu'il produit sont susceptibles d'expliquer cet assassinat qui, à ses yeux, est un meurtre d'intérêt.
L'avocat a entrepris des investigations au Registre de commerce à propos de la Société des Editions Domat-Montchrestien, qui lui ont apporté « la preuve éclatante du considérable intérêt que R. Denoël avait dans cette entreprise ».
Si l'éditeur avait,début 1945, conçu le projet de céder ses parts à Jeanne Loviton, « c'était uniquement parce qu'en sous-main, et par personne interposée, Robert Denoël présidait aux Editions Domat-Montchrestien, comme il avait aux Editions de la Tour la majorité des parts et qu'il pouvait ainsi, sans danger même en cas de confiscation de ses biens, céder les parts de la Société Denoël à une autre société qu'en fait il contrôlait. »
Me Rozelaar étayait ensuite ses affirmations : « Le 18 décembre 1942, M. Alexandre Gougeon, professeur de droit, cédait à Mme Loviton et à M. Germain Martin les 504 parts qu'il possédait dans la Société à raison de 502 parts à Mme Loviton et 2 parts à Germain Martin. Le capital social était alors réparti de la manière suivante : 1 332 parts à Jeanne Loviton, 2 parts à Germain Martin. » M. Gougeon quittait l'affaire et Mme Loviton en devenait la seule gérante.
« Le 18 août 1943 eut lieu un acte de cession entre Jeanne Loviton, Yvonne Dornès et Germain Martin. M. Germain Martin cédait ses deux parts à Mme Dornès, et Mme Loviton cédait à la même 666 parts. »
Au terme de cet accord, le capital social était réparti entre Mme Loviton (664 parts) et Mme Dornès (668 parts), cette dernière devenant majoritaire dans la société.
Pour Me Rozelaar il ne fait aucun doute qu'un changement aussi radical dans la répartition des parts n'avait lieu d'être que parce que Robert Denoël a racheté les siennes à Yvonne Dornès et qu'il a pris ainsi le contrôle de Domat-Montchrestien : « Des cessions de parts en blanc ont certainement été établies, ainsi qu'il le faisait habituellement pour toutes ses sociétés. » Le raisonnement de l'avocat est crédible mais que sont devenues ces parts en blanc ? On n'a rien retrouvé dans l'appartement de Denoël, boulevard des Capucines...
L'avocat poursuivait sa démonstration : « le 8 janvier 1946 Mmes Loviton et Dornès signent entre elles une nouvelle cession de parts de leur société : Mme Dornès cède à Mme Loviton 337 parts sur les 668 qu'elle détenait, et Mme Loviton redevient alors largement majoritaire chez elle avec 1 001 parts, tandis que Mme Dornès n'en conserve que 333. »
Une nouvelle réunion des actionnaires dans la Société Domat-Montchrestien a lieu le 29 janvier 1946. Elles sont trois : Jeanne Loviton (1 001 parts), Mireille Fellous (65 parts, qui les tient d'Yvonne Dornès), Mme Dornès (qui en a conservé 266). C'est ce même jour que Jeanne Loviton annonce officiellement à ses associées qu'elle a fait l'acquisition de la majorité des parts de la Société des Editions Denoël, et que la Société Domat-Montchrestien modifie ses statuts en adjoignant à l'édition d'ouvrages juridiques celle d'ouvrages de littérature.
Le crime d'intérêt avait déjà été invoqué en 1946, lors de l'enquête de la Brigade Criminelle, et l'inspecteur Ducourthial ne l'avait d'ailleurs pas écarté dans ses conclusions : « Cette hypothèse émise par la partie civile ne trouve cependant pas sa confirmation dans le procès existant entre Mme Denoël et Mme Loviton, étant donné que cette question de cession de parts peut être régulière, comme elle peut constituer des manœuvres consécutives à la mort de M. Denoël, alors que rien ne prouve que le meurtre soit une conséquence de la préméditation de ces manœuvres. »
Quatre ans plus tard Me Rozelaar avait de nouveaux arguments à faire valoir mais il lui manquerait toujours les seules pièces décisives que constituaient les cessions de parts en blanc disparues. Il possédait bien des documents probants mais il ne semble pas que la dernière enquête de police en ait tenu compte : « Si l'on rapproche ces événements de certaines traites acceptées par les Editions Domat-Montchrestien, escomptées par les Editions de la Tour du vivant de R. Denoël et dont le prix restait à payer (elles sont en ma possession), ce qui prouve ainsi que c'était bien R. Denoël qui finançait Domat-Montchrestien et non le contraire, on s'aperçoit que la mort subite et mystérieuse de R. Denoël pouvait arranger bien des choses. »
L'avocat pourrait aussi contester la validité de la cession de parts du 25 octobre 1945, enregistrée six jours après la mort de l'éditeur et déclarée tardivement aux actionnaires des Sociétés Denoël et Domat-Montchrestien, mais c'est l'expert Caujolle qui détenait désormais la clé de l'affaire.
Le mémoire de l'avocat de Cécile Denoël était nettement plus incisif que celui qu'il avait adressé au juge Gollety, le 21 mai 1946 : « L'enquête est donc à reprendre depuis le début et, dans l'intérêt de la Justice et de la Vérité, quelles que soient les relations dont puissent se prévaloir certaines personnes, il faut que cette enquête aboutisse et que, dans cette affaire, on en finisse une bonne fois avec cette atmosphère trouble, faite entièrement de doute, de suspicion, de combinaisons, de truquages et d'interventions politiques qui ont jusqu'à maintenant empêché la bonne marche de la justice. »
Le 28 décembre, le Parquet de la Seine ordonne la réouverture de l’enquête criminelle par réquisitoire n° 92647, la plaignante ayant apporté « un certain nombre d'éléments de nature à faire rejeter la version d’un crime crapuleux pour faire admettre la possibilité d’un crime commis par intérêt ».
1950
Le 8 janvier : Cécile Denoël se constitue à nouveau partie civile et adresse au juge Ferdinand Gollety un mémoire de 20 pages A4, qui porte à la fois sur les circonstances de la mort de son mari et sur ses affaires, les deux étant liées.
Cécile rappelle qu'à la Libération, son mari lui avait écrit qu'elle ne manquerait de rien, qu'il continuerait à travailler, et qu'il possédait des réserves lui permettant de remonter une entreprise quand et dès qu'il le pourrait : « D'après mon estimation personnelle et d'après ce que mon mari m'avait laissé comprendre, la somme liquide dont il disposait à l'époque était de l'ordre de 5 à 6 millions de francs au moins. »
Lorsque Denoël fut, le 19 février 1945, inculpé d'intelligence avec l'ennemi, « il m'assura qu'étant donné les relations que Mme Loviton possédait dans les milieux officiels, il finirait bien par ne pas avoir trop de difficultés. »
Elle évoque les Editions de la Tour, dirigées par Denoël sous le couvert de deux prête-noms, Albert Morys et Maurice Percheron, grâce à des cessions de parts en blanc confiées à son agent d'affaires, Georges Hagopian, qui les lui remit après la mort de son mari, sauf celles de Percheron qui prétendit qu'elles lui appartenaient en propre en raison d'un prêt qu'il aurait consenti à l'éditeur, et qui sont aujourd'hui chez un séquestre amiable, Me Roger Danet.
Cécile reconnaît qu'au cours de l'année 1945 Denoël lui avait fait part, à diverses reprises, de son intention de divorcer mais il tenait, avant de prendre des décisions concernant sa vie privée, à en terminer d'abord avec son inculpation devant la cour de justice. Un non-lieu fut prononcé en juillet, Denoël prit alors des vacances en compagnie de Jeanne Loviton et, à son retour en septembre, lui dit qu'il avait la ferme intention de reprendre la direction de son entreprise : « C'est également à cette époque qu'il me déclara qu'il avait décidé, évidemment d'accord avec moi, une procédure de divorce amiable. Il m'écrivit à ce sujet le 7 novembre 1945 une lettre que mon conseil a versée au dossier [non retrouvée] et qui vous donnera son véritable état d'esprit, tant à mon égard qu'à celui de notre fils. »
Elle assure que vers la fin novembre, Denoël lui téléphona pour lui demander de retarder la procédure du divorce si elle ne l'avait déjà engagée : « Bien entendu, j'étais trop heureuse de ce revirement et, comme rien n'avait encore été fait, je m'empressai de rester dans la même situation. »
Cécile raconte ensuite la nuit terrible du 2 décembre, au cours de laquelle elle tenta sans succès de prévenir Jeanne Loviton et Maurice Percheron. Vers minuit 30 elle appela Elsa Triolet, qui fondit en larmes : « Je lui dis que l'on pensait qu'il s'agissait d'un crime crapuleux mais que, personnellement, je n'en croyais rien et elle me déclara : " Ne croyez pas, en tout cas, que ce soit un crime politique ". »
Elle appela ensuite Paul Vialar : « après un début de conversation, la communication fut coupée. Ensuite je téléphonai à nouveau chez Mme Loviton où j'obtins enfin une réponse à 2 h 30. Sa femme de chambre répondit que Mme Loviton n'était pas encore rentrée, qu'elle était sortie le soir même avec des amis. » Jeanne Loviton l'appela à trois heures 30 pour lui raconter sa propre soirée tragique.
Dès le lendemain et au cours des jours suivants, Cécile reçut quantité de visites et d'appels de sympathie, notamment de Robert Beckers, qui avait téléphoné à Denoël la veille et, affirme-t-elle, « mon mari lui avait déclaré qu'il avait le soir un rendez-vous important, sans préciser avec qui. »
Maximilien Vox lui révéla qu'il avait appris la nouvelle du crime dès le lendemain matin par son fils Flavien Monod, qui est un ami de Guillaume Hanotaux, lequel lui avait raconté qu'il s'était trouvé l'un des premiers sur les lieux du drame, en compagnie de Roland Lévy. Vox lui aurait aussi fait part d'un coup de téléphone reçu le 3 décembre au matin de la part d'un ami médecin qui disait avoir accompagné Denoël et Jeanne dans sa voiture, le soir de l'attentat.
Cécile rapporte un curieux incident survenu à René Barjavel, venu se plaindre près d'elle d'avoir été licencié par Vox : « Or le jour de l'enterrement, MM. Barjavel et Vox se serrèrent amicalement les mains en ma présence et j'entendis M. Vox dire à M. Barjavel qu'il réintégrerait les Editions Denoël. » On ignore de quel différend il peut s'agir et on ne voit pas trop pourquoi Cécile le mentionne dans son mémoire.
Elle réaffirme que Barjavel, Percheron et Vialar l'ont pressée de vendre ses parts à Jeanne Loviton, ajoutant que « c'avait été le vœu de Denoël et que Mme Loviton serait infiniment plus compétente que je ne pouvais l'être moi-même pour diriger cette entreprise ».
Indignée, Cécile les avait envoyés chez son avocat, en le prévenant « qu'à aucun prix je n'accepterais de céder une seule part de la société à celle qui avait été la maîtresse de mon mari et qui me faisait ainsi solliciter 48 heures après sa mort violente. »
C'est au cours de ces journées pénibles que Me Rozelaar lui fit part d'une étrange entrevue : « Il avait eu au Palais une conversation avec Me Simone Penaud, qui fut l'avocate de mon mari et celle-ci, invoquant l'amitié qui la liait personnellement à Mme Loviton, lui avait demandé, en raison de l'état de nervosité dans lequel ce drame avait plongé cette dernière, de ne pas prendre immédiatement de mesures cœrcitives telles que, par exemple, des appositions de scellés. »
Cécile n'y avait vu, de prime abord, aucun inconvénient - Me Rozelaar non plus, apparemment - mais une démarche de Percheron, venu lui annoncer que Jeanne se proposait de payer les obsèques de son mari, l'avait péniblement impressionnée : « On essayait déjà de me faire croire que le malheureux était mort sans un sou vaillant et qu'il ne possédait pour toute fortune que les 12 000 francs retrouvés dans son portefeuille ».
Cécile et son conseil avaient donc accédé à la demande incongrue de Simone Penaud mais, en janvier 1946, ils étaient avertis par Maximilien Vox que Mme Loviton, « devenue propriétaire de toutes les parts de Robert Denoël dans sa société », avait demandé une réunion des actionnaires, rue Amélie.
Des scellés furent alors apposés tardivement boulevard des Capucines : « je compris alors pourquoi on avait cherché à me dissuader d'apposer les scellés immédiatement après le décès de Robert : on avait fait disparaître les livres, la correspondance, les contrats, les manuscrits, l'appareil photographique et même les photos de mon fils et de moi-même que des témoins avaient pu voir encadrées dans la glace surmontant la cheminée du cabinet de travail de mon mari. Je commençai à comprendre pourquoi on nous avait attendris sur le chagrin de Mme Loviton. »
Elle fit, par huissier, sommation à Mme Loviton, rue de l'Assomption, « d'avoir à me restituer tous les objets qu'elle avait pris, boulevard des Capucines. Elle me répondit par une protestation assez curieuse. » La protestation de Jeanne Loviton, datée du 5 février 1946, disait que Denoël « n'avait rien emporté avec lui, laissant à sa femme tout ce qu'il possédait, et qu'il avait dû vendre ses livres pour des raisons de nécessités pressantes ».
Qu'y avait-il de curieux dans la réponse ? Cécile écrit que Jeanne avait aussi affirmé avoir fait des avances importantes à Denoël au cours des années 1944-1945 et qu' « actuellement elle était associée en participation avec M. Denoël dans la Société des Editions de la Tour ». Si elle a prononcé ces paroles, il y avait effectivement de quoi s'étonner car Jeanne Loviton n'a jamais possédé une seule action dans cette société. Quant aux livres appartenant à Robert Denoël qui auraient été vendus en 1945 « pour des raisons de nécessités pressantes », aucun n'est apparu sur le marché depuis trente ans. Ceux qu'on y trouve parfois proviennent de la collection du fils de l'éditeur, dont j'ai fait l'inventaire en 1980.
A cet endroit Cécile joint le pénal au civil, rappelant qu'elle s'est constituée partie civile dans les deux dossiers. Elle rappelle que le 3 décembre 1945, à la morgue de l'hôpital Necker, Maurice Percheron « avait crié à la cantonade qu'il s'agissait indubitablement d'un crime crapuleux commis par un nègre américain. Toutes les personnes présentes pourront l'attester ». Elle cite Mme Fernand Houbiers, Serge Moreux, Bernard Steele, « et d'autres personnes », sans les nommer.
L'attitude de Percheron était déplacée mais on ne voit pas ce qui peut faire douter Cécile de son honnêteté, si ce ne sont les démarches insistantes qu'il a entreprises peu après pour récupérer ses parts fictives dans la Société des Editions de la Tour. Maurice Percheron a pris le parti de Jeanne Loviton : c'est ce qui la meurtrit le plus.
Au cours des semaines qui ont suivi la mort de son mari, Cécile a, de divers côtés, souvent entendu parler de crime d'intérêt mais, dit-elle, « je ne voyais pas très bien au départ qui pouvait avoir intérêt à tuer mon mari. »
Un de ses amis lui apprit [mais quand ?] que « des bruits parvenus jusqu'à lui, lui permettaient d'affirmer qu'un autre service de police de la Préfecture avait fait une enquête approfondie sur cette affaire et qu'il existait un dossier confidentiel soigneusement caché dans un coffre-fort au cabinet même du préfet de police. Il ajoutait que, connaissant personnellement l'actuel préfet de police, M. Léonard, il accepterait de lui poser la question. »
Cet ami s'appelle Pierre Clarel [1899-1953], il est comédien et a figuré en 1942 dans Haut-le-Vent, un film de Jacques de Baroncelli, où Albert Morys tenait un petit rôle. C'est donc une relation de Morys et Cécile et il a édité chez eux, aux Editions du Feu Follet, un roman gai : Mes Folles, en 1948.
S'appuyant sur les confidences de cet acteur si bien informé, Cécile a relu les procès-verbaux de la première enquête de la Brigade Criminelle (en tant que partie civile, elle en a le droit) et s'est aperçue que le soir du crime, l'un des premiers coups de téléphone de Jeanne Loviton fut pour Yvonne Dornès, directrice-adjointe de SVP, « qui connaissait particulièrement feu M. Luizet, préfet de police ».
Les deux rapports de la Brigade Criminelle ne mentionnent nullement des relations privilégiées entre Yvonne Dornès et le préfet de police de l'époque, Charles Luizet. C'est Françoise Pagès du Port qui est supposée proche de l'ancien préfet, et c'est Armand Rozelaar qui l'affirme dans un courrier de la même époque.
Peu importe pour Cécile Denoël qui, avec d'aussi fragiles éléments, lance son comédien à l'assaut de la préfecture de police, d'où il revient « tout déconfit ». Clarel lui explique qu'il avait voulu lui ménager un rendez-vous avec le préfet Léonard mais que celui-ci s'était récusé, lui disant simplement « qu'il ne voulait pas qu'il fût parlé de cette affaire, qu'il s'opposerait par tous les moyens à ce que son nom fût cité, qu'il conseillait à Pierre Clarel de ne pas s'en occuper, ajoutant simplement : " Oui, c'est un crime d'intérêt ". Cela me suffisait. Il me restait désormais à déterminer à qui le crime avait profité. »
Il lui restait aussi à déterminer ce que l'on avait pu détourner de sa succession en le supprimant, ce dont elle n'avait qu'une idée vague. Elle dit avoir obtenu la réponse « plusieurs mois après son décès » en recevant de l'hôpital Necker les affaires personnelles de son mari, notamment « son agenda Hermès dans lequel il écrivait ses rendez-vous, les adresses les plus importantes et surtout sur lequel il tenait sa comptabilité clandestine ».
Cet agenda, que Jeanne Loviton avait chargé Billy Ritchie-Fallon de récupérer dès le lendemain de la mort de l'éditeur, « contient énormément de choses, et c'est même grâce à ses inscriptions fragmentaires, toutes de la main de mon mari, sur un carnet ne portant que sur un seul trimestre, que j'ai pu, petit à petit, reconstituer son activité. »
Cécile y avait trouvé, à la date du 1er novembre 1945, des annotations concernant le bail de son appartement, 39 boulevard des Capucines qui, à la suite d'une loi du 11 octobre 1945, devait changer de statut. Denoël avait écrit au crayon : « au nom de Mme Loviton ou au nom d'une troisième personne », ce qui l'avait laissée « rêveuse » : « Mme Loviton n'avait-elle pas toujours dit que c'était elle qui avait loué ce petit appartement pour que mon mari puisse y trouver un abri ? »
L'appartement du boulevard des Capucines avait bien été loué, le 1er avril 1944, au nom de Jeanne Loviton, c'était irréfutable, mais si Robert Denoël notait dans son calepin, en novembre 1945, qu'il fallait établir un nouveau bail au nom d'un autre prête-nom, « c'est peut-être qu'à ce moment-là, il avait l'intention de se défaire peu à peu de la " protection " de Mme Loviton. », suggère-t-elle. Ou que Jeanne Loviton n'était qu'un prête-nom, un de plus, dans cette affaire de bail.
« On comprend, dès lors, que Mme Loviton ait voulu (à titre sentimental, bien entendu !) posséder ce carnet qui contient la comptabilité clandestine de mon mari, comptabilité qui, encore une fois, porte sur des sommes qui se chiffrent par millions. » La démarche de Jeanne Loviton au lendemain de la mort de son amant était indubitablement un faux-pas, d'autant qu'elle avait mis à contribution le propre frère de Cécile, ce qui dénotait chez elle un manque de discernement que la justice n'a pas sanctionné, mais que l'on peut apprécier autrement aujourd'hui.
Emportée par son tempérament orageux, Cécile s'exclame : « Tout de même, Monsieur le Juge, un homme comme Robert Denoël n'est pas mort sans laisser derrière lui au moins quelques lettres, de la correspondance reçue ou à écrire, et des objets personnels d'usage courant ! Tous les amis de Robert, y compris son fils qui venait y faire ses devoirs de latin sous la direction de son père, pourront vous dire ce qui se trouvait exactement au 39, boulevard des Capucines. »
Cette politique de la table rase dans l'appartement de Robert Denoël avait été menée sans ménagement par les amis de Jeanne Loviton (qui n'a sans doute pas supervisé l'opération) mais, chez un homme de lettres, on laisse au moins quelques lettres, et pas uniquement des vêtements usagés : « Avec un cynisme sans égal et la certitude de l'impunité, Mme Loviton avait tout fait disparaître. »
Cécile s'efforce alors de faire l'inventaire de ces biens disparus mais on voit qu'elle n'en a aucune idée précise : « Mon mari avait indiscutablement gagné beaucoup d'argent dans les derniers temps de l'Occupation. Il avait acheté de l'or pour une somme très importante ». Elle cite pour témoins Albert Morys, Fernand Houbiers et Catherine Mengelle : son amant, son cousin, et une maîtresse de Denoël, qui pourront assurer que son mari « possédait de l'or pour une somme dépassant 2 millions de 1945 ». Elle montre ainsi que son mari se livrait, dans les derniers temps de l'Occupation, à des opérations sur l'or dont il ne lui rendait pas compte.
Elle paraît tout ignorer des Editions de la Tour dont son ami Morys avait pourtant la charge mais sans en connaître les rouages financiers : « Cette affaire avait un très bon débit en 1945, débit qui s'est ralenti par la suite parce que les contrats d'auteurs ayant été pris par Mme Loviton, la Société des Editions de la Tour ne pouvait pas continuer à tourner sans contrats et sans argent frais. »
Les Editions de la Tour n'ont publié en 1945 que des éditions de demi-luxe, sans autres droits que ceux qui revenaient à leurs illustrateurs car il s'agissait de textes du XIXe siècle. Le seul contrat signé avec un auteur vivant était celui de Blaise Cendrars pour Dan Yack. Les brochures résistantialistes de Maurice Percheron publiées entre mars et novembre 1945, vendues à prix modique, ne pouvaient renflouer la trésorerie inexistante de cette maison d'édition créée en attente d'un jugement concernant Robert Denoël et sa société.
Cécile évoque ensuite les « trois affaires d'édition » dont lui parlait souvent Denoël : quelle était donc la troisième ? Ses informations sont de seconde main : Morys, « qui avait reçu les confidences de mon mari, m'avait bien toujours dit qu'il s'agissait des Editions Domat-Montchrestien. »
Elle ignore tout de cette maison ancienne parfaitement organisée mais elle donne ici des informations que son avocat n'avait pu livrer dans son mémoire du 21 décembre 1949 : « La Société des Editions Domat-Montchrestien était en effet, jadis, une toute petite affaire. [...] Des difficultés surgirent en 1942 entre Mme Loviton et son associé M. Gougeon, à la suite desquelles M. Gougeon se retira et céda ses parts à Mme Loviton. Mais comme il faut être au moins deux pour conserver une société, Mme Loviton demanda à son vieil ami Germain Martin, ancien ministre des Finances, depuis décédé, de devenir propriétaire de deux parts, pro forma ».
Quand Robert Denoël « commença à s'intéresser à cette affaire et entrevit la possibilité de la contrôler, soit directement, soit par personne interposée, il fallut trouver quelqu'un qui acceptât d'être son prête-nom ». Jeanne et Robert choisirent alors une personne insoupçonnable qui avait une situation séparée : Yvonne Dornès.
« C'est un fait : Mme Jeanne Loviton devient minoritaire chez elle le 18 août 1943. On comprend beaucoup mieux, dès lors pourquoi, au mois de février 1945, mon mari aurait pu signer, pour se couvrir et se garantir d'une confiscation éventuelle, une cession de parts à la Société des Editions Domat-Montchrestien sans indication de nom du gérant. »
Certes, Jeanne Loviton a bien essayé, au cours du procès commercial, d'expliquer qu'Yvonne Dornès et elle alternaient à la gérance, « mais c'est faux : c'est mon mari qui a exigé que restât en blanc le nom du gérant, parce qu'à partir du moment où il cédait ses parts des Editions Denoël à la Société Domat-Montchrestien dans laquelle il avait la majorité par l'entremise d'Yvonne Dornès, il tenait également sans doute à déterminer lui-même qui en serait le gérant. »
Il est sûr, poursuit-elle, qu'il existait un accord, comme avec Percheron et Bruyneel dans la Société des Editions de la Tour, et que des cessions de parts ont été signées en blanc par Mme Dornès. Ces documents doivent se trouver, croit-elle, chez Hagopian ou chez Streichenberger, les deux contentieux ayant été mêlés à l'affaire : « A moins, ce qui est encore possible, que ces cessions de parts ne se soient trouvées dans le tiroir de son bureau, 39 boulevard des Capucines, d'où elles auraient disparu avec le reste. »
Cécile revient, comme son avocat, sur la question des modifications intervenues, le 8 janvier 1946, au sein de la Société des Editions Domat-Montchrestien : pourquoi Yvonne Dornès, majoritaire depuis le 18 août 1943, cède-t-elle la moitié de ses parts à Jeanne Loviton ? « Le raisonnement est élémentaire : Robert Denoël avait disparu, les cessions de parts en blanc signées par Yvonne Dornès ne se retrouveraient jamais plus : ces dames ont alors partagé entre elles les dépouilles opimes de Robert Denoël ; et Mme Loviton, qui menait le jeu, se retrouvait majoritaire dans la société où elle avait été contrainte d'abandonner sa majorité du vivant de Robert Denoël. »
Elle en vient ensuite à des questions personnelles : « Mme Loviton a cherché, par tous les moyens, à me diminuer et à me nuire. Elle savait très bien que, le jour où j'arriverais à découvrir la vérité, je déterminerais du même coup les motifs qui auraient pu pousser les assassins de mon mari à le supprimer. »
Elle conclut : « Je suis maintenant persuadée que c'est uniquement parce que mon mari a voulu se débarrasser de ses prête-noms et de ses hommes de paille qu'il a été victime de ce crime trop habilement camouflé en crime crapuleux. »
*
Cécile Brusson était une femme incontrôlable dont Denoël a bien cerné la personnalité dans la lettre qui introduit cet article. En toutes circonstances, elle est « sur les planches », là où elle aurait voulu faire carrière et où elle n'a jamais brillé. La mort brutale de son mari lui a donné une ultime occasion de remonter sur scène, mais elle avait affaire à trop forte partie. Jeanne Loviton aussi était comédienne, mais avec plus de maîtrise, plus de moyens financiers et, surtout, plus de relations.

Cécile Denoël au palais de Justice de Paris, le 25 mars 1950
Son pensum désordonné, venu à la suite du mémoire de son avocat, mettait en cause le préfet de police, Roger Léonard, auquel elle prêtait des commentaires qui n'auraient pas dû paraître dans la presse. Or ils s'y trouvent, dès le 3 décembre 1949, à propos d'un dossier secret « chambré par la préfecture ».
Il est impossible de ne pas y voir une campagne orchestrée par Armand Rozelaar qui, excédé par les pressions politiques qui pèsent sur ce dossier, choisit de tout « balancer » dans les journaux - ce en quoi il a raison, car toute l'affaire aurait pu rester limitée aux seuls tribunaux - mais il s'expose alors à des « retours » catastrophiques car Jeanne Loviton ne manque pas d'appuis dans la presse et dans la politique.
*
Dès le 13 janvier 1950, la plupart des grands quotidiens consacrent des articles étoffés à l'affaire Denoël - des articles qu'ils auraient pu rédiger cinq ans plus tôt - mais telle est la presse, qui tourne selon le vent qu'il fait, et celui de 1950 n'est plus à la répression résistantialiste.
Il n'est pas surprenant qu'ils commentent l'assassinat de l'éditeur plutôt que ses affaires complexes qui, pourtant, sont le véritable motif des procès à répétition initiés par sa veuve : les lecteurs sont plus attentifs à ce qui se passe dans la rue qu'à ce qui se chuchotte dans les prétoires.
Le 14 janvier, Cécile Denoël accorde une interview à France-Soir, où elle fait part de ses impressions quant à l'assassinat de son mari. Jeanne Loviton fait répondre par une employée qu'elle est « très heureuse de la décision prise par le Parquet à la demande de la partie civile. Elle est persuadée que toute la lumière sera faite sur cette affaire qui bouleversa une période heureuse de sa vie. »
Le 16 janvier : L’enquête sur la mort de l'éditeur est reprise par la Police Judiciaire en exécution d’une nouvelle commission rogatoire du juge Gollety. Les enquêteurs sont l’inspecteur principal Voges et l’inspecteur chef Colleta, sous la direction du commissaire principal Henri Mathieu, 36, quai des Orfèvres.
Le 20 janvier, Aux Ecoutes situe l'affaire sur un tout autre terrain. L'éditeur Wilhelm Andermann a entrepris de récupérer sa mise et il a choisi le même défenseur que Cécile : « Me Rozelaar, l'avocat même de Mme Denoël qui a soudain déclenché l'offensive parallèle et tapageuse que l’on sait contre la Société française, propriétaire de la majorité des parts de l'affaire. On a parlé de crime d'intérêt. Que non pas. Les affaires d'intérêt, comment donc ! »
Me Rozelaar s'en plaint le jour même au juge Gollety et se dit ulcéré par les attaques de la partie adverse : son client allemand est « un homme particulièrement estimable. Ce n’est pas moi qui le dis. Ce sont mes excellents confrères Me Joisson et Me S. Penaud-Angelelli, qui défendaient à l’époque Robert Denoël poursuivi devant M. Olmi, juge d’instruction. »
Le 21 janvier : La première démarche des inspecteurs de la PJ est une perquisition suivie d'un interrogatoire de Georges Hagopian, l'homme d'affaires de Denoël durant l'Occupation, chez qui ont été saisis plus de 120 documents. Il s'agit bien de vérifier si les cessions de parts en blanc disparues ne se trouvent pas à son cabinet. Mais si Hagopian a été chargé de toutes les cessions de parts privées et commerciales de l'éditeur, il n'a pas eu à traiter celle des Editions Denoël. Il a néanmoins des confidences à faire à propos des Editions de la Tour : « Deux mois après le décès de M. Denoël, j'ai reçu un certain jour la visite d'un monsieur qui s'est dit être docteur en médecine. »
Le visiteur lui a réclamé une cession de parts en blanc que lui avait confiée Denoël, ajoutant « que je n'aurais pas à m'en repentir, que je serais largement satisfait ». Hagopian l'avait évincé mais l'homme revint ensuite à la charge au téléphone, toujours pour ce même document, et toujours en offrant de le rémunérer. Hagopian ne livre pas le nom de ce médecin, dont il dit ne pas connaître le nom, se bornant à le décrire (« 45 à 50 ans, portant lunettes »).
Le 23 janvier : Georges Hagopian est à nouveau interrogé, après saisie chez lui de 64 documents concernant les Editions de la Tour qu'il a évoquées, deux jours plus tôt. La mémoire lui est revenue à propos du visiteur indélicat, grâce à un reçu daté du 6 février 1946 signé du séquestre amiable, Me Danet, à qui il a remis l'acte de cession en blanc de 18 parts dans la Société des Editions de la Tour au docteur Maurice Percheron : « Maintenant je suis certain que c'est bien le docteur Percheron qui s'est présenté à mon cabinet. D'autre part les coups de téléphone anonymes concernaient uniquement les actes de cession de parts du docteur Percheron. »
L'acte de cession en blanc de 32 parts dans la même société au nom de Maurice Bruyneel a été remis à l'intéressé le même jour, avec l'accord de Mme Denoël.
Le 28 janvier, Le Cri de Paris commente à sa manière la réouverture de l'enquête criminelle : « Il s'agit actuellement de savoir si Mme V..., grande profiteuse de l'assassinat, y a joué ou non un rôle d'exécutante ou de complice. » L'hebdomadaire ne craint pas d'écrire que Jeanne Loviton eut la carrière d'une demi-mondaine : « D'abord un très haut fonctionnaire de la police judiciaire, puis une dame exerçant des fonctions publiques, et qui est devenue l'épouse d'un président du Conseil. D'autres encore. »
Je n'ai malheureusement pas trouvé le nom de ce haut fonctionnaire de police mis en cause, pas plus que les auteurs qui, depuis lors, ont écrit à propos de Jeanne Loviton. Peut-être s'agissait-il d'une simple provocation mais, le 7 mai, Jeanne attaquera l'hebdomaire pour diffamation, alors que les noms du fonctionnaire et de Suzanne Bidault n'avaient pas été divulgués.
A partir du 31 janvier, le commissaire de la Police judiciaire interroge tous les témoins liés à l'affaire.
Albert Morys conforte la version de Cécile Denoël et de son avocat selon laquelle Denoël était, depuis le 18 août 1943, majoritaire chez Domat-Montchrestien par le truchement d'Yvonne Dornès mais il n'a aucun argument à faire valoir. Quant à la cession de ses parts dans la Société des Editions Denoël, il n'y croit à aucun moment : « Denoël était incapable de profiter des largesses d'une femme et à plus forte raison de déshériter son fils qu'il chérissait particulièrement. » Il ajoute que, s'étant rendu fréquemment au pied-à-terre du boulevard des Capucines, il a pu y voir des meubles de bois clair, ainsi que des archives volumineuses et un nombre important de livres : « ces livres provenaient de la rue de Buenos-Ayres où je les ai vus emballés. [...] Certains documents ayant été produits à la police et en justice me laisse supposer que Mme Loviton avait fait procéder à un déménagement. »
Catherine Mengelle ignore tout des affaires de l'éditeur mais elle l'a rencontré plusieurs fois avant et après la Libération : il lui avait demandé en 1943 de trouver 150 à 200 louis d'or dans son entourage, lui avait avancé à deux reprises de l'argent [« 25 000 F en 1943, 70 000 F après la Libération »], et avait aidé financièrement Irène Champigny « en souvenir de l'aide que cette dernière lui avait apportée lorsqu'il avait débuté ».
Auguste Picq assure que la situation matérielle de Robert Denoël était bonne au moment de son décès : « Il devait posséder approximativement une somme de 900 000 F en or et devises, dont il m'avait parlé. » L'éditeur avait fait transporter des meubles de son bureau personnel des Editions Denoël aux Editions Domat-Montchrestien peu avant la Libération : « Ces meubles au prix de facture valaient à l'époque 75 000 francs. [...] je savais que M. Denoël avait un bureau permanent aux Editions Domat-Montchrestien, où il travaillait régulièrement, et où il a fait travailler pendant un certain temps sa secrétaire aux Editions Denoël, Mme Tardieu, ex-Mle Collet. » Mais il reconnaît ignorer si Denoël « possédait, par personnes interposées, des parts dans les Editions Domat-Montchrestien, ou s'il existait un sous-seing privé entre Mme Loviton et lui. Il ne m'a jamais entretenu de la question. » Picq confirme qu'outre les meubles décrits par Morys, il a vu à l'appartement des Capucines des dossiers dans une armoire vitrée.
Au cours de l'Occupation George-Day a remplacé durant deux ou trois mois Jean Moreau, le gérant de la Librairie des Trois Magots, et il lui est arrivé d'acheter en salle des ventes quelques livres de luxe ou de collection, pour le compte de l'éditeur : « M. Denoël les gardait pour lui-même ou pour son fils. Leur valeur ne représentait pas une somme élevée. »
Le 11 mars : Me Armand Rozelaar, sans attendre les résultats de la nouvelle enquête qu'il a provoquée en décembre 1949, adresse au Procureur Général près la Cour d'appel de Paris, Antonin Besson, un nouveau mémoire de cinq pages, qui met clairement en cause Jeanne Loviton.
Après avoir rendu hommage aux nouveaux enquêteurs de la PJ qui « effectuent, dans cette affaire délicate, un travail remarquable », il remet en cause les déclarations de la maîtresse de Denoël, qui « n'a jamais dit la vérité, et il est manifeste que, soit par crainte, soit par intérêt, elle se refuse à dénoncer ceux qui ont effectivement participé au crime ».
Il lui paraît évident qu'un homme de la carrure et de la force de Robert Denoël « n'aurait pas envoyé une femme, seule, errer dans la nuit, au mois de décembre, à la recherche d'un commissariat de police situé à un demi-kilomètre de là. ». L'avocat remet en cause son témoignage quant à la journée du 2 décembre 1945 chez Marion Delbo, où on l'avait priée de rester dîner : « M. Denoël avait accepté, mais Mme Loviton aurait prétexté l'obligation impérieuse d'être à Paris de bonne heure », pour assister à un spectacle. Les époux Baron, qui étaient présents, ont assuré que le couple « avait rendez-vous avec des amis », ce soir-là, ce qui a été confirmé par Sidonie Zupanek, la bonne de Jeanne Loviton. Me Rozelaar s'emporte : « Il faudra bien tout de même que Mme Loviton finisse par avouer ce qu'ils ont fait entre 20 heures et 21 heures 15, et avec qui ils avaient rendez-vous ce soir-là. »
L'avocat soulève alors la question d'un compte bancaire que détient Jeanne Loviton à la Banque Ferrier-Taillard, à Genève. Il a prié le juge Gollety de lancer une commission rogatoire en Suisse.
Me Rozelaar est fâché contre Jeanne Loviton, qui a mis en cause son intégrité, et il ne s'embarrasse plus de périphrases pour conclure : « J'ai l'impression particulièrement nette que, si l'on adoptait à l'égard de Mme Loviton la procédure généralement employée à l'égard d'un suspect ordinaire, la vérité ne serait pas longue à nous être révélée. Mais devant les invraisemblables protections dont elle bénéficie, on assiste à des hésitations que l'on n'aurait certes pas en pareilles circonstances, pour un justiciable ordinaire. »
Bien plus, il n'hésite pas à demander carrément son inculpation et son arrestation pour faux témoignage :
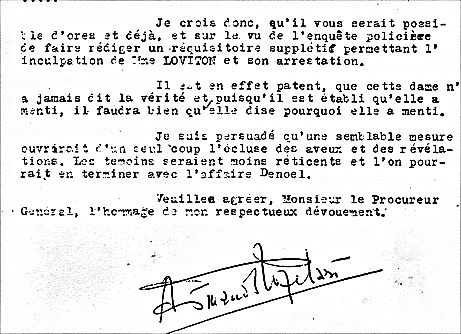
Le 24 mars, Me Armand Rozelaar adresse au juge Gollety un nouveau mémoire de 18 pages dans lequel il lui fait part du « résultat de ses investigations ». On a vraiment l'impression que c'est lui qui, désormais, mène l'enquête, mais il s'en défend : « Mon but, à l'heure actuelle, consiste simplement à souligner les invraisemblances, les mensonges et les contradictions relevées dans les diverses dépositions des témoins entendus au cours de l'enquête. » L'avocat met en cause l'enquête menée en 1946 par la Brigade Criminelle, et non celle qui est alors en cours.
Il écarte d'emblée les témoignages concernant les affaires d'édition qui « apparaissent aujourd'hui comme ayant été la conséquence (on peut même dire la conséquence logique) du crime lui-même », pour se concentrer sur les personnes qui ont joué avant, pendant, et immédiatement après le crime, un rôle essentiel.
Sa première cible est Jeanne Loviton, dont les déclarations ont varié au fil des interrogatoires. L'itinéraire adopté par Denoël pour se rendre d'Auteuil à Montparnasse n'est compréhensible que si le couple avait un rendez-vous aux Invalides, ce qu'elle a toujours nié : « Qu'avez-vous fait et avec qui étiez-vous entre 20 h 55 et 21 h 15 ? »
L'avocat retrace alors le chemin de croix que fut le transport du corps de l'éditeur jusqu'à Necker : « Lorsqu'une femme, ignorant absolument ce qui a pu se passer, trouve son amant blessé à mort et qu'elle accompagne, dans un car de police, le corps de cet amant jusqu'à l'hôpital, elle dit n'importe quoi, pousse des exclamations, des cris, s'agite, pleure... Mme Loviton n'a absolument rien fait de tout cela. »
Jeanne Loviton manque de cœur et contrôle parfaitement ses émotions, c'est avéré depuis longtemps, mais cela ne fait pas d'elle une commanditaire d'assassinat, et l'avocat doit en convenir. Il épingle ensuite les déclarations des témoins immédiats qui, tous, assurent qu'ils n'ont vu personne s'enfuir des lieux de l'attentat. Me Rozelaar est persuadé que l'auteur du crime se trouve parmi les badauds mais, malheureusement, le policier de service n'a pas songé à relever leur identité : « Si Denoël a été abattu par un coup de feu et qu'immédiatement après, tous les témoins sont d'accord pour dire qu'ils ont aperçu quelques personnes sur le trottoir, mais qu'ils n'ont vu aucune de ces personnes prendre la fuite, c'est qu'évidemment, Denoël a été abattu par l'une de ces personnes. »
Me Rozelaar ne cherche pas à doubler les enquêteurs, il pointe seulement un élément capital dans cette affaire, qui tient à la disparition des clés de l'éditeur, dont les premiers enquêteurs ne se sont absolument pas souciée. L'avocat, au contraire, s'en préoccupe légitimement car celui qui a récupéré les clés de Robert Denoël est celui qui a ensuite fait disparaitre toutes ses affaires personnelles entreposées au 39, boulevard des Capucines, ce petit appartement loué depuis 1944 au nom de Jeanne Loviton...
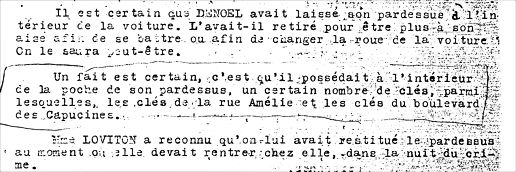
Il s'interroge à propos de la voiture accidentée, que la police n'a pas pris la peine d'examiner, avant de permettre au chauffeur de Jeanne Loviton de la ramener à Auteuil, au lendemain du drame. Abel Gorget avait déclaré en octobre 1946 qu'il en avait changé le pneu éclaté, avant d'avouer, quatre ans plus tard, qu'il l'avait donnée à réparer « dans un garage à proximité du domicile de Mme Loviton, entre les quais et la rue de La Fontaine ». Ce chauffeur, qui a travaillé pour Jeanne Loviton entre septembre 1943 et décembre 1947, ignore ce qu'est devenue cette voiture, qu'il n'a pas cherché à récupérer...
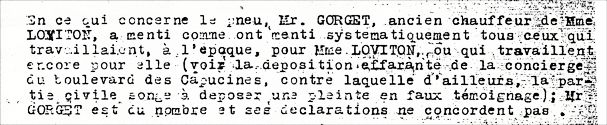
Me Armand Rozelaar se fâche vraiment, et avec raison, car même les anciens employés de Jeanne Loviton continuent à faire des déclarations favorables à leur ancienne patronne - qui, croit-il, les tient par l'argent qu'elle leur distribue largement. Même la concierge du pied-à-terre de Denoël, boulevard des Capucines, n'aurait été témoin d'aucun déménagement, en décembre 1945...
Il associe alors Jeanne Loviton et Maurice Percheron qui, « dès le lendemain du crime, ont cherché à rejeter la responsabilité et l'origine du crime sur des tiers. Ces tiers, en l'occurrence, étaient, dans leur esprit, Mme Denoël et M. Maurice Bruyneel. »
En fait, il n'y eut dans la presse que deux mises en cause de la veuve Denoël et de son ami Morys dans l'assassinat de l'éditeur. Abel Manouvriez [Paroles Françaises, 18 novembre 1949] et Paul Bodin [Carrefour, 17 janvier 1950] avaient en effet rédigé des articles favorables à Jeanne Loviton, mais ils furent sans conséquences car les parts que détenait Morys dans cette petite maison d'édition sans avenir ne constituaient pas un mobile convaincant.
L'avocat, lui, tient à y revenir : si Jeanne a, dès 1946, déposé à la Brigade Criminelle les copies de la lettre de Denoël à sa femme et le contrat déliant Morys de ses liens avec les Editions de la Tour, c'était pour montrer les sentiments amoureux qui les liaient, et qui faisaient d'eux des commanditaires possibles de l'assassinat. Jeanne Loviton les aurait alors désignés dans le cadre d'un crime passionnel : c'était autrement plus crédible.
D'autre part, l'attitude de Percheron dans cette affaire n'est pas nette : il n'était pas chez lui le soir du crime, il a fait des démarches singulières auprès de l'agent d'affaires Hagopian et de Morys : « on peut se demander le rôle exact qu'il a pu jouer à l'occasion du drame lui-même. »
En résumé, Me Rozelaar affirme que tous les témoins favorables à Jeanne Loviton sont circonvenus. Et il insiste particulièrement sur le rôle joué par Yvonne Dornès, « qui ne se souvient plus du tout ni de la somme qu'elle a payée pour l'acquisition des parts de la Société Domat-Montchrestien au mois d'août 1943, ni du nom du contentieux chargé de la rédaction des actes. Elle ne se souvient pas davantage des conditions dans lesquelles elle a rétrocédé la majeure partie de ces parts, le 8 janvier 1946. Elle ne se souviendra donc pas davantage des actes de cession en blanc qu'elle a dû signer en même temps. Et elle n'a pas, en téléphonant à Mme Marion Delbo, révélé que si Denoël était mort, c'était à la suite d'un meurtre et non d'un banal accident. »
Le 24 mars, Juvénal consacre un écho à l'affaire dont on parle dans Tout Paris : « la maîtresse de Denoël, une femme au cœur d'airain, mais non de cœur pur, n’ignore rien de l'auteur ni des circonstances du drame, puisque celui-ci s'est déroulé sous ses yeux. Seulement, voilà : on chuchote que cette Walkyrie aurait un faible pour une personnalité en place. Ce serait la raison pour laquelle l'affaire aurait été mise en sommeil, une première fois. » C'est encore Suzanne Bidault qui est visée. Jeanne Loviton portera plainte pour diffamation contre l'hebdomadaire, le 7 mai.
Le 25 mars : Cécile Denoël et Jeanne Loviton sont confrontées dans le cabinet du juge Gollety. Les deux femmes se rencontrent pour la première fois depuis le 3 décembre 1945. Cécile est assistée de son avocat ; Jeanne, qui n'est que témoin dans l'affaire criminelle, est seule.
D'emblée la partie civile met en doute la version de la panne fortuite de voiture et va à l'essentiel : « Avec qui Mme Loviton et Robert Denoël avaient-ils rendez-vous, le soir du 2 décembre 1945 ? »
Jeanne répond qu'ils n'avaient aucun rendez-vous mais Cécile lui rappelle que trois témoins ont assuré que, chez Marion Delbo, elle était pressée de rentrer à Paris pour y retrouver des amis. Elle ne se démonte pas : « Je réponds que lorsqu'on vient déjeuner chez quelqu'un à 13 heures et qu'on quitte cette maison après 17 heures, c'est que l'on n'est pas bien pressé de s'en aller. » Quant à ces trois témoins, dont deux lui étaient inconnus et la troisième, qu'elle n'avait plus vue depuis trois ans : « nous n'avions pas de confidences à leur faire sur notre emploi du temps. »
Cécile fait remarquer que, lors de son premier interrogatoire [en 1946], Mme Loviton avait déclaré qu'elle n'avait jamais vécu maritalement avec Denoël, ce qui est faux. Jeanne réplique que si elle lui avait loué en avril 1944 un petit appartement au boulevard des Capucines, « c'est parce que je n'ai jamais voulu vivre maritalement avec lui avant mon mariage. »
On imagine la tête des personnes présentes devant tant d'audace tranquille venant d'une dame dont le passé amoureux très chargé est connu de Tout Paris, mais Jeanne ajoute aussitôt : « Il est certain qu'il venait souvent chez moi mais nous avons toujours gardé une indépendance d'habitation. » Formellement, en effet, Denoël n'a jamais été domicilié au 11 de la rue de l'Assomption.
A la question qui lui est posée à propos de son emploi du temps entre le retour de Saint-Brice et le départ pour le théâtre d'Agnès Capri, elle répond qu'elle a dû se reposer, et qu'elle a discuté avec Denoël s'il fallait vraiment se rendre à ce spectacle « en raison de ma fatigue ».
Cécile évoque alors le coup de téléphone entre Denoël et Robert Beckers, qui a duré vingt minutes et dont Beckers ne se rappelle plus la teneur : « Je ne peux pas me mettre à la place de Robert Beckers ».
Elle lui demande à quelle heure le couple a quitté la rue de l'Assomption pour Montparnasse : « Je ne regarde pas l'heure quand je quitte mon domicile. » Cécile rétorque : « Alors, comment saviez-vous que vous étiez en retard ? » La réponse est à l'image de son auteur, superbe et arrogante : « On peut savoir qu'on est en retard sans savoir de combien de temps on est en retard. »
Cécile insiste : puisque le couple sait qu'il est en retard pour le spectacle qui commence à 21 heures, et que le plus court chemin est la ligne droite, pourquoi emprunte-t-il un itinéraire aussi compliqué ? « J'ai déjà répondu à cette question, et je précise que ni Robert Denoël ni moi, n'étions chauffeurs de taxi ».
On lui demande comment elle a eu l'impression, en arrivant aux Invalides, qu'un pneu de sa voiture avait crevé : « J'ai eu la sensation que toute personne qui est dans une voiture et qui sent qu'il a un pneu crevé peut ressentir.
Quelle heure était-il ? « Je n'ai pas regardé ma montre. »
Apparemment Jeanne Loviton ne regarde pas souvent sa montre. La partie civile lui fait observer que, se sachant déjà en retard, elle aurait pu vérifier l'heure qu'il était à ce moment, l'incident risquant de la retarder davantage : « Un pneu crevé est beaucoup plus ennuyeux qu'un retard au théâtre. Je n'ai pas regardé l'heure. »
Cécile lui demande combien de temps il a fallu au couple pour rentrer de Saint-Brice à Neuilly : « Je ne suis pas un chronomètre vivant ». Elle l'interroge alors à propos du temps qu'elle a passé au poste de police : « J'y suis restée un temps qui m'a paru long et qui était cependant court. »
La veuve de l'éditeur ne s'est pas emportée : son avocat était là pour la tempérer. Ces réponses hautaines et désinvoltes, dans une affaire de meurtre qui les touchait l'une et l'autre de près, auraient pu provoquer l'intervention du juge Gollety : il est resté muet. Sans doute le code le lui prescrivait-il.
Le 26 avril, Me Armand Rozelaar adresse au juge Gollety un mémoire de 12 pages concernant l'affaire où il met en cause l'enquête bâclée de la Brigade Criminelle et où il rend hommage au travail des enquêteurs actuels, mais, ajoute-t-il, « à la lumière de ce que nous savons déjà, il nous apparaît désormais d'une manière éclatante, que la Police a connu, dès le 3 décembre 1945, les moindres détails de ce qui s'était passé. »
Me Rozelaar voudrait en finir avec l'explication « rudimentaire » proposée par la Brigade Criminelle (« crime de rôdeur »), mais il sait qu'en accédant à la supplique de sa consœur Simone Penaud de ne pas faire apposer trop rapidement des scellés sur les deux endroits habités par Robert Denoël, « en raison de l'état de nervosité » de sa cliente et amie, il a faussé involontairement le dossier qu'il défend depuis cinq ans. Dès ce jour-là, l'affaire était perdue sur le plan « crime d'intérêt ». L'avocat examine donc l'enquête criminelle de l'inspecteur Ducourthial et tous ses manquements. Je les ai détaillés ailleurs, et ne retiens ici que ce qui concerne son côté « affaires ».
Armand Rozelaar déplore que les enquêteurs n'aient pas eu l'idée de faire d'emblée des investigations au domicile de Jeanne Loviton et au 39 boulevard des Capucines : « C'est ainsi que tous les papiers personnels de M. Denoël ont pu disparaître, couvrant désormais d'un voile opaque toute l'activité que cet homme avait déployée dans les derniers mois et surtout dans les derniers jours de sa vie. »
Le 28 avril, Me Rozelaar adresse un nouveau mémoire de 6 pages au juge Gollety qui concerne, en partie, les affaires de l'éditeur. Il ne manque pas de rappeler la singulière cession de parts intervenue le 29 janvier 1946 aux Editions Domat-Montchrestien, « un mois exactement après la mort de Denoël », à la suite de laquelle Jeanne Loviton s'est retrouvée majoritaire dans sa société, tandis que Mireille Fellous, « auteur des manipulations comptables », reprenait des parts appartenant à Yvonne Dornès : « Mme Loviton voulait essayer de prouver qu'elle avait réellement payé la pseudo-cession de parts dans la Société Denoël. »
Le 28 avril, le juge Gollety provoque à son cabinet une seconde confrontation entre Cécile Denoël et Jeanne Loviton, et elle est aussi tendue que celle du 25 mars. La veuve de l'éditeur lui rappelle les paroles singulières qu'elle aurait prononcées en arrivant sur les lieux de l'attentat, le 2 décembre 1945 : « Ils me l'ont tué ». Jeanne répond : « Je n'ai rien à dire ». Cécile rétorque : « Vous êtes en contradiction formelle avec plusieurs témoins avec lesquels vous serez confrontée ultérieurement. » Jeanne répond tranquillement : « Est-ce que ces témoins ont été entendus il y a quatre ans ? Ils peuvent très bien l'avoir imaginé depuis. »
Cécile lui demande pourquoi elle a déclaré en 1946 que son amant ne lui paraissait pas mort : « Il n'y avait aucune trace de sang sur lui et il semblait évanoui ». Cécile s'insurge : « Je pourrais présenter la chemise de la victime : elle est tachée de sang ! » Jeanne reste imperturbable : « Sur la chemise, il y avait un gilet et une veste. Robert Denoël était sur la civière et on le montait dans le car de police. Je me suis assise au pied de la civière et je n'ai pas procédé à un examen. » Cécile affirme que trois témoins ont précisé que le corps de Denoël était déjà dans le car de Police-Secours lorsque Mme Loviton est arrivée : « Cela prouve le manque de précision des témoins », répond Jeanne, qui ajoute hardiment : « Il y a une seule personne ici qui dit la vérité : ces événements se sont gravés dans ma mémoire car ils étaient les plus importants de toute ma vie. »
Cécile pose alors une question délicate : « Saviez-vous que Denoël avait l'intention de reprendre la direction de ses affaires dès le mois de janvier 1946 ? » Jeanne lui répond que si l'éditeur l'a « constamment dit autour de lui, sans préciser à tout le monde à quel titre il allait revenir aux Editions Denoël, c'était pour ne pas voir se lasser ses auteurs et ses collaborateurs. »
A propos des paroles qu'elle aurait prononcées à l'Hôpital Necker lorsqu'elle apprit la mort de son amant, attestées par plusieurs témoins (« Pardonne-moi, mon chéri, c'est de ma faute »), Jeanne Loviton déclare : « Je ne sais pas si j'ai dit exactement ces paroles, je ne crois pas avoir dit " pardonne-moi ", mais ces mots correspondaient exactement à ma pensée. J'ai toujours pensé, du jour où j'ai connu Robert Denoël, qu'il était un homme enfantin et vulnérable, et qu'il avait besoin de moi à tous les instants, et je souligne, à tous les instants. J'ai pensé qu'il avait suffi que je le quitte cinq minutes pour qu'il lui arrive malheur. »
La partie civile lui demande à qui elle a téléphoné, le soir du crime, de l'Hôpital Necker, et Jeanne répond qu'elle a lancé un S.O.S. à des amies intimes pour qu'elles viennent l'assister, mais ces amies ne sont pas n'importe qui : « Mlle Pagès du Port, à laquelle le témoin a téléphoné vers 22 heures, n'était-elle pas, par elle-même ou par une de ses amies, en relation avec le cabinet du préfet de police ? » Jeanne répond : « Certainement pas, car je connais Mlle Pagès. », ce qui ne veut pas dire grand-chose. « Et Mme Dornès ? » « Certainement pas », répète-t-elle, ce qui ne signifie toujours rien.
Cécile Denoël lui demande ce qu'est devenu le dossier que préparait Denoël en vue de sa comparution devant le Comité d'épuration de l'Edition, et Jeanne, qui a aidé à le constituer, fait cette réponse inattendue : « Voilà quatre ans que j'entends parler d'un dossier qui n'a jamais existé. Robert Denoël avait lu tous les livres de collaboration publiés pendant la guerre. Il était au courant de la situation exacte de l'Edition. Il n'a jamais été dans ses intentions de se conduire en dénonciateur. »
Cécile parle alors d'une mallette « contenant des pièces d'or et pesant deux ou trois kilos », dont un témoin [son cousin, Fernand Houbiers] affirme qu'il l'a vue dans les mains de l'éditeur « deux ou trois jours avant sa mort », et qui a disparu entretemps. Jeanne Loviton pourrait éluder la question, qui ne la concerne pas directement, mais elle répond : « Celui-là, c'est le roi des menteurs. »
On lui demande si, en avril 1946, elle n'a pas demandé à Maximilien Vox de conserver sine die l'administration provisoire des Editions Denoël « à la condition qu'il ne gardât que la signature, ce qui lui permettrait d'exercer elle-même la gérance ». La réponse est : « Je n'en ai aucun souvenir ».
Cécile évoque ensuite une créance personnelle à Robert Denoël mais en droit attribuée à la Société des Editions Denoël concernant la maison de Marion Delbo à Saint-Brice-sous-Forêt. En lui octroyant en 1943 un prêt dont la somme n'est pas évoquée, l'éditeur avait pris une option hypothécaire sur cette maison et l'affaire restait pendante, sept ans plus tard. Jeanne lui répond : « La Société Denoël étant, par suite des instances en cours et de la publicité malencontreuse de la partie civile, dans une situation tragique, l'Administration des Domaines s'est employée à recouvrer les créances de la Société, parmi lesquelles celle sur Mme Jeanson, et le remboursement a eu lieu voici peu de temps. »
La veuve de l'éditeur, qui a épuisé toutes ses cartouches, revient une dernière fois sur la scène de l'attentat où Jeanne Loviton prétend qu'elle n'a reconnu personne : « Je l'affirme expressément. Je pense que vous faites allusion à M. Hanoteau, que je ne connais pas personnellement, que j'ai peut-être eu l'occasion de voir cinq minutes autrefois chez Me Maurice Garçon et qui n'a d'ailleurs jamais lui-même pris la peine de me prévenir qu'il avait vu le corps de Robert Denoël. »
C'était un faux-pas important car aucun organe de presse n'avait cité jusqu'alors le nom de Guillaume Hanoteau dans cette affaire, bien que son nom apparaisse dès 1946 dans le dossier de Me Rozelaar et dans ses courriers au juge Gollety.
La partie civile réagit aussitôt : « Comment avez-vous appris qu'un nommé Hanoteau était sur les lieux du crime ? » Et Jeanne qui, jusque-là, tenait la dragée haute à ses opposants, déclare piteusement : « Je l'ai appris il y a peu de temps, je ne sais même plus par qui. » Cécile insiste : « Qui vous a appris cela ? » Jeanne Loviton tente alors de railler : « Peut-être par les articles que fait Me Rozelaar dans la presse. »
Si l'avocat de Cécile Denoël a « alimenté » les journaux parisiens, il n'a jamais, jusqu'à cette date, dévoilé le nom de Guillaume Hanoteau. Jeanne Loviton avoue à cette occasion qu'elle connaît tout le dossier, supposé secret. Armand Rozelaar n'en demandait pas tant : deux jours plus tard, le nom de Hanoteau se retrouvait dans la presse.
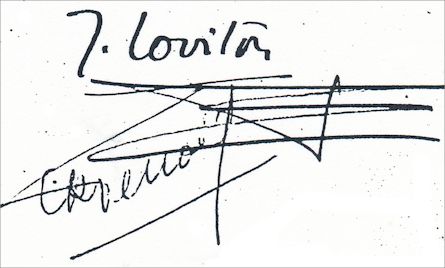
Les signatures entrelacées de Cécile Denoël et de Jeanne Loviton, 28 avril 1950
Le 30 avril : parution d'un article explosif dans l'hebdomadaire Express-Dimanche, qui dévoile les noms des témoins directs de l'assassinat de l'éditeur : « C’est en fait les dessous d’un assassinat resté impuni depuis 1945, grâce à un réseau de complicités tacites et d’interventions actives, qui vont être évoqués dans le cabinet d’instruction du juge Gollety ; on y prononcera des noms que le public sera stupéfait de voir mêlés à une affaire de sang. »
Cet article était signé Roger Darbois, un journaliste qui, jusque-là, ne s'occupait que de mots croisés dans la presse parisienne. Il avait sans doute été initié par Me Rozelaar car certains détails mentionnés ne se trouvaient alors que dans le dossier de l'avocat. Deux personnes réagirent peu après : Roland Lévy fit insérer une « rectification » qui fut publiée le 4 juin. Jeanne Loviton déposa plainte pour diffamation et réclama à l'auteur de l'article et à l'hebdomadaire des dommages et intérêts à hauteur de cinq millions de francs. Roger Darbois retourna à ses mots croisés et Express-Dimanche se saborda quelques mois plus tard.
Le 10 mai, Cécile Denoël est confrontée à Guillaume Hanoteau dans le bureau du juge Gollety. L'ancien avocat, devenu auteur à succès, est prié de raconter sa soirée du 2 décembre 1945, ce dont il s'acquitte fort bien, mais la partie civile lui demande pourquoi, lors de son interrogatoire par le juge Gollety, le 18 mars, il a déclaré être arrivé au ministère du Travail vers 20 h 15, alors qu'il fixe aujourd'hui cette arrivée à 20 h 50 ? Il répond qu'il avait, par recoupement, pu vérifier qu'à 20 h 15 il devait être encore au Châtelet, avant de se rendre au ministère pour y rencontrer son ami Roland Lévy

La porte du ministère du Travail était-elle ouverte ou fermée ? Hanoteau déclare qu'elle devait être fermée, ce qui va de soi puisqu'un gardien de la paix s'y trouvait en faction depuis 19 h 30 et qu'il n'a quitté son poste qu'à 21 heures. Cécile insiste : « Le témoin s'est-il annoncé ? » Il répond que le concierge lui a demandé où il allait. On suppose qu'il avait donc pu entrer (en se réclamant de Lévy, sans doute) mais le portier chargé d'actionner l'ouverture de la porte aurait dû noter son nom dans le registre des entrées car son rôle est d'éconduire les importuns et il n'ouvre la porte qu'aux personnes de qualité (communistes) ou connues de lui, surtout un dimanche soir, alors que le ministère est désert. On lui demande alors où se trouve le bureau de son ami Lévy : à droite, dit-il, du côté des Invalides. Au rez-de-chaussée ? « Je n'en sais rien ». Hanoteau n'a manifestement jamais mis les pieds dans le bureau de Roland Lévy.
La partie civile lui demande : « Vous connaissiez fort bien Mme Loviton ? » Hanoteau le nie : « Je pense bien ! je l'ai rencontrée quatre fois dans ma vie ! » Une première fois en 1934 chez Me Maurice Garçon, qui avait réuni ses anciens collaborateurs au Vert Galant, la dernière en 1938 chez Jacques Mourier, le collaborateur de Me Garçon, dit-il.
Me Rozelaar s'exclame : « Le témoin se souvient avec précision de ses rencontres avec Mme Loviton, mais lorsqu'elle descend seule d'un taxi alors qu'un crime vient d'être commis, il ne la reconnaît pas ! » Hanoteau répond : « Non. Il y avait sept ans que je n'avais pas vue. »
L'avocat lui demande pourquoi, lorsqu'il est rentré vers 21 h 15 au ministère en compagnie de Lévy, celui-ci a parlé au portier d'une « histoire de bonne femme » ? « Il avait été surpris par la venue de la femme, que j'ai su être Mme Loviton, et qui s'est écriée : " Qui a fait cela ? " » Hanoteau et Lévy n'ont pu voir alors Jeanne Loviton, dont le taxi n'est arrivé sur les lieux qu'à 21 h 30...
Armand Rozelaar perd patience : « Il est insensé que dans une telle artère, on abatte un homme et que vous soyez là immédiatement ! [...] Pourquoi M. Roland Lévy n'a-t-il pas jugé utile de donner votre nom ? » Guillaume Hanoteau termine l'entrevue en répondant : « Il a eu tort. En tous les cas, en ce qui me concerne, je n'ai jamais caché cette affaire. »
Sa déclaration est curieuse puisque son nom n'est apparu dans la presse que dix jours plus tôt. En revanche il a, depuis 1946, ignoré toutes les convocations de la Brigade Criminelle, et n'a été entendu une première fois par la Police Judiciaire qu'en février 1950.
Le 15 mai, Jeanne Loviton adresse au Procureur Général près la Cour d'appel de Paris, Antonin Besson, un mémoire de dix pages pour se plaindre des éreintements qu'elle subit dans la presse et pour présenter sa version de l'affaire : « Attaquée et diffamée depuis de longs mois et notamment par un article récent [Express-Dimanche du 30 avril] où vous avez été vous-même mis en cause et pour lequel j'ai déposé une plainte de diffamation, prise pour cible depuis décembre dernier en raison d'une seconde ouverture d'information qui a été recherchée par mes adversaires pour tenter une diversion ou une obstruction au seul fond d'une affaire qui est un procès civil, interrogée de nombreuses fois par la police judiciaire et par M. le Juge d'Instruction comme témoin et donc sans avocat, persécutée par des gens qui ne reculent devant aucune accusation pour faire pression contre moi, je ne peux que m'adresser à vous afin que cesse au plus tôt cette période d'épreuve aussi complètement injuste qu'intenable pour moi. »
Rédigé à la troisième personne, ce mémoire est très cohérent. Jeanne rappelle qu'en février 1945 Robert Denoël envisageait de céder ses parts à la Société des Editions Domat-Montchrestien, « société dans laquelle il n'avait et n'eut jamais aucun intérêt mais dont il comptait, dès qu'il aurait obtenu son divorce, épouser la gérante. »
Les deux associées de Domat-Montchrestien avaient décidé d'acquérir ces parts, étant entendu qu'au préalable « serait assurée la libre disposition du vendeur ». En effet si Denoël avait été condamné en cour de justice, et une confiscation de ses biens prononcée, une telle vente aurait été frappée de nullité.
Un acte de cession fut donc préparé le mois suivant mais non signé : « L'acte était, contrairement aux affirmations mensongères produites depuis des années, un acte nominatif. Le nom du cessionnaire n'était pas en blanc et, dès lors, il n'y avait pas d'abus de blanc seing possible. L'acte était fait au nom de la Société des Editions D-M ».
« Ce qui avait été laissé en blanc c'était, conformément à l'usage, le nom du mandataire. [...] Conformément à l'usage également, aucune date n'était portée. On ne date pas un acte avant qu'il ne soit signé et, en l'espèce, la signature ne pouvait intervenir avant le terme de l'information concernant Robert Denoël. »
Le dossier de Denoël fut classé le 13 juilllet et l'acte définitivement établi le 25 octobre 1945. Elle ne s'explique pas sur ce délai de trois mois, mais elle l'avait fait chez le juge d'instruction : l'un et l'autre étaient alors en vacances.
« A ce propos, il convient de faire une remarque très importante : les cinq exemplaires de la cession de parts sont tous revêtus de la signature de Robert Denoël, précédée des mots écrits de sa main : " Bon pour cession de 1 515 parts ". Or jamais cette signature n'a été déniée. Le prix était fixé à 757 500 F, c'est-à-dire à la valeur nominale des actions. »
La partie civile n'a en effet jamais mis en doute la validité de la signature de Denoël ; ce qu'elle a contesté, c'est la date du 25 octobre 1945 « inscrite frauduleusement après coup » (c'est-à-dire le 8 décembre 1945, date de l'enregistrement du document au Tribunal de commerce), et le montant de la transaction.
« Avec une persistante mauvaise foi, Mme Denoël soutient que ce prix n'est pas un juste prix et que les parts valaient des millions. Il suffira de relever que si R. Denoël avait bénéficié personnellement d'un non-lieu, sa société était sous administration provisoire et, en outre, en tant qu'être moral, l'objet d'une information si sérieuse qu'elle se termina par un renvoi devant la Cour de justice, devant laquelle elle ne fut acquittée que le 30 avril 1948. Ainsi, au moment où était fixé le prix, nul ne pouvait savoir si la Société Denoël ne serait pas dissoute par arrêt de justice et tous ses biens confisqués. Cet aléa immense justifiait, de toutes façons, le prix payé. »
Jeanne explique que la Société D-M ne pouvait, en octobre 1945, décaisser les 757 500 F : « Or l'acte passé en donnait quittance ». C'est bien cette anomalie qui fut sanctionnée par le Tribunal de commerce, le 24 décembre 1948. Apparemment, la Société D-M n'en avait toujours pas les moyens, un mois plus tard, puisque Jeanne prétend qu'elle a personnellement avancé les fonds à sa société fin novembre, puis les en a retirés afin de les remettre en mains propres à Denoël, sans témoin ni reçu, le 30 novembre 1945.
« Tout cela est parfaitement normal mais, du fait que R. Denoël a été assassiné le 2 décembre, l'adversaire exploite publiquement ce drame de façon éhontée en plaidant ou en faisant imprimer combien cet enregistrement, postérieur à la mort, était suspect. Cette thèse est proprement absurde puisque précisément la mort de R. Denoël donnait, sans enregistrement, date certaine à l'acte. »
Cécile et son conseil n'étaient pas les seuls à trouver suspect cet enregistrement tardif : le Tribunal de commerce aussi l'a sanctionné en 1948. Quant à considérer que la mort de l'éditeur donnait date certaine à l'acte, cela reste à prouver car l'expert Caujolle a justement été mandaté pour en vérifier le fondement.
On a reproché à Jeanne Loviton d'avoir tardé à signaler aux actionnaires de la Société Denoël l'acquisition des parts de l'éditeur. C'est que l'assassinat « retentit douloureusement sur la santé de Mme Loviton. Elle tomba malade, abandonna ses affaires », et ne put se manifester que le 9 janvier 1946.
Jeanne rappelle qu'elle a obtenu gain de cause à plusieurs reprises : le 30 octobre 1946 le juge Bourdon a rendu une ordonnance de non-lieu dans l'affaire de vol, escroquerie, abus de confiance, faux, usage de faux et abus de blanc seing, qui a été confirmée par la Cour d'appel, le 20 décembre 1946. Dix jours plus tard, elle a obtenu la levée du séquestre sur les parts litigieuses, et la Cour d'appel a confirmé cette ordonnance par un arrêt en date du 19 juillet 1947.
« Ainsi donc, deux arrêts de Cour lavaient entièrement Mme Loviton de toutes les calomnies dont elle avait été accablée et il est extraordinaire que les accusations d'abus de blanc seing, de vol et autres puissent être constamment reprises alors que l'arrêt de la Chambre des Mises notamment en a fait justice et que cet arrêt a autorité de chose jugée. »
Jeanne Loviton en vient à l'acte de cession contesté par Cécile Denoël qui, dit-elle, « soutient deux thèses pour le moins contradictoires : 1° L'acte était imparfait au décès de Robert Denoël. Mme Loviton s'en est frauduleusement emparé, l'a complété et signé. 2° L'acte est parfaitement régulier en la forme, mais il a été simulé pour tromper le fisc. » Personnellement, je n'ai vu la seconde thèse évoquée nulle part dans le dossier de Me Armand Rozelaar.
Certes le Tribunal de commerce s'est bien prononcé, le 24 décembre 1948, pour la fictivité de la cession de parts mais, dit-elle, ce jugement a été rendu « dans des conditions de rapidité brusquée, sans ordonner d'expertise, et sans tenir aucun compte de l'arrêt de la Chambre des Mises ». D'ailleurs, s'il s'est prononcé dans ce sens, « c'est notamment parce qu'il croyait avoir découvert une contradiction sur l'heure à laquelle ledit acte aurait été signée. »
L'agent d'affaires Lucien aurait affirmé que l'acte avait été signé dans son cabinet à 15 heures, alors que Jeanne déclarait que le rendez-vous avait eu lieu à 19 heures : « Cette prétendue contradiction sur l'heure a paru au Tribunal la preuve que Vve Denoël avait raison quand elle soutenait que le rendez-vous n'avait jamais eu lieu. »
Le Tribunal de commerce s'était forgé cette opinion sur base d'une copie d'un procès-verbal de l'interrogatoire de l'agent d'affaires par la PJ : ce document comportait une faute de frappe. L'original a fait justice de cette erreur : c'est bien à 19 heures qu'eut lieu le rendez-vous, ainsi qu'ils l'avaient l'un et l'autre déclaré : « L'opinion du Tribunal de commerce s'est donc formée sur un faux. »
C'est à cela qu'on reconnait les grandes plaideuses : leur capacité à monter en épingle un point de détail au détriment des questions de fond. C'est que les attendus du Tribunal de commerce étaient moins rudimentaires qu'elle le dit. Les juges consulaires ont épinglé la date tardive de l'enregistrement du document ; la quittance douteuse pour un paiement qui n'avait pas eu lieu à la date indiquée dans l'acte de cession ; le caractère de complaisance des inscriptions dans les livres comptables de la Société Domat-Montchrestien ; le montant de la transaction... Tout était dans le « notamment » qui précède son argumentation.
Jeanne s'emploie ensuite à démontrer le caractère intéressé de la démarche de sa rivale : « Mme Vve Denoël qui, des termes mêmes de la mission pouvait induire à brève échéance, avec l'écroulement de ses machinations et la preuve de ses mensonges, l'échec de toutes ses espérances, n'eut plus qu'une idée : retarder la décision au civil par tous les moyens et se venger de Mme Loviton. La partie civile, dont le plus vif désir est de faire parler d'elle, jugea astucieux de prendre pour cible Mme Loviton [...] Espérant l'atteindre dans sa vie professionnelle, sur un terrain où son héritage paternel, son travail et ses efforts auraient dû la rendre spécialement inattaquable, son adversaire créa le scandale, diffusa la calomnie, ne lui épargnant rien de ce qui pouvait porter préjudice à son crédit commercial et moral auprès des hautes personnalités avec lesquelles elle entretient des relations d'affaires et d'amitié. »
Quand on sait que Cécile Denoël n'avait accès à aucune des hautes sphères où évoluait la maîtresse de son mari, il est difficile de croire qu'elle ait pu initier la plupart des articles défavorables à Jeanne Loviton qui fleurissaient dans la presse depuis six mois. La vie amoureuse assez agitée de Jeanne Loviton était connue du Tout Paris, et certains faits nouveaux apparus au cours de la nouvelle enquête ne venaient pas forcément du cabinet de Me Armand Rozelaar.
Elle commente alors l'enquête de l'expert Caujolle qui, « d'ores et déjà, a établi que Robert Denoël se trouvait, de la Libération à sa mort, dans une situation d'impécuniosité qui était de notoriété publique. Il passait son temps à emprunter, non seulement à ses amis, mais même au personnel des Editions Denoël. [...] L'information de M. Caujolle est, à cet égard, décisive, et se trouve renforcée par l'invraisemblance des dépositions de certains témoins. Ainsi, l'amant de Mme Denoël et quelques autres personnes de son entourage, ne craignant ni le mensonge ni le ridicule, ont affirmé que R. Denoël avait une réserve d'or qu'il exhibait volontiers au café. »
Jeanne Loviton a toujours une longueur d'avance dans cette affaire. Le rapport Caujolle ne sera déposé que le 13 octobre 1950 mais elle est en mesure de le commenter dès le mois de mai. Elle connaît aussi les déclarations de Fernand Houbiers, le cousin de Cécile, à propos de pièces d'or que Denoël lui aurait montrées en 1945, et qui ne se trouvent que dans le dossier du juge d'instruction. Si elle ne manipule pas formellement les enquêtes, elle en maîtrise tous les rouages.
Elle livre encore un détail d'importance qui est censé prouver que Denoël était bien son obligé : « Mme Loviton lui apportait l'appui de la Banque Worms - banque des " Cours de Droit " - appui que la Banque Worms d'ailleurs, ne consentait qu'intuitu personæ, ce qui incluait la nécessité, pour Mme Loviton, représentant les Editions Domat-Montchrestien, d'avoir es-qualité, le contrôle de la Société des Editions Denoël. »
La locution latine « intuitu personæ » signifie : « en fonction de la personne » ; l’intuitu personae peut aussi être une personne morale, en l’occurrence une société ; dans ce cas, la banque doit s’assurer de son capital, de sa répartition, du fait qu’elle fasse partie de tel groupe, de sa notoriété commerciale, de son savoir-faire technique, etc.
Jeanne Loviton était donc, selon elle, garante des opérations financières des Editions de la Tour, par exemple. Cela n’implique pas que les sommes nécessaires à la bonne marche de cette affaire provenaient de ses maisons d’édition : on en retrouverait la trace dans leur comptabilité. D'ailleurs Mme Loviton prend soin de dire qu’elle a financé cette petite maison d'édition en son nom propre, et « sans aucune garantie, sans aucun papier », puisqu’elle avait « la plus extrême confiance » en l’homme qu’elle allait épouser...
En fait elle avance cette assertion contestable pour la raison que, « depuis les poursuites, il n’avait aucun compte en banque ». Denoël n'en avait pas besoin pour contrôler la Société des Editions de la Tour puisqu'elle lui appartenait grâce aux cessions de parts en blanc qu'il avait fait signer en 1944 aux deux prête-noms qui la représentaient.
Jeanne explique alors l'interminable querelle qui l'oppose à Cécile par un ressentiment personnel : « La volonté de Robert Denoël d'épouser Mme Loviton [...] fut sans aucun doute un des mobiles de l'acharnement de Mme Vve Denoël à l'égard de Mme Loviton. Le but des campagnes de presse, de la violation répétée du secret de l'instruction, était de ruiner sa réputation. Il ne faut pas se dissimuler que le préjudice causé est réel, immense, irréparable. Mme Loviton est atteinte dans sa santé, elle est atteinte dans sa situation personnelle, elle restera toujours, aux yeux du public, la femme qui a été mêlée à un assassinat sur lequel la justice a été incapable de faire la lumière. »
Que n'a-t-elle subi au cours de ces derniers mois de la part de la Police Judiciaire, qui a fait droit à toutes les requêtes de la partie adverse : auditions de témoins dont « presqu'aucun n'avaient été témoins du fait, entendus pendant des journées entières, non pas une fois, mais plusieurs fois », confrontations jugées nécessaires « au cours desquelles la partie civile était autorisée à poser toutes les questions qui lui convenaient sans que l'autre partie, du fait de l'information contre X, ait pu à son tour poser quelques questions qui n'auraient peut-être pas été inutiles pour l'instruction »...
Jeanne Loviton est avocate : elle sait ce qu'implique une information contre X et connaît les moyens dont elle dispose légalement pour se faire entendre, mais il lui importe de montrer que « L'instruction a toujours été à voie unique, dirigée exclusivement contre Mme Loviton et contre son entourage », ce qui est un peu exagéré quand on connaît tous les jugements favorables dont elle a bénéficié depuis 1946 et qu'elle énumère d'ailleurs au début de son pensum.
Il n'importe : on s'est trop acharné à son sujet alors qu'il ne semble pas « qu'on se soit préoccupé ni du passé de Mme Vve Denoël, ni de son existence actuelle, ni du rôle que joue son amant Maurice Bruyneel, avec lequel elle collabore dans une maison d'édition, " Le Feu Follet ", maison spécialisée dans les publications pornographiques. »
A quel passé fait-elle allusion ? Sans aucun doute à celui qui est étalé dans la lettre de 1945 qui introduit cet article, et qu'elle a si obligeamment confiée à la Brigade Criminelle dès 1946. Quant au présent, il s'agit de la publication, en 1947, du roman d'Anta Grey, Salauds, qui a fait l'objet de plusieurs condamnations pour atteinte aux bonnes mœurs.
Elle en veut assurément à ce Bruyneel dont Denoël s'est séparé en octobre 1945 « pour des raisons qu'on peut qualifier, si l'on veut être indulgent, de raisons commerciales et dans des conditions que, sans doute, l'expertise de M. Caujolle mettra à jour. »
Caujolle n'a nullement été mandaté pour expertiser la comptabilité des Editions de la Tour, déclarées en faillite dès le 20 janvier 1948, et dont on connaît le parcours : Jeanne se livre à un « enfumage », bien inutile d'ailleurs, car ce dont l'expert-comptable devra rendre compte est un document qui la met en cause dans l'acquisition des parts de son amant dans sa société d'édition.
Si Jeanne Loviton voit juste lorsqu'elle déclare au procureur Besson qu'elle « restera toujours, aux yeux du public, la femme qui a été mêlée à un assassinat non élucidé », elle se leurre singulièrement quant au rôle que la postérité, archives à l'appui, pourrait lui assigner dans l'acquisition de la maison d'édition Denoël, et dont sa rivale l'accuse alors...
Elle revient encore sur les accusations à peine voilées contenues dans l'article d'Express-Dimanche, qui a signalé la présence, sur les lieux de l'attentat, de Roland Lévy et de Guillaume Hanoteau, ce qui lui a valu d'être entendue à ce sujet, « bien que cette présence fût connue depuis quatre ans et demi ».
En réalité, la présence de Lévy et Hanoteau sur les lieux du crime a été connue dès le lendemain de l'attentat par les enquêteurs et par quelques proches de l'éditeur, qui n'en ont rien dit à la presse avant avril 1950, mais Jeanne, elle, la connaît depuis quatre ans et demi, ce qui situerait son information à juillet 1949.
Quand Jeanne Loviton s'emporte, elle s'emporte bien : « Quel a été l'objet des interrogatoires des inspecteurs de police ? Faire avouer à Mme Loviton qu'elle connaissait MM. Lévy et Hanoteau. Même si Mme Loviton avait parfaitement connu MM. Roland Lévy et Hanoteau, est-ce que de ce fait l'instruction aurait fait un pas ? La police suppose-t-elle, un instant, que M. Roland Lévy, actuellement membre du Conseil de la Magistrature, et M. Hanoteau, dans les loisirs que leur laisse leurs occupations, font métier de tueurs à gage ?
Dans les romans policiers - qui paraissent devenus le bréviaire de certains inspecteurs de police - sont suspectes toutes les personnes qui se trouvaient sur les lieux au moment du crime. Mais, en l'espèce, MM. Roland Lévy et Hanoteau ne s'y trouvaient pas et sont soupçonnés parce qu'ils sont arrivés auprès du corps du malheureux Robert Denoël, immédiatement après le crime, attirés - semble-t-il - par le bruit du coup de feu. Ils étaient encore là quand la police est arrivée, ce qui n'est pas, en général, considéré comme une preuve de culpabilité. »
On ne peut qu'admirer l'arrogance tranquille dont fait preuve Jeanne Loviton dans ce mémoire destiné au plus haut magistrat de la Cour d'appel de Paris. Elle fait, en dix pages, le tour d'une affaire dont elle se dit la victime expiatoire, et qu'elle conclut ainsi : « Pour prolonger le plaisir, Mme Vve Denoël fait procéder par la PJ , qui fait droit à toutes ses requêtes, aux interrogatoires les plus inattendus, mais que justifie sans doute la volonté de nuire à Mme Loviton ».
Le dernier paragraphe de sa « supplique » se termine par une injonction qui mérite d'être reproduite :
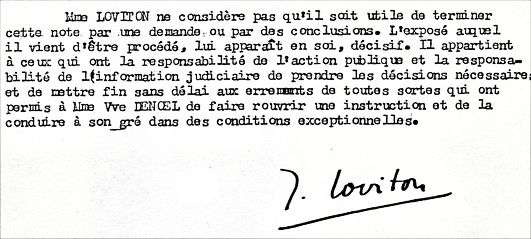
Le mémoire de Jeanne Loviton a le mérite de la clarté. Il va droit au but et ne s'embarrasse pas, comme celui de sa rivale, de digressions intempestives. Son écriture, magnifique, témoigne d'une rectitude de pensée sans faille. Cette femme sait où elle va, et elle fait preuve, en toutes circonstances, d'un sang froid qui provoque l'admiration - mais non la sympathie. Aucune chaleur n'émane de ses écrits, romans ou lettres, qu'elle maîtrise trop bien. Il n'y a rien de spontané chez elle, tout est calculé.
Le 26 juin, Cécile Denoël écrit à Jean Rogissart : « Il y eut les mois derniers d’interminables et odieuses confrontations ; il y eut plus que jamais des intrigues pour tenter de faire échouer une fois encore les recherches de la police et de la Justice ; il y a encore et toujours des influences exercées sur ceux qui devraient être équitables. Et le temps passe, et les nerfs se fatiguent. Au moment où l’on croit que le but va être enfin atteint, une nouvelle intervention, une nouvelle pirouette et à nouveau on cherche à étouffer l’affaire. Mais cette fois-ci, je suis décidée à aller jusqu’au bout et il FAUDRA que la vérité éclate même si elle doit éclabousser des personnes " en place ". »
[en cours de rédaction]
